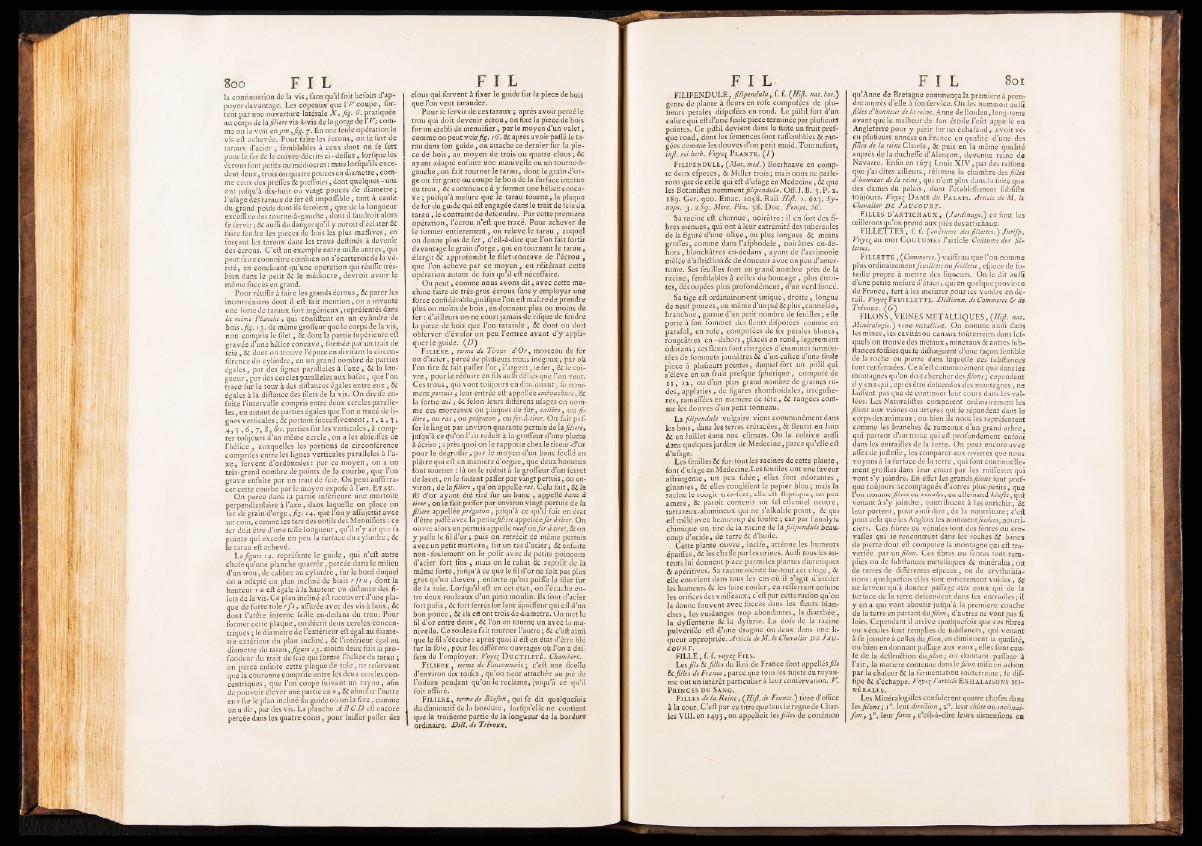
la continuation de la vis, fans qu’il foit befoin d’appuyer
davantage. Les copeaux que V F coupe, for-
tent par une ouverture latérale X , fig. 6. pratiquée
au corps de la-;filière vis-à-vis de la gorge de l’F ; comme
on le voit en pm ,fig. 7. En une feule opération la
vis eft achevée. Pour faire les écrous, on fe fert de
taraux d’acier , femblables à ceux dont on fe fert
pour le fer & le cuivre décrits ci - deffus, lorfque les
écrous font petits ou médiocres : mais lorfqu’ils excédent
deux, trois ou quatre pouces en diamètre, comme
ceux des preffes 6 cpreffoirs, dont quelques-uns
ont jufqu’à dix-huit ou vingt pouces de diamètre ;
Fufage des taraux de fer eft impoffible, tant à caufe
du grand poids dont ils feroient, que de la longueur
exceftivédes tourne-à-gauche, dont il faudrait alors
fe fervir ; 6c aufli du danger qu’il y aurait d’éclater 6c
faire fendre les pièces de bois les plus maflives, en
forçant lés taraux dans les trous deftinés à devenir
des écroüs. C’eft un exemple entre mille autres, qui
peut faire connoître combien on s’écarterait de la vérité,
en concluant qu’une opération quiréuffit tres-
bien dans le petit 6c le médiocre, devroit avoir le
même fuccès en grand.
Pour réulTir à faire les grands écrous, & parer les
inconvéniens dont il eft fait mention, on a inventé
une forte de taraux fort ingénieux,repréfentés dans
La même Planche, qui confident en un cylindre de
bois, fig. /_3. de même grofleur que le corps de la vis,
non compris le filet, 6c dont la partie fupérieure eft
gravée d’une hélice concave, formée par un trait de
feie, & dont on trouve l’épure en divifant la circonférence
du cylindre, en un grand nombre de parties
égales, par des lignes parallèles à l’axe , 6c la longueur
, par des cercles parallèles aux bafes, que l’on
trace fur le tour à des diftances égales entre eux, 6c
égales à la diftance des filets de la vis. On divife en-
fuite l’intervalle compris entre deux cercles parallèles
, en autant de parties égales que l’on a tracé de lignes
verticales ; 6c portant fucceflivement , 1 , 1 , 3 ,
4, 5 , 6 , 7, 8, &c. parties fur les verticales, à compter
toujours d’un même cercle, on a les abfciffes de
l’hélice , auxquelles les portions de circonférence
comprifes entre les lignes verticales parallèles à l’axe
, fervent d’ordonnées : par ce moyen, on a un
très-grand nombre de points de la courbe, que l’on
grave enfuite par un trait de feie. On peut aufli tracer
cette courbe par le moyen expofé à l’art. Etau.
On perce dans la partie inférieure une mortoife
perpendiculaire à l’axe, dans laquelle on place un
fer de grain d’orge ,fig. 14. que l’on y affujettit avec
un coin, comme les fers des outils des Menuifiers : ce
fer doit être d’une telle longueur, qu’il n’y ait que fa
pointe qui excede un peu la furface du cylindre ; 6c
le tarau eft achevé.
La figure 14. repréfente le guide, qui n’eft autre
chofe qu’une planche quarrée, percée dans le milieu
d’un trou, de calibre au cylindre, fur le bord duquel
on a adapté un plan incliné de biais r f t u , dont la
hauteur r « eft égale à la hauteur ou diftance des filets
de la vis. Ce plan incliné eft recouvert d’une plaque
de forte tôle r f t , afîurée avec des vis à bois, 6c
dont l’arête interne faille en-dedans du trou. Pour
former cette plaque, on décrit deux cercles concentriques
; le diamètre de l’extérieur eft égal au diamètre
extérieur du plan incliné, 6c l’intérieur égal au
diamètre du tarau, figure 1 3 . moins deux fois la profondeur
du trait de feie qui forme l’hélice du tarau ;
,on perce enfuite cette plaque de tôle, ne refervant
que la couronne comprife entre les deux cercles concentriques
, que l’on coupe fuivant un rayon, afin
de pouvoir élever une partie en v , 6c abaiffer l’autre
en t fur le plan incliné du guide où on la fixe , comme
on a dit, par des vis. La planche A B C D eft. encore
percée dans les quatre coins, pour laiffer pafler des
clous qui fervent à fixer le guide lur la piece de bois
que l’on veut tarauder.
Pour fe fervir de cestaraux ; après avoir percé le
trou qui doit devenir écrou, on fixe la piece de bois
fur un établi de menuifier, par le moyen d’un valet,
comme on peut voirfig. 1 G. &c après avoir pafl'é le tarau
dans fon guide, on attache ce dernier lur la piece
de bois, au moyen de trois ou quatre clous ; 6c
ayant adapté enfuite une manivelle ou un tourne-à-
gauche , on fait tourner le tarait,- dont le grain d*or-
ge ou fer grate ou coupe le bois de la furface interne
du trou, 6c commence à y former une hélice concave
; puifqu’à mefure que le tarau tourne, la plaque
de fer du guide qui eft engagée dans le trait de feie du
tarau, le contraint de descendre. Par cette première
opération, l’écrou n’eft que tracé. Pour achever de
le former entièrement, on releve le tarau , auquel
on donne plus: de fer, c’eft-à-dire que l’on fait fortir
davantage le grain d’orge, qui en tournant le tarau,
élargit 6c approfondit le filet ^concave de l’écrou ,
que l’on achevé par ce moyen, en réitérant cette
opération autant de fois qu’il eft néceflaire.
On peut, comme nous avons dit, avec cette machine
faire de très-gros écrous fans y employer une
force confidérable,puifque l’on eft maître de prendre
plus ou moins de bois, en donnant plus ou moins de
fer : d’ailleurs on ne court jamais de rifque de fendre
la piece de bois que l’on taraude , 6c dont on doit
obferver d’évafer un peu l’entrée avant d’y appliquer
le guide. (.O)
F i l i e r e , terme de Tireur c fOr , morceau de fer
ou d’acier, percé de plufieurs trous inégaux, par où
l’on tire 6c fait pafler l’o r, l’argent, le fer, 6c le cuivre
, pour le réduire en fils aufli déliés que l’on veut.
Ces trous, qui vont toujours en diminuant, fe nomment
permis ; leur entrée eft appellée embouchure, 6c
la fortie'ceil ; 6c félon leurs différens ufageson nomme
ces morceaux ou plaques de fer, calibre, où f ilière
, ou ras , ou prégaton, ou fer-à-tirer. On fait paffer
le lingot par environ quarante pertuis de la filiere,
jufqu’à ce qu’on l’ait réduit à la grofleur d’une plume
à écrire ; après quoi on le rapporte chez le tireur-d’or
pour le dégroflir, par le moyen d’un banc fcellé en
plâtre qui eft en maniéré d’orgue, que deux hommes
font tourner : là on le réduit à la grofleur d’un ferret
de lacet, en le faifant pafler par vingt pertuis, ou environ
, de la filiere, qu’on appelle ras. Cela fait, 6c le
fil d’or ayant été tiré fur un banc , appellé banc à
tirer , on le fait pafler par environ vingt pertuis de la
filiere appellée prégaton, jufqu’à ce qu’il foit en état
d’être pafl'é avec la petit efiliere appellée fer à tirer. On
ouvre alors un pertuis appellé neufou fer à tirer, & on
ypaffe le fil d’or; puis on rétrécit ce même pertuis
avec un petit marteau, fur un ras d’acier ; 6c enfuite
non-feulement" on le polit avec de petits poinçons
d’acier fort fins , mais on le rabat 6c repolit de la
même forte, jufqu’à ce que le fil d’orne foit pas plus
gros qu’un cheveu , enforte qu’on puiffe le filer fur
de la loie. Lorfqu’il eft en cet état, on l’écache entre
deux rouleaux d’un petit moulin. Ils font d’acier
fort polis, 6c fort ferrés lur leur épàiffeur qui eft d’un
bon poüce, 6c ils en ont trois de diamètre. On met le
fil d’or entre deux, 6c l’on en tourne un avec la manivelle.
Ce rouleau fait tourner l’autre ; 6c c’eft ainfi
que le fil s’écache : après quoi il eft en état d’être filé
fur la foie, pour les différens ouvrages où l’on a def-
fein de l’employer, Foye^ D u c t i l i t é . Chambers.
F i l i e r e , terme de Fauconnerie ; c’eft une ficelle
d’environ dix toifes , qu’on tient attachée au pié de
i’oifeau pendant qu’on le reclame, jufqu’à ce qu’il
foit afluré.
F i l i e r e , terme de Blafon, quife dit quelquefois,
du diminutif de la bordure, lorfqu’elle ne contient
que la troifieme partie de la longueur de la bordure
ordinaire. Dict. de Trévoux.
FILIPENDULE, filipendula, f. f. (Hiß. nat. bot.')
genre de plante à fleurs en rofe compofées de plu-
lieurs petales difpofées en rond. Le piftil fort d’un
calice qui eft d’une feule piece terminée par plufieurs
pointes. Ce piftil devient dans la fuite lin fruit pref-
que rond, dont les femences font raffemblées & rangées
comme les douves d’un petit muid. Tournefort,
inß. rei kerb. Foye[ PLANTE, (ƒ)
Filipendule, (Mat. med.) Boerhaave en compte
deux efpeces, & Miller trois ; mais nous ne parlerons
que de celle qui eft d’ufage en Medecine, 6c que
les Botaniftes nomment filipendula. Off. J. B. 3. P. z.
189. Ger. 900. Emac. 1058. Raii Hiß . 1. 6 z3. Sy -
nops. 3 . z 6 g . Merc. P in. 38. Doc. Pempt. 6 6 .
Sa racine eft charnue, noirâtre ; il en fort des fibres
menues, qui ont à leur extrémité des tubercules
de la figure d’une olive, ou plus longues 6c moins
grafles, comme dans l’afphodele, noirâtres en-dehors
, blanchâtres en-dedans , ayant de l’acrimonie
mêlée d’aftriftion & de douceur avec un peu d’amertume.
Ses feuilles font en grand nombre près de la
racine, femblables à celles du boucage, plus étroites,
découpées plus profondément, d’un verd foncé.
Sa tige eft ordinairement unique, droite, longue
de neuf pouces, ou même d’un pié 6c plus, cannelée,
branchue, garnie d’un petit nombre de feuilles ; elle
porte à fon fommet des fleurs difpolées comme en
parafol, en rofe, compofées de fix pétales blancs,
rougeâtres en - dehors, placés en rond, legerement
odorans; ces fleurs font chargées d’étamines furmon-
tées de fommets jaunâtres 6c d’un calice d’une feule
piece à plufieurs pointes, duquel fort un piftil qui
s’élève en un fruit prefque fphérique , compofé de
11 , iz , ou d’un plus grand nombre de graines rudes
, applaties , de figures rhomboidales, irrégulières
, ramaffées en maniéré de tête, & rangées comme
les douves d’un petit tonneau.
La filipendule vulgaire vient communément dans
les bois, dans les terres crétacées, & fleurit en Juin
6c en Juillet dans nos climats. On la cultive aufli
dans quelques jardins de Medecine, parce qu’elle eft
d’ufage.
Les feuilles & fur-tout les racines de cette plante,
font d’ufage en Medecine. Les feuilles ont une faveur
aftringente, un peu falée ; elles font odorantes ,
gluantes, 6c elles rougiflênt le papier bleu ; mais la
racine le rougit très-fort ; elle eft ftiptique, un peu
amere, 6c paraît contenir un fel effentiel neutre,
tartareux-alumineux qui ne s’alkalife point, 6c qui
eft mêlé avec beaucoup de foufre ; car par l’analyfe
chimique on tire de la racine de la filipendule beaucoup
d’acide, de terre 6c d’huile.
Cette plante ouvre, incife, atténue les humeurs
épaiffes, 6c les chaflëpar les urines. Aufli tous les auteurs
lui donnent place parmi les plantes diurétiques
& apéritives. Sa racine mérite fur-tout cet éloge, &
elle convient dans tous les cas où il s’agit d’incifer
les humeurs 6c les faire couler, en refferrant enfuite
les orifices des vaiffeaux ; c’eft par cette raifon qu’on
la donne fouvent avec fuccès dans les fleurs blanches,
lesvuidanges trop abondantes, la diarrhée,
la dyffenterie 6c la dyfurie. La dofe de la racine
pulvérifée eft d’une dragme ou deux dans une liqueur
appropriée. Article deM. le Chevalier DE J a ç ~
CO U R T .
FILLE, f. f. voye[ Fil s .
Les fils & filles du Roi de France font appellés fils
6c filles de France, parce que tous les fujets du royaume
ont un intérêt particulier à leur confervation. H .
Prin ces du Sang.
Filles delà Reine, (H iß .de France.) titre d’office
à la cour. C’eft par ce titre que fous le regne de Charles
VIII. en 1493, on appellent les filles de condition
qu’Anne de Bretagne commença la première à prendre
auprès d’elle à fon fervice. On les nommoit aufli
filles d'honneur de la reine. Anne de Boulen, long-tems
avant que le malheur de fon étoile l’eut appellé en
Angleterre pour y périr fur un échafaud, avoit vécu
plufieurs années en France en qualité d’une des
filles de la reine Claude, & puis en la même qualité
auprès de la ducheffe d’Alençon, devenue reine de
Navarre. Enfin en 1673 Louis XIV, par des raifons
que j’ai dites ailleurs, réforma la chambre des filles
d'honneur de la reine, qui n’eut plus dans la fuite que
des dames du palais, dont l’établiffement fubfifte
toujours. Foye{ D a m e du P a l a i s . Article de M. le
Chevalier D E JA U C O U R T .
F i l l e s d ’a r t i c h a u x , (Jardinage!) c e fo n t le s
o e ille ton s qu ’o n p ren d a u x p ié s des a r t ic h a u x .
FILLETTES , f. f. ( coutume des fillettes. ) Jurifp.
Voyei a u m o t C o u t u m e s l’ a r t ic le Coutume des fil-
■ lettes.
F i l l e t t e , (Commerce!) vaiffeau que l’on nomme
plus ordinairement feuillette ou feillette, efpece de futaille
propre à mettre des liqueurs. On le dit aufli
d’une petite mefure d’étain, qui en quelque province
de France, fert à les mefurer pour les vendre en détail.
Foyei Fe u i l l e t t e . Diclionn. de Commerce & de
Trévoux. (G )
FILONS, VEINES METALLIQUES, (Hifi. nat.
Minéralogie!) vente metaUica. On nomme ainfi dans
les mines, les cavités ou canaux foûterreins dans lef-
quels on trouve des métaux, minéraux & autres fubftances
foflîles qui fe diftinguent d’une façon fenfible
de la roche ou pierre dans laquelle ces fubftances
font renfermées. Ce n’eft communément que dans les
montagnes qu’on doit chercher des filons ; cependant
il y en a qui, après être delcendus des montagnes, ne
laijftent pas que de continuer leur cours dans les vallées.
Les Naturaliftes comparent ordinairement les
filons aux veines ou arteres qui fe répandent dans le
corps des animaux; ou bien ils nous les repréfentent
comme les branches 6c rameaux d’un grand arbre,
qui partent d’un tronc qui eft profondément enfoui
dans les entrailles de la terre. On peut encore avec
allez de jufteffe, les comparer aux rivières que nous
voyons à la furface de la terre, qui font continuellement
groffi.es dans leur cours par les ruiffeaux qui
vont s’y joindre. En effet les grands filons font prefque
toujours accompagnés d’autres plus petits, que
l’on nomme fibres ou vènules, en allemand klufte, qui
venant à s’y joindre, contribuent à les enrichir, 6c
leur portent, pour ainfi dire, de la nourriture ; c’eft
pour cela que les Anglois les nommentfeeders, nourriciers,
Ces fibres ou vénules lbnt des fentes ou cre-
vaffes qui fe rencontrent dans les roches ÔC bancs
de pierre dont eft compolée la montagne qui eft tra-
verfée par un filon. Ces fibres ou fentes (ont remplies
ou de fubftances métalliques 6c minérales, ou
de terres de différentes efpeces , ou de cryftalfifa-
tions : quelquefois elles font entièrement vuides, 6c
ne fervent qu’à donner paffage aux eaux qui de la
furface de la terre defeendent dans fes entrailles; il
y en a qui vont aboutir jufqu’à la première couche
de la terre en partant du filo n , d’autres ne vont pas li
loin. Cependant il arrive quelquefois que ces fibres
ou vénules font remplies de fubftances, qui venant
à fe joindre à celles du filon, en diminuent la qualité,
ou bien en donnant p^flage aux eaux, elles font cau-
fe de la deftruâion diifilon; ou donnant paffage à
l’air, la matière contenue dans le filon mife en adTion
par la chaleur & la fermentation loûterreine, fe dif-
fipe 6c s’échappe, Foye^ l'article E x h a l a i s o n s m i n
é r a l e s .
L e s M in é ra lo g ifte s c o n fid e r en t q u a t re c h o fe s d an s
le s filons ; 1 °. le u r direction, le u r chûte o u inclinaifo
n y 30, leur fo r c e , c’eft-à-dire leurs dimenfions eu