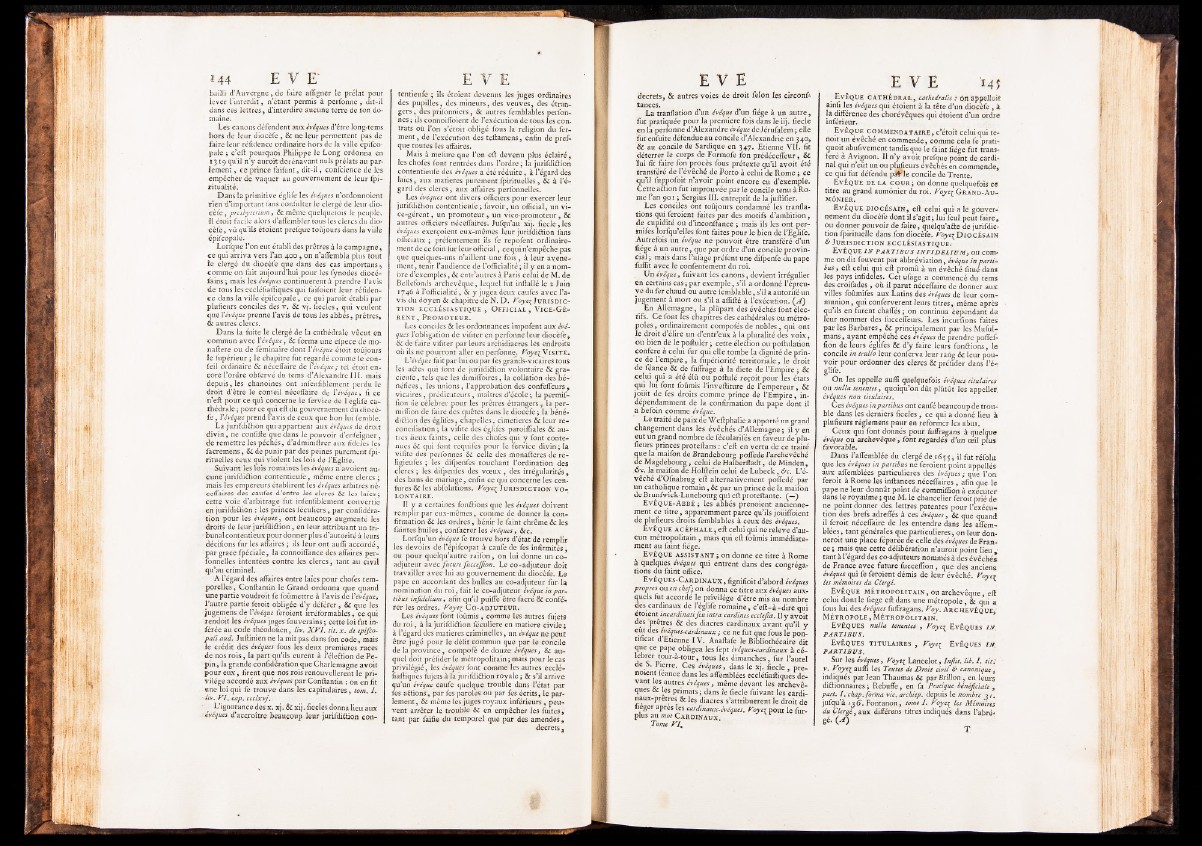
bailli d’Auvergne, de faire affigner le prélat pour
lever l’interdit, n’étant permis à perfonne , dit-il
dans ces lettres, d’interdire aucune terre de Ion do-
’ znaine.
Les canons défendent aux évêques d’être long-tems
hors de leur diocèfe , & ne leur permettent pas de
faire leur réfidence ordinaire hors de la ville épifco-
pale ; c’efl pourquoi Philippe le Long ordonna en
1319 qu’il n’y aurait dorénavant nuis prélats au parlement
, ce prince faifant, dit-il, confcience de les
empêcher de vaquer au gouvernement de leur fpi-
ritualité.
Dans la primitive églife les évêques n’ordonnoient
rien'd’important fans confulter le clergé de leur diocèfe
, presbyterium, & même quelquefois le peuple*
II étoit facile alors d’affembler tous les clercs du-dio*
cè fe , vu qu’ils étoient prefque toujours dans la ville
épifcopale»
Lorfque l’on eut établi des prêtres à la campagne,
ce qui arriva vers l’an 400 , on n’affembla plus tout
le clergé du diocèfe que dans des cas importans*
comme on fait aujourd’hui pour les fynodes diocé-
fains ; mais les évêques continuèrent à prendre l’avis
de tous les eccléfiafliques qui faifoient leur réfiden-
ce dans la ville épifcopale, ce qui paroît établi par
plufieurs conciles des v . & vj. fiecles, qui veulent
que Yévêque prenne l’avis de tous les abbes, prêtres,
& autres clercs»
Dans la fuite le clergé de la cathédrale vécut en
commun avec Y évêque, &c forma une elpece de mo-
nallere ou de féminaire dont Yévêque étoit toûjours
le fupérieur ; le chapitre fut regardé comme le con-
feil ordinaire ÔC néceflaire de Y évêque; tel étoit encore
l’ordre obfervé du tems d’Alexandre III. mais
depuis, les chanoines ont infenfiblement perdu le
droit d’être le conleil néceflaire de Y évêque, fi ce
n’efl pour ce qui concerne le fervice de l ’églife cathédrale
; pour ce qui eft du gouvernement du diocèfe
, Y évêque prend l’avis de ceux que bon lui femble.
La jurifdiélion qui appartient aux évêques de droit
d ivin, ne confifie que dans le pouvoir d’enfeigner,
de remettre les péchés, d’adminifirer aux fideles les
faCremens, & de punir par des peines purement fpi-
rituelles ceux qui violent les lois de l’Ëglile*
Suivant les lois romaines les évêques n’a voient aucune
jurifdiâion contentieufe, même entre clercs ;
mais les empereurs établirent les évêques arbitres né-
Ceflaires des caufes d ’entre les clercs & les laïcs;
cette voie d’arbitrage fut infenfiblement convertie
en jurifdiction : les princes féculiers, par confédération
pour les évêques, ont beaucoup augmenté les
•droits de leur jurifdiélion, en leur attribuant un tribunal
contentieux pour donner plus d’autorité à leurs
décifions fur les affaires ; ils leur ont auffi accordé,
par grâce fpéciale, la connoiffance des affaires per-
îbnnelles intentées contre les clercs, tant au civil
qu’au criminel.
A l’égard des affaires entre laïcs pour chofes tem-
- porelles, Conflantin le Grand ordonna que quand
une partie voudroit fe foumettre â l’avis de Y évêque,
l ’autre partie feroit obligée d’y déférer, & que les i
jugemens de Y évêque feroient irréformables, ce qui
rendoit les évêques juges fouverains ; cette loi fut inférée
au code théodofien, liv. X V I . tit. x . de epifco-
pali aud. Juflinien ne la mit pas dans fon code, mais
le crédit des évêques fous les deux premières races
de nos rois, la part qu’ils eurent à l’éleôion de Pépin
, la grande confidération que Charlemagne avoit
pour eu x, firent que nos rois renouvelèrent le privilège
accordé aux évêques par Conflantin : on en fit
une loi qui fe trouve dans les capitulaires, tom. I.
• liv. VI. cap. ccclxvj.
L’ignorance des x. xj. & xij. fiecles donna lieu aux
évêques d’aççroître beaucoup leur jurifdiétion contentieufê
; ils étoient devenus les juges ordinaires
des pupilles, des mineurs, des veuves, des étrangers
, des ptifonniers, & autres femblables perfon-
nes ; ils connoiffoient de l’exécution de tous les contrats
où l’on s’étoit obligé fous la religion du ferment
, de l’exécution des teflamens, enfin de prefque
toutes les affaires.
Mais à mefure que l’on eft devenu plus éclairé ,
les chofes font rentrées dans l’ordre ; la jurifdiâion
contentieufe des évêques a été réduite, à l’égard des
laïcs, aux matières purement fpirituelles, & à l’égard
des clercs, aux affaires perfonnelles.
Les évêques ont divers officiers pour exercer leur
jurifdiâion contentieufe ; favoir, un official, un vi-
ce-gérent, un prompteur, un vice-promoteur, &
autres officiers néceffaires. Jufqu’au xij. fiecle, les
évêques exerçoient eux-mêmes leur jurifdiâion fans
officiaux ; préfentement ils fe repofent ordinairement
de ce foin fur leur official, ce qui n’empêche pas
que quelques-uns n’aillent une fo is , à leur ayene-
ment, tenir l’audience de l’officialité ; il y en a nombre
d’exemples, & entr’autres à Paris celui de M. de
Bellefonds archevêque, lequel fut inflallé le 2 Juin
1746 à l’officialité, & y jugea deux caufes avec l’avis
du doyen & chapitre de N. D . Voye^ Jurisdic-
ÏION ECCLÉSIASTIQUE, OFFICIAL , VlCE-GÉ-
rent, Promoteur.
Les conciles & les ordonnances impofent aux évêques
l’obligation de vifiter en perforine leur diocèfe;
& de faire vifiter par leurs archidiacres lés endtoits
où ils ne pourront aller en perfonne. Voye^ Visite.
U évêque fait par lui ou par fes grands-vicaires tous
les aâes qui font de jurifdiâion volontaire & gra-
cieufc, tels que les dimiffoires, la collation des bénéfices
, les unions, l’approbation des confeffeurs ,
vicaires, prédicateurs, maîtres d’école ; la permif-
fion de célébrer pour les prêtres étrangers, la per-
miffion de faire des quêtes dans le diocèfe ; la béné-
diâion des églifes, chapelles, cimetières & leur réconciliation
; la vifite des églifes paroiffiales & autres
lieux faints, celle des chofes qui y font contenues
& qui font requifes pour le fervice divin ; la
vifite des perfonnes 8c celle des moriafleres de re-
ligieufes ; les difpenfes touchant l’ordination des
clercs ; les difpenfes des voeux , des irrégularités ,
des bans de mariage, enfin ce qui concerne les cen*
fures 8c les abfolutions. Voye^ Jurisdiction volontaire.
Il y a certaines fonâiônS qué leS évêques doivent
remplir par eux-mêmes, comme de donner la confirmation
& les ordres, bénir le faint chrême 8c les
faintes huiles, confacrer’ les évêques, &c.
Ldrfqu’un évêque fe trouve hors d’état de remplir
les devoirs de l’épifcopat à caufe de fes infirmités ,
ou pour quelqu’autre raifon, on lui donne un coadjuteur
avéc future fuccejjion. Le co-adjuteur doit
travailler avec lui au gouvernement du diocèfe. Le
pape en accordant des bulles au co-adjuteur fur- la
nomination du roi ,• fait le co-adjuteur évêque in par-,
tibus infidelium, afin qu’il puiffe être facré 8c conférer
les ordres. Voye^ Co-adjuteur.
Les évêques font foûmis , comme les autres fujets
du ro i, à la jurifdiâion féculiere en matière civile ;
à l’égard des matières criminelles, un évêque ne peut
être jugé pour le délit Commun que par le concile
de la p rovince, coriipofé de douze évêques, 8c auquel
doit préfider le métropolitain ; mais pour le cas
privilégié, les évêques font comme les autres ecclé-
fiaftiques fujets à la jurifdiâion royale ; & s’il arrive
qu’un évêque caufe quelque trouble dans l’état par
fes aâions, par fes paroles ou par fes écrits, le parlement
, 8c même les juges royaux inférieurs, peuvent
arrêter le trouble 8c en empêcher les fuites,
tant par faille du temporel que par des amendes ,
decrets a
décrets, & autres voies de droit félon les circonf-
tarices.
La tranlïation d’un évêque d’un liège à un autre,
fut pratiquée pour la première fois dans le iij. fiecle
en la perfonne d’Alexandre évêque de Jérufàlem ; elle
fut enfuite défendue au concile d’Alexandrie en 340,
& au concile de Sardique en 347. Etienne VII. fit
déterrer le corps de Formofe fon prédéceffeur, &
lui fit faire fon procès fous prétexte qu’il avoit été
transféré de l’évêché de Porto à celui de Rome ; ce
qu’il fuppofoit n’avoir point encore eu d’exemple.
Cette aâion fut improuvée par le concile tenu à Rome
l’an 901 ; Sergius III. entreprit de la jùllifier.
Les conciles ont toûjours condamné les tranfla-
tions qui feroient faites par des motifs d’ambition,
de cupidité ou d’inconflance ; mais ils les ont per-
jmifes lorfqu’elles font faites pour le bien de l’Eglife.
Autrefois un évêque n,e pouvoit être transféré d’un
fiege à un autre, que par ordre d’un concile provincial
; mais dans l’ufage préfent une difpenfe du pape
fuffit avec le confentement du roi.
Un évêque, fuivaht les canons, devient irrégulier
en certains cas ; par exemple, s’il a ordonné l’épreuv
e du fer chaud ou autre fèmblable, s’il a autorifé un
jugériiènt à mort ou s’il a affilié à l’exécution. (A )
Ën Allemagne, la plûpart des évêchés font électifs.
Cè font les chapitres des cathédrales ou métropoles
, ordinairement compofés de nobles, qui ont
lè droit d’élire un d’entr’eux à la pluralité des vo ix ,
ou bien de le pofluler ; cette élection ou poflulation
conféré à celui fur qui elle toriibe la dignité de prince
dé l’empire, la fupériorité territoriale, le droit :
de feance & de fufîrage à la diete de l’Empire ; 8c
celui qui a été élu ou poflulé reçoit pour les états
lui font foûmis l’invefliture de l’empereur, 8c
joiiit de fes droits comme prince de l’Empire, indépendamment
de la confirmation du pape dont il
a befoin comme évêque.
Le traite de paix de Weftphalie a apporté un grand
changement dans les évêchés d’Allemagne ; il y en
eut Un grand nombre de fécularifés en faveur de plufieurs
princes proteflans : c’efl en vertu de ce traité
que la maifon de Brandebourg poffede l’archevê'ché
de Magdebourg, celui de Halberfladt, de Minden,
.&c. la maifon de Holflein celui de Lubeck, &c. L’évêché
d’Ofnabrug 'eft; alternativeriient poffedé par
un catholique romain, 8c par un prince de la maifon
de Brunfwick-Lunebourg qui efl proteflante. (—)
Evêque-A bbé ; les abbés prenoient anciennement
ce titre, apparemment parce qu’ils joüiflbient
de plufieurs droits femblables à ceux des évêques. Évêque acéphale ; efl celui qui ne releve d’aucun
métropolitain , mais qui efl foûmis immédiatement
au faint fiége. Evequè assistant ; on donne ce titre à Rome
à. quelques évêques qui entrent dans des congrégations
du faint office.
Evêques-Ca rd in a u x , fignifioit d’abord évêques
propres ou en chef; on donna ce titre aux évêques auxquels
fut accorde le privilège d’être mis au nombre
des cardinaux de l’églife romaine, c’efl-à -dire qui
etoient incardinati feu intra cardines ecclcjia. Il y avoit
des prêtres 8c des diacres cardinaux avant qu’il y
eut des évêques-cardinaux; ce ne fut que fous le pontificat
d’Etienne IV . Anaflafe le Bibliothécaire dit
que ce pape obligea les fept évêques-cardinaux à célébrer
tour-à-rour, tous les dimanches, fur l’autel
de S. Pierre. Ces évêques, dans le xj. fiecle pre-
noient féance dans les affemblées eccléfiafliques de-
vant les autres évêques , même devant les archevêques
& les primats ; dans le fiecle fuivant les cardi-
naux-pretres & les diacres s’attribuèrent le droit de
lieger apres les cardinaux-évêques. Voyer pour le fur-
plus au mot Cardinaux.
Tome VI* *
_ EvêqXje cathédral, cathedralis : ôn àppelloifc
ainfi les évêques qui étoient à la tête d’un diocèfe , à la différence inférieur. des chorévêques qui étoient d’un ordre
Evêque commendataire, c’étoit celui qui te-
noit un eveche en commende^ comme cela fe prati-
quoit abufivement tandis que le faint fiége fut trans*
fere a Avignon* Il n’y avoit prefque point de cardinal
qui n eut un ou plufieurs évêchés en commende^
ce qui fut défendu parle concile de Trente* Evêque de la cour; on donne quelquefois e t
titre au grand aumônier du roi. Voye^ Grand-Au-,
mônier.
Evêque diocésain, efl celui qui a lé. gouvernoeum
deonntn deur pdoioucvèofier ddoen fta iilr se’,a gqiute; llquui’ afeéulel dpee ujut rfiafdiriec-,
tion fpirituelle dans fon diocèfe. Voye^ Diocésain
& JEurisdiction ecclésiastique* vêque in p a r t ib u s in f id e l iu m , ou comme
on dit fouvent par abbre viation, évêque in parti—
buS , efl celui qui efl promu à un évêché fitué dans
les pays infidèles. Cet ufage a commencé du tems
des croifades, où il parut néceflaire de donner aux
villes foûmifes aux Latins des évêques de leur communion
, qui conferverent leurs titres, même après
qu’ils en furent chaffés ; on continua cependant de
leur nommer des fucceffeurs. Les incurfions faites
par les Barbares, & principalement par les Muful-
mans ., ayant empêché ces évêques de prendre poffef-
fion de leurs églifes & d’y faire leurs fondions, le
concile in trullo leur conferva leur rarig & leur pouvoir
pour ordonner des clercs & préfider dans MÊË
glife.
On les appelé auffi quelquefois évëquès titulaires
ou nulla tènenies, quoiqu’on dût plûtôt les appeller,
évêques non titulaires.
Ces évêques in partibus ont caufé beaucoup de trouble
dans les derniers fiecles , ce qui a donné lieu à
plufieurs réglemens pour en reformer les abus.
Ceux qui font donnés pour fuffragans à quelque
évêque ou "archevêque, font regardés d’un oeil plus
favorable.
Dans l’âffemblée du elèrgé dé.1655 * ^ fut réfôlu
que les évêques in partibus ne feroient point appellés
aux affemblées particulières des évêques ; que l’on
feroit à Rome les inflances néceffaires , afin que le
pape ne leur donnât point de commiffion à executer
dans le royaiime ; que M. le chancelier feroit prié de
ne point donner des lettres patentes pour l’exécution
des brefs adreffés à ces évêques, & que quand
il feroit néceflaire de les entendre dans les affembléesi
j tant générales que particulières <, on leur donnerait
une place féparée de celle des évêques de France
; mais que cette délibération n’auroit point lieu 1
tant à l’égard des co-adjuteurs nommés à des évêchés
de France avec future fucceffion, que des anciens
évêques qui fe fefoient démis de leur évêché. Voyer
les mémoires du Clergé.
Evêque métropolitain, ou archevêque, efl: celui dont le fiege efl dans une métropole, & qui a
fous lui des évêques fuffragans. Voy. A r c h e v ê q u e / MéEtropole , Métropolitain. vêques nulla tenentes , Voyer EvÊQÙes IN
PARTIBUS. Evêques titulaires , Voye1 Evêques in ,
PARTIBUS.
Sur les évêques, Voye{ Lancelot, Inflit. lib. I. tir.
y. Voye^ auffi les Textes de Droit civil & canonique ,
indiqués par Jean Thaumas & par Brillon j en leurs
diélionnaires ; Rebuffe, en fa Pratique bénéficiait ,
part. I , c h a p i forma vie. archiep. depuis le nombre 31 *
jufqu’à i j (5. Fontanon, tome I. Vyyeç les Mémoires
du Clergé, aux différens titres indiqués dans l’abrégé
G O
T