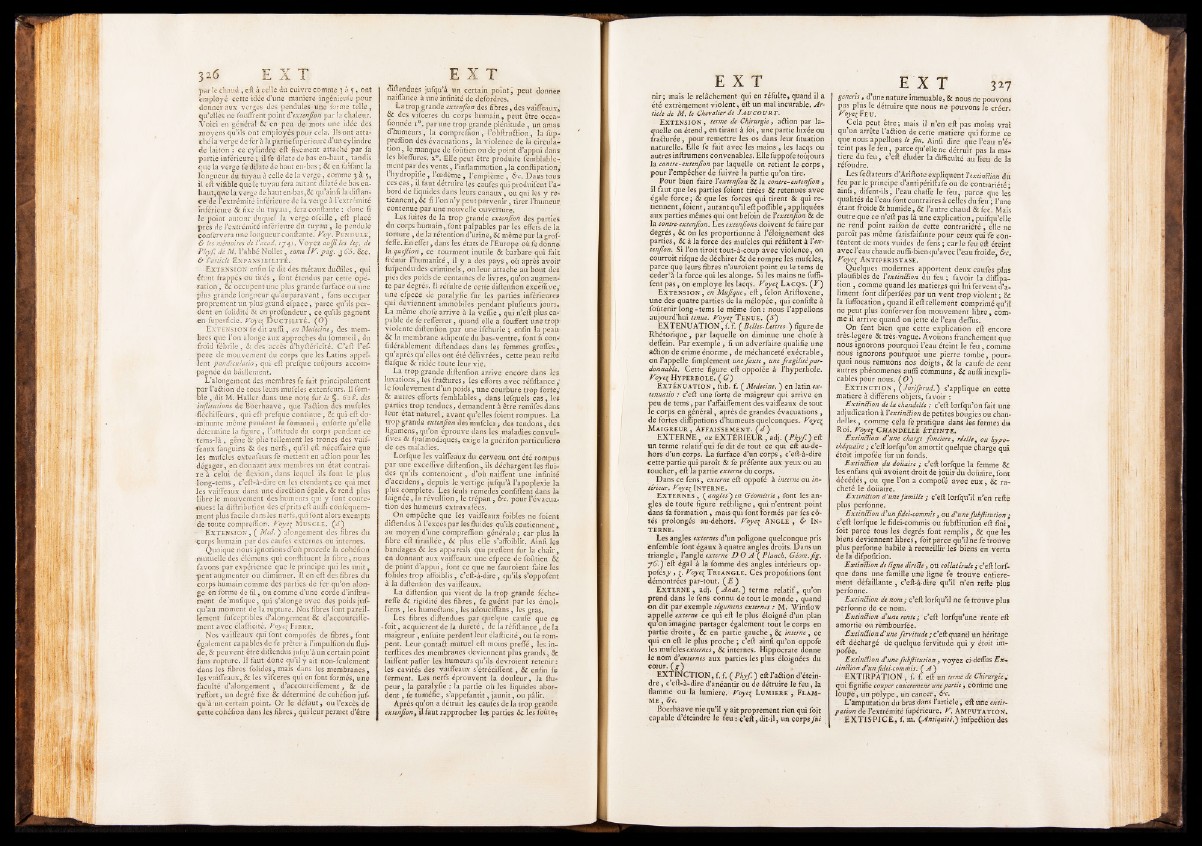
par lé chaud, eft à celle du cuivre comme 3 à 5, ont
employé cette idée d’une maniéré ingénieufe pour
donner aux verges des pendules Une forme telle,
qu’eliês ne fouffreht point d’extenfon par la chaleur.
Voici en général & en peu de mots une idée des
moyens qu’ils ont employés pour cela. Ils ont attaché
la verge de fer à là partiefupérieure d’un cylindre
de laiton : ce cylindre eft fixement attaché par fa
partie inférieure ; il fe dilaté de bas en-haut, tandis
que la verge fe dilate de haut en-bas ; & en faifant la
longueur du tuyau à celle de la verge, comme 3 à 5,
il eft vifible que ïe tuyau fera autant dilaté de bas en-
haut,que la verge de haut en-bas,& qu’ainfi la diftan-
c e de l’extrémité inférieure de la verge à l’extrémité
inférieure & fixe du tuyau, fera confiante : donc fi
le point autour duquel la verge- ofcille, eft placé
près de l’extrémité inférieure du tuyau , le pendule
Confervera une longueur confiante. Voy. P e n d u l e ^
& Us mémoires de l'acad. 1741. Voyez aujji les leç. de
Phyf. dé M. l ’abbé Nollet, tome IV. pag. 366. &c.
& F article EXPANSIBILITÉ.
E x t e n s i o n enfin fe dit des ïftétaux duéKles, qui
étant frappés ou tirés , font étendus par cette opération,
& occupent une plus grande furface ou une
plus grande longueur qu’auparavant, fans occuper
proprement un plus grand efpace, parce qu’ils perdent
en folidité & en profondeur, ce qu’ils gagnent
en fuperficie. Voye{ D u c t i l i t é . (O)
E x t e n s i o n fe dit auffi , en Médecine, des membres
que l’on àlonge aux approches du fommeil, du
froid fébrile, & des accès d’hyftéricité. C ’eft l’ef*
pece de mouvement du corps que les Latins appellent
pandiculatio, qui eft prefque toûjours accompagnée
du bâillement.
L’alongement des membres fe fait principalement
par 'l’ââion de tous leurs mufcles extenfeurs. Il fem-
ble , dit M. Haller dans une note fur le § . Çz8. des
injlitutions dé B'ôerhaave, que l’a&ion des mufcles
flécbifîeurs, qui eft prefque continue, & qui eft dominante
même pendant le fommeil, enforte qu’elle
détermine la figure , l’attitude du corps pendant ce
fems-là , gêne & plie tellement les troncs des vaif-
feaux fanguins & des nerfs, qu’il eft néceflaire que
les mufcles extenfeurs fe mettent en a dion pour les
dégager, en donnant aux membres un état contraire
à celui de flexion, dans lequel ils font le plus
long-tems , c’eft-à-dire en les étendant ; ce qui met
les vaifleaux dans une diredion égale, & rend plus
libre le mouvement des humeurs qui y font contenues:
la diftribution des efprits eft auffi coriféquem-
ment plus facile dans les nerfs,qui font alors exempts
dé toute compreffion. Voye[ M u s c l e , (tl)
E x t e n s i o n , ( Med. ) a lo n g em e n t d e s fib r e s du
•ç o rp s h um a in p a r d e s c a u fe s e x t e rn e s o u in te rn e s .
Quoique nous ignorions d’où procédé la cohéfion
mutuelle des élémens qui conftituent la fibre , nous
favons par expérience que le principe qui les unit,
peut augmenter ou diminuer. Il en eft des fibres du
corps humain comme des parties de fer qu’on alon-
ge en forme de f il, ou comme d’une corde d’inftru-
ment de mufique, qui s’alonge avec des poids jusqu’au
moment de la rupture. Nos fibres font pareillement
fufceptibles d’alongement & d’accourcifle-
ment avec élafticité. Voyeç F i b r e .
Nos vaifleaux qui font compofés de fibres, font
également capables de fe prêter à l’impulfion du fluide,
& peuvent être diftendus jufqu’à un certain point
fans rupture. Il faut donc qu’il y ait non-feulement
dans les fibres folides, mais dans les membranes ,
les vaifleaux, & les vifeeres qui en font formés, une
faculté d’alongement , d’accourciflement, 8c de
reflbrt, un degré fixe & déterminé de cohéfion jufqu’à
'un certain point. Or le défaut, ou l’excès de
cette cohéfion dans les fibres, qui leur permet d’être
diftendues jufqu’à un certain point,' peut donner
naiffance à une infinité de defordres.
La trop grande extenjion des fibres, des vaifleaux,
& des vifeeres du corps humain, peut être occa-
fionnée i° . par une trop grande plénitude , un amas
d’humeurs, la compreffion, Tobftrudion', la fup-
preffion des évacuations-, la violence de la circulation
, le manque de foûtien ou de point d’appui dans
les blefliires. 20. Elle peut être produite femblable-
ment par des vents, l’inflammation, la conftipation,’ 1 hydropifie, l’oedème , l ’empième , &c._ Daas tous;
ces cas, il faut détruire les caufes qui produifent l’abord
de liquides dans leurs canaux , ou qui les y retiennent,
& fi l’on n’y peut parvenir, tirer l’humeur,
contenue par une nouvelle ouverture»
Les.fuites de la trop grande extenjion des parties}
du corps humain,,font palpables par les effets de la
torture , de la rétention d’urine, & même par la grof-
fefle. En effet, dans les états de l’Europe où fe donne
la queflioti, ce tourment inutile & barbare qui fait
frémir l’humanité, il y a des pays, où après avoir
fufpendu des criminels, on leur attache au bout des
piés des poids de centaines de livres, qü’on augmen*
te par degrés. Il réfulte de cette diftenfioti exceffive,'
une efpecé de paralyfie fur les parties inférieure»
qui deviennent immobiles pendant plufieurs jours»
La même chofe arrive à la véffie, qui n’eft plus capable
de fe reflerrer, quand elle a fôuffert une trop
violente diftenfion par une ifehurie ; enfin la peau
& la membrane adipeulè du bas-ventre, font fi con*
fidérablement diftendues dans les femmes greffes,
qu’après qu’elles ont été délivrées, cette peau refte
flafque & ridée toute leur vie.
La trop grande diftenfion arrive encore dans les
luxations, les fradures, les efforts avec réfiftance
le foulevement d’un poids, une courbure trop forte,"
& autres efforts femblables, dans lefquels ca s , les
parties trop tendues, demandent à être remifes dans
leur état naturel, avant qu’elles foient rompues. La
trop grande extenjion des mufcles , des tendons, des
ligamens, qu’on éprouve dans les maladies convul-
fives & fpafmodiques, exige la guérifon particulier©
de ces maladies.
Lorfque les vaifleaux du cerveau ont été rompus
par une exceffive diftenfion, ils déchargent les fluides
qu’ils contenoient, d’où naiflent une infinité
d’accidens, depuis le vertige jufqu’à l’apoplexie la
plus complété. Les feuls remedes confiftent dans la
faignée , la révulfion, le trépan, &c. pour l’évacuation
des humeurs extravafées.
On empêche que les vaifleaux foibles ne foient
diftendus à l ’excès par les fluides qu’ils contiennent,
au moyen d’une cômpreffion générale ; car plus la
fibre eft tiraillée, & plus elle s’affoiblit. Ainfi les
bandages & les appareils qui preflent fur la chair,
en donnant aux vaifleaux une efpece de foûtien &
de point d’appui, font ce que ne fauroient faire les
folides trop affoiblis, c’ eft-à-dire, qu’ils s’oppofent
à la diftenfion des vaifleaux.
La diftenfion qui vient de la trop grande féche-
refle & rigidité des fibres, fe guérit par les émoi-
liens , les humedans, les adouciffans, les gras.
Les fibres diftendues par quelque caufe que ce
- foit, acquièrent de la dureté, de la réfiftance, de la
maigreur , enfuite perdent leur élafticité, ou fe rom-
jpent. Leur çontad mutuel eft moins prefle, les in-
terftices des membranes deviennent plus grands, &
laiflent paffer les humeurs qu’ils devroient retenir :
les cavités des vaifleaux s’étréciflent, & enfin fe
ferment. Les nerfs éprouvent la douleur, la ftu-
peur, la paralyfie : la partie où les liquides aboi-
dent, fe tuméfie, s’appefantit, jaunit, ou pâlit.
Après qu’on a détruit les caufes de la trop grande
extenjion, il faut rapprocher les parties ôt les foute*
nir; mais le relâchement qui en réfulte, quand il a
été extrêmement v iolent, eft un mal incurable. Article
de M. U Chevalier de J A U CO U R T . Extension , terme de Chirurgie, adion par laquelle
on étend, en tirant à foi, une partie luxée ou
fradurée, pour remettre les os dans leur fltuation
naturelle. Elle fe fait avec les mains , les lacqs ou
autres inftrumens convenables. Elle fuppofe toûjours
la contre-extenjion par laquelle on retient le corps,
pour l’empêcher de fuivre la partie qu’on tire.
Pour bien faire ¥ extenjion & la contre-extenjion ,
il faut que les parties foient tirées & retenues avec
égale force ; & que les forces qui tirent & qui retiennent
, foient, autant qu’il eft poffible, appliquées
aux parties mêmes qui ont befoin de ¥ extenjion & de
la contre-extenjion. Les extenjions doivent fe faire par
degrés, & on les proportionne à l’éloignement des
parties, & à la force des mufcles qui réliftent à ¥extenjion.
Si l’.on tiroit tout-à-coup avec violence, on
courroit rifque de déchirer & de rompre les mufcles,
parce que leurs fibres n’auroient point eu le tems de
ceder'à la force qui les alonge. Si les mains ne fuffi-
fent pas, on employé les E lacqs. Voye1 Lacqs. (T) xtension , en Mujique, e ft , félon Ariftoxene,
une des quatre parties de la mélopée, qui confifte à
foûtenir long - tems le même fon : nous l’appelions
aujourd’hui tenue. Voye^ Tenue. (S)
EXTENUATION, f. f. ( Belles-Lettres. ) figure de
Rhétorique, par laquelle on diminue une chofe à
deffein. Par exemple, fi un adverfaire qualifie une
adion de crime énorme, de méchanceté exécrable,
on l’appelle Amplement une faute, une fragilité pardonnable.
Cette figure eft oppofée à l’hyperbole.
Voye^ Hyperbole. ( G) Exténuation , fub. f. ( Medecine. ) en latin ex-
tenuatio : c’eft une forte de maigreur qui arrive en ,
peu de tems, par l’affaiflement des vaifleaux de tout
le corps en général, après de grandes évacuations ,
de fortes diflipations d’humeurs quelconques. Voye^ Maigreur, Affaissement. ( d )
EXTERNE, ou EXTÉRIEUR, adj. (Phyf.) eft
un terme relatif qui fe dit de tout ce qui eft au-de-
hors d’un corps. La furface d’un corps, c’eft-à-dire
cette partie qui paroît & fe préfente aux yeux ou au
toucher, eft la partie externe du corps.
Dans ce fens, externe eft oppofé à interne ou intérieur.
Voye^ Interne.
Externes , (angles) en Géométrie, font les angles
de toute figure rediligne, qui n’entrent point
dans fa formation, mais qui font formés par fes côtés
prolongés au-dehors. Voye^ Angle , & Interne.
Les angles externes d’un poligone quelconque pris
enfemble font égaux à quatre angles droits. Dans un
triangle, l’angle externe D O A ( Planch. Géom.fig,
y 6.) eft égal à la fomme des angles intérieurs op-
p o fé sy , 1. Voyei Triangle. Ces propofitions font
démontrées par-tout. ( E ) Externe, adj. ( Anat. ) terme relatif, qu’on
prend dans le fens connu de tout le monde, quand
on dit par exemple tégumens externes : M. "Winflow
appelle externe ce qui eft le plus éloigné d’un plan
qu’on imagine partager également tout le corps en
partie droite, & en partie gauche, & interne , ce
qui en eft le plus proche ; c’eft ainfi qu’on oppofe
les mufcles externes, & internes. Hippocrate donne
le nom d’externes aux parties les plus éloignées du
coeur, ( g )
EXTINCTION, f. f. ( Phyf. ) eft l’aôion d’éteindre
, c’eft-à-dire d’anéantir ou de détruire le feu, la
flamme ou la lumière. Voye{ Lumière , Flamme
, &c.
Boerhaave nie qu’il y ait proprement rien qui foit
capable d’éteindre le feu: c’eft, dit-il, un corps fu i
gtneris, d’une nature immuable, & nous ne pouvons
pas pliis le détruire que nous ne pouvons le créer.
V<yt[ Feu .
Cela peut être ; mais il n’en eft pas riiôins vrai
qu on arrête l’aftion de cette matière qui forme ce
que nous appelions le feu. Ainfi dire que l’eau n’é-
teint pas le feu , parce qu’elle ne détruit pas la matière
du feu, c’eft éluder la difficulté au lieu de la
réfoudre.
Les fefrateurs d’Ariftote expliquent ¥ extinction du
feu parle principe d’antipériftafe ou de contrariété ;
ainfi, 'difent-ils, l’eau chafle le feu, parce que les
qualités de l’eau font contraires à celles du feu ; Tune
étant froide & humide, & l’autre chaud &fec. Mais
outre que ce n’eft pas là une explicatiori, puifqu’elle
ne rend point raifon de cette contrariété, elle ne
paroît pas même fatisfaifante pour Ceux qui fe contentent
de mots vuides de fens ; car le feu eft éteint
avec 1 eau chaude auffi-bien qu’avec l’eau froide, &c,
Voyei A n t ip e r i s t a s e .
Quelques modernes apportent deux caufes plus
plaufibles de ¥ extinction du feu ; favoir la diflipa-
tion, comme quand les matières qui lui fervent d’aliment
font difperfées par un vent trop violent ; 8c
la fuffocation, quand il eft tellement comprimé qu’il
ne peut plus conferver fon mouvement libre, comme
il arrive quand on jette de l’eau defliis.
On fent bien que cette explication eft encore
très-legere & très-vague. Avoiions franchement que
nous ignorons pourquoi l’eau éteint le feu , comme
nous ignorons pourquoi une pierre tombe, pourquoi
nous remuons nos doigts, & la caufe de cent
autres phénomènes auffi communs, & auffi inexplicables
pour nous. (O )
E x t i n c t i o n , (Jurifprud.) s’applique en cette
matière à différens objets, favoir :
Extinction de la chandelle : c’eft lorfqu’on fait une
adjudication à ¥ extinction de petites bougies ou chandelles,
comme cela fe pratique dans les fermes du
Roi. Voyeç CH AN D ELLE ÉTEINTE.
Extinction d ’une charge foncière, réelle, ou hypo-
thèquaire ; c’eft lorfqu’on amortit quelque charge qui
étoit impofée fur un fonds.
Extinction jdu douaire ; c’eft lorfque la femme 8c
les enfans qui avoient droit de joïiir du doiiàire, font
décédés, ou que Ton a compofé avec eu x , & racheté
le doüaire.
Extinction d’une famille ; c’eft lorfqu’il n’en refte
plus perfonne.
Extinction d ’un fidei-commis , ou d’une fubjlitution ;
c’eft lorfque le fidei-commis ou fubftitution eft fini,
foit parce tous les degrés font remplis, & que les
biens deviennent libres, foitparce qu’il rie fe trouve
plus perfonne habile a recueillir les biens en vertu
de la difpofition.
Extinction de ligne directe , ott collatérale ; c’eft lorfque
dans une famille urie ligne fe trouve entièrement
défaillante , c’ eft-à-dire qu’il n’en refte plus
perfonne.
Extinction de nom; c’eft lorfqu’il ne fe trouve plus
perfonne de ce nom.
Extinction d'une rente; c’eft lorfqu’une rente eft
amortie ou rèmbourféè.
Extinction d'une fervitude ; e’eft quand ürt héritage
eft déchargé de quelque fervitude qui y étoit impofée.
Extinction d une fubjlitution , voyez ci-dèflus Ex*
tinction d’un Jidti-comrhis. ( A )
EXTIRPATION , f. f. eft un terme de Chirurgie
qùi lignifie couper entièrement une partie, contme une
loupe, un polype, un cancer, &c.
L’amputation du bras dans l’article, eft urie extirpation
de l’extrémité fupérieure. V. A m p u t a t i o n .
E X T IS P IC E , f. ixù (Antiquité.) infpeftion des