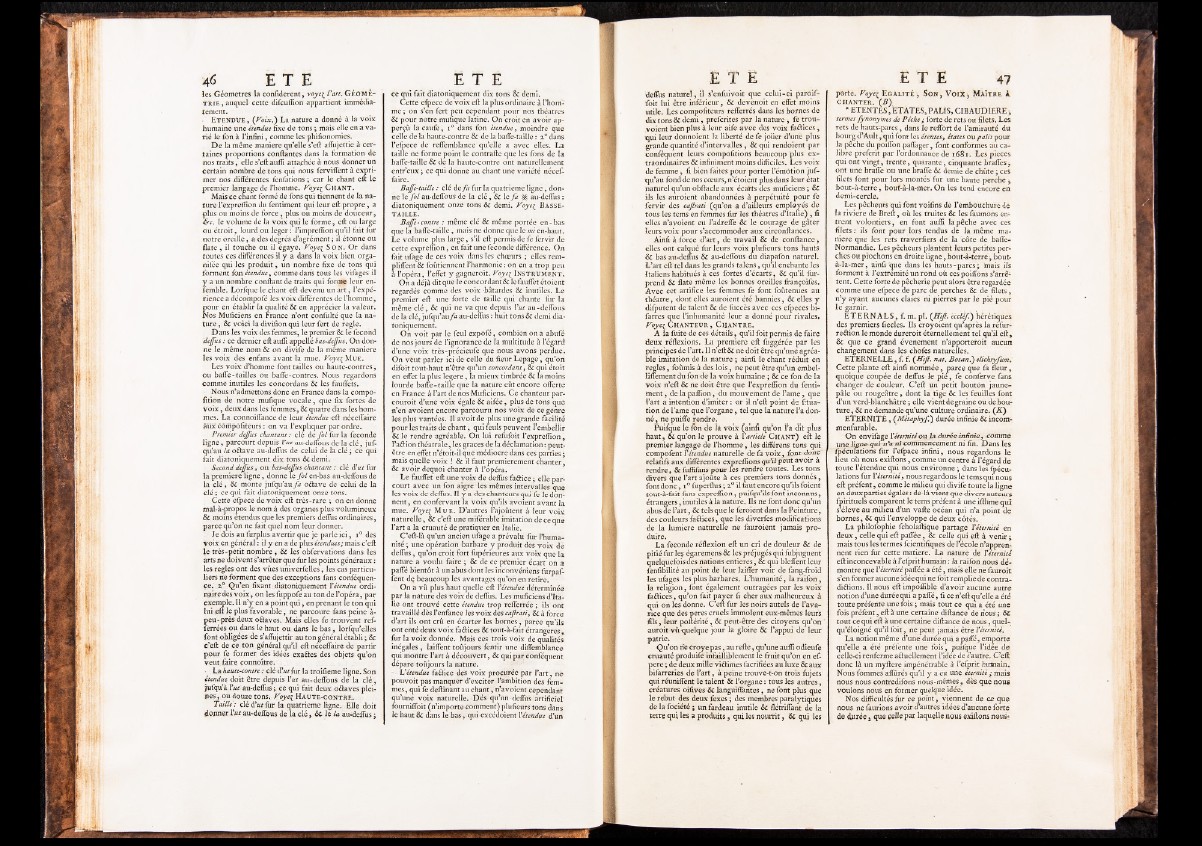
les Géomètres la confiderent, voye^ l'art. GioMÉ-
trie , auquel cette difcuflion appartient immédiatement.
Etendue , (’Voix.) La nature a donné à la voix
humaine une étendue fixe de tons ; mais elle en a varié
le fon à l’infini, comme les phifionomies.
D e la même maniéré qu’elle s’eft affujettie à certaines
proportions confiantes dans la formation de
nos traits, elle s’eftaufli attachée à nous donner un
certain nombre fie tons qui nous ferviffent à exprimer
nos différentes fenfations ; car le chant elt le
premier langage de l’homme. Voye[ Chant.
Mais ce chant formé de Tons qui tiennent de la nature
l’expreflîon du fentiment qui leur eft propre, a
plus ou moins de force, plus ou moins de douceur,
&c. le volume de la voix qui le forme, eft ou large
ou étroit, lourd ou leger : l’impreflïon qu’il fait fur
notre oreille, a des degrés d’agrément ; il étonne ou
flate , il touche ou il égaye. Voye^ S o n . Or dans
toutes ces différences il y a dans la voix bien orga-
nilée qui les produit, un nombre fixe de tons qui
forment fon étendue, comme dans tous les vifages il
y a un nombre confiant de traits qui forme leur en-
femble. Lorfque le chant eft devenu un art, l’expérience
a décompofé les voix différentes de l’homme,
pour en établir la qualité 8c en apprécier la valeur.
Nos Muficiens en France n’ont confulté que la nature
, & voici la divifion qui leur fert de réglé.
Dans les voix des femmes, le premier 8c le fécond
deffus : ce dernier eft aufli appelle bas-dejfus. On donne
le même nom 8c on divife de la même maniéré
les voix des enfans avant la mue. Voyeç Mue.
Les voix d’homme font tailles ou haute-contres,
ou baffe-tailles ou baffe-contres. Nous regardons
comme inutiles les concordans 8c les fauffets.
Nous n’admettons donc en France dans la compo-
fition de notre mufique vocale, que lix fortes de
v o ix , deux dans les femmes, 8c quatre dans les hommes.
La connoiffance de leur étendue eft néceffaire
aux compofiteurs : on va l’expliquer par ordre.
Premier dejfus chantant : clé de fo l fur la fécondé
ligne, parcourt depuis Vue au-deflous de la c lé , jufqu’au
la oftave au-deffus de celui de la clé ; ce qui
fait diatoniquement dix tons 8c demi.
Second dejfus, ou bas-dejfus chantant : clé d'ut fur
la première ligne, donne le fo l en-bas au-deffous de
la c lé , 8c monte jufqu’au fa oCtave de celui de la
clé ; ce qui fait diatoniquement onze tons.
- Cette éfpece de voix eft très-rare ; on en donne
mal-à-propos le nom à des organes plus volumineux
8c moins étendus que les premiers deffus ordinaires,
parce qu’on ne fait quel nom leur donner.
. Je dois au furplus avertir que je parle ic i, i° des
yoix eu général : il y en a de plus étendues; mais c’eft
Je très-petit nombre, 8c les obfervations dans les
arts ne doivent s’arrêter que fur les points généraux :
les réglés ont des vues imiverfelles, les cas particuliers
ne forment que des exceptions fans conféquen-
çe. z° Qu’en fixant diatoniquement l'étendue ordinaire
des voix , on les fuppofe au ton de l’opéra, par
exemple. Il n’y en a point qui, en prenant le ton qui
lui elt le plus favorable, ne parcoure fans peine à-
peu-près deux oCtaves. Mais elles fe trouvent ref-
ierrées ou dans le haut ou dans le bas, lorfqu’elles
font obligées de s’affujettir au ton général établi ; 8c
c’ëft de .ee ton général qu’il eft néceffaire de partir
pour fe former des idées exaétes des objets qu’on
veut faire çonnoître.
■ l a haute-contre : clé d'ut fur la troifieme ligne. Son
étendue doit être depuis l'ut au-deffous de la c lé ,
jufqu’à l’jw au-deffus ; ce qui fait deux oûaves pleines;*
ou douze tons. Voye^ Haute-contre. ..
Taille : clé dut fur la quatrième ligne. Elle doit
donner l’ut au-deffbus de la c lé , 8c le la au-deffus ;
ce qui fait diatoniquement dix tons 8c demi.
Cette efpece de voix eft la plus ordinaire à l’homme
; on s’en fert peu cependant pour nos théâtres
8c pour notre mufique latine. On croit en avoir ap-
perçû la caufe, i° dans fon étendue, moindre que
celle de la haute-contre 8c de la baffe-taille : z° dans
l’efpece de reffemblance qu’elle a avec elles. La
taille ne forme point le contrafte que les fons de la
baffe-taille 8c de la haute-contre ont naturellement
entr’eux ; ce qui donne au chant une variété néceffaire.
Baffe-taille : clé de fa fur la quatrième ligne, donne
le fo l au-deffous de la c lé , 8c le ^ ^ au-deffus :
diatoniquement onze tons 8c demi. Voye^ Basse-
taille.
Baffe-contre : même clé 8c même portée en-bas
que la baffe-taille, mais ne donne que le mi en-haut.
Le volume plus large, s’il eft permis de fe fervir de
cette expreflion, en fait une fécondé différence. On
fait ufage de ces voix dans les choeurs ; elles rem-
pliffent 8c foûtiennent l’harmonie : on en a trop peu
à l’opéra, l’effet y gagneroit. Voyeç Instrument.
On a déjà dit que le concordant 8c le fauffet étoient
regardés comme des voix bâtardes 8c inutiles. Le
premier eft une forte de taille qui chante fur la
même c lé , 8c qui ne va que depuis Vue au-deffous
de la clé, jufqu’au fa au-deffus : huit tons 8c demi diatoniquement.
On voit par le feul expofe, combien on a abufé
de nos jours de l’ignorance de la multitude à l’égard
d’une voix très-précieufe que nous avons perdue.
On veut parler ici de celle du fieur Lepage, qu’on
difoit tout-haut n’être qu’un concordant, & qui étoit
en effet la plus legere, la mieux timbrée 8c fa moins
lourde baffe-taille que la nature eut encore offerte
en France à l’art de nos Muficiens. Ce chanteur par-
couroit d’une voix égale 8c aifée, plus de tons que
n’en avoient encore parcouru nos voix de ce genre
les plus vantées. Il avoit de plus une grande facilité
pour les traits de chant, qui feuls peuvent l’embellir
8c le rendre agréable. On lui refufoit l’expreflîon,
l’aéHon théâtrale, les grâces de la déclamation : peut-
être en effet n’étoit-il que médiocre dans ces parties ;
mais quelle voix ! 8c il faut premièrement chanter,
8c avoir dequoi chanter à l’opéra.
Le fauffet eft une voix de deffus faéfice ; elle parcourt
avec un fon aigre les mêmes intervalles que
les voix de deffus. Il y a des chanteurs qui fe le donnent
, en confervant la vo ix qu’ils avoient avant la
mue. Voye^ M u e . D’autres l’ajoûtent à leur voix
naturelle, 8c c’eft une miférable imitation de ce que
l’art a la cruauté de pratiquer en Italie.
C ’eft-là qu’un ancien ufage a prévalu fur l’humanité
; une opération barbare y produit des voix de
deffus, qu’on croit fort fupérieures aux v oix que la
nature a voulu faire ; 8c de ce premier écart on a
paffé bientôt à un abus dont les inconvéniens furpaf-
fent dq beaucoup les avantages qu’on en retire.
On a vu plus haut quelle eft Vétendue déterminée
par la nature des voix de deffus. Les muficiens d’Italie
ont trouvé cette étendue trop refferrée ; ils ont
travaillé dès l’enfance les voix des cafrati, 8c à force
d’art ils ont cru en écarter les bornes, parce qu’ils
ont enté deux vo ix factices 8c tout-à-fait étrangères,.
fur la voix donnée. Mais ces trois voix de qualités
inégales , laiffent toujours fentir une diffemblance
ui montre l’art à découvert, 8c qui par conféquent
épare toujours la nature.
L’étendue faâice des voix procurée par l’art, ne
pouvoit pas manquer d’exciter l’ambition des femmes,
qui fe deftinant au chant, n’avoient cependant
qu’une voix naturelle. Dés qu’un deffus artificiel
fourniffoit (n’importe comment) plufieurs tons dans
le haut 8c dans le bas, qui excédoient l'étendue d’un
deffus naturel, il s’enfuivoit que celui-ci parôif-
foit lui être inférieur, 8c devenoit en effet moins
utile. Les compofiteurs refferrés dans les bornes de
dix tons 8c demi, preferites par la nature * fe trou-
,voient bien plus à leur aife avec des voix faétices,
iqui leur donnoient la liberté de fe joiier d’une plus
grande quantité d’intervalles, 8c qui rendoient par
conféquent leurs compofitions beaucoup plus extraordinaires
8c infiniment moins difficiles. Les voix
de femme, fi bien faites pour porter l’émôtion jufqu’au
fond de nos coeurs, n’étoient plus dans leur état
naturel qu’un obftacle aux écarts des muficiens ; 8c
ils les auroient abandonnées à perpétuité pour fe
fervir des cafrati (qu’on a d’ailleurs employés de
tous les tems en femmes fur les théâtres d’Itafie.) , fi
elles n’avoient eu l’adreffe 8c le courage de gâter
leurs v oix pour s’accommoder aux circonftances.
Ainfi à force d’art, de travail 8c de conftancé *
elles ont calqué fur leurs voix plufieurs tons hauts
8c bas au-deffus 8c au-deffous du diapafon naturel.
L ’art eft tel dans les grands talens, qu’il enchante les
Italiens habitués à ces fortes d’écarts, 8c qu’il fur-
prend 8c flate même les bonnes oreilles ffançoifes.
Avec cet artifice les femmes fe font foûtenues au
théâtre, dont elles auroient été bannies, 8c elles y
difputent de talent 8c de fuccès avec ces efpeces bi-
farres que l’inhumanité leur a donné pour rivales»
Voyei Chanteur , Chantre.
A la fuite de ces détails, qu’il foit permis de faire
deux réflexions. La première eft fuggérée par les
principes de l’art. Il n’eft8c ne doit être qu’une agréable
imitation de la nature ; ainfi le chant réduit en
réglés, fournis à des lo is, ne peut être qu’un embel-
liffement du fon de la voix humaine ; 8c ce fon de la
voix n’eft 8c ne doit être que l’expreffion du fentiment
, de la paflion, du mouvement de l’ame, que
l’art a intention d’imiter : or il n’eft point de fitua-
tion de l ’ame que l’organe, tel que la nature l’a donné
, ne puiffe rendre.
Puifque le fon de là voix (ainfi qü’on l’a dit plus
haut, 8c qu’on le prouve à Varticle Chant) eft le
premier langage de l’homme, les différens tons qui
compofent l'étendue naturelle de fa v o ix , font donc
relatifs aux différentes expreflïons qu’il peut avoir à
rendre, & fuffifans pour les rendre toutes. Les tons
divers que l’art ajoûte à ces premiers tons donnés,
font donc, i° fuperflus ; z° il faut encore qu’ils foient
tout-à-fait fans expreflion, puifqu’ilsfont inconnus,
étrangers, inutiles à la nature. Ils ne font donc qu’un
abus de l’art, 8c tels que le feroient dans la Peinture,
des couleurs faétices, que les diverfes modifications
de la lumière naturelle ne fauroient jamais produire
»
La fécondé réflexion eft un cri de douleur 8c de
pitié fur le? égaremens 8c les préjugés qui fubjuguent
quelquefois des nations entières, 8c qui bleffent leur
lenfibilité au point de leur laiffer voir de fang-froid
les ufages les plus barbares. L ’humanité, la raifon,
la religion, font également outragées par les voix
faûices, qu’on fait payer fi cher aux malheureux à
qui on les donne. C ’eft fur les noirs autels de l’avarice
que des peres cruels immolent eux-mêmes leurs
fils, leur poltérité, 8c peut-être des citoyens qu’on
auroit vu quelque jour la gloire 8c l’appui de leur
patrie*
Qu’on necroyepas, au refte, qu’une aufli odieufe
cruauté produife infailliblement le fruit qu’on en ef-
pere ; de deux mille victimes l'acrifiées au luxe 8c aux
bifarreries de l’art, à peine trouve-t-on trois fujets
qui réunifient le talent 8c l’organe : tous les autres,
créatures oifives 8c languiffantes, ne font plus que
le rebut des deux fexes ; des membres paralytiques
de la fociété ; un fardeau inutile 8c flétriffant de la
terre qui les a produits, qui les nourrit, 8c qui les
porte. P’oyei Egalité , S o n , Voix, Ma ître à.
chanter. (B )
* ETENTES, ETÀTES, PALIS, CIBAUDIERE -,
termes fynonymes de Pêche ; forte de rets ou filets. Les
rets de hauts-parcs, dans le reffort de l’amirauté du
bourg d’Ault, qui font les ètentes> étates ou -palis pour
la pêche du poiffon paffager, font conformes au calibre
preferit par l’ordonnance de 1681. Les pièces
qui ont vingt , trente, quarante, cinquante braffes,
ont une braffe ou une brafle 8c demie de chiite ; ces
filpts font pour lors montés fur une haute perche ,
bout-à-terre, bouf-à-la-mer. On les tend encore en
demi-cercle.
Les pêcheurs qui font voifins dè l’embouehùrè dè
la riviere de Breft, où les truites 8c les faumons entrent
volontiers, en font aufli la pêche avec ces
filets: ils font pour lors tendus de la même maniéré
que les rets traverfiers de la côte de baffe-
Normandie. Les pêcheurs plantent leurs petites perches
ou piochons en droite ligne, bout-à-terre -, bout»
à-la-mer, ainfi que dans les hauts-parcs; hiais ils
forment à l’extremité un rond où ces poiffôns s’arrêtent.
Cette forte de pêcherie peut alors être regardée
comme une efpece de parc de perches 8c de filets,
n’y ayant aucunes claies ni pierres par le pié pouf
le garnir.
E T E R N A L S , f. m. pl. (jïifi- éccléfé) hérétiques
des premiers fiecles. Ils croyoient qu’après la relur-
reCtion le monde dureroit éternellement tel qu’il eft,
8c que ce grand événement n’apporteroit aucun
changement dans les chofes naturelles.
ETERNELLE, f. f. (H if . nat. Botan.) eUchryfum.
Cette plante eft ainfi nommée, parce que fa fleur,
quoique coupée de deffus le pié , fe conferve fans
changer de couleur. C ’eft un petit bouton jaune-
pâle ou rougeâtre, dont la tige 8c les feuilles font
d’un verd-blanehâtre ; elle vient de graine ou de bouture,
8c ne demande qu’une culture ordinaire. (X )
ÉTERNITÉ, (Métaphyf. ) durée infinie 8c incom-
menfurable»
On envifage Véternité ou la durée infinie, comme
une ligne qui n ’a ni commencement ni fin. Dans les
Spéculations fur l’efpace infini, nous regardons le
lieu où nous exiftons, comme un centre à l’égard de
toute l’étendue qui nous environne ; dans les fpécu-
lations fur l'éternité, nous regardons le tems qui nous
eft p réfent, comme le milieu qui divife toute la ligne
en deux parties égales : de-là vient que divers auteurs
fpirituels comparent le tems préfent à une ifthme qui
s’élève au milieu d’un vafte océan qui n’a point de
bornes, 8c qui l’enveloppe de deux côtés.
La philofophie fcholaftique partage Véternité en
deux, celle qui eft paffée, 8c celle qui eft à venir ;
mais tous les termes feientifiques de l’école n’apprend
nent rien fur cette matière. La nature de l’éternité
eft inconcevable à l’efprit humain : la raifon nous démontre
que Véternité paffée a é té , mais elle ne fauroit
s’en former aucune idée qui ne foit remplie de contradictions.
Il nous eft impoflible d’avoir aucune autre
notion d’une durée qui a paffé, fi ce n’eft qu’elle a été
toute préfente une fois ; mais tout ce qui a été une
fois préfent, eft à une certaine diftance de nous; 8c
tout ce qui eft à une certaine diftance de nous, quel-
qu’éloigné qu’il foit, ne peut jamais être l’éternité.
La notion même d’une durée qui a paffé, emporte
qu’elle a été préfente une fois, pui/que l’idee de
celle-ci renferme actuellement l’idée de l’autre. C’eft
donc là un myftere impénétrable à l’efprit humain.
Noiis fommes affûrés qu’il y a eu une éternité ; mais
nous nous contredifons nous-mêmes, dès que nous
voulons nous en former quelque idée.
Nos difficultés fur ce point, viennent de ce que
nous ne faurions avoir d’autres idées d’aucune forte
de durée i que celle par laquelle nous exiftons nous