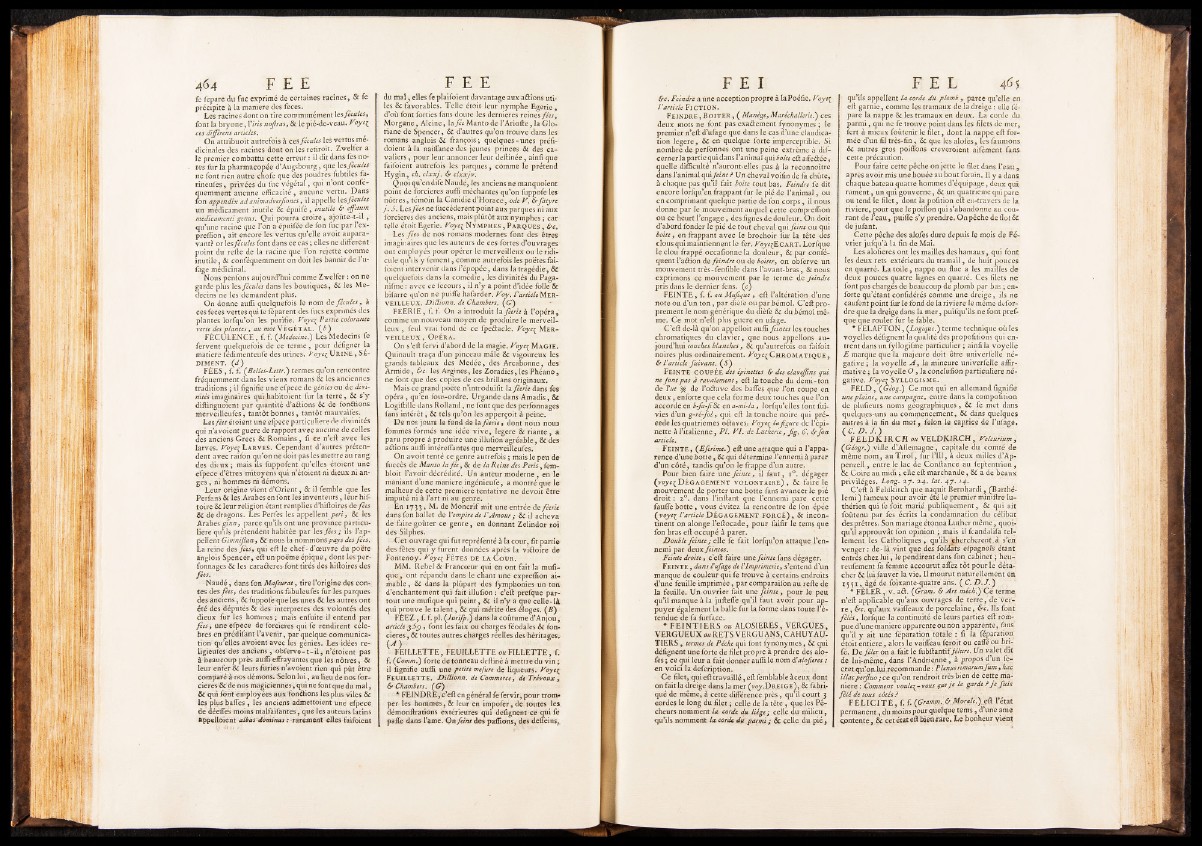
464 F E E
fe fepare du fuc exprimé de certaines racines, & fe
précipite à la maniéré des feces. •• ■ H
Les racines dont on tire communément lts fécules,
font la bryone, Vins nofiras, & le pié-de-veau. Voyeç
ces dijférens articles, f
On attribuoit autrefois à ces fécules les vertus médicinales
des racines dont on les retiroit. Zwelfer a
le premier combattu cette erreur : il dit dans fes notes
fur la pharmacopée d’Augsbourg, que les fécules
ne font rien autre chofe que des poudres fubtiles fa-
rineufes, privées du fuc végétal, qui n’ont confé-
quemment aucune efficacité, aucune vertu. Dans
ion appehdix ad animadverfionts, il appelle les fecules
un médicament inutile & épuilé, inutile & ejfetum
médicament! genus. Qui pourra croire, ajoûte-t-il ,
qu’une racine que l’on a épuifée de fon fuc par 1 ex-
preffion, ait encore les vertus qu’elle avoit auparavant?
or les fécules font dans ce cas ; elles ne different
point du refte de la racine que l’on rejette comme
inutile, & conféquemment on doit les bannir de l’u-
fage médicinal.
Nous penfons aujourd’hui comme Zwelfer : on ne
garde plus les fécules dans les boutiques, & les Médecins
ne les demandent plus.
On donne auffi quelquefois le nom de fécules, à
ces feces vertes qui fe féparent des fucs exprimés des
plantes lorfqu’on les purifie. Voyez Partie colorante
verte des plantes, au mot VÉGÉTAL. (b )
FÉCULENCE, f. f. (Medecine.) Les Médecins fe
fervent quelquefois de ce terme, pour défigner la
matière lédimenteufe des urines, f'oyez U r in e , Séd
im e n t . (d)
FÉES, f. f. {Belles-Lettré) termes qu’on rencontre
fréquemment dans les vieux romans & les anciennes
traditions ; il lignifie une efpece de génies on de divinités
imaginaires qui.habitoient fur la terre, & s’y
diftinguoient par quantité d’aftions St de fondions
merveilleufes, tantôt bonnes, tantôt mauvaifes.
Les fées étoient une efpece particulière de divinités
qui n’avoient guere de rapport avec aucune de celles
des anciens Grecs St Romains, fi ce n’eft avec les
larves. Voyez L a r v e s . Cependant d’autres prétendent
avec raifon qu’on ne doit pas les mettre au rang
des dieux ; mais ils fuppofent qu’elles -étoient une
efpece d’êtres mitoyens qui n’étoient ni dieux ni anges
, ni hommes ni démons.
Leur origine vient d’Orierit, & il femble que les
Perfans & les.Arabes en font les inventeurs, leur histoire
St leur religion étant remplies d’hiftoires de fées
& de dragons. Les Perfes les appellent péri, St les
Arabes ginn, parce qu’ils ont une province particulière
qu’ils prétendent habitée par les fées ; ils l’appellent
Gimnifian, & nous la nommons pays des fées.
La reine des fées, qui eft le chef - d’oeuvre du poète
ànglois Spencer-, eft un poème épique, dont les per-
fonnages St les caraûeresfont tirés des hiftoires des
fées/ -
Naudé, dans fon Mafcurdt, tire l’origine des contes
des fées, des traditions fabuleufes fur les parques
des anciens, St fuppofe que les unes St les autres ont
été des députés & des interprètes des volontés des
dieux fur les hommes ; mais enfuite il entend par
fées; Une efpece de forcieres qui fe rendirent célébrés
en prédifant l’avenir, par quelque communication'
qu’elles avoient avec les génies. Les idées re-
ligiëiifësrdesanciens , o b fe rv e - t - il, n’étoient pas
à beaucoup près auffi effrayantes que lès nôtres, &
leur enfer St leurs furies n’avoient rien qui pût être
comparé à nos démons. Selon lui, au lieu de nos forcieres
S£dé nos magiciennes, qui ne font que du mal,
St qui font employées aux fondions les plus viles St
les plus baffes , les anciens admettoient une efpece
de dééfles moins malfâifantes, que les auteurs latins
appelaient albas dominas : rarement elles faifoient
F E E
du m al, elles fe plaifoient davantage aux a&ions utiles
St favorables. Telle ét-oit leur nymphe Egerie,
d’où font forties fans dout e les dernieres reines fées,
Morgane, Alcine, la fée Manto de l’Ariofte, la Glo-
riane de Spencer, St d’autres qu’on trouve dans les
romans anglois St françois; quelques-unes préfi-
doient- à la naiffance des jeunes princes & des cavaliers
, pour leur annoncer leur deftinée, ainfi que
faifoient autrefois les parques, comme le prétend
Hygin, ch. clxxj. & clxxjv.
Quoi qu’en dife Naudé, les anciens né manquoient
point de forcieres auffi méchantes qu’on fuppofe les
nôtres, témoin la Canidie d’Horace, ode V. &fatyre
j . 5. Les fées ne fuccéderent point aux parques ni aux
forcieres des anciens, mais plutôt aux nymphes ; car
telle étoit Egerie. Voyez N ym p h e s , P a r q u e s , &c.
Les fées de nos romans modernes font des êtres
imaginaires que les auteurs de ces fortes d’ouvrages
ont employés pour opérer le merveilleux ou le ridicule
qu’ils y fement, comme autrefois les poètes faifoient
intervenir dans l’épopée, dans la tragédie, &
quelquefois dans la comédie, les divinités du Paga-
nifme : avec ce fecours, il n’y a point d’idée folle &
bilarre qu’on ne puiffe hafarder. Voy. l ’article Mer v
e i l l e u x . Diclionn. de Chambers. (G)
FÉERIE, f. f. On a introduit la féerie à l’opéra,'
comme un nouveau moyen de produire le merveilleux
, feul vrai fond de ce fpe&acle. Voyez M er v
e i l l e u x , O p é r a .
On s’eft fervi d’abord de la magie. Voyez M a g i e .
Quinault traça d’un pinceau mâle St vigoureux les
grands tableaux des Medée, des Arcabonne, des
Armide, &c■ les Argines, les Zoradïes, les Phéano,
ne font que des copies de ces brillans originaux.
Mais ce grand poète n’introduifit la féerie dans fes
opéra, qu’en fous-ordre. Urgande dans Amadis, &
Logiftille dans Rolland, ne font que des perfonnages
fans intérêtj St tels qu’on les apperçoit à peine.
De nos jours le fond de la féerie , dont nous nous
femmes formés une idée v iv e , legere & riante, a
paru propre' à produire une illufion agréable, St des
allions auffi intéreffantes que merveilleufes.
On avoit tenté ce genre autrefois ; mais le peu de
fuccès de Manto la fée, & de la Reine des Péris, fem-
bloit l’avoir décrédité. Un auteur moderne , en le
maniant d’une maniéré ingénieufe, a montré que le
malheur de cette première tentative ne devoit être
imputé ni à l’art ni au genre.
En 1733, M. de Moncrif mit une entrée de féerie
dans fon ballet de l’empire de VAmour ; & il acheva
de faire goûter ce genre, en donnant Zelindor roi
des Silphes.
Cet ouvrage qui fut repréfenté à la cour, fit partie
des fêtes qui y furent données après la viôoire de
Fontenoy. Voyez F ê t e s d e l a C o u r .
MM. Rebel & Francoeur qui en ont fait la mufi-
que, ont répandu dans le chant une expreffion aimable
, St dans la plûpart des fymphonies un ton
d’enchantement qui fait illufion : c’eft prefque partout
une mufique qui peint, & il n’y a que celle-là
qui prouve le talent, St qui mérite des éloges. (R)
FÉEZ , f. f. pl. (Jurifp.) dans la coûtume d’Anjou,
article $5c), font les faix ou charges féodales St foncières
, St toutes autres charges réelles des héritages.
H i .
FEILLETTE, FEUILLETTE ou F ILLETTE, f.
f. ( Comm.) forte de tonneau deftiné à mèttre du vin ;
il fignifie auffi une petite mefure de liqueurs. Voyeç
Fe u i l l e t t e . Diclionn. de Commerce, de Trévoux,
& Chambers. (G)
* FEINDRE,c’eft en général fe fervir, pour tromper
les hommes, & leur en impofer, de toutes les
démonftrations extérieures qui defignent ce qui fe
paffe dans l’ame. Qn feint des paffions, des deffeins,
F E I &c. Feindre a line acception propre à laPoéfie. Voyez
Varticle Fi c t i o n .
F e in d r e , B o it e r , ( Manège, Marèchallerieé) ces
deux mots ne font pas exactement fynonymes ; le
premier n’eft d’ufage que dans le cas d’une claudication
legere, & en quelque forte imperceptible. Si
nombre de perfonnes ont une peine extrême à dif-
cerner la partie qui dans l’animal qui boîte eft affeélée,
uelle difficulté rt’auront-elles pas à la reconnoître
ans l’animal qui feint? Un cheval voifin de fa chûte,
à chaque pas qu’il fait boite tout bas. Feindre fe dit
encore lorfqu’en frappant fur le pié de l’animal, ou
en comprimant quelque partie de fon corps, il nous
donne par le mouvement auquel cette cofhpreffion
ou ce heurt l’engage, des lignes de douleur. On doit
d’abord fonder le pié de tout cheval qui feint ou qui
boite, en frappant avec le brochoir fur la tête des
clous qui maintiennent le fer. A'oy^EcART. Lorfque
le clou frappé occafionne la douleur, & par confé-
quent l’aâion de feindre ou de boiter, on obferve un
mouvement très-fenfible dans l’avant-bras, &nous
exprimons ce mouvement par le terme de feindre
pris dans le dernier fens. (e)
FEINTE, f. f. en Mufique , eft l’altération d’une
note ou d’un ton, par dièfe ou par bémol. C ’eft proprement
le nom générique du dièfe St du bémol même.
Ce mot n’eft plus guere en ufage.
C ’eft de-là qu’on appelloit auffi feintes les touches
chromatiques du clavier, que nous appelions aujourd’hui
touches blanches , & qu’autrefois on faifoit
noires plus ordinairement. VoyezC h r o m a t iq u e ,
& l ’article fuivant. (S )
FEINTE COUPÉE des épinettes & des claveffins qui
ne font pas a ravalement, eft la touche du demi-ton
de l’ut % de l’oélave des baffes que l’on coupe en
deux, enforte que cela forme deux touches que l’on
accorde en b-fa-fi&c ena-mi-la , lorfqu’eiles font fui-
vies d’un g-rè-fol, qui eft la touche noire qui précédé
les quatrièmes o&aves, Voye^ la figure de l’épi-
nette à l’italienne, Pl. VI. de Lutherie, fig. 6, & fon
article.
F e in t e , {Efcrime.) eft une attaque qui a l ’apparence
d’une botte, & qui détermine l’ennemi à parer
d’un côté, tandis qu’on le frappe d’un autre.
Pour bien faire une feinte, il faut, i° . dégager
Çyoye^ D é g a g e m e n t v o l o n t a ir e ) , & faire le
mouvement de porter une botte fans avancer le pié
droit : z°. dans l’inftant que l’ennemi pare cette
fauffe botte, vous évitez la rencontre de fon épée
(voyc{ l ’article D é g a g e m e n t f o r c é ) , & incontinent
on alonge l’eftocade, pour faifir le tems que
fon bras eft occupé à parer.
Double feinte; elle fe fait lorfqu’on attaque l’ennemi
par deux feintes.
Feinte droite, c’eft faire une feinte fans dégager.
F e in t e , dans lufage de l’Imprimerie, s’entend d’un
manque de couleur qui fe trouve à certains endroits
d’une feuille imprimée, par comparaifon au refte de
la feuille. Un-ouvrier fait une feinte, pour le peu
qu’il manque à la jufteffe qu’il faut avoir pour appuyer
également la balle fur la forme dans toute l ’étendue
de fa furface.
* F E IN T IE R S ou ALOSIERES, VERGUES,
VERGUEUX ou RETS VERGÙ4NS, CAHUYAU-
TIERS , termes de Pêche qui font fynonymes, & qui
défignent une forte de filet propre à prendre des alor
fes ; ce qui leur a fait donner auffi le nom d’alofieres :
en voici la defeription.
Ce filet, qui eft travaillé, eft femblable àceux dont
on fait la dreige dans la mer (voy.DREiGE), & fabriqué
de même, à cette différence,près, qu’il court 3
cordes le long du filet ; celle de la tête , que les Pêcheurs
nomment la corde du liège; celle du milieu,
qu’ils nomment la corde du parmi ; & celle du pié,
F E L 465 qu’ils appellent la corde du plomb , parce qu’elle en
eft garnie, comme les tramaux de la dreige : elle fepare
la nappe & les tramaux en deux. La corde du
parmi, qui ne fe trouve point dans les filets de mer,
fert à mieux foûtenir le filet, dont la nappe eft formée
d’un fil très-fin, & que les alofes, les faumons
& autres gros poiffons creveroient aifément fans
cette précaution.
Pour faire cette pêche on jette le filet dans l’eau ,
après avoir mis une bouée au bout forain. Il y a dans
chaque bateau quatre hommes d’équipage, deux qui
rament, un qui gouverne, & un quatrième qui pare,
ou tend le filet, dont la pofition eft en-travers de la
riviere, pour que le poiffon qui s’abandonne au courant
de l’eau, puiffe s’y prendre. On pêche de flot ôc
de jufant.
Cette pêche des alofes dure depuis le mois de Février
jufqu’à la fin de Mai.
Les alofieres ont les mailles des hamaux, qui font
les deux rets extérieurs du tramait, de huit pouces
en quarré. La toile, nappe ou flue a les mailles de
deux pouces quatre lignes en quarré. Ces filets ne
font pas chargés de beaucoup de plomb par bas ; en-
forte qu’étant confidérés comme une dreige, ils ne
caufent point fur le fond de la riviere le même defor-
dre que la dreige dans la mer, puilqu’ilsne font prefque
que rouler fur le fable.
* F E L A P T O N , {Logique.) terme technique où les
v o y e lle s défignent la qualité des propofitions qui entrent
dans un fyllogifme particulier ; ainfi la v o y e lle
E marque que la majeure doit être univerfelle nég
a t iv e ; la v o y e lle A , la mineure univerfelle affirmative
; la v o y e lle O , la conclufion particulière négative
. Voye£ Sy l l o g i sm e .
FELD, {Géog.) Ce mot qui en allemand fignifie
une plaine, une campagne, entre dans la compofition
de plufieurs noms géographiques, & fe met dans
quelques-uns au comipencement, & dans quelques
autres à la fin du mot, félon le caprice de l’ulâge.
( C .D . J . )
F E L D K IR C H ou V ELDK IRCH, Velcurium,
(Géogr.) ville d’Allemagne, capitale du. comté de
même nom, au T iro l, fur l’Ill, à deux milles d’Ap-
penzell, entre le.lac de Confiance au féptentrion,
& Coire au midi ; elle eft marchande, & a de beaux
privilèges. Long. 27. 24. lat. 47. 14.
C ’eft à Feldkirch que naquit Bernhardi, (Barthé-
lemi ) fameux pour avoir été le premier miniftre luthérien
qui fe foit marié publiquement, & qui ait
foûtenu par fes écrits la condamnation du célibat
des prêtres. Son mariage étonna Luther même , quoiqu’il
approuvât fon opinion ; mais il feandalifa tellement
les Catholiques , qu’ils cherchèrent , à s’ën
venger: de-là vint que des foldars efpagnois étant
entrés chez lui, le pendirent dans fon, cabinet ; heu-
reufement fa femme accourut, affez tôt pour le détacher
& Iui.fauver la vie. Il mourut naturel.lemèht en
1551, âgé de foixante-quatre àns. ( C. D . J. )
* FÊLER, v . a£t. (Gram. & Art méch'.)'Ce terme
n’eft applicable qu’aux ouvrages de terre, de verre
, &c. qu’aux vaiffeaux de porcelaine, &c. Ils font
fêlés, lorfque la continuité de leurs parties eft rompue,
d’une maniéré apparente ou non apparente, fans
qu’il y ait une féparatioii totale : fi la féparatiôn'
etoit entière, alors le vaiffeau fefoit ou caffé ou bri-
fé. De fêler on a fait le fubftantiffêlure. Un valet dit
de lui-piêtue,, dans l’Andriennè, à propos d un fe-
cret qu’onluirecommande : Plenusrimarum fum, haç
illacpetfiuo ; ce qu’on rendroit très bien dé cette maniéré
: Comment voulez-vous qpe je le garde ? j e fuis
fêle de tous côtés ?
F É L IC I T É , f. f. (Gramrn.,6f Morale.) eft l’état
permanent, du moins pour quelque tems, d une ame
çpntente, & cet état eft bienrare. Le bonheur vient