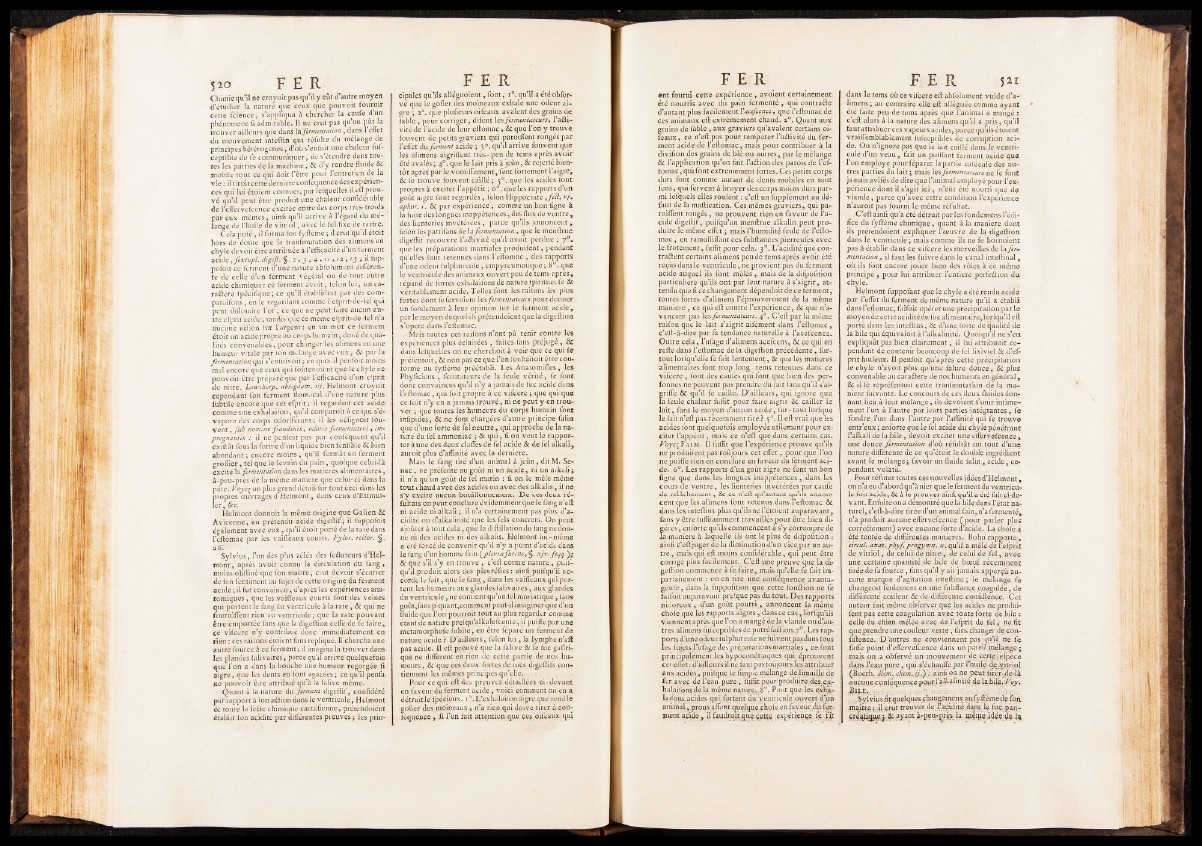
520 r £ Jtv
Chimie qu’il ne croyoit pas qu’il y eût d’autre moyen
d’étudier la nature que ceux que pouvoit fournir
cette fcience, s’appliqua à chercher la caufe d’un
phénomène fi admirable. Il ne crut pas cju on put la
trouver ailleurs que dans la 'fermentation, dans l’effet
du mouvement inteftin qui réfiilte du mélangé de
principes hétérogènes, d’où s’enfuit une chaleur fuf-
ceptible de le communiquer, de s’étendre dans toutes
les parties’de la machine, & d’y rendre fluide &
mobile tout ce qui doit l’être pour l’entretien de la
vie : il tiroit cette derniere confequence des ex perien-
ces qui lui étoient connues, par lefquelles il eft prouvé
qu’il peut être produit une chaleur corffiderable
de l’effervefcence excitée entre des corps très- froids
par eux-mêmes, ainfi qu’il arrive a 1 égard du mélangé
de fhuile de vitriol, avec le fel fixe de tartre.
Cela pofé, il forma l'on fyftème ; il crut qu’il étoit
hors de doute que la tranfmutation des alimens en
chyle devoit être attribuée à l’efficacité d’un ferment
acide, fextupl. digeji. § . 2 , 3 , 4 , 1 1 , 1 2 , 1 3 ; il fup-
pofoit ce ferment d’une nature abfolument difierenr
te de celle d’un ferment végétal ou de tout autre
acide chimique : ce ferment avoit ; -félon lui, un ca-
raftere fpécifique; ce qu’il établifloit par des com-
paraifons, en le regardant comme l efprit-de-fel qui
peut diffoudre l’or , ce que ne peut faire aucun autre
efprit acide ; tandis que ce même eiprit-de-fel n’a
aucune a&ion lur l’argent: en un mot ce ferment
étoit un acide propre au corps humain, doué de qualités
convenables, pour changer les alimens en une
humeur vitale par ion mélange avec eux, & par la
fermentation qui s’enliiivoit; en quoi il penfoit moins
mal encore que ceux qui lbûtenoient que le chyle ne
pouvoit être préparé que par l'efficacité d’un efprit
de nitre. Lowthorp. abrigdam. Uj. Helmont croyoit
cependant fon ferment ftomacal d’une nature plus
fubtile encore que cet efprit ; il regardoit- cet acide
comme une exhalaifon, qu’il comparoit à ce qui s’évapore
des corps odoriférans ; il les défignoit fou-
vent , jub nomine fraudinis, odoris fermentativi , im-
pregnantis : il ne penfoit pas par conféquent qu’il
exillât fous la forme d’un liquide bien fenfible & bien
abondant; encore moins , qu’il formât un ferment
groffier, tel que le levain du pain, quoique celuidà-
excite \z fermentation fans les matières alimentaires,
à-peu-près dé la même maniéré que celui- ci dans la
pâte. Voÿe^ un plus grand détail fur tout ceci dans les
propres ouvrages d'Helmont, dans ceux d’Ettmul-
le r , &c.
Helmont dorinoit la même origine que Galien &
Avicenne, au prétendu acide digeftif ; il fuppofoit
également avec eux, qu’il étoit porté de la rate dans
l’eftomac par les vaifleaux courts. Pylon reclor. §.
Sylvius, l’un des plus zélés des fe&ateurs d’Hel-
jnont, après avoir connu la circulation du lang ,
moins obftiné que fon maître; crut devoir s’écarter
de fon fentiment au fujet de cette origine du ferment
acide ; il fut Convaincu, d’après les expériences anatomiques,
que les vaifleaux courts font des veines
qui portent le fang du ventricule à la rate, & qui ne
fourniflent rien au ventricule ; que la rate pouvant
être emportée fans que la digeftion cefle de.fe faire,
ce vifeere n’y contribue donc immédiatement en
rien : ces raifons étoient fans répliqué. II chercha une
autre fource à ce ferment ; il imagina la trouver dans
les glandes falivaires, parce qu’il arrive quelquefois
que l’on a dans là bouche une humeur regorgée fi
aigre, que les dents en font agacées ; ce qu’il penfa
ne pouvoir êire attribué qu’à la falive même.
- Quant à la nature du ferment digeftif, confidéré
par rapport à fon aftion dans le ventricule, Helmont
6c toute la fe&e chimique cartéfienne, prétendoiént
établir Ion acidité par différentes preuves ; les principales
qu’ils alléguoient r font, i° . qu’il a été obfer-
v é que le gofier des moineaux exhale une odeur aigre
; i° . que plufieurs oifeaux avalent des grains de
fable, pour corriger, difent les fermentateurs, l’aâ i-
vité de l’acide de leur eftomae, & que l’on y trouve
fouvept de petits graviers qui paroiffent rongés par
l’effet du ferment acide ; 30. qu’il arrive fouvent que
les alimens aigrifîent très-peu de tems après avoir
été avalés ; 40. que le lait pris à jeun, & rejetté bientôt
après' par le vomiffement, fent fortement l’aigre,
& fe trouve fouvent caillé ; 50. que les acides font
propres à exciter l’appétit ; 6°. que les rapports d’un
goût aigre font regardés, félon Hippocrate , f c l . y»
aphor. 1. 6c par expérience , comme un bon figne à
la fuite des longues inappétences, des flux de ventre ,
des lienteries invétérées, parce qu’ils annoncent,
félon les partifans de la fermentation, que le menftrue
digeftif recouvre l’aâivité qu’il avoit perdue ; 70.
que les préparations martiales produifent, pendant
qu'elles font retenues dans l’eftomac , des rapports
d’une odeur fulphureufe, empyreumatique; 8°. que
le.ventricule des animaux ouvert peu de tems après,
répand de fortes exhalaifons de nature fpiritueufe &
véritablement acide. Telles font les raifons les plus
fortes dont fefervoient les fermentateurs pour donner
un fondement à leur opinion fur le ferment acide,
par le moyen duquel ils prétendoient que la digeftion
s’opère dans l’eftomac.
Mais toutes ces raifons n’ont pu tenir contre les
expériences plus éclairées , faites fans préjugé, &
dans lefquelles on ne cherchoit à voir que ce qui fe
préfentoit, & non pas ce que l’on fouhaitoit être conforme
au fyftème préétabli. Les Anatomiftes, les
Phyficiens , ferutateurs de la feule vérité , fe font
donc convaincus qu’il n’y a jamais de fuc acide dans
l’eftomac, qui foit propre à ce vifeere ; que qui que
ce foit n’y en a jamais trouvé, ni ne peut y en trouver
; que toutes les humeurs du corps humain font
infipides, 6c ne font chargées d’autre principe falin
que d’une forte de fel neutre, qui approche de la nature
du fel ammoniac ; & qui, fi on veut le rapporter
à une des deux claffes de fel acide & de fel alkali,
auroit plus d’affinité avec la derniere.
Mais le fang tiré d’un animal à jeun, dit M. Se-
n a c , ne préfente au goût ni un acide, ni un aikali ;
il n’a qu’un goût de fel marin : fi on le mêle même
tout chaud avec des acides ou avec des alkalis, il ne
s’y excite aucun bouillonnement. De ces deux ré-
fultats on peut conclure évidemment que le fang n’eft
ni acide ni alkali ; il n’a certainement pas plus d’acidité
ou d’alkalinité que les fels concrets. On peut
ajoûtçr à tout cela, que la diftillation du fang ne donne
ni des acides ni des alkalis. Helmont lui-même
a été forcé de convenir qu’il n’y a point d’acide dans
le fang d’un homme fain {plevtafurens, § . xjv. feqq.~);
& que s’il s’y en trouve , c’eft contre nature, puisqu'il
produit alors des pleuréfies : ainfi puifqu’il accorde
le fait, que le fang, dans les vaifleaux qui portent
les humeurs aux glandes falivaires , aux glandes
du ventricule, ne contient qu’un fel muriatique, fans
goût,fans piquant,comment peut-ilimaginer que d’un
fluide que l’on pourroit tout au plus regarder comme
étant de nature prefqu’alkalefcente, il puiffe par une
métamorphofe fubite, en être féparé un ferment de
nature acide ? D ’ailleurs, félon lu i, la lymphe n’d l
pas acide. Il eft prouvé que la falive & le lue gaftri-
que ne different en rien de cette partie de nos humeurs
, 6c que ces deux fortes de lues digeftifs contiennent
les mêmes principes qu’elle.; ,
Pour ce qui eft des preuves détaillées ci- devant
en faveur du ferment acide , voici comment on en a
détruit le fpécieux. i° .L ’exhalaifon aigre que rend le
gofier des moineaux, n’a rien qui doive tirer à con-
léqu.ençe, fi l’on fait attention que ces oifeaux qui
F E R
ont fourni cette expérience, avoient certainement
été nourris avec du pain fermenté, qui contrafte
d’autant plus facilement Ÿacefcence, que l’eftomac de
ces animaux eft extrêmement chaud. 20. Quant aux
grains de fable, aux graviers qu’avalent certains oi-
feaux, ce n’eft pas pour tempérer l’aâivité du ferment
acide de l’eftomac, mais pour contribuer à la
divifion des grains de blé ou autres, par le mélange
6c l’application qu’en fait l’aftion des parois de l’eftomac,
qui font extrêmement fortes. Ces petits corps
durs font comme autant de. dents mobiles en tout
fens, qui fervent à broyer des corps moins durs parmi
lefquels elles roulent : c’eft un fupplément au défaut
de la maftication. Ces mêmes graviers, qui pa-
roiffent rongés , ne prouvent rien en faveur de l’acide
digeftif, puifqu’un menftrue alkaiin peut produire
le même effet ; mais l’humidité feule de l’eftomac
, en ramolliffant ces.fubftances pierreufes avec
le frotement, fuffit pour cela. 30. L.’acidité que contractent
certains alimens peu de tems après avoir été
reçûs dans le ventricule, ne provient pas du ferment
acide auquel ils font mêlés , mais de la difpofition
particulière qu’ils opt par leur nature à s’aigrir, attendu
que fi ce changement dépendoit de.ee ferment,
tontes fortes d’alimens l’éprouveroient de la même
maniéré, ce qui eft contre l’expérience, 6c que n’a-
yancent p a s fermentateurs. 40. C’eft par la.même
raifon que le lait s’aigrit aifément dans l’eftomac ,
c’eft-à-dire par fa tendance naturelle à l’acefcence.
Outre cela, l’ufage d’alimens acefcens, 6c ce qui en
refte dans l’eftomac de la digeftion précédente, fur-
tout lorfqu’elle fe fait lentement, & que les matières
alimentaires font trop long - tems retenues dans ce
vifeere , font des caufes qui font que bien des per-
fonnes ne peuvent pas prendre du lait fans qu’il s’ai-
griffe 6c qu’il fe caille. D’ailleurs, qui ignore que
la feule chaleur fuffit pour faire aigrir 6c cailler le
lait, fans le moyen d’aucun acide, fur-tout lorfque
le lait n’eft pas récemment tiré ? 50. Il eft vrai que les
acides font quelquefois employés utilement pour exciter
l’appétit, mais ce n’eft que dans certains cas.
Voye^ Fa im . Il fuffit que l’expérience prouve qu’ils
ne produifent pas toujours cet effet, pour que l’on
ne puiffe rien en conclure en faveur du ferment acide.
6°. Les rapports d’un goût aigre ne font un bon
figne que dans les longues inappétences.,, dans les
cours de ventre, les lienteries invétérées par çaufe
de relâchement ; 6c ce n eft qu’autant qu’ils annoncent
que les alimens font retenus dans l’eftomac &
dans les inteftins plus qu’ils ne l’étoient auparavant,
fans y être iuffifamment travaillés pour être bien digérés,
enlorte qu’ils commencent à s’y corrompre de
la maniéré à laquelle ils^pnt le plus de difpofition :
ainfi c’eftjuger de la diminution d’un vice par un autre
, mais qui eft moins confidérable, qui- peut être
corrigé plus facilement. G’eft une preuve que la dû
geftion commence à fe faire, mais qu’elle fe fait imparfaitement
• .on en tire une çonfequence a vanta-
geule, dans la fuppofition que cette fonction ne fe
faifoit auparavant prefque pas du-tout. Des rapports
nidoreux ; d’un goût pourri, annoncent la même
choie que les rapports aigres, dans ce cas, lorfqu’ils
viennent après que l’on a mangé de la viande ou d’au-
tres alimens fufceptibles de,putréfaéI,ion.70. Les rapports
d’une qdeui;.lulphureulè ne fuiventpa^dans tous
les fpjets.l’uïage des pié.parations martiales,. çerfont
principalement les hypocondriaques, qui éprouvent
cet effet : d’ajlleurs il ne faut pas toujours les,'attribuer
aux acides ,.puilque le fimple. mélange detlimaill,e de
-fer avec ue l’eau pure , fuffit pqu.r produire,des^xr-
halaifpns,,d.é la même nature.r8°. Pour que les. qxjfa-
laifons.acides. quirfprtent du ,yentricule .Quvert^ûp
animal, prouvaffent quelque çhofe en faveur .au ferjnent
acide, il faudroit.que cette expérience fs. ?$t
F E R 521
dans le tems où ce vifeere eft abfolument vuide d’alimens;
au contraire elle eft alléguée,comme ayant
été faite peu de tems après que l’animal a mangé :
c’eft alors à la nature des alimens qu’il a pris, qu’il
faut attribuer ces vapeurs acides, parce qu’ils étoient
vraiffemblablement fufceptibles de corruption acide.
On n’ignore pas que le lait caillé dans le ventricule
d’un veau, fait un puiffant ferment acide que
l’on employé pourféparer la partie caléeufe des autres
parties du lait ; mais les fermentateurs ne fe font
jamais avifés de dire que l’animal employé pour l’expérience
dont il s’agit ic i, n’eût été nourri que de
viande, parce qu’avec cette condition l’expérience
n’auroit pas fourni le même réfultat.
C’eft ainfi qu’a été détruit par les fondemens l’édifice
du fyftème chimique, quant à la maniéré dont
ils prétendoient expliquer l’oeuvre de la digeftion
dans le ventricule ; mais comme ils ne fe bornoient
pas à établir dans ce vifeere les merveilles de la fermentation
, il faut les fuivre dans le canal inteftinal,
où ils font encore jouer, bien des rôles ,à ce même
principe , pour lui attribuer l’entiere perfeûion du
chyle.
Helmont fuppofant que le chyle a été rendu,acide
par l’effet du ferment de même nature qu’il a établi
dans l’eftomac, faifoit opérer une précipitation.par le:
moyen de cette aciditédu fuc alimentaire, lorfqu’il eft
porté dans les inteftins, 6c d’une forte de qualité de
la bile qui équivaloit à l’alkalinité. Quoiqu’il ne s’en
expliquât pas bien clairement, il lui attribuoit cependant
de contenir beaucoup de fel lixiviel & d’efi
prit huileux. Il penfoit qu’après cette précipitation
le chyle n’avoit plus qu’une falure douce, & plus
convenable au caradere de nos. humeurs en général,
& il fe repréfentoit cette tranfmutation de la maniéré
fuivante. Le concours de ces deux fluides donnant
lieu à leur mélange, ils dévoient s’unir intimement
l’un à l’autre par leurs parties intégrantes, fe
fondre l’un dans l’autre par l’affiniré qui fe trouve
entr’eux; enforte que le fel acide du chyle pénétrant
l’alkali de la hile, devoit exciter une effervefcence ,
une douce fermentation d’où réfultât un tout d’une?
nature différente de ce qu’étoit le double ingrédient
avant le mélange; favoir un fluide falin,,acide, cependant
volatil.
Pour réfuter toutes ces nouvelles idées d’Helmont,
on n’a eu d’abord qu’à nier que le ferment du ventricu-
le.foit acide, & à le prouver ainfi qu’il a été fait ci-devant.
Enfuite on a démontré que la bile dans l’état naturel,
c’eft-à-dire tirée d’un animal fain, n’a fermenté*
n’a produit aucune effervefcence ( pour parler plus
correctement) avec aucune forte d’acide. La chofe à
été.Rentée,de différentes maniérés. Bohri rapporte »
circul. anat. phyf. progymn. x . qu’il a mêlé del’efprit
de vitriol, de celui;de.nitre.,- de celui de,fel, avec
une certaine quantité de bile de boeuf récemment
tirée de fâjfource, fans qu’il y ait jamais appçrçû aucune
marque d’agitation,inteftine; le mélange fe
changeoit feulement en une fubftançe coagulée, de
différente couleur &:d.‘e: différente, confiftençe. Cet
auteur fait même obferver que les acides ne produifent
pas cette coagulation avec toute forte de bile
celle du chien mêlée avec-def’efprit ,de . fel ; ne. fit
que .prendre une couleur, verte ,-fans changer de. confidence.
D ’autres ne conviennent pas qu’il ne fe
faffe point d’effervefcence dans un pareil mélange ;
mais, on a obfervé un [mouvement de cettp; efpece
dans l’eau pure, qui sjéchauffe par l’huii.e de*yitrioI
(Bperh. .ilèin. çJûmr, ij.fi-, ajnffon ne peut tijter-fle-Ià
-aucune, conféquençeppurj’alk^linité d© oy.
;BlLE. ^ l'SOÏll
,'Sylvius fit;queIquesjijVau&ePîPus au,fyftéme de fon
jnaùre :-.il,çrut trou'yer deil'^dité/d^is^le fuc^pan-
.ayant à - g fu -g à la 1»,