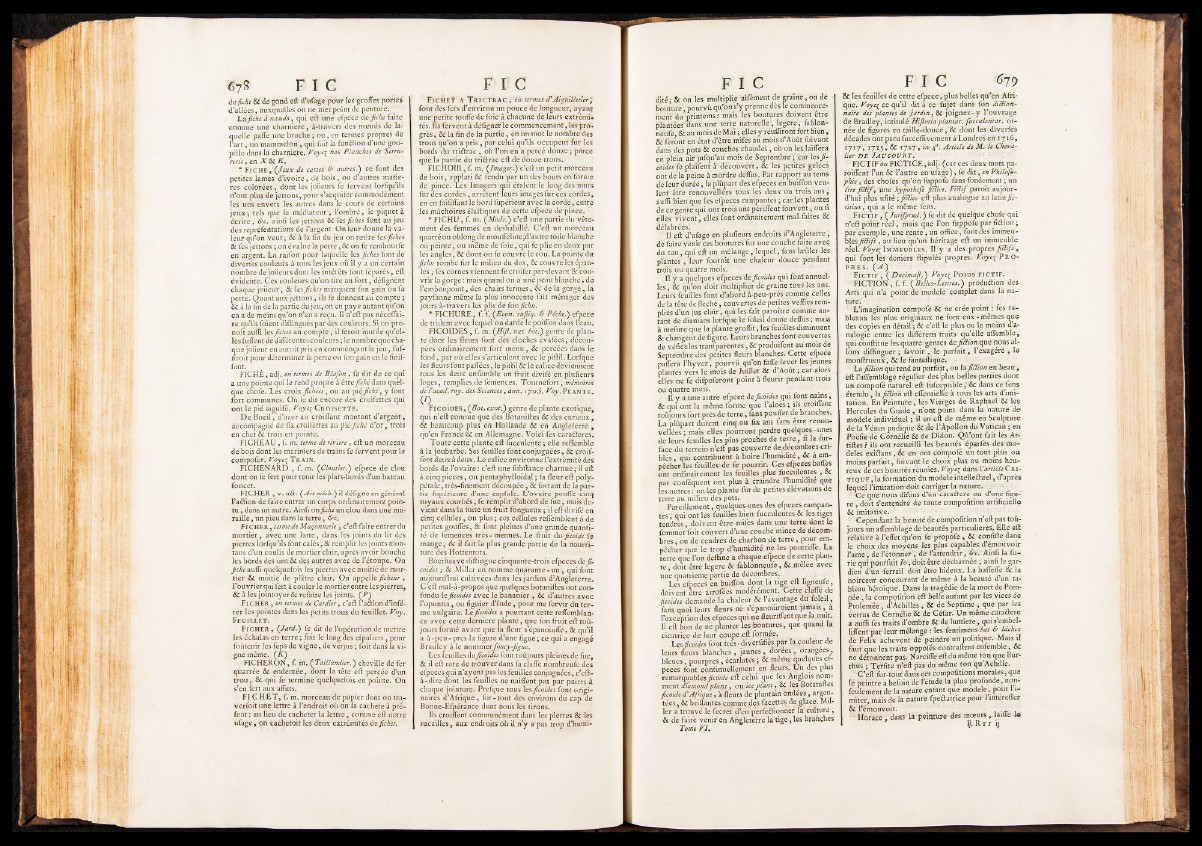
F I C
défiché & d e g o n d è f t d ’ u f a g e p o u r l e S 'g i ’o f f e s p o r t e s
d ’ a l l é e s , a u x q u e l l e s o n n e m e t p o i n t d e p e h t u r e v •
La jîché à nceudi, qui eft lifte èfpëce defâke faite^
comme une 'charnière, à-tràVèrs dés noeuds de laquelle
paffe une broche ; o it, en termes propres de
l’art, un marrtmelon , qui fait la fonftion d’une goupille
dans la charnière. Voye[ nos Planches de Serrurerie,
en X & cK .
* Fich e ', ( Jeux de cartes' & autres.) Ce font des
petites lames d’ivo ire, de bois, ou d’autres matières
colorées, dont les joueurs fe fervent lorfqn’ils
rî’ont plus de jetions j pour s’acquiter commodément
les uns envers les autres dans le cours de Certains
jeux * tels que le médiateur , l’ombre, le piquet à
écrire, &c. aiflfi les jettôns 6c les fiches font ail jeu
dés repréfeiitatiotts dé l’argént. On leur donné la valeur
qu’on veut ; 6c à la fin du jeu on retire fes fiches
& fes jettons ; on évalue la perte, 6c on fe rembourfe
en argent. La raifon pour laquelle lés fiches font de
divérfes couleurs à tous les jeux où il y a un certain
nombre de joueurs dont les intérêts font féparés, eft
évidente. Ces couleurs qu’on tire au fort, déiignent
chaque joiieur, & les fiches marquent fon gain ou fa
perte. Quant aux jettons , ils fe donnent au compte ;
6c à la fin de la partie du jeu, on en paye autant qu’on
en a de moins qii’ori n’en a reçu. Il fi’eft pas néceflài-
re qu’ils foient diftingués par dés couleurs. Si on pre-
noit aufli les fiches aü compte, il fer oit inutile qu’el-'
les fuiTent dé différentes couleurs ; le nombre qiie chaque
joiieur en auroit pris en commençant le jeu , fuf-
firoit pour déterminer fa perte où fon gain en lé finif-
fant.
FICHÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit de ce qui
a une pointe qui le rend propre à être fiché dans quelque
cnofê. Lés croix fichées, où au pié fiché, y font
fort communes. On le dit encore des croifettes qui
o n t le pié aiguifé. Voye% C r o i s e t t e .
De Bueil, d’azur au croiflant montant d’argent,
accompagné de f i x eroifettës àü pié fiché d’o r , trois
en chef ôc trois en pointe;.
FICHE A U , f. M . terme dé riviere, e f t u n m o r c e a u
d e b o i s d o n t l e s m a r in i e r s d e t r a in s f e f e r v e n t p o u r l e
c o m p o f e r . Voye{ T r a i n .
FICHENARD , fi m. ( Cloutier.) efpece de clou
dont on fe fert pour tenir les plats-bords d’un bateau
foncet.
FICHER , v . a£t. ( Art méch.) il défigne en général
l’aftion de faire entrer un corps ordinairement pointu
, dans un autre. Ainfi on fiche un clou dans une muraille
, un pieu dans la terre, &c.
F i c h e r , terme de Maçonnerie, c’eft faire entrer du
mortier, avec une latte, dans les joints du lit dés
pierres lorfqu’ils font calés, & remplir les joints mon-
tans d’un coulis de mortier clair, après avoir bouché
les bords des uns 6c des autres avec de l’étoupe. On
fiche aufli quelquefois les pierres avec moitié de mortier
6c moitié de plâtre clair. On appelle ficheur,
l’ouvrier qui fert à couler le mortier entre les pierres,
6c à les jointoyer 6c refaire les joints. (P )
F i c h e r , en termes de Cardier, c ’ e f t l ’ a & i o n d ’ in f é r
e r l e s p o in t e s d a n s l e s p e t i t s t r o u s d u f e u i l l e t . Voy.
F e u i l l e t .
Fich er , ('Jard.) fe dit de l’opération de mettre
les échalas en terre ; foit le long des efpaliers, pour
fôûtenir lés feps de vigne, de verjus ; foit dans la vi-
gnemêftie. (K )
FICHERON, f. m. ( Taillandier.) cheville de fer
quarréë 6c endentée, dont la tête eft percée d’un
trou, 6c qui fe termine quelquefois en pointe. On
s’en fert aux affûts.
FI G H E T , f. m. morceau de papier dont on tra-
vêrfoit une lettre à l’endroit où on la cacheté à pré-
fent : au lieu de cacheter la lettre, comme eft notre
ufage -, on cachetait lés deux extrémités du fichet.
F I C
F i c f î E f A T r i C T R A C ^èh termes d? Aigiiilletier ",
f o n t d è s f e r s d ’ e n v i r o n u n p o u c e d e l o n g u e u r ; a y a n t
u n e p e t i t e t o u f f e d e f o i e à c h a c u n e d e l e u r s e x t r é m i t
é s . I l s f é r v é n t à d é f i g n e r l e c o m m e n c e m e n t , l e s j j r o .
g r è s , 6 c l a f in d e l a p a r t i e , e n U n m o t l e n o m b r e d e s
t r o u s q ù ’ o r i a p r i s , p a r c e l u i q u ’ i l s o c c u p e n t f u r l e s
b o r d s d u t r i & r a c , où l ’o n e n a p e r c é d o u z e ; p a r c e
q u e l a p a r t i e d u t r i â r a c e f t d e d o u z e t r o u s . -
FICHOIR, f. m. (Imager.yc’eft un petit morceau
de bois, applati 6c fendu par un des bouts en forme
dé pincé; Les Imagers qui étalent le long des murs
fur des cordes, arrêtent lëurs images fur ces cordes^
ert en fâifïffant le bord fùpérieur avec la corde, entre
les mâchoires élaftiques de cette efpecèvdé pince.
* FICHU, f. lii. (Mode.) c’eft une partie du vêtement
des femmes en deshabillé. C ’eft un morceau
quarréou oblong de mouffeline,d’autre toile blanche
Où peinte, ou même de foie, qui fe plie en deux-par
les angles, 6c dont on fe couvre le cou. La pointe du
fichu tombe fur le milieu du dos, 6c couvre les épaules
; fes cornes viennent fe croifer par-devant &' couvrir
la gorge : mais quand on à une peau blanche, de
l’embonpoint, des chairs fermes-, 6c de la gbrge ,'là
payfanne même la plus innocente fait’ ménager des
jours à-travers lés plis de fon fichu.
* FICHURE, f. f. (Econ: rujliq. & Pèche.) efpecd
de trident avec lequel on darde le poiffon dans l’eau.
FICOIDES , f. m. (Hifi. nat. bot.) genre dë plante
dont les fleurs font dés cloches évaféeS, découpées
ordinairement fort menu, 6c percées dans le
fond, par où elles s’articulent avec le piftil. Lorfqué
les fleurs font pafféès, le piftil 6c le calice deviennent
tous les deux ènfemble un fruit divifé en plufieurs
loges, remplies de femences. Tournefort, mémoirei
de Üacad.roy. des Sciences, ann. /yod. Voy. P l a n t e .
■
F i c o ï d e s , (Bot. exot.) genre de plante exotique,'
qui n’eft connue que des Botaniftes 6c des curieux,
6c beaucoup plus en Hollande 6c en Angleterre ,
qu’en France 6c en Allemagne. Voici fes carafteres.
Toute cette plante eft fueculente ; elle reffemble
à la joubarbe. Ses feuilles font conjuguées, 6c croif-
fent deux à deux. Le calice environne l’extrémité des
bords dé l’ovaire : c’eft une fubftance charnue ; il eft
à cinq pièces, Ou pentaphylloïdal ; fa fleur eft poly-
pétale, très-finement découpée, 8ç fortant de la partie
fupérieure d’une capfule. L’ovaire pouffe cinq
tuyaux courbés, fe remplit d?abord de fuc, mais devient
dans la fuite un fruit fongueux ; il eft divifé en
cinq cellules, ou plus; ces cellules reflemblent à de
petites goüfles, 8c font pleines d’une grande quantité
de femences très - menues. Le fruit du fico'ide fe
mange, 6c il fait la plus grande partie de la nourriture
des Hottentots.
Boerhaave diftingue cinquante-trois efpeces de ficoïdes
; 8t Miller en nomme quarante - u n , qui font
aujourd’hui cultivées dans les jardins d’Angleterre.
C ’eft mal-à-propos que quelques botaniftes ont confondu
1 e ficoides avec le bananier , ôc d’autres avec
l’opuntia, ou figuier d’Inde, pour me fervir du terme
vulgaire. Le ficoïdes a pourtant cette reffemblan-
ce avec cette derniere plante, que fon fruit eft toujours
formé avant que fa fleur s’épanoiiiffe, 6c qu’il
a à-peu-près la figure d’une figue; ce qui a engagé
Bradley à le nommer foucy-figue.
Les feuilles du ficoïdes font toûjours pleines de fuc,
8c il eft rare de trouver dans fa claffe nombreufe des
efpeces qui n’ayent pas les feuilles conjuguées, c’eft-
à-dire dont les feuilles ne naiffent pas par paires à
chaque jointure. Prefque tous 1 es ficoïdes font originaires
d’Afrique, fur-tout des environs du cap de
Bonne-Efpérance dont nous les tirons.
I l s c r o i f f e n t c o m m u n ém e n t d a n s l e s p i e r r e s 8 c l e s
r o c a i l l e s , a u x e n d r o i t s o ù i l n ’ y a p a s t r o p d ’h u m i -
F I C dite ; & on les multiplie aifément de graine, ou de -
bouture , pourvu qu’on s’ÿ prenne ;dès le commencement
du printems : mais le? bouturés doivent etre
plantées flans une terre naturelle1, légère , fabjon-
nèufe, 8c aù rriois de Mai ; eJleS y réuflirOnt fort bien,
5c feront eh état d’être mifés au mois d’Âbüt fiuvant
dan? dé? pots 8c coüchès chaudes, oiron les biffera
en plein air jufqu’aù mois de Septembre ;\çar lès f i -
edidedk plaifent à découvert, 6c les petites ^èlée?
ont dé la peine à môrdrè deffus. Par rapport âutems
de lëùr durée, la plupart des efpeces en buiffon veulent
être renouvellees tous les deux ou'trois ans ,
àufli bien que les efpeces rampantes ;'car iés plantes
de ce genre qui .ont trois ans përiffent fouVent j ou fi
ellès vivent, élles:font ordinairement mal faites 6c
délabrées: #
Il eft d’ufage en plufieurs endroits d’Angleterre,
de faire venir ces boirturés fur une couche faite avec
du tan, qui eft un mélange, lequelfans brûler les
plantes , leur fournit une chaleur douce pendant
trois ou quatre mois." "
Il y a quelques efpeces de'ficoïdes qui font annuelles,
6c qU’on doit multiplier de grainé tons les ans.
Leurs feuilles font d’abord à-peu-près comme celles
de là tête de fléché , couvertes de petites veflres remplies
dùin jus clair , qui les fait paroître comme autant
de diamaris lorfque le foleiî donne deffûS'; mais
à mefure que la plante groffit, les feuilles diminuent
6c changent de figuré. Leurs branches font-couvertes
de véficules tranfparentes, 6c produifent au mois de
Septembre de? petites fleurs blanches. Cette efpece
paffera l’hyver, pourvu qu’on faffe lever les jeunes
plantes vers lé mois de Juillet 6c d’Aout ; car alors
elles ne fe difpoferont point à fleurir pendantitrois
ou quatre mois. ‘ '
Il y a une autre efpéee d e ficoïdes qui font nains,
6c qui ont la même forme que l’aloès. ; ils croiffent
toujours fort près de terre, fans pouffer dé branches;
La plûpart durent cinq ou fix ans fans être renou-
vellées ; mais elles pourront perdre quelques-unes
de leurs feuilles les plus proches de terre, fi la fur-
face du terrein n’eft pas couverte de,décombres criblés
, qui contribuent à boire l’humidite , 8c à ent~ ,
pêcher les feuilles de fé pourrir. Ces éfpeees baffes
ont ordinairement les feuilles plus fucCule.ntes , 6c
par conféquent ont plus à craindre 1 humidité que
les autres : on les plante fur de petites élévations de
terre au milieu des pots.
Pareillement, quelques-unes des efpeces rampantes
, qui opt les feuilles bien fucculentes 6c les tiges
tendres, doivent être mifes dans une terre,dont le
fommet foit couvert d’une couche mince de décombres
, ou de cendres de charbon,de terre, pour empêcher
que le trop d’humidite ne les .pourriflè. La
terre que l’on deftine à chaque; elpece de cette plante,
doit être legere & lablonneufè, 6c melee .avec
une quatrième partie de décombres.
Les efpeces en buiffon dont la tige eft ligneufe,
doivent être ârrOféés modérément. Cètte çlaffé de
ficoides demande la chaleur 6c l’avantage dtr foleiî,
fans quoi leurs fleurs né s’ëpanoiuroient jamais, à
l’exception des efpeces qui ne fleuriflent que la nuit.
Il eft bon de ne planter les boutures * que quand la
cicatrice de leur coupe ^eft formée.
Lqsficfiïdes font très -diverfifiés par la çquleur de
leurs fleurs blanchès , jaufies, dorèés”;’ orangées ,
bleues, pourpres, écarlates ; 6c mêriié quelquès efpeces
font continuèllepiéut en fleurs^ p n des plus
remarquables fico'ide èft celui que les Anglois nomment
diamoridplant, ow îctplant, ÔC léS.Botahiftes
ficoide d'Afrique, à fleurs de plantain ondées, argentées
x ,6c brillantes cqjinmè.dçs facettés dé,gla-cè* Miller
a trouvé le fecret d’enpèr féélionner la'culture ,
& de faire venir en Angleterre la’tige ,le s branches
Tome VU
F I C 6 7 9
& les feuilles de cette efpece, plus belles qu’en Afrique.
Voyt^ ce qu’il dit à ce fujet dans5 fon dictionnaire
des plantes de jardin, 6c jo ig n e z -y 'l’Ouvrage
dé Bradley, intitulé Hifioria plantdr. fucculentar. ornée
de figures en taille-douce , 8c dont les diverfes
décade? 'ont paru fucceflïvement à-Londres en 1716,
é j ï j ; 6c t'ji.j-, iri-40. Article de M. le Chevalier
D E JA U C 'O U R T .
FICTIF ou FICTICE,adj: (car ees deux mots pa-
ïoiffent l’un 6c l’autre en Ufage), fé dit -, eh Philojo-
phié , des chofés qu’on fuppede fans fondement ; un
êtrè ficiif , üné hypothefe fiÙice. Fictif paroît au jourd’hui
plus ufité yfixtïce eft plus analogue au latin fic-
titius., qui a le" même fens.
F i c t i f , / Jurifprud. ) fe dit de quelque chofe qui
n’eft poipt reel , mais qué l’on fuppofe par fidion ;
par exemple.,ùnè rente , un office , font dès immeu-
bl'és fictifs ’, au lieu qn’un héritage eft un immeuble
réel'.' Voyei Im m e u b l e s . Il y a des propres fictifs,
: qui font lès deniers ftipulés propres. VoyejP R O -
PRE'si ( A )
F i c t i f , (Doci/hafi.) P o i d s f i c t i f .
•‘ •-FiqTION , f.' f ; ; 'ÇBfliesrLettrcs. ) ' produâion des
Arts qui ri’a point dé modelé complet dans la natures
\ .
L’imagination compofe 6c ne crée point : fes tableaux
les plüs originaux ne-font eux - mêmes que
des copies en détail ; 6c c’eft le plus ou le moins d a-
rialôgie ientre les différens traits qu’elle àffemble,’
qüi'conftitue lès quatre genres de fiction qué nous allons
diftinguer ; favoir , le parfait, l’exagéré , le
mohftruèüx, 6c le fantaftiqüe.
La fiction qui tend au parfait, oU \z. fiction en beau ,
èft l’affemblagè régülièr des 'plus belles parties- dont
un compofé naturel eft füfceptible'6c dans ce fens
étendu j la fictiorï^eft effentielle’ à -tous’l'es'ar.ts d’imitation.
En Peinture jrlê? Vierges de Raphaël 6c les
Hercules du Guide , n’ont point dans la nature de
modèle individuel^ il en eft de même en Sculpture
de la Vénus pudique 6c ’de pApollon du Vâticatl ; en
Poëfiëflé Cornélië 6ç de Didon. Qu’ont fait lès Ar-
tiftes?.ils ont recueilli les beautés ép^rfes des modèles
ëxiftans, .& en-ôilt (ài'mpofé Un tout .plüs ou
hioins parfait, fuivantlé1 choix plus pu moins heureux
de ces beautés.féùnie'sV Voye^ dans l’ârric'/e C r i t
i q u e , la formàtio'n du-modele intelleétUel, d’après
lequel l’imitation' doit corriger la nature.
• Ce que poiis diforis ^’un càraétere ou d’une figure
, doit s’entendre do toute compofition artificielle
8c imitative. , , . -
Cependant la, beauté de compofition n’eft pas toûjours
un affemblagé de beautés particulières. Elle eft
fela’tive à l’effet qu’ôn fé propofe , 6c confifte dans
le choix .des pioyens les plus capables d’émouvoir
Paine, de l’étpnnër , de1 l’attendrir, &c. Ainfi la furie
qui pourfuit /ô'î'doit être décharnée ; ainfi le gardien
d’un ferrai! doit être hideux. La baffeffe 6c la
noirceur concourentfle même à la beauté d’un tableau
héroïque. Dans la tragédie de la mort de Pompée
I la compofition eft belle autant par-les'vices de
Ptoleméë , d’Âchillàs , 6c de Septime , que par les
YertUs de Corhéliè 6c de Céfar. Un meme caraftere
a aufli fes traits d’ombre 6c de lumiere , qui s’embel-
ljffent par leur mélange : lesfentimens & lâches
dè Félix achèvent dè peindre un politique. Mais il
faut qüe les traits oppôfés contraftent enfemble, 6c
ne détonnent pàs. Nàrciffe eft du meme ton que Bur-
rhus ’; Terfite n’eft pas du même ton qu’Achille.
: C ’efl ïur-toUt dans çës compofitions morales, que
fé peintre a befoin fle l’étude la plus profonde, non-
feulement de la nature entant que modèle, pour l’i-
mïter, mais de la nature fpe&atrice pour-Piiiterefler
ÔC'ljëmQüvoir. " ' . >/r-. . ;
Horace , dans la peinture- des moeurs , lailie ie
Ç -R r r i*