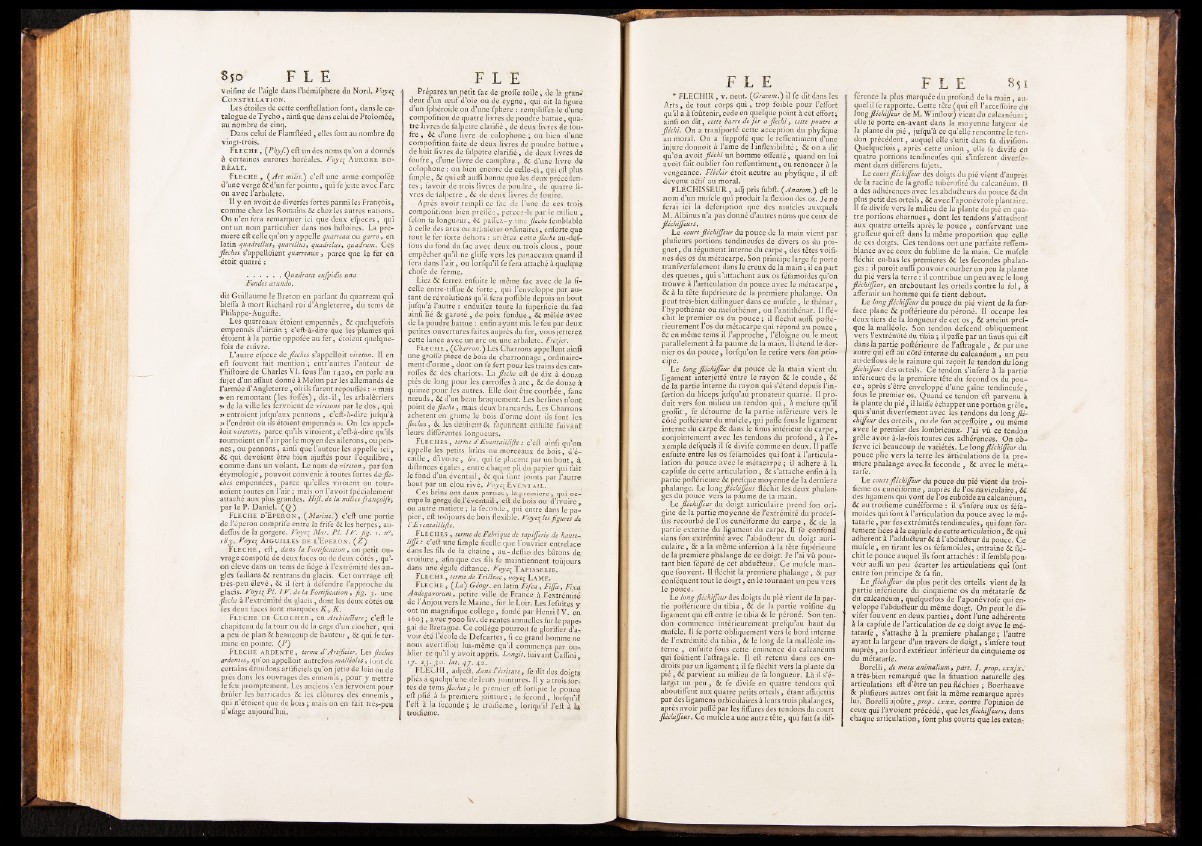
voifine de l’aigle dans l’hémifphere du Nord. Foye^
C o n s t e l l a t i o n .
Les étoiles de cette conftellation font, dans le catalogue
de T y ch o , ainfi que dans celui de Ptolomée,
au nombre de cinq.
Dans celui de FÎamftéed, elles font au nombre de
vingt-trois.
F l é c h é , (Phyfi) e f t u n d e s n o m s q u ’ o n a d o n n é s
à c e r t a in e s a u r o r e s b o r é a l e s . Foye^ A u r o r e b o r
é a l e .
F l é c h é , (A r t milit.) c’eft une arme compofée
d ’une verge 8c d’un fer pointu, qui fe jette avec l’arc
ou. avec l’arbalete.
Il y en avoit de diverfes fortes parmi les François,
comme chez les Romains & chez les autres nations.
O n n’en fera remarquer ici que deux efpeces, qui
ont un nom particulier dans nos hiftoires. La première
eft celle qu’on y appelle quarreau ou ga.no, en
latin quadrdlus, quardlus, quadrilus, quadrum. CeS
léchés s’appelloient quarreaux, parce que le fer en
étoit quarrë :
................ Quadratce oufpidis una
■ Fendet arundo.
dit Guillaume le Breton en parlant du quarreau qui
bleffa à mort Richard roi d’Angleterre, du tems de
Philippe-Augufte.
Les quarreaux étoient empennés, 8c quelquefois
empennés d’airain ; c’eft-à-dire que les plumes qui
étoient à la partie oppofée au fer , étoient quelquefois
de cuivre.
L ’autre elpece de fléchés s’appelloit virtton. Il en
eft fouvent fait mention ; entr’autres l’auteur de
l ’hiftoire de Charles VI. fous l’an 1420, en parle au
fujet d’un affaut donné à Melun par les allemands de
i’armée d’Angleterre, où ils furent repouffés : « mais
» en remontant fies foffés), d it- il, les arbalétriers
» de la v ille les fervoient de virttons par le dos, qui
» entroient jufqu’aux pennons , c’eft-à-dire jufqu’à
l’endroit où ils étoient empennés ». On les appel-
loit virttons, parce qu’ils viroient, c’eft-à-dire qu’ils
tournoient en l’air par le moyen des ailerons, ou pennes
, ou pennons, ainfi que l’auteur les appelle i c i ,
& qui dévoient être bien ajuftés pour l’équilibre,
comme dans un volant. Le nom de virtton, par fon
étymologie, pouvoit convenir à toutes fortes de f i e -
ches empennées, parce qu’elles viroient ou tournoient
toutes en l’air ; mais on l’avoit fpécialement
attaché aux plus grandes. Hifi. de la milice françoife;
par le P. Daniel. (Q )
F l é c h é d ’E p e r o n , (Marine.') c ’ e f t u n e p a r t i e
d e l ’ é p e r o n c o m p r i f e e n t r e l a f r i f e & l e s h e r p e s , a u -
d e f f u s de l a g o r g e r e . Foye^ Mar. PI. I F . fig. /. n°.
183 . Foyt[ A i g u i l l e s d e l ’E p e r o n . ( Z )
F l é c h é , e ft, dans la Fortification, un petit ouvrage
compofé de deux faces ou de deux côtés, qu’on
éleve dans un tems de fiége à l’extrémité des angles
faillans 8c rentrans du glacis. Cet ouvrage eft
très-peu é lev é, 8c il fert à défendre l’approche du
glacis. F 7y t[ PI. I F . de la Fortification , fig. 3 . une
fitche à l’extrémité du glacis, dont les deux côtés ou
l e s deux faces font marquées K , K .
F l é c h é d e C l o c h e r , -en Architecture; c’eft le
chapi.teau de la tour ou de la cage d’un clocher, qui
a peu de plan & beaucoup de hauteur, 8c qui fe termine
en pointe. (P )
Fléché a r d e n t e , terme d'Artificier. Les fléchés
ardentes, qu’on appelloit autrefois malléoles, font de
certains droudons artificiels qu’on jette de loin ou de
près dans les ouvrages des ennemis, pour y mettre
lé feu promptement. Les anciens s’en f ervoient pour
brûler les barricades 8c les clôtures des ennemis ,
qui n’étoieht que de bois ; mais on en fait très-peu
.d’ufage aujourd’hui.
Préparez un petit fac de groffe toile, de là grandeur
d’un oeuf d’oie ou de cygne, qui ait la figure
d’un fphéroïde ou d’une fphere : rempliffez-le d’une
compofition de quatre livres de poudre battue, quatre
livres de falpetre clarifié , de deux livres de fou-
fre , 8c d’une livre de colophone ; ou bien d’une
compofition faite de deux livres de poudre battue >
de huit livres de falpetre clarifié, de deux livres de
fouffe, d’une livre de camphre , 8c d’une livre de
colophone : on bien encore de celle-ci, qui eft plus
fimple, 8c qui eft aufïi bonne que les deux précédentes
; lavoir de trois livres de poudre , de quatre livres
de falpetre , 8c de deux livres de foufre.
Après avoir rempli ce fac de l’une de ces trois
compofitions bien preffée, percez-le par le milieu ,
félon la longueur, 8c paffez-y une fléché femblable
à celle.des arcs ou arbalètes ordinaires, enforte que
tout le fer forte dehors : arrêtez cette fléché au-def-
fous du fond du fac avec deux ou trois clous, pour,
empêcher qu’il ne gliffe vers les panaceaux quand i!
fera dans l’air, ou lorfqu’il fe fera attaché à quelque,
chofe de ferme.
Liez 8c ferrez enfuite le même fac avec de la ficelle
entre-tiflùe 8c forte, qui l’enveloppe par autant
de révolutions qu’il fera poflible depuis un bout
jufqu’à l’autre : enduifez toute la fuperficie du faG
ainfi lié & garoté , de poix fondue, 8c mêlée avec
de la poudre battue : enfin ayant mis le feu par deux
petites ouvertures faites auprès du fer, vous jetterez
cette lance avec un arc ou une arbalète. Frefier,
Fléché , (Charron.) Les Charrons appellent ainfi
une grolfe piece de bois de charronnage , ordinairement
d’orme, dont on fe fert pour les trains des car-
roffes & des chariots. La fléché eft de dix à douze,
pies de long pour les carroffes à arc, 8c de douze à
quinze pour les autres. Elle doit être courbée, fans
noeuds, 8c d’un beau braquement. Les berlines n’ont
point de fléché, mais deux brancards. Les Charrons
achètent en grume le bois d’orme dont ils font le*
fléchés, & les débitent & façonnent enfuite fuivant
leurs différentes longueurs.
Fléchés, terme d’Eventaillifle : c’eft ainfi qu’on
appelle les petits brins ou morceaux de bois, d’é-
caille, d’ivoire, &c. qui fe placent par un bout, à
difiances égalés , entre chaque pli du papier qui fait
le. fond d’un éventail, 8c qui iont joints par l’autre
bout par un clou rivé. Foye^ Ev e n t a il .
Ces brins pnt deux parties ; la première, qui occupe
la gorgé de l’éventai.1, eft de bois ou d’ivoire ,
ou autre matière ; la fécondé, qui entre dans le papier
, eft toûjours de bois flexible. Foye^ les figures de.
l 'Eventaillifle.
FLECHES , terme de Fabrique de tapijferie de haute-
lififie : c’eft une fimple ficelle que l’ouvrier entrelace
dans les fils de la chaîne , au-deffus des bâtons de;
croifure , afin que ces, fils fe maintiennent toûjours
dans une égale diftance. Foye^ Tapisserie.
Fléché , terme de Trictrac , voye^ Lame.
Fléché , (L a ) Géogr. en latin F ifca , Fiffa, F ixa
Andegavorum, petite ville de France à l’extrémité
de l’Anjou vers le Maine, fur le Loir. Les Jefuites y
ont un magnifique college, fondé par Henri IV. en
1603 , avec 7000 liv. de rentes annuelles fur le pape-
gai de Bretagne. Ce collège pourroit fe glorifier d’avoir
été l’école de Defcartes, fi ce grand homme ne
nous avertiffoit lui-même qu’il commença par oublier
ce qu’il y avoit appris. Longit. fuivant Caflïni,
'7- 23 -.3 ° - lat. ^y. 42.
FLECHI, adjett. dans C écriture , fe dit des doigts
pliés à quelqu’une de leurs jointures. II y a trois fortes
de tems fléchis ; Je premier eft lorfque le pouce
eft plié à fa première jointure ; le fécond , lorfqu’il
l’eft à la fécondé ; le troffieme, lorfqu’il i’eft à la
troifîeme.
* FLECHIR, v . Uetit. (Gramm.) U fe dit dans les
A r ts , de tout corps q u i, trop foible poiir l’effort’
qu’il a à foûtenir, cede en quelque point à cet effort;
ainfi on dit, cette barre de fer a fléchi , cette poutre a
fléchi. On a tranfporté cette acception du phyfique
au moral. On a fuppôfé que le reffentiment d’une
injure donnoit à l’ame de 1 inflexibilité ; & on a dit
qu’on avoit fléchi un homme offenfé, quand on lui
avoit fait oublier fon reffentiment, ou renoncer à la
vengeance. Fléchir étoit neutre au phyfique, il eft
devenu aftif au moral.
FLÉCHISSEUR, adj pris fubft. (Anatom!) eft le
nom d’un mufcle qui produit la flexion des os. Je ne
ferai ici la defcription que des mufcles auxquels
M. Albinus n’a pas donné d’autres noms que ceux de
fléchifleurs.
Le court fléchifleur du pouce de la main vient par
plufieurs portions tendineufes de divers os du poignet
, du tégument interne du carpe, des têtes voifi-
nés des os du métacarpe. Son principe large fe porte
tranfverfalement dans le creux de la main ; il en part
des queues, qui s ’attachent aux os féfamoïdes qu’on
trouve à l’articulation du pouce avec le métacarpe,
& à la tête fupérieure de la première phalange. On
peut très-bien diftinguer dans ce mufcle , le thénar,
ï ’hypothénar ou melothénar, ou l’antithénar. Il fié-'
chit le premier os du pouce ; il fléchit aufli pofté-
rieurement l’os du métacarpe qui répond au pouce,
& en même tems il l’approche, l’eloigne ou le meut
parallèlement à la paume de la main. Il étend le dernier
os du pouce, lorfqu’on le retire vers fon principe.
Le long fléchifleur du pouce de la main vient du
ligament interjette entre le rayon 8c le coude, 8c
de la partie interne du rayon qui s’étend depuis l’in-
fertion du biceps jufqu’au pronateur quarré. Il produit
vers fon milieu un tendon q u i, à mefure qu’il
grofîit, fe détourne de la partie inférieure vers le
côté poftérieur du mufcle, qui paffe fous le ligament
interne du carpe 8c dans le finus intérieur du carpe,
conjointement avec les tendons du profond, à l’exemple
defquels il fe divife comme en deux. Il paffe
enfuite entre les os féfamoïdes qui font à l’articula-
lation du pouce avec le métacarpe ; il adhéré à la
capfule de cette articulation, 8c s’attache enfin à la
partie poftérieure 8c prefque moyenne de la derniere
phalange. Le long fléchifleur flécHÈpes deux phalanges
du pouce vers la paume de la main.
Le fléchifleur du doigt auriculaire prend fon origine
de la partie moyenne de l’extrémité du procef-
fus recourbé de l’os cunéiforme du carpe , & de la
partie externe du ligament du carpe. Il fe confond
dans fon extrémité avec l’abdufteur du doigt auriculaire,
& a la même infertion à la tête fupérieure
de la première phalange de ce doigt. Je l’ai vû pourtant
bien féparé de cet abdufteur. Ce mufcle manque
fouvent. Il fléchit la première phalange, & par
conféquent tout le doigt, en le tournant un peu vers
le pouce.
Le long fléchifleur des doigts du pié vient de la partie
poftérieure du tibia , 8c de la partie voifine du
ligament qui eft entre le tibia & le péroné. Son tendon
commence intérieurement prefqu’au haut du
mufcle. Il fe porte obliquement vers lè bord interne
de l’extrémité du tibia, & le long de la malléole interne
, enfuite fous cette éminence du calcanéum
qui foûtient l’aftragale. Il eft retenu dans ces endroits
par un ligament ; il fe fléchit vers la plante du
p ie , 8c parvient au milieu de fa longueur. Là il s’élargit
un peu , & fe divife en quatre tendons qui
aboutiffent aux quatre petits orteils, étant affujettis
par des ligamens orbiculaires à leurs trois phalanges,
après avoir paffé par les fiffures des tendons du court
fléchifleur. Ce mufcle aune autre tête, qui fait fa différenCe
la plus Marquée du profond de la main , auquel
il fe rapporte. Cette tête (qui eft l’acceffoire du
long fléchifleur de M. Wïnflow) vient du calcanéum ;
elle lè porte en-avant dans la moyenne largeur de
la plante du pié , jufqu’à ce qu’elle rencontre le tendon
précédent, auquel elle s’unit dans fa divifion.
Quelquefois, après cette union , elle fe divife en
quatre portions tendineufes qui s’inferent diverfe-
ment dans différens fujets.
Le court fléchifleur des doigts du pié vient d’auprès
de la racine de la groffe tubérofité du calcanéum. Il
a des adhérences avec les abdu&eurs du pouce 8c du
plus petit des orteils, & avec l’aponévrole plantaire.
Il fe divife vers le milieu de la plante du pié en quatre
portions charnues, dont les tendons s’attachent
aux quatre orteils après le pouce , confervant Une
groffeur qui eft dans la même proportion que celle
de ces doigts. Ces tendons ont une parfaite reffem*
Mance avec ceux du fublime de la main. Ce mufcle
fléchit en-bas les premières S c les fécondés phalan*
ges : il paroît aufli pouvoir courber un peu la plante
du pié vers la terre : il contribue un peu avec le long
fléchifleur, en arcboutant les orteils contre le fo l, à
affermir un homme qui fe tient debout.
Le long fléchifleur du pouce du pié vient de la fur*
face plane & poftérieure du péroné. Il occupe les
deux tiers de la longueur de cet o s , & atteint prefque
la malléole. Son tendon defcend obliquement
vers l’extrémité du tibia ; il paffe par un finus qui eft:
dans la partie poftérieure de l’aftragale , & par une
autre qui eft au côté interne du calcanéum, un peu
au-deffous delà rainure qui reçoit le tendon du l o n g
fléchifleur des orteils. Ce tendon s’infere à la partie
inférieure de la première tête du fécond Os du pouce
, apres s’être enveloppé d’une gaine tendineufe,
fous le premier os. Quand ce tendon eft parvenu à
la plante du p ié, il laiffe échapper une portion grêle ,
qui s’unit diversement avec les tendons du long fié*
chifleur des orteils, ou de fon acceffoire , ou même
avec le premier des lombricaux. J’ai vû ce tendon
grêle avoir à-la-fois toutes ces adhérences. On ob-
lerve ici beaucoup de variétés. Le long fléchifleur du
pouce plie vers la terre les articulations de la première
phalange avecda fécondé , 8c avec le méta*
tarfe.
Le court fléchifleur du pouce du pié vient du ïroi*
fieme os cunéiforme, auprès de l’os naviculaire, & c
des ligamens qui vont de l’os cuboïde au calcanéum,
8c au troifieme cunéiforme : il s’infere aux os féfamoïdes
qui font à l’articulation du pouce avec le mé-
tatarfe, par fes extrémités tendineufes, qui f o n t fortement
liées à la capfule de cette articulation, 8c qui
adhèrent à l’addu&eur 8c à l’abdu&eur du pouce. Ce
mufcle en tirant les os féfamoïdes, entraîne 8c fléchit
le pouce auquel ils font attachés : il femble pou*
voir aufli un peu écarter les articulations qui font
entre fon principe & fa fin.
Le fléchifleur du plus petit des orteils vient de la
partie inférieure du cinquième os du métatarfe 8c
du calcanéum, quelquefois de l’aponévrofe qui enveloppe
l’abdu&eur du même doigt. On peut le di-
vifer fouvent en deux parties, dont l’une adhérente
à la capfule de l’articulation de ce doigt avec le métatarfe
, s’attache à la première phalange ; l’autre
ayant la largeur d’un travers de doigt, s’infere tout
auprès, au bord extérieur inférieur du cinquième os
du métatarfe.
Borelli, de motu animalium, part. I . prop. cx x jx é
a très-bien remarqué que la fituation naturelle des
articulations eft d’être un peu fléchies ; Boerhaave
& plufieurs'autres ont fait la même remarque après
lui. Borelli ajoûte, prop. c x x x . contre l’opinion de
ceux qui l’avoient précédé, que les fléchifleurs, dans
chaque articulation, font plus courts que les extern«