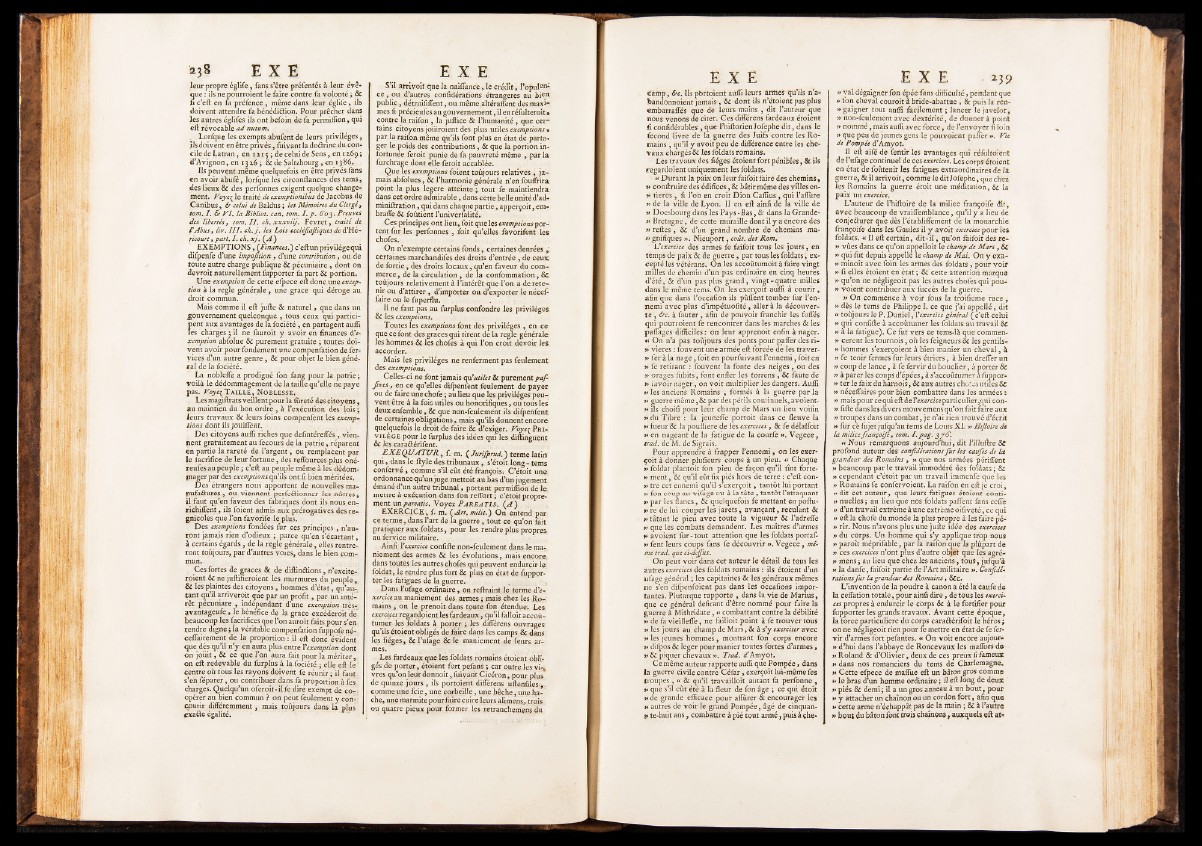
leur propre églife, fans s’être préfentés à leur évêque
: ils ne pourroient le faire contre fa volonté ; ôc
U c’eft en fa préfence , même dans leur églife, ils
.doivent attendre fa bénédi&ion. Pour prêcher dans
les autres églifes ils ont befoin de fa permiffion, qui
eft révocable ad nutum.
| Lorfque les exempts abufent de leurs privilèges,
ils doivent en être privés, fuivant la doétrine du concile
de Latran, en 121 ç ; de celui de Sens, en 1269 ;
d’Avignon, en 13 26 ; & de Saltzbourg, en 13 86.
Ils peuvent même quelquefois en être privés fans
en avoir abufé, lorfque les circonftances des tems,
ides lieux ôc des perlonnes exigent quelque changement.
Voyt^ le traité de exemptionibus de Jacobus de
Canibus, & celui de Baldus ; les Mémoires du Clergé,
tom. I. 6* VI. la Bibliot. can. tom. I. p. 603. Preuves
des libertés y tom. I I . ch.xxxviij. Fevret, traité de.
VAbus y liv. I I I . ch .j. les Lois eccléjiaftiques de d’Hé-
ricourt y part. I . ch. x j. (A )
EXEMPTIONS, (Finances.") c’eft un privilégequi
difpenfe d’une impojition , d’une contribution, ou de
toute autre charge publique ôc pécuniaire , dont on
devroit naturellement fupporter fa part ôc portion.
Une exemption de cette elpece eft donc une exception
à la réglé générale, une grâce qui déroge au
droit commun.
Mais comme il eft jufte & naturel f que dans un
gouvernement quelconque , tous ceux qui particiÎ
>ent aux avantages de la fociété, en partagent auffi
es charges ; il ne fauroit ÿ avoir en finances dV
xemptionabfolue ôc purement gratuite ; toutes, doivent
avoir pour fondement une compenfation de fer-
vices d’un autre genre, & pour objet le bien génér
ral de la fociété.
La noblefle a prodigué fon fang pour la patrie ;
voilà le dédommagement de la taille qu’elle ne paye
p a s . Voye^T a i l l e , N o b l e s s e .
Les magiftrats veillent pour la fûreté des citoy ens,
au maintien du bon ordre , à l’exécution des lois;
leurs travaux ôc leurs foins compenfent les exemptions
dont ils jouiffent.
Des citoyens auffi riches que defintérefles , viennent
gratüitement au fecours de la patrie, réparent
en partie la rareté de l’argent, ou remplacent par
le facrifice.de leur fortune, des reflources plus pné-
reufes au peuple ; c’eft au peuple même à les dédom-
piagerpar des exemptions qu’ils ont.fi bien méritées.
Dès étrangers nous apportent de nouvelles manufactures
, ou viennent perfectionner les nôtres;
il faut qu’en faveur des fabriques dont ils nous en-
richiffent, ils foient admis aux prérogatives des re-
gnicoles que l’on favorife le_plus.
Des exemptions fondées fur ces principes , n’au-,
ront jamais rien d’odieux ; parce qu’en s’écartant,
à certains égards, de la réglé générale, elles rentre-,
ront toujours, par d’autres voies,_ dans le bien commun.
Ces fortes de grâces & de diftinCtions, n’excite-’
roient & ne juftifieroient les murmures du peuple
& les plaintes des citoyens, hommes d’état, qu’aux
tant qu’il arriveroit que par un profit, par un intérêt
pécuniare , indépendant d’une exemption très*
avantageufe, le bénéfice de la grâce excéderoit de"
beaucoup les facrifices que l’on auroit faits, pour s’en
fendre digne ; la véritable compenfation fuppofe pe-
ceffairement de la proportion : il eft donc évident
que dès qu’il n’y en aura plus entre Vexemption dont
on joiiit, & ce que l’on aura fait pour la mériter,,
on eft redevable du furplus à la fociété ; elle eft le ‘
centre oit tous les rayons doivent fe réunir ; il faut
s’eh féparer, ou contribuer dans fa proportion à fes:'
charges. Quelqu’un oferoit - il le dire exempt de cor :
opérer au bien commun ? on peut feulement y coiif •
cpurir différemment, mais toujours dans la plus
exaCte égalité.
S’il arrivoit que là naiffance, le crédit, I’opuleU“
c e , ou d’autres confédérations étrangères au bien
public, détruififfent, ou même.altéraffent des maxi“
mes fi préeieufes au gouvernement, il en réfulteroit »
contre la raifon, la juftice & l’humanité, que certains
citoyens joiiiroient des plus utiles exemptions ,
par la raifon même qii’ils font plus en état de partager
le poids des contributions, & que la portion infortunée
feroit punie de fa pauvreté même , par la
furchrage dont elle feroit accablée.
Que les exemptions foient toûjours relatives , jamais
abfolues, & l’harmonie générale n’en fouffrira
point la plus legere atteinte ; tout fe maintiendra
dans cet ordre admirable, dans cette belle unité d’ad-
miniftration, qui dans chaque partie, apperçoit, em-
braffe ôc foûtient l’univerfalité.
Ces principes ont lieu, foit que les exemptions portent
fur les pçrfonnes , foit qu’elles favorifent les
chofes.
On n’exempte certains fonds, certaines denrées
certaines marchandifes des droits d’entrée , de ceux
de fortie, des droits locaux, qu’en faveur du commerce,
de la circulation, de la confommation, ôc
toûjours relativement à l ’intérêt que l’on a de retenir
ou d’attirer, d’importer ou d’exporter le nécefi
faire ou le fuperflu.
Il né faut pas au furplus confondre les privilèges ÔC fes exemptions.
Toutes les exemptions font des privilèges , en ce
que ce font des grâces qui tirent de la réglé générale
les hommes ÔC les chofes à qui l’on croit devoir les
accorder.
Mais les privilèges ne renferment pas feulement
des exemptions.
Celles-ci ne font jamais qu’«//Zw & purement paf-
fives, en ce qu’elles difpenl'ent feulement de payer
ou de faire une chofe ; au lieu que les privilèges peuvent
être à la fois utiles ou honorifiques, ou tous les
deux enfemble, ôc que non-feulement ils difpenfent
de certaines obligations, mais qu’ils donnent encore
quelquefois le droit de faire ôc d’exiger. Voye^ Privilège
pour le furplus des idées qui les diftinguent
ôc les caraétérifent.
E X E Q U A T U R , f. m. ( Jurifprud. ) terme latin
qui, dans le ftyle des tribunaux, s’étoit long - tems
confervé , comme s’il eût été françois; C ’étoit une
ordonnance qu’un juge mettoit au bas d’ün jugement
émané'd’un autre tribunal, portant permiffion de le.
mettre à exécution dans fon reffort ; c’étoit proprement
un pareatis. Voyez P ARE ATI S. ( A ) ,
EXERCICE, f. m. (Art, milit.) On entend par
ce terme, dans l’art de la guerre, tout ce qu’on fait
pratiquer ;aux: foldats, pour les rendre plus propres,
au fervice militaire.
Ainfi l'exercice confifte non-feulement dans le maniement
des armes ôc les évolutions, mais .encore,,
dans toutes les autres chofes qui peuvent endurcir le
foldatj le rendre plus fort ôc plus en état de fupporter
les fatigues de la guerre.
Dans Fufage ordinaire, on reftraint le terme d’exercice
au maniement des: armes ; mais chez les -Ror-
mains,,,on le prenoit dans toute fon étenduei, Les
exercices regardoient les fardeaux, qu’il falloir accoutumer.
les foldats à porter * les ftifférens ouvrages
qu’ils étoient obligés de faire dans les camps & dans
les fiéges, ôc l ’ufage ôc le maniement de leurs armes.
'
j Les fardeaux que les foldats romains étoient obliges
de porter, étoient fort pefans ; car outre les vi-*
vres qu’on leur donnoit, fuivant C icéron, pour plps
de quinze jours , ils portoient différens uftenfiles ,
comme une feie, une corbeille, une bêche, une.hache,
une marmite pour faire cuire leurs alimens,trois
ou quatre pieux pour former les retranchemens du
ëamp, (te. Ils pbrtoient auffi leurs armes qu’ils n’a-
bandonnoient jamais, ôc dont ils n’étoient pas plus
«mbarraffés que de leurs mains , dit l’auteur que
nous venons de citer. Ces différens fardeaux étoient
fi confidérables , que l’hiftorien Jofephe d it, dans le
fécond livre de la guerre des Juifs contre les Romains
, qu’il y avoit peu de différence entre les chevaux
chargés & les foldats romains.
Les travaux des fiéges étoient fort pénibles, & ils
regardoient uniquement les foldats.
** Durant la paix on leur faifoit faire des chemins »
» conftruire des édifices, & bâtir même des villes en-
■ » tierés j fi l’on en croit Dion Caffius, qui l’affûre
*> de la ville de Lyon. Il en eft ainfi de la ville de
» Doesbourg dans les Pays-Bas, & dans la Grandè-
» Bretagne, de cette muraille dont il y a encore des
» reftes , & d’un grand nombre de chemins ma-
*> gnifiques ». Nieuport, coût, des Rom.
L’exercice des armes fe faifoit tous les jours, en
temps de paix & de guerre, par tous les foldats j excepté
les vétérans. On les accoûtumoit à faire vingt
milles de chemin d’un pas ordinaire en cinq heures
d’été, & d’un pas plus grand, vingt-quatre milles
dans le même tems. On les exerçoit auffi à courir,
afin que dans l’occafion ils pûffent tomber fur l’ennemi
avec plus d’impétuofité, aller à la découverte
, (te. à fauter, afin de pouvoir franchir les fofles
qui pourroient fe rencontrer dans les marches & les
paffages difficiles : on leur apprenoit enfin à nager.
« On n’a pas toûjours des ponts pour paffer des ri-
» vieres : louvent une armée eft forcée de les traver-
» fer à la nage, foit en pourfuivant l’ennemi, foit en
» fe retirant : fouvent la fonte des neiges, ou des
» orages fubits, font enfler les torrens , & faute de
» lavoir nager, on voit multiplier les dangers. Auffi
*> les anciens Romains , formés à la guerre par la
» guerre même, & par des périls continuels, avoient-
>> ils choifi pour leur.champ de Mars un lieu voifin
» du Tibre : la jeuneffe portoit dans ce fleuve la
» fueur & la pouffiere de les exercices , 8c fe délaffoit
» en nageant de la fatigue de la courfe ». Vegece,
trad. de M. deSigrais.
Pour apprendre à frapper l’ennemi, on les exerçoit
à donner plufieurs coups à un pieu. « Chaqûe
» foldat plantoit fon pieu de façon qu’il tînt forte-
» ment, & qu’il eût fix piés hors de terre : c’eft con-
» tre cet ennemi qu’il s’exerçoit , tantôt lui portant
» fon coup au vifage ou à la tê te , tantôt l’attaquant
» par les flancs, & quelquefois fe mettant en poftu-
» re de lui couper les jarets, avançant, reculant &
» tâtant le pieu avec toute la vigueur & l’adreffe
» que les combats demandent. Les maîtres d’armes
» avoient fur - tout attention que les foldats portaf-
» fent leurs coups fans fe découvrir ». Vegece, meme
trad. que ci-dejjus.
On peut voir dans cet auteur le détail de tous les
autres exercices des foldats romains : ils étoient d’un
iilage général ; les capitaines & les généraux mêmes
ne s’en difpenfoient pas dans les occafions importantes.
Plutarque rapporte , dans la vie de Marais,
que ce général defirant d’être nommé pour faire la
guerre à Mithridate, « combattant contre la débilité
» de fa vieillefle, ne failloit point à fe trouver tous
» les jours au champ de Mars , & à s’y exerciter avec
» les jeunes hommes, montrant fon corps encore
» difpos & leger pour manier toutes fortes d’armes ,
» & piquer chevaux ». Trad. rf’Amyot.
Ce même auteur rapporte auffi que Pompée, dans
la guerre civile contre Céfar, exerçoit lui-même fes
troupes , « & qu’il travailloit autant fa perfonne ,
» que s’il eût été à la fleur de fon âge ; ce qui étoit
» de grande efficace pour affûrer & encourager les
» autres de voir le grand Pompée, âgé de cinquan-
» te-huit ans, combattre à pié tout armé, puis à çhe-
» val dégaignêr fon épée fans difficulté > pendant que
» fon cheval couroit à bride-abattue, & puis la ren-
» gaigner tout auffi facilement ; lancer le javelot^
» non-feulement avec dextérité, de donner à point
» nommé, mais auffi avec force, de l’envoyer fi loin
» que peu de jeunes gens le pouvoient paflfer ». Vie
de Pompée d’Amyot.
Il eft aifé de fentir les avantages qui réfultôient
de l’ufage continuel de ces exercices. Les corps étoient
en état de foûtenir les fatigues extraordinaires de la
guerre* & il arrivoit, comme le dit Jofephe, que chez
les Romains la guerre étoit une méditation, & la
paix un exercice.
L’auteur de l’hiftoirê de ïa milice françoife dit,
avec beaucoup de vraiflemblance, qu’il y a lieu de
conjecturer que dès l ’établiffement de la monarchie
françoife dans les Gaules il y avoit exercice pour les
foldats. « Il eft certain, d it- il, qu’on faifoit des re-
» vûes dans ce qu’on appelloit le champ de Mars, &
» qui fut depuis appelle le champ de Mai. On y exa-
» minoit avec foin les armes des foldats, pour voir
» fi elles étoient en état ; & cette attention marque
» qu’on ne négligeoit pas les autres chofes qui pou*
» voient contribuer aux fuccès de la guerre^
» On commence à voir fous la troifieme ra c e ,
» dès le tems de Philippe I. ce que j’ai appellé, dit
« toûjours le P. Daniel, [’exercice général ( c ’eft celui
» qui confifte à accoutumer les foldats au travail ôc
» à la fatigue). Ce fut vers ce tems-là que commen-
» cerent les tournois, oii les feigneurs & les gentils-
» hommes s’exerçoient à bien manier un cheval, à
» fe tenir fermes fur leurs étriers, à bien drefler un
» coup de lance, à fe fervir dti bouclier, à porter &
» à parer les coups d’épées, à s’accoûtumer à fuppor*
» ter le faix du harnois, & aux autres cho.es utiles 8c
» néceflaires pour bien combattre dans les armées :
» mais pour ce qui eft de Y exercice particulier,qui con-
» fifte dans les divers mouvemens qu’on fait faire aux
» troupes dans un combat, je n’ai rien trouvé d’écrit
» fur ce fujet jufqu’au tems de Louis XI. » Hifioire de
la milice françoife, tom. /. pag. 376".
« Nous remarquons aujourd’hui, dit l’illulire ÔC
profond auteur des conjidérations fur les caüfes de la
grandeur des Romains, » que nos armées périflent
» beaucoup par le travail immodéré des foldats ; ÔC
» cependant c’étoit par un travail immenfe que les
» Romains fe confervoient. La raifon en eft je croi,
»dit cet auteiir, que leurs fatigues étoient conti-
» nuelles ; au lieu que nos foldats pafîent fans cefle
» d’un travail extrême à une extrême oifiveté, ce qui
» eft la chofe du monde la plus propre à les faire pé-
» rir. Nous n’avons plus une jufte idée des exercices
» du corps. Un homme qui s’y appliqué trop nous
» paroît méprifable, par la raifon que là plûpart de
» ces exercices n’ont plus d’autre objet que les agré-
» mens ; au lieu que chez les anciens, tous, jufqu’à
» la danfe, faifoit partie de l’Art militaire ». Conjidérations
fur la grandeur des Romains, ÔCC.
L’invention de la poudre à canon a été là caufe de
la ceffation totale, pour ainfi dire, de tous les exercices
propres à endurcir le corps ôc à le fortifier pour
fupporter les grands travaux. Avant cette époque,
la force particulière du corps caraétérifoit le héros ;
on ne negligeoit rien pour le mettre en état de fe fervir
d’armes fort pefantes. « On voit encore aujour-
» d’hui dans l’abbaye de Roncevaux les maffues de
» Roland & d’Olivier, deux de ces preux fi fameux
» dans nos romanciers du tems de Charlemagne.
» Cette efpecé de mafiue eft un bâton gros comme
» le bras d’un homme ordinaire ; il eft long de deux
» piés Ôc demi; il a un gros anneau à un bout, pour
» y attacher un chaînon ou un cordon fort, afin que
» cette arme n’échappât pas de la main ; ÔC à l’autre
» bout du bâton font trois chaînons, auxquels eft at*