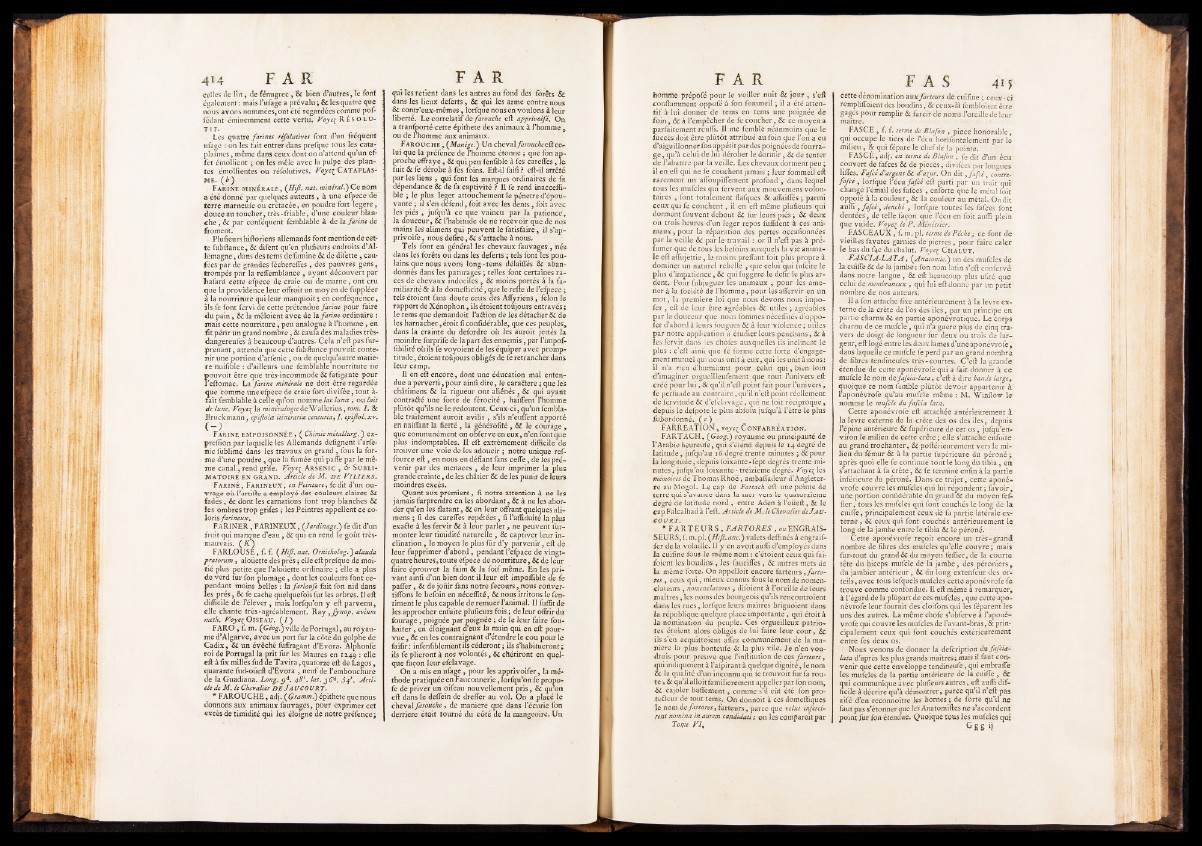
celles de lîrt, de fénugrec, & bien d’autres, le font
également : mais l’ufage a prévalu ; Ô£ les quatre que
nous avons nommées, ont été regardées comme pof-
fédant éminemment cette vertu. Voye[ R é s o l u t
i f .
Les quatre farines rèfolutivts font d’un fréquent
ufage : on les fait entrer dans prefque tous les cata-
plalmes, même dans ceux dont on n’attend qu’un effet
émollient ; on les mêle avec la pulpe des plantes
émollientes ou réfolutives. Voye^ C a t a p l a s m
e . ( £ )
F a r in e m in é r a l e , (//*/?. nat. minéral.) Ce nom
a été donné par quelques auteurs, à une efpece de
terre marneufe ou crétacée, en poudre fort legere,
douce au toucher, très-friable, d’une couleur blanche
, & par conféquent femblable à de la farine de
froment.
Plufieurs hiftoriens allemands font mention de cette
fubftance, & difent qu’en plufieurs endroits d’Allemagne
, dans des tems de famine & de difette, eau-
fées par de grandes féchereffes , des pauvres gens,
trompés par la reffemblance , ayant découvert par
ïiafard cette efpece de craie ou de marne, ont cru
que la providence leur offroit un moyen de fuppléer
à la nourriture qui leur manquoit ? en conféquence,
ils fe font fervi de cette prétendue farine pour faire
du pain, & la mêloient avec de la farine ordinaire :
mais cette nourriture, peu analogue à l’homme, en
fît périr un grand nombre, & caula des maladies très-
dangereufes à beaucoup d’autres. Cela n’eft pas fur-
prenant , attendu que cette fubflance pouvoit contenir
une portion d’arfenic, ou de quelqu’autre matière
nuifible : d’ailleurs une femblable nourritute ne
pouvoit être que très-incommode & fatigante pour
î ’eftomac. La farine minérale ne doit être regardée
?ue 'comme une efpece de craie fort divifée, tout à-
àit femblable à celle qu’on nomme lac lunce , ou lait
de lune. Voye^ la minéralogie de allerius, tom. I . &
Bruckmann, epijloloe itinérante centuria3I. epijlol.xv.
FARINE EMPOISONNÉE, ( Chimie métallurg. ) e x-
prefiion par laquelle les Allemands defignent l’arfe-
nic fublimé dans les travaux en grand , fous la forme
d’une p o u d r e , que la fumée qui paffe par le même
c a n a l,r en d grife. Voye^ A r s e n ic , 6* Su b l i -
MATOIRE EN GRAND. Article de M. D E V l L I E K S .
F a r in é , Fa r in e u x , en Peinture, fedit d’un ouvrage
où l’artifte a employé des côuleurs claires &
fades, ôc dont les carnations font trop blanches ôc
les ombres trop grifes ; les Peintres appellent ce coloris
farineux.
FARINER, FARINEUX, (Jardinage.) fe dit d’un
fruit qui manque d’eau , &C qui en rend le goût très-
mauvais. ( K )
FARLOUSE, f. f. ( Hijl. nat. Ornitholog. ) alauda
pratorum, alouette des prés ; elle eft: prefque de moitié
plus petite que l’aloiiette ordinaire ; elle a plus
de verd fur fon plumage, dont les couleurs font cependant
moins belles : la farloufe fait fon nid dans
les prés, & fe cache quelquefois fur les arbres. Il eft
difficile de l’élever, mais lorfqu’on y eft parvenu,
elle chante très-agréablement. Ray 3fynop. avium
meth. Voyt{ OlSEAU. ( ƒ )
FA R O , f. m. {Gèogd) ville de Portugal, au royaume
d’Algarve, avec un port fur la côte du golphe de
Cadix, ôc un évêché fuffragant d’Evora. Alphonfe
roi de Portugal la prit fur les Maures en 1249 : elle
eft à fix milles fud ae T avira, quatorze eft de Lagos,
quarante fud-oüeft d’Evora , neuf de l’embouenure
de la Guadiana. Long. c>d. 48'. lat. 64'. Article
de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* FAROUCHE, adj. (Gramm.) épithete que nous
donnons aux animaux fauvages, pour exprimer cet
excès de timidité qui les éloigne de notre préfence;
qui les retient dans les antres au fond des forêts 8c
dans les lieux deferts, & qui les arme contre nous
Ôc contr’eux-mêmes, lorfque nous en voulons à leur
liberté. Le corrélatif dè farouche eft apprivoifé. On.
a tranfporté-cette épithete des animaux à l’homme L
ou de l’homme aux animaux.
F a r o u c h e , (Manège.) Un cheval farouchetft. celui
que la préfence de l’homme étonne ; que fon approche
effraye, & qui peu fenfible à fes carefles, le
Fuit & fe dérobe à fes foins. Eft-il faifi ? eft-il arrêté
par les liens , qui font les marques ordinaires de fa
dépendance & de fa captivité ? Il fe rend inaccefli-
ble ; le plus leger attouchement le pénétré d’épouvante
; il s’en défend, foit avec les dents, foit avec
les piés , jufqu’à ce que vaincu par la patience,
la douceur, & l’habitude de ne recevoir que de nos
mains les alimens qui peuvent le fatisfaire, il s’ap-
privoife, nous defire, & s’attache à nous.
Tels font en général les chevaux fauvages , nés
dans les forêts ou dans les deferts ; tels font les poulains
que nous avons long-tems délaiffés & abandonnés
dans les pâturages ; telles font certaines races
de chevaux indociles , & moins portés à la familiarité
& à la domefticité, que le refte de l’efpece ;
tels étoient fans doute ceux des Affyriens, félon le
rapport de Xénophon, ils étoient toujours entravés ;
le tems que demandoit l’a&ion de les détacher & dé
les harnacher ,étoit fi confidérable, que ces peuples,
dans la crainte du defordre où les âuroit jettes la
moindre furprife de la part des ennemis, par l’impof.
fibilité où ils fe voyoient de les équiper avec promptitude
, étoient toûjours obligés de fe retrancher dans
leur camp.
Il en eft encore, dont une éducation mal entendue
a perverti, pour ainfi dire, le cara&ere ; que les
châtimens & la rigueur ont aliénés , êc qui ayant
contradé une forte de férocité , haïffent l’homme
plutôt qu’ils ne le redoutent. Ceux-ci, qu’un femblable
traitement auroit avilis , s’ils n’euuent apporté
en naiffant la fierté , la générofité , & le courage ,
que communément oq obferve en eux, n’en font que
plus indomptables. Il eft extrêmement difficile de
trouver une voie de les adoucir ; notre unique ref*
fource e f t , en nous en défiant fans celle, de les prévenir
par des menaces , de leur imprimer la plus
grande crainte, de les châtier & de les punir de leurs
moindres excès.
Quant aux premiers, fi notre attention à ne les
jamais furprendre en les abordant, & à ne les aborder
qu’en les datant, & en leur offrant quelques alimens
; fi des carefles repétées, fi l’afliduite la plus
exade à les fervir & à leur parler, ne peuvent fur-
monter leur timidité naturelle , & captiver leur inclination
, le moyen le plus fur d’y parvenir, eft de
leur fupprimer d’abord, pendant l’efpace de vingt-
?uatreheures, toute efpece de nourriture, ôc de leur
aire éprouver la faim & la foif même. En les privant
ainfi d’un bien dont il leur eft impoflible de fe
paffer, & de joiiir fans notre fecours, nous conver-
tiffons le befoin en néceflîté, & nous irritons le fen-
timent le plus capable de remuer l’animal. Il fuffit de
les approcher enfuite plufieurs fois ; de leur offrir du
fourage, poignée par poignée ; de le leur faire fou-
haiter, en éloignant a’eux la main qui en eft pourvue
, & en les contraignant d’étendre le cou pour le
faifir: infenfiblementils céderont ; ils s’habitueront;
ils fe plieront à nos volontés, ôc chériront en quelque
façon leur efclavage.
On a mis en u fage, pour les apprivoifer, la méthode
pratiquée en Fauconnerie, lorfqu’on fe propo-
fe de priver un oifeau nouvellement pris, & qu’on
eft dans le deflein de dreffer au vol. On a placé le
cheval farouche, de maniéré que dans l’écurie fon
derrière étoit tourné du côté de la mangeoire. Un
homrfie prépofé pour le veiller nuit ôc jour , s’eft
conftamment oppofé à fon fommeil ; il a été attent
if à lui donner de tems en tems une poignée de
fo in , Ôc à l’empêcher de fe coucher, ôc ce moyen a
parfaitement reufîi. II me femble néanmoins que le
fuccès doit être plûtôt attribué au foin que l’on a eu
d’aiguillonner fon appétit par des poignées de fourrag
e , qu’à celui de lui dérober le dormir, & de tenter
de l’abattre par la veille. Les chevaux dorment peu ;
il en eft qui ne fe couchent jamais ; leur fommeil eft
rarement un affoupiffement profond, dans lequel
tous les mufcles qui fervent aux mouvemens volontaires
, font totalement flafques & affaiffés ; parmi
ceux qui fe couchent, il en eft même plufieurs qui
dorment fouvent debout ÔC fur leurs piés ; Ôc deux
ou trois heures d’un leger repos fuffilènt à ces animaux
, pour la réparation des pertes occafionnées
par la veille ôc par le travail : or il n’eft pas à préfumer
que de tous les befoins auxquels la v ie animale
eft affujettie, le moins preffant foit plus propre à
dominer un naturel rebelle , que celui qui lufcite le
plus d’impatience, ôc qui fuggere le denr le plus ardent.
Pour fubjuguer les animaux , pour les amener
à la fociété de l’homme, pour les affervir en un
mot, la première loi que nous devons nous impo-
fer , eft de leur être agréables Ôc utiles ; agréables
par la douceur que nous fommes néceflités d’oppo-
fer d’abord à leurs fougues ôc à leur violence ; utiles
par notre application à étudier leurs penchans, & à
les fervir dans les chofes auxquelles ils inclinent le
plus : c’eft ainfi que fe forme cette forte d’engagement
mutuel qu< nous unit à eux, qui les unit à nous :
il n’a rien d’humiliant pour celui q u i, bien loin
d’imaginer orgueilleufement que tout l’univers eft
-créé pour lu i, & qu’il n’eft point fait pour l’univers,
fe perfuade au contraire, qu’il n’eft point réellement
de fervitude Ôc d’efclavage, qui ne foit réciproque,
depuis le defpote le plus abfolu jufqu’à l’être le plus
fubordonné. ( e )
FARRÉATION, voye1 C o n fAr r Éa t io n .
FARTACH, (Géog.') royaume ou principauté de
l ’Arabie heureufe, qui s’étend depuis le 14 degré de
latitude, jufqu’au 16 degré trente minutes ; ôepour
la longitude, depuis loixante-fept degrés trente minutes
, jufqu’au loixante - treizième degré. Voye^ les
mémoires de Thomas Rhoë, ambaffadeur d’Angleterre
au Mogol. Le cap de Fartach eft une pointe de
terre qui s’avance dans la mer vers le quatorzième
degré de latitude nord , entre Aden à Poüeft, & le
capFalcalhadà l’eft. Article de M. le Chevalier de J AU -
C O U R T .
* F A R T E U R S , FARTORE S , ouENGRAIS-
SEURS, f. m. pi. ('PUfi. anc.) valets deftinés à engraif-
fer de la volaille. Il y en avoit auflï d’employés dans
la cuifine fous le meme nom : c’étoient ceux qui fai-
foient les boudins , les faucilles, êc autres mets de
la même forte. On appelloit encore farteurs 3 far tores
, ceux qui, mieux connus fous le nom de nomen-
clateurs , nomenclatores , difoient à l’oreille de leurs
maîtres, les noms des bourgeois qu’ils rencontroient
dans les rues, lorfque leurs maîtres briguoient dans
la république quelque place importante, qui étoit à
la nomination du peuple. Ces orgueilleux patriotes
étoient.alors obligés de lui faire leur cour, êc
ils s’en acquittoient aflez communément de la maniéré
la plus honteufe & la plus vile. Je n’en vou-
drois pour preuve que l’inftitution de ces farteurs,
qui indiquoient à l'afpirant à quelque dignité, le nom
& la qualité d’un inconnu qui fe trouvoit fur fa rout
e , & qu’il alloit familièrement appellerpar fon nom,
•êc cajoler baffement, comme s’il eût été fon protecteur
de tout tems. On donnoit à ces domeftiques
le nom de fartores3farteurs, parce que velut inftfd-
fent nomina in aurem candidati ; ©n les COmparoit par
Tome VIy
cette dénomination aux faneurs de cuifine ; ceux-ci
rempliffoient des boudins, & ceux-là fembloient être
ga^és pour remplir & farcir dé noms l’oreille de leur
maître.
FASCE , f. f. terme de Blafoh , piece honorable,
qui occupe le tiers de l’ecu horifontalement par le
milieu, & qui fépare le chef de la pointe.
FASCE, adj. en terme de Blafon, fe dit d’un écu
couvert de fafees & de pièces, divifées par longues
lifles. Fafcé d'argent & d'azur. On d i t , fafel | contre-
fafcè, lorfque l’écu fafcé eft parti par un trait qui
change l’émail des fafees , enforte que le métal foit
oppofé à la couleur, & la couleur au métal. On dit
au flï, fafcè, denchè , lorfque toutes les fafees font
dentées!, de telle façon que l’écu en foit aufli plein
que vuide. Voyer Le P. Ménétrier.
FASCEAUX, f. m. pl. terme de Pêche ; ce font de
v ie ille s favates garnies de pierres , pour faire caler
le bas du fa c du chalut. Voye1 C h a l u t .
FASCJA-LATA, (Anatomie.) un des mufcles de
la cuiffe & de la jambe : fon nom latin s’eft confervé
dans notre langue, & eft beaucoup plus ufité que
celui de membraneux , qui lui eft donné par un petit
nombre de nos auteurs.
Il a fon attache fixe antérieurement à la levre externe
de la crête de l’os des îles, par un principe en
partie charnu & en partie aponévrotique. Le corps
charnu de ce mufcle, qui n’a guere plus de cinq travers
de doigt de longueur fur deux ou trois de largeur,
eft logé entre les deux lames d’une aponévrofe,
dans laquelle ce mufcle fe perd par un grand nombre
de fibres tendineufes très-courtes. C ’eft la grande
étendue de cette aponévrofe qui a fait donner à ce
mufcle le nom de fafcia-lata, c’eft-à-dire bande large9
quoique ce nom femble plûtôt devoir appartenir à
l’aponévrofe qu’au mufcle même : M. \Vinflow le
nomme le mufcle du fafeia lata.
Cette aponévrofe eft attachée antérieurement à
la levre externe de la crête des os des îles, depuis
l’épine antérieure & fupérieure de cet o s , jufqu’en-
viron le milieu de cette crête ; elle s’attache enfuite
au grand trochanter, & poftérieurement vers le milieu
du fémur & à la partie fupérieure du péroné ;
après quoi elle fe continue tout le long du tibia, en
s’attachant à fa crête, & fe termine enfin à la partie
inférieure du péroné. Dans ce trajet, cette aponévrofe
couvre les mufcles qui lui répondent ; favoir,
une portion confidérable du grand & du moyen fe£
fier, tous les mufcles qui font couchés le long de la
cuiffe, principalement ceux de fa partie latérale externe
, & ceux qui font couchés antérieurement le
long de la jambe entre le tibia & le péroné.
Cette aponévrofe reçoit encore un très-grand
nombre de fibres des mufcles qu’elle couvre ; mais
fur-tout du grand & du moyen feffier, de la courte
tête du biceps mufcle de la jambe, des péroniers,
du jambier antérieur, & du long extenfeur des orteils
, avec tous lefquels mufcles cette aponévrofe fe
trouve comme confondue. Il eft même à remarquer,
à l ’égard de la plûpart de ces mufcles, que cette aponévrofe
leur fournit des cloifons qui les féparent les
uns des autres. La même chofe s’obferve à l’aponé-
vrofe qui couvre les mufcles de l’avant-bras, & principalement
ceux qui font couchés extérieurement
entre fes deux os.
Nous venons de donner la defeription du fafcia-
lata d’après les plus grands maîtres; mais il faut convenir
que cette enveloppe tendineufe, qui embraffe
les mufcles de la partie antérieure de la cuiffe , ÔC
qui communique avec plufieurs autres, eft aufli difficile
à décrire qu’à démontrer, parce qu’il n’eft pas
aifé d’en reconnoître les bornes ; de forte qu’il ne
faut pas s’étonner que les Anatomiftes ne s’accordent
point fur fon étendue. Quoique tous les mufcles qui
P s s >).