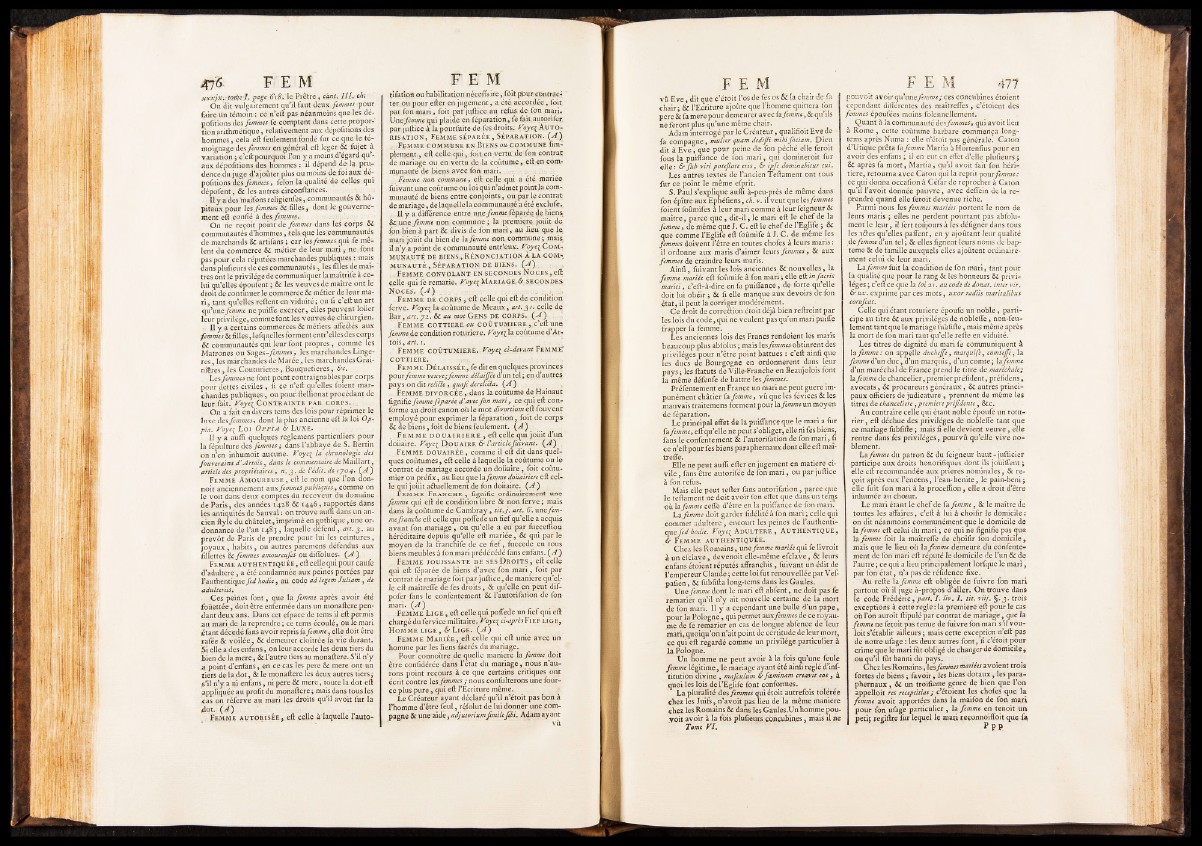
xxxjx.-to.rfieT, page 6181'îç. Prêtre , c'ant. III.-ch:
On dit vulgairement qu’il, faut deux femmes-pour
faire un tériioin:: ç é n ’eft pas néanmoins que.les: dépolirions
des femmes fe comptent dans cette .proportion
arithmétique, relativement aux dép.ofitions.des
hommes, cela eft feulement.fondé fur ce que le té-
moignagedes/bw/ner.en général eft léger &C, fiijët à
variation ; c’eft pourquoi l’on y a moins d’égard qu’aux
dépolirionsdes hommes : il dépend dé: la pru-
dence.du juge d’ajoûter pius ou moins de. foi aux de-
pofitions des femmes, felonla qualité de celles qui
dépofent , & les autres cirçonftances. . ,
Il y a des maifons religieufeS], communautés & hôpitaux
pour les femmes & filles * dont le gouvernement
eftjç.qnfié à àe^ femmes.
Ôn rie reçoit point de femmes dans les corps &
communautés d’hommes, tèls-que les [communautés
de marchands & artifans ; car les femmes qui fe mêlent
du commerce & métier de leur mari *• ne font
pas pour cela réputées marchandés publiques : mais
dans plufieurs de ces communautés, les filles de maîtres
ont le privilège de communiquer lamaîtrife à celui
qu’elles époufent ; & les veuves de maître ont le
droit de continuer le commerce & métier de leur mari
, tant qu’elles relient en viduité ; ou fi c’ell un art
qu’unz femme ne puiffe exercer, ellçs peuvent loüer
leur privilège, comme font les veuves de chirurgien.
■ Il y a Certains commerces & métiers affeéles aux
femmes & filles, lefquelles forment entr’elles des corps
&c communautés qui leur font propres, comme les
Matrones ou Sages-femmes, les marchandes Linge-
res, les màrchandes de Marée , les marchandes Grai-
nfères , les Couturières, Bouquetières, &c.
Les femmes ne font point contraignables par corps
pour dettes civiles , li ce n’eft qu’elles foient marchandes
publiques, ou pouf ftellionat procédant de
leur fait. Voye{ C o n t r a in t e p a r c o r p s . : .
Ôn a fait en divers tems des lois pour réprimer le;
luxe des femmes, dont la plus ancienne eft la loi Op-
pia. Voye{ L o i O P P I A & LUXE.
Il y a auffi quelques reglemens particuliers pour
la fépulture des femmes ; dans.l’abbaye de S. Bertin
on n’en inhumoit aucune. Voyei la chronologie des
fouyerains d'Artois, dans le commentaire de Maillart,
article des propriétaires , n. j . de l'édit, de 1704- (A )
F em m e A m o u r e u s e , eft.le nom que l’on don-
noit anciennement aux femmes publiques., comme on
le voit dans deux comptes du receveur du domaine
de Paris, des années 1418 & 1446 » rapportés dans
les antiquités de Sauvai : on trouve auffi dans un ancien
ftyle du châtelet, imprimé en gothique, une ordonnance
de l’an 14839 laquelle defend, art. 3 . au
prévôt de Paris de prendre pour lui les ceintures,
Joyaux, habits, ou autres paremens défendus aux
fillettes & femmes amoureufes ou diffolues. (A )
F em m e a u t h e n t iq u é e , eft celle qui pour caufe
d’adultere, a été condamnée aux peines portées par
l’authentique fed hodie, au code adlegem Juliam, de
adulteriis.
Çes peines font, que la femme après avoir été
foiiet-tée, doit être enfermée dans un monaftere pendant
deux ans. Dans cet efpace de tems il eft permis
au mari de la reprendre ; ce tems écoulé, ou le mari
dtant décédé fans avoir repris fa femme, elle doit être
rafée & voilé e, & demeurer cloîtrée fa v ie durant.
jSi elle ades enfans, on leur accorde les deux tiers du
Bien de la piere, & l’autre tiers au monaftere. S’il n’y
ja point d’enfans, en ce cas les pere & mere ont un
tiers de la,dot, & le monaftere les deux autres tiers;
.s’il n’y a pi enfans, ni pere & mere, toute la dot eft
appliquée au profit du monaftere ; mais dans tous les
jeas on réferve au mari les droits qu’il avoit lur la
4 <?t. ÇA)
F e m m e a u t o r i s é e , e f t c e l l e à ’ l a q u e l l e l ’ a u t o -
rifafiorî ou habilitation néeefi'air'e, foit ppur çOntrac-*
ter :ôu pour efter en jugement, par/fon mari, foit par jijftiçe. aua réetéfu, as cdceo frodnée m, faoriit.;
\Jnç:fè/n/ne qui plaid.e en féparation , fe foiTautorifer,
par juftice à iapourfuite.de,fes droits;- Autorisation,
Femme séparée, Séparation. ( A ) p||le;JFmÎeemnmt,,e ecfto cmemlleuqnuei ,e fno Biti-eenns-v ©e«r..tcuodmefmoun ncoen AtrmaF
de mariage ou en vertu de ,1a. coutume, eft;§n corn-,
menante de biens, avec fon mari. . ..
fuiFveamntm,uen neo cno ucptummmeu pnue, l oeif qt ucie nll’ea dqmuei t ap qéftoét. lma caorimee
munauté de biens entre conjoints, ou par le.contrat
d,,e Iml yar aia gdief,f édree lnacqeu eelnlter lea ucnome munauté a été çxclufe. femme féparée de biens
féoÇniUhriiee. nfe mà mpaer tn &on dciovmism due.nfeo n> mla aprrie, mauiè .rleie, ujo quiute- dlee, iml nar’yi j ao. ipioiti dnut dbei ecno mdem lau nfeamumtée e nnotrn’e. cuoxm. mune ; mais Voyey. Communauté
d e biens » Rénonciation.X la com-^
AJUNAUTÉ ,, SÉPARATION DE BIENS. ( A ) ; '. F em m e c o n v o l a n t - en s e c o n d e s N o c e s , eft;
çelie. qui fe remarie. V?ye{ Ma r i a g e # s e c o n d e s
N ^ ges^ ( A ) . . . ... . j j. ..j 1
ferFyee.m m e d e c o r p s * eft celle qui eft de condition Voye^ la coutume de Meaux , art. 31. cellç de
Bar, art. 72. & au mot G ens d e CORPS.. {A )
F em m e c o t t i e r e ou c o û t u m i e r e , c’eft une
femnze àQ condition roturière. V jycj la coutume d’Ar-r
t.o\s,art. 1.
Fem m e c o û t u m ie r e . -Voyei ci-devant Fem m e "
COTTIERE. ir;v ' ' :
Fem m e D é l a i s s é e , fe dit en quelques provinces
pour femme veuve; femme délaiffée d’un tel ; en d autres
pa y s on d it relicie , quafi derelicla. (A )
f. igFniefime m e d iv o r c é e ,r.dans la coutume de Hainaut femme féparée d'avec fon mari , ce qui eft conr
feomrmpleo yaéu pdorouirt ecxapnroinm oeùr llae mféopta draivtoiortniu, mfo eiftt d feo ucvoerpnst
& de biens, foit de biens feulement. (A )
dpüFaeirme.m e d o u a i r i è r e , eft cellequi joiiitd’un Voye^ D o u a ir e 6* l'articlefuivant. (A~)
Fe m m e d o u a ir é e , comme il eft dit dans quelqcuoenst
rcaot udteu mmearsi,a egfet acceclloer àd ela uqnu edloleu laai rceo,u ftuomit ec oouut ule
mier ou préfix, au lieu que la femme douairière eft celle
qui joiiit a&uellement de fon doiiaire. {A )
F e m m e F r a n c h e , fignifie ordinairement une
fdemanms el aq ucoi uetfut mdee dcoe nCdaitmiobnr laibyr,e & non ferve ; mais tit.j. art. 6. une femamve
farnatn fcohne emfta creiallgee q ,u io puo fqfue’deell uen a f ieeuf 1q pua’erl lfeu acc aecfquuoins
hméoréydeint adiree ldae pfruainse qnuif’ee ldlee ecfet mfieafr,i éfeu,c c&ed qeu ei np ator ules biensmeubles à fon mari prédécédé fans enfans. ÇA)
Fem m e j o u i s s a n t e d e s e s D r o it s , eft celle
qcouni terfatt fdéep maraérei adgee fboieitn ps adr’ jauvfeticc efo, nd em maarnii,é rféo iqtu p’ealr
pleo feefrt mfaanîstr eleff ec odnes feenst edmroeintst ,& & l ’qauu’teolrlief aetnio pne udte dfoifn-
mari. Ç A ' )
Fem m e L i g e , eft c e lleq u i poffede un fie f qui eft
chargé du fe rvice militaire. Vjye^ ci-après F ie f l ig e ,
Ho m m e l i g e , & L ig e . Ç A )
F em m e M a r ié e , eft celle qui eft unie avec un
homPmouer peaorn lneos îltireen sd efa qcuréesll de um maanriiéargée l.a femme doit
rêotrnes cpoonifnidt érreéceo udrasn sà lc’éet aqtu de uc mertaariinasg ec,r intioquuse sn ’oanut
écrit contre les femmes ; nous confulterons une four-
ce Lpleu Cs préuartee,u qr uaiy eafnt tl ’dEéccrliaturére q mu’iêlm ne’é.toit pas bon à
l’homme d’être feul, réfolut de lui donner une compagne
& une aide, adjutorïumfimilejibi, Adam ayavnfti
vù E v e , dit que c’étoit l’os de fes os & la chair de fa
chair; & l’Ecriture ajoute que l’homme quittera fon
pere & fa mere pour demeurer avec fa femme, & qu’ils
ne feront plus qu’une meme chair.
Adam interrogé par le C réateur, qualifioit Eve de •
fa compagne, mulier quam dedifli mihi fociam. Dieu
dit à E v e , que pour peine de fon péché elle feroit
fous la puiffance de ion mari, qui domineroit fur
elle: &fub viri potefate cris, & ipfe dominabitur tui.
Les autres textes de l’ancien Teftament ont tous
fur ce point le même efprit.
S. Paul s’explique auffi à-peu-près de même dans
fon épître aux Ephéfiens, ch. v. il veut que les femmes
foient foûmifes à leur mari comme à leur feigneur &
maître, parce que, dit-il, le mari eft le chef de la
femme, de même que J. C. eft le chef de l’Eglife ; &
que comme l’Eglife eft foûmife à j. C. de même les
femmes doivent l’être en toutes chofes à leurs maris :
il ordonne aux maris d’aimer leurs femmes , & aux
femmes de craindre leurs maris.
Ainfi, fuivant les lois anciennes & nouvelles, la
femme mariée eft foûmife à fon mari ; elle eft infacris
mariti, c’eft-à-dire en fa puiffance, de forte qu’elle
doit lui obéir ; & fi elle manque aux devoirs de fon
état, il peut la corriger modérément.
Ce droit de corre&ion étoit déjà bien reftreint par
les lois du code, qui ne veulent pas qu’un mari puiffe
frapper fa femme.
Les anciennes lois des Francs rendoient les maris
beaucoup plus abfolus ; mais les femmes obtinrent des
privilèges pour n’être point battues : c’eft ainfi que
les ducs de Bourgogne en ordonnèrent dans leur
pays ; les ftatuts de Ville-Franche en Beaujolois font
la même défenfe de battre 1 es femmes.
Préfentement en France un mari ne peut guere impunément
châtier fa femme, vu que les févices & les
mauvais traitemens forment pour la femme un moyen
de féparation.
Le principal effet de la puiffance que le mari a fur
fa femme, eft qu’elle iie peut s’obliger, elle ni fes biens,
fans le confentement & l’autorifation de fon mari, fi
ce n’eft pour fes biens paraphernaux dont elle eft maîtreffe.
Elle ne peut auffi efter en jugement en matière civile
, fans être autorifée de fon mari, ou par juftice
à fon refus.
Mais elle peut tefter fans autorifation, parce que
le teftament ne doit avoir fon effet que dans un teiqs
où la femme ceffe d’être en la puiffance de fon mari.
l.a femme doit garder fidélité à fon mari ; celle qui
commet adultéré, encourt les peines de l’authentique
fed hodie. Voye^ ADULTERE , AUTHENTIQUE,
& F em m e a u t h e n t iq u é e .
Chez les Romains, une femme mariée qui fe livroit
à un efclave, devenoit elle-même efclave, & leurs
enfans étoient réputés affranchis, fuivant un édit de
l’empereur Claude ; cette loi fut renouvellée par Vef-
pafien, & fubfifta long-tems dans les Gaules.
Une femme dont le mari eft abfent, ne doit pas fe
remarier qu’il n’y ait nouvelle certaine de la mort
de fon mari. Il y a cependant une bulle d’un pape,
pour la Pologne, qui permet aux,femmes de ce royaume
de fe remarier en cas de longue abfence de leur
mari, quoiqu’on n’ait point de certitude de leur mort,
ce qui eft regardé comme un privilège particulier à
la Pologne.
Un homme ne peut avoir à la fois qu’une feule
femme légitime, le mariage ayant été ainfi réglé d’inf-
titution divine , mafculum & faminam creavit eos , à
quoi les lois de l’Eglife font conformes.
La pluralité des femmes qui étoit autrefois tolérée
chez les Juifs, n’avoit pas lieu de la même maniéré
chez les Romains & dans les Gaules.Un homme pou-
yoit avoir à la fois plufieurs concubines, mais il ne
Tome VI,
pouvoit avoir qu’une femme) ces concubines étoient
cependant differentes des maîtreffes , c’étoient des
femmes époufées moins folennellement.
Quant à la communauté des femmes, qui avoit lièu
à Rome, cette coutume barbare commença long-
tems après Numa : elle n’étoit pas générale. Caton
d’Utique prêta fa femme Martia à Hortenfius pour en
avoir des enfans ; il en eut en effet d’elle plufieurs ;
& après fa mort, Martia, qü’il avoit fait fon héritière,
retourna avec Caton qui la reprit pour femme :
ce qui donna occafion à Céfar de reprocher à Caton
qu’il l’avoit donnée pauvre, avec deffein de la re-
prendré quand elle feroit devenue riche.
Parmi nous les femmes mariées portent le nom de
leurs maris ; elles ne perdent pourtant pas abfolu-
ment le four, il fert toûjours à les défigner dans tous
les ades qu’elles paffent, en y ajoûtant leur qualité
de femme d’un tel ; & elles lignent leurs noms de baptême
& de famille auxquels elles ajoûtent ordinairement
celui de leur mari.
La femme fuit la condition de fon mari, tant pour
la qualité que pour le rang & les honneurs & privilèges
; c’eft ce que la loi 21.au code de donat. inter vir.
& ux. exprime par ces mots, uxor radiis maritalibus
corufcat.
Celle qui étant roturière époufe un noble, participe
àu titre & aux privilèges de nobleffe, non-feulement
tant que le mariage fubfifte, mais même après
la mort de fon mari tant qu’elle refte en viduité.
Les titres de dignité du mari fe communiquent à
la femme : on appelle ducheffe, marquife, comttjfe, la
femme d’un duc, d’un marquis, d’un comte ; la femme
d’un maréchal de France prend le titre de maréchale;
la femme de chancelier, premier préfident, préfidens ,
avocats, & procureurs généraux, & autres principaux
officiers de judicature , prennent de même les
titres de chanceliere, première préfidente, &c.
Au contraire celle qui étant noble époufe un roturier,
eft déchue des privilèges de nobleffe tant que
ce mariage fubfifte ; mais fi elle devient v eu ve, elle
rentre dans fes privilèges, pourvu qu’elle vive noblement.
La femme du patron & du feigneur haut - jufticiér
participe aux droits honorifiques dont ils joiiiffent ;
elle eft recommandée aux prières nominales, & reçoit
après eux l’encens, l’eau- benite, le pain-beni ;
elle fuit fon mari à la proceffion, elle a droit d’être
inhumée au choeur.
Le mari étant le chef de fa femme, & le maître de
toutes les affaires, c’eft à lui à choifir le domicile :
on dit néanmoins communément que le domicile de
la femme eft celui du mari ; ce qui ne fignifie pas que
la femme foit la maîtreffe de choifir fon domicile ,
mais que le lieu où la femme demeure dii cônfente-
ment de fon mari eft réputé le domicile de l’un & de
l’autre; ce qui a lieu principalement lorfqùe le m ari,
par fon état, n’a pas de réfidence fixe.
Au refte la femme eft obligée de fuivre fon mari
partout où il juge à-propos d’aller. On trouve dans
le code Frédéric, part. I . liv. I. tit. viij. § . 3 . trois
exceptions à cette réglé : la première eft pour le cas
où l’on auroit ftipulé par contrat de mariage, que la
femme ne feroit pas tenue de fuivre fon mari s’il vou-
loit s’établir ailleurs ; mais cette exception n’eft pas
de notre ufage : les deux autres font, fi c’étoit pour
crime que le mari fût obligé de changer de domicile*
ou qu’il fut banni du pays*
Chez lesRomains, les femmes mariées avoient trois
fortes de bièns ; fa vo ir , les biens dotaux, les paraphernaux
, & un troifieme genre de bien que l’on
appelloit res receptitias ; c’étoient les chofes que la
femme avoit apportées dans la maifon de fon mari
pour fon ufage particulier, la femme en tenoit un
petij regiftre fur lequel le mari reçonnoiffoit que fo