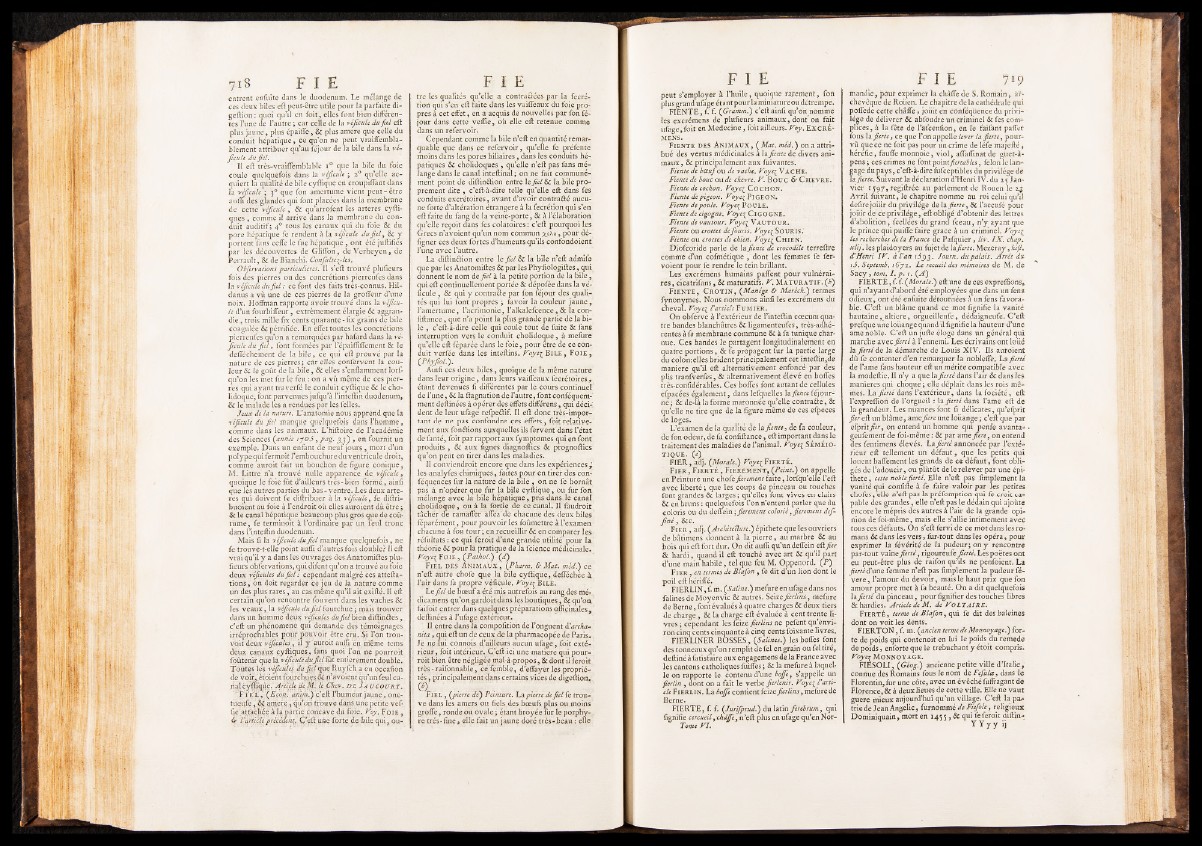
entrent enfuite dans le duodénum. Le mélange de
ces deux biles eft peut-être utile pour la'parfaite di-
geftion : quoi qu’il en foit, elles font bien différentes
l’une de l’autre ; car celle de la vèficule du fie l eft
plus jaune, plus épaiffe, & plus amere que celle du
conduit hépatique, ce qu’on ne peut vraiffembla-
blement attribuer qu’au léjour de la bile dans la vé-
Jîcule du fie l. . _ .
Il eft très-vraiffcmblable i ° que la bile du foie
coule quelquefois dans la vèficule ; z° qu’elle acquiert
la qüalité de bile cyftique en croupiffant dans
la vèficule ; 30 que fon amertume vient peut-être
anfli des glandes qui font placées dans la membrane
de cette vèficule , & qu’arrofent les arteres cyfti-
ques , comme il arrive dans la membrane du conduit
auditif ; 40 tous les canaux qui; du foie 6c du
pore hépatique fe rendent à la vèficule du fiel, 6c y
portent fans celle le fuc hépatique , ont été juftifies
par les découvertes de Gliffon, de V erheyen, de
Perrault, 8c de Bianchi. Confulte^-les.
Obfervations particulières. Il s’eft trouvé plulieurs
fois des pierres ou des concrétions pierreufes dans
la vèficule du fiel : ce font des faits très-connus. Hil-
danus a vu une de ces pierres de la groffeur d’une
noix. Hoffman rapporte avoir trouvé dans la vèficule
d’un fourbiffeur, extrêmement élargie & aggran-
die, trois mille lix cents quarante-fix grains de bile
coagulée 8c pétrifiée. En effet toutes les concrétions
pierreufes qu’on a remarquées par hafard dans la vèficule
du fiel, font formées par l’épaiffiffement & le
defféchement de la b ile, ce qui eft prouvé par la
nature de ces pierres ; car elles confervent la couleur
6c le goût de la bile, & elles s’enflamment lorf-
qu’on les met fur le feu : on a vu même de ces pierres
qui ayant traverfé le conduit cyftique 8c le cholidoque,
font parvenues jufqu’à l’inteftin duodénum,
& le malade les a rendues par les felles.
Jeux de la nature. L’anatomie nous apprend que la
vèficule du fiel manque quelquefois dans l’homme,
comme dans les animaux. L’hiftoire de l’académie
des Sciences (année iy à â , pag. 3 3 ) , en fournit un
exemple. Dans un enfant de neuf jours, mort d’un
polype qui fermoit l’embouchure du ventricule droit,
comme auroit fait un bouchon de figure conique,
M. Littré n’a trouvé nulle apparence de vèficule,
quoique le foie fût d’ailleurs très - bien forme., ainli
que les autres parties du bas-ventre. Les deux arteres
qui doivent fe diftribuer à la vèficule, fe diftri-
buoient au foie à l’endroit où elles auroient dû être ;
& le canal hépatique' beaucoup plus gros que de coû-
tume, fe terminoit à l’ordinaire par un feul tronc
dans l’inteftin duodénum.
Mais li la vèficule d u fie l manque quelquefois, ne
fe trouve-t-elle point auffi d’autres fois double? II eft
vrai qu’il y a dans les ouvrages des Anatomiftes plu-
liéurs obfervations, qui difent qu’on a trouvé au foie
deux yéfic'ules du fie l : cependant malgré ces attefta-
tions, on doit regarder çe jeu de la nature comme
un des plus rares, au cas même qu’il ait exifté. Il eft
certain qu’on rencontre fouvent dans les vaches 8c
les veaux, la vèficule du fie l fourchue ; mais trouver ’
dans un homme deü x. véficules du fie l hien diftinâes ,
c’eft un phénomène qui demande des témoignages
irréprochables pour pouvoir être cru. Si l’on trouvait
deux véficules, il y 'auroit auffi en même tems
deux canaux çyftiques, fans quoi l’on ne pourroit
foûtenir que la vèficule d u fie l fût entièrement double.
Toutes les véficules du fe/que Ruyfch a eu occafion
de voir, etoient fourchues & n’ avoient qu’un feul canal
cyftique. A rfic lfd e _ M .le C h e v . D E J.a u COURT.
’ FÏ‘e~l y (Econ. anirp) ç’eft l’humeur jaune, onc-
tueiife, am.ere^ qu’on trouve danjs.une petite vèf-
% ’âttacnée à lapartie' concave du fpie, V o y . Foie ,
& fiariiçléprécèdent. Ç’eft une forte de bile qui, out
r e l e s q u a l i t é s q u ’ e l l e a c o n t r a r i é e s p a r l a f e c r é -
t i o n q u i s ’ e n e f t f a i t e d a n s l e s v a i f f e a u x d u f o i e p r o p
r e s à c e t e f f e t , e n a a c q u i s d e n o u v e l l e s p a r f o n f é -
j o u r d a n s c e t t e v e f f i e , o i t e l l e e f t r e t e n u e c o m m e
d a n s u n r e f e r v o i r .
C e p e n d a n t c o m m e l a b i l e n ’ e f t e n q u a n t i t é r em a r q
u a b l e q u e d a n s c e r e f e r v o i r , q u ’ e l l e f e p r é f e n t e
m o in s d a n s l e s p o r e s b i l i a i r e s , d a n s l e s c o n d u i t s h é p
a t iq u e s & c h o l i d o q u e s , q u ’ e l l e n ’ e f t p a s f a n s m é l
a n g e d a n s l e c a n a l i n t e f t i n a l ; o n n e f a i t c o m m u n é m
e n t p o in t d e d i f t in r i i o n e n t r e l e fiel 8 c l a b i l e p r o p
r e m e n t d i t e , c ’ e f t - à - d i r e t e l l e q u ’ e l l e e f t d a n s f e s
c o n d u i t s e x c r é t o i r e s , a v a n t d ’ a v o i r c o n t r a r i é a u c u n
e f o r t e d ’ a l t é r a t i o n é t r a n g è r e à l a f e c r é t i o n q u i s ’ e n
e f t f a i t e d u f a n g d e l a v e i n e - p o r t e , & à l ’ é l a b o r a t i o n
q u ’ e l l e r e ç o i t d a n s f e s c o l a t o i r e s : c ’ e f t p o u r q u o i l e s
G r e c s n ’ a v o i e n t q u ’u n n o m c o m m u n ^ oa»i , p o u r d é -
f i g n e r c e s d e u x f o r t e s d ’h u m e u r s q u ’ i l s c o n f o n d o i e n t
l ’ u n e a v e c l ’ a u t r e .
La diftinriion entre le fiel 8c la bile n’eft admife
que par les Anatomiftes 8c par les Phyliologiftes, qui
donnent le nom de fiel à la petite portion de la b ile,
qui eft continuellement portée & dépofée dans la v èficule
, 8c qui y contrarie par fon féjour des qualités
qui lui font propres ; (avoir la couleur jaune,
l’amertume, l’acrimonie, l’alkalefcence, & la con-
fiftance, que n’a point la plus grande partie de la bile
, c’eft-à-dire celle qui coule tout de fuite & fans
interruption vers le conduit cholidoque, à mefure
qu’elle eft féparée dans le foie, pour etre de ce conduit
verfée dans les inteftins. Voye1 Bil e , Fo ie ,
(Pkÿfiàï.'). / H H H H H
A i n l i c e s d e u x - b i l e s - , q u o i q u e d e l a m ê m e n a t u r e
d a n s l e u r o r i g i n e , d a n s l e u r s v a i f f e a u x f e c r é t o i r e s ,
é t a n t d e v e n u e s f i d i f f é r e n t e s p a r l e c o u r s c o n t i n u e l
d e l ’u n e , 6 c l a f t a g n a t i o n d e l ’ a u t r e , f o n t c o n f é q u e m -
m e n t d e f t i n é e s à o p é r e r d e s e f f e t s d i f f é r e n s , q u i d é c i- ;.
d e n t d e l e u r u f a g e r e f p e r i i f . I l e f t d o n c t r è s - im p o r t
a n t d e n e p a s c o n f o n d r e c e s e f f e t s , f o i t r e l a t i v e m
e n t a u x f o n d i o n s a u x q u e l l e s i l s f e r v e n t d a n s l ’ é t a t
d é f a n t é , f o i t p a r r a p p o r t a u x f y m p t o m e s q u i e n f o n t
p r o d u i t s , 8 c a u x l i g n e s d i a g n o f t i c s & p r o g n o f t i c s
q u ’ o n p e t i t e n t i r e r d a n s l e s m a la d ie s ,.
I l c o n v i e n d r o i t e n c o r e q u e d a n s l e s e x p é r i e n c e s r
l e s a n a l y f e s c h im i q u e s , f a i t e s p o u r e n t i r e r d e s c o n -
f é q u e n c e s f u r l a n a t u r e d e l a b i l e , o n n e f e b o r n â t
p a s à n ’ o p é r e r q u e f u r l a b i l e c y f t i q u e , o u f u r f o n
m é l a n g e a v e c l a b i l e h é p a t i q u e , p r i s d a n s l e c a n a l
c h o l i d o q u e , o u à l a f o r t i e d e c e c a n a l . I l f a u d r o i t
t â c h e r d e r a m a f f e r à f f e z d e c h a c u n e d e s d e u x b i l e s
f é p a r é m e n t , p o u r p o u v o i r l e s f o û m e t t r e à l ’ e x a m e n
c h a c u n e à f o n t o u r ; e n r e c u e i l l i r ô c e n c o m p a r e r l e s
r é f u l t a t s : c e q u i f e r o i t d ’u n e g r a n d e u t i l i t é p o u r l a
t h é o r i e 6 c p o u r l a p r a t i q u e d e l a f c i e n c e m é d i c i n a l e .
Voye^ Foie ? ( Pathol.) (fi)
F i e ;l d e s A n i m a u x , (Pharm. & Mat. méd.) c e .
n ’ e f t a u t r e c h o f e q u e l a b i l e c y f t i q u e , d e f f é c h é e à
l ’ a i r d a n s f a p r o p r e v è f i c u l e . Voye^ B i l e .
L e fiel d e b oe u f a é t é m i s a u t r e f o i s a u r a n g d e s m é - ,
d i ç a m e n s q u ’ o n g a r d o i t d a n s l e s b o u t i q u e s , 8 ç q u ’o n
f a i f o i t e n t r e r d a n s q u e l q u e s p r é p a r a t i o n s o f f i c in a l e s ,
d e f t i n é e s à l ’u f a g e e x t é r i e u r .
Il entre dans la compofition de l’onguent ôiartha-
nita, qui eft un de ceux de la pharmacopée de Paris.
Jè ne lui connais d’ailleurs aucun ufage,,foit extérieur
, foit intérieur. C ’eft ici une matière qui pourrait
bien être négligée mal-à-propos, & dont il feroit
, principalement dans certains vices de digeftion. mm ... m Fiel , (pierre de) Peinture. La pierre de fiel fe trou-,
v e dans les amers ou fiels des boeufs plus ou moins
groffe, ronde ou ovale ; étant broyée fur le porphy-.
re très-fine, elle fait un jaune doré très-beau ; elle
très - raifonnable, ce fémble, d’effayerles propriétés
p e u t s * e ï f i p î ô y è r à l ’h u i l e , q u o i q u e r a r e m e n t , f o n
p lu s g r a n d u f a g e é t a n t p o u r l a m i n i a t u r e o u d é t r e m p e .
FIENTE, f. f. ( Gramm.) c’eft ainli qu’on nomme
les excrémens de plufieurs animaux, dont on fait
u fa g e , fo it en M ed e c in e , foit ailleurs. Voy. Ex c r é -
M e n s .
F i e n t e d e s A n i m a u x , (Mat. méd.') o n a a t t r i b
u é d e s v e r t u s m é d i c in a l e s a l a fiente d e d i v e r s a n i m
a u x , 8 c p r i n c i p a l e m e n t a u x f u i v a n t e s .
Fiente de boeuf ou de vache. Voyeç V a c h e .
Fiente de bouc o u de chèvre. V. B o u c & C H E V R E .
Fiente de cochon. Voyeç C o c h o n .
Fiente de pigeon. Voye^ PlGEON.
Fiente de poule. Voye£ POULE.
Fiente de cigogne. Voye{ ClGOGNÉ.
Fiente de vautour. Voye^ VAUTOUR.
Fiente o u crottes defouris. Voye^_So\JKïSl
Fiente ou crottes de chien. Vôye%_ C H I E N .
Diofcoride parle de la fiente de crocodile terreftre
comme d’un cofm'ét'ique , dont les femmes fe fer-
voient pour fe rendre le tein brillant.
Les e x c r é m e n s h u m a i n s p a f f e n t p o u r v u l n é r a i res
, c i c a t r i f a n s , & m a t u r a t i f s . V. M a t u r a t i f . (fi)
F i e n t e , C r o t i n , (Manège & Marèch.) termes
fynonynies. Nous nommons ainli les excrémens du
cheval. Voyeç l'article F u M I È R .
On obferve à l’extérieur de l’intèftin cæcum quatre
bandes blanchâtres & ligamenteufes, très-acÛié-
rentes à fa membrane commune & à fa tunique charnue.
Ces bandes le partagent longitudinalement en
quatre portions, & le propagent lur la partie large
du eolonrelles brident principalement cet inteftin,de
maniéré qu’il eft alternativement enfoncé par des
plis tfanfverfes, & alternativement élevé en boffes
très-confidérables. Ces boffes font autant de cellules
efpacées également, dans lefquelles la fiente féjour-
ne ; & de-là la forme maronnée qu’elle contraûe, &
qu’elle ne tire que de la figure même de ces efpeces
de loges; '
L’examen de la qualité de la fiente, de fa couleur,
de fon odeur, de fa confiftance, eft important dans le
traitement des maladies de l’animal. Voyei S é m é i o t
i q u e . (è)
FIER, a d j . (Morale.) Voye£ F i e r t é .
F i e r , F i e r t é , F i e R e m e n t , (Peint.) on appelle
en Peinture une chofe fierement faite, lorfqu’elïe l’eft
avec liberté ; que les coups de pinceau ou touches
font grandes & larges ; qu’elles font vives en clairs
& en bruns : quelquefois l’on n’entend parler que du
coloris ou du deflein ; fierement colorié, fierement défi-
Jînè, &c.
F i e r , adj. (Architecture.) épithete que les ouvriers
de bâtimens donnent à la pierre, au marbre 6c au
bois qui eft fort dur. On dit auffi qu’un deffein eft fier
&. hardi, quand il eft touché avec art 6c qu’il part
d’une main habile, tel que feu M. Oppenord. (P)
F i e r en termes de B lafon, f e d i t d ’ u n l i o n d o n t l e
p o i l e f t h é r i f f é .
F1ERLIN, f. m. (Saline.) mefure en ufage dans nos
falines de Moyenvic 6c autres. Seizefierlins, mefure
de Berne, font évalués à quatre charges 6c deux tiers
de charge , 6c la charge eft évaluée à cent trente livres
; cependant les feize fierlins ne pefent qu’envi-
ron cinq cents cinquante à cinq cents foixante livres.
FIERLINER BOSSES, (Salines.) les boffes font
des tonneaux qu’on remplit de fel en grain ou feltiré,
deftiné à fatisfaire aux engagemens de la France avec
les cantons catholiques fuiffes ; 6c la mefure à laquelle
on rapporte le contenu d’une bofie, s’appelle un
fierlin , dont on a fait le verbe fierlenir. Voye{ l'article
F i e r l i n . La bojfe contient feize fierlins, mefure de
Berne.
FIERTE, f. f. (Jurifprud.) du latin ferebrum, qui
lignifie cercueil ychâjfe, n’eft plus en ufage qu’en Nor-
Tome VI.
mandié, pôüï exprimer la châffé de S. Romain 9 archevêque
de Rouen. Le chapitre de la cathédrale qui
poffede cette châffe ; joint en cdnféqüence du privilège
de délivrer 6c abfoudre un criminel & fes complices
, à la fête de l’afcenfion * en le faifant paffer
fous la fierté, ce que l’on appelle lever la 'fierte, pour-
vû <juece ne foit pas pour un crime de léfe majefté t
hérefie, fauffe monnoie, viol^ affaffinat de giiet-à-
pens ; ces crimes ne font pointfiertables, félon le langage
du pays, c’eft-à-dire fufceptibles du privilège dé
la fierte. Suivant la déclaration d’Henri IV. du 15 Janvier
1 <97, regiftrée au parlement dé Rouen le 24
Avril luivant, le chapitre nomme au roi celui qu’il
déliré jouir du privilège delà fierte, 6c l’accufé pour
jouir de ce privilège, eft obligé d’obtenir des lettres
d’abolition, fcellées du grand fceau, n’y ayant que
le prince qui puiffe faire grâce à un criminel. Voye^
les recherches de la France de Pafquier > liv. IX . chap.
xlij. les plaidoyers au fujét de lafierte. M ezeray, hifl.
d'Henri IV. à l'an >£ <)$. Journ. du palais. Arrêt du
iS. Septemb. iGyx. Le recueil des mémoires de M. de
Sacy y toril. I . p. 1. (A )
FIERTÉ, f. f. (Morale.) eft line de ces éxpreffiôns*'
qui n’ayant d’abord été employées que dans un fens
odieux, ont été enfuite détournées à un fens favorable.
C ’eft un blâme quand ce mot lignifie la vanité
hautaine, altiere, orgueilleufe, dédaigneufe. G’ eft
prefque une loiiange quand il lignifie la hauteur d’Uné
ame noble. C ’eft un jufte éloge dans un général qui
marche avec fierté à l’ennemi. Les écrivains ont loiié
la fierté de la démarche de Louis XIV. Ils autoient
dû fe contenter d’en remarquer la nobleffe. La fierté
de l’ame fans hauteur eft un mérite compatible avec
la modeftie. Il n’y a que la fierté dans l’air 6c dans les
maniérés qui choque ; elle déplaît dans les rois mê-
rriès. La fierté dans l’extérieur, dans la fociété -, eft
l ’èxpreffion de l’Orgueil : Izfierté dans l’ame eft de
la grandéur. Les nuances font fi délicates, qu’efprit
fier eft un blâme , ame fiere une loiiange ; c’eft que par
efprit fier y on entend un homme qui penfe avanta-
geufement de foi-même : 6c par ame fiere y on entend
des fentimens élevés. La fierté annoncée par l’extérieur
eft tellement un défaut, que les petits qui
louent baffement les grands de ce défaut, font obligés
de l’adoucir, ou plutôt de le relever pâr une épithete
, cette noble fierté. Elle n’eft pas Amplement la
vanité qui eonfifte à fe faire valoir par les petites
chofes, elle n’eft pas la préfomptioil qui fe croit capable
des grandes, telle n’eft pas le dédain qui ajoûte
encore le mépris des autres à l’air de la grande opinion
de foi-même, mais elle s’allie intimement avec
tous ces défauts. On s’eft fervi de ce mot dans les romans
6c dans les vers, fur-tout dans les opéra, pour
exprimer la févérité de la pudeur; on y rencontre
par-tout vaine fierté, rigoureufe fierté. Les poètes ont
eu peut-être plus de raifon qu’ils ne penfoient, La
fierté d’une femme n’eft pas Amplement la pudeur fé-
v e re , l’amour du devoir, mais le haut prix que fon
amour propre met à fa beauté. On a dit quelquefois
la fierté du pinceau, pour lignifier des touches libres
6c hardies. Article de M. de V o l t a ir e .
F i e r t é , terme de Blafon y qui fe dit des baleines
dont on voit les dents.
FIERTON, f. m. (ancien terme de Monnoyage.) forte
de poids qui contenoit en lui le poids du remede
de poids, enfortequele trébuchant y étoit compris*
Voyeç M O N N O YA G È .
FIESOLI, (Géog.) ancienne petite ville d’Italie,
connue des Romains fous le nom de Fefula, dans le
Florentin, fur une côte, avec un évêché fuffragant de
Florence, 8c à deux lieues de cette ville. Elle ne vaut
guere mieux aujourd’hui qu’un village. C ’eft la pa»»
trie de Jean Angelic, furnommé de Fiefole, religieux
Dominiquain, mort en 1455, 8c qui fe feroit diftin