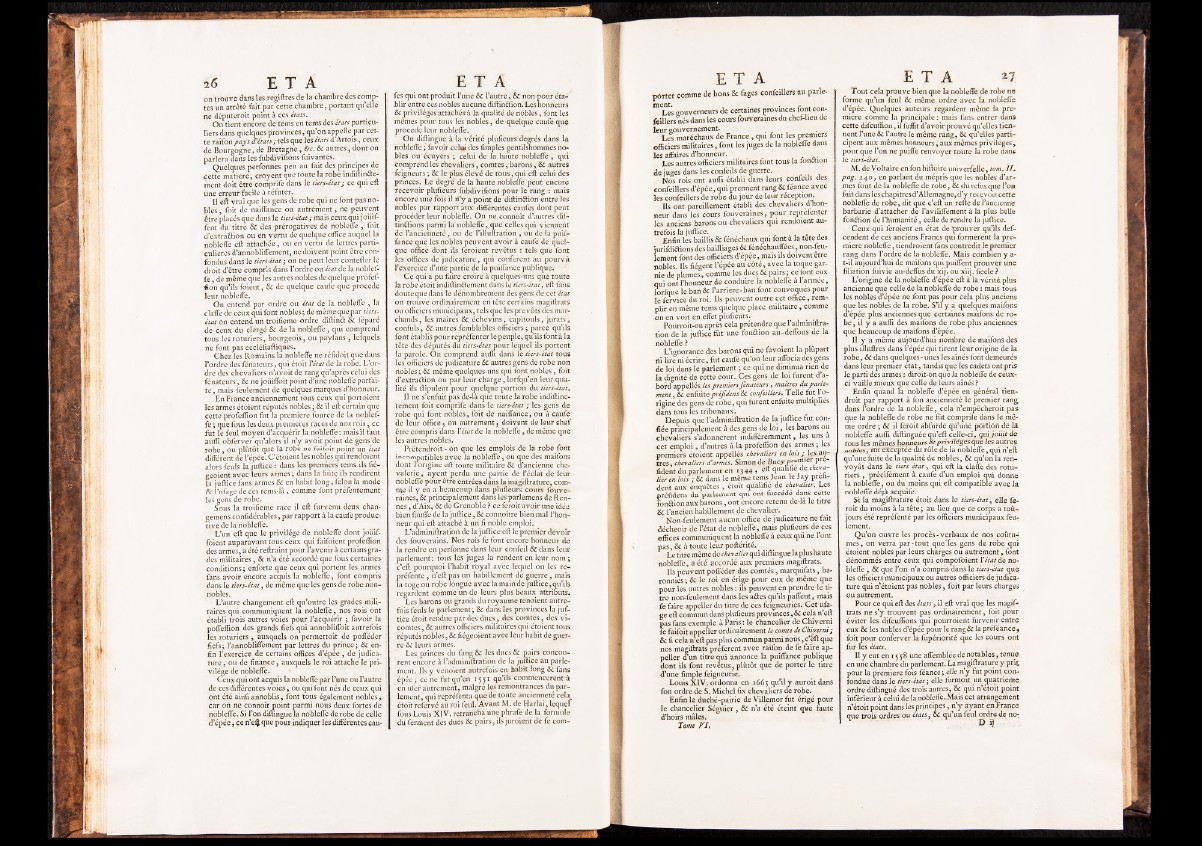
on trouve dans les regiftres de la chambre des comptes
un arrêté fait par cette chambre, portant qu’elle
ne députeront point à ces états. '■
On tient encore de tems en tems des états particuliers
dans quelques provinces, qu’on appelle par cette
raifôn pays d'états ; tels que les états d Artois, ceux
de Bourgogne, de Bretagne, &c. & autres, dont on
parlera dans les fubdivifions fuivantes.
Quelques perfonnes peu au fait dés principes de
oette matière, croyent que toute la robe indiftinéfe-
rnènt doit être comprife dans le tiers-état ; ce qui eft
une erreur facile à réfuter.
Il eft vrai que les gens de robe qui ne font pas nobles,
foit de naiffance ou autrement, ne peuvent
être placés que dans le tiers-état ; mais ceux.qui joiirf-
fent du titre & des prérogatives de nobleffe , foit
d’extrattion ou en vertu de quelque office auquel la
nobléffe eft attachée, ou en vertu de lettres particulières
d’annobliffement, ne doivent point être confondus
dans le tiers-état ; on ne peut leur cohtefter lé
droit d’être compris dans l’ordre ou état de la noblef-
f e , de même que les autres nobles de quelque profef-
fion qu*ils foient, & de quelque caufe que procédé
leur nobleffe.
On entend par ordre ou état de la nobleffe , là
claffe de ceux qui font nobles; de même que par tiers-
état on entend un troifieme ordre diftinâ & féparé
de Ceux du clergé & de la nobleffe, qui comprend
tous les roturiers, bourgeois, ou payfans , lesquels
ne font pas eccléfiaftiques.
Chez les Romains la nobleffe ne réfidoit que dans
l’ordre des fénateurs, qui étoit l'état de la robe. L ’ordre
des chevaliers n’avoit de rang qu’après celui des
fénateurs, & ne joüiffoit point d’une nobleffe parfait
e , mais feulement de quelques marques d’honneur.
En France anciennement tous ceux qui portoient
les armes étoient réputés nobles ; & il elt certain que
cette profeflion fut la première fource de la nobleffe
; que fous les deux premières races de nos rois, ce
fut le feul moyen d’acquérir la nobleffe : mais il faut
auffi obferver qu’alors il n’y avoit point de gens de
robe, ou plûtôt que la robe ne f&foit point un état
différent de l’épée. C’étoient l,es nobles qui rendoient
alors feuls la juftice : dans les premiers tems ils fié-
geoient avec leurs armes; dans la fuite ils rendirent
la juftice fans armes & en habit long, lelon la mode
& l’ufage de ces tems-là, comme font préfentement
les gens de robe.
Sous la troifieme race il eft furvenu deux chan-
gemens confidérables, par rapport à la caufe productive
de la nobleffe.
L’un eft que le privilège de nobleffe dont joiiif-
foient auparavant tous ceux qui faifoient profeflion
des armes, a été reftraint pour l’avenir à certains grades
militaires, & n’a été accordé que fous certaines
conditions ; enforte que ceux qui portent les armes
fans avoir encore acquis la nobleffe, font compris
dans le tiers-état, de même que les gens de robe non-
nobles.
L’autre changement eft qu’outre les grades militaires
qui communiquent la nobleffe, nos rois ont
établi trois autres voies pour l’acquérir ; favoir la
poffeflion des grands fiefs qui annobliffoit autrefois
les roturiers , auxquels on permettoit de pofféder
fiefs; l’annobliffement par lettres du prince; & enfin
l’exercice de certains offices d’épée , de judica-
turè, ou de finance, auxquels lé roi attache le privilège
de nobleffe.
Ceux qui ont acquis la nobleffe par l’une ou l’autre
de ces différentes vo ie s , ou qui font nés de ceux qui
ont été ainfi annoblis, font tous également nobles ;
car on ne connoît point parmi nous deux fortes de
nobleffe. Si l’on diftingue la nobleffe de robe de celle
d’épée, ce n’elj que pour indiquer les différentes eaufes
qui ont produit l’une & l’autre, & non pour établir
entre ces nobles aucune diftinélion. Les honneurs
& privilèges attachés à la qualité de:rtoblés, font les
mêmes pour tous les nobles, de quelque caufe que
procédé leur nobleffe.
On diftingue. à la vérité plulieurs degrés dans .la
nobleffe ; favoir celiji des fimples gentilshommes nobles
ou écuyers ; celui de la haute nobleffe , qui
comprend les chevaliers, comtes, barons, & autres
fejgneurs ; & le plus élevé de tous, qui eft celui des
princes. Le degré de la haute nobleffe peut encore
recevoir plufieurs fubdivifions pour le r a n gm a is
encore une fois il ri’y a point de diftinâion entre les
nobles par rapport aux différentes caufes dont peut
procéder.leur nobleffe. On ne.connoît d’autres dif-
tinûions parmi la nobleffe, que celles qui viennent
de l’ancienneté', ou de l’illultratiôn , ou de là puif-
fance que les nobles peuvent avoir à caufe de quelque
office dont ils feroient revêtus : tels que font
les offices de judicatUre, qui coîiferent au pourvu
l’exercice d’une partie de la puiffance publique.
Ce qui a pu faire croire à quelques-uns que toute
la robe étoit indiftin&ement dans le tiers-état, eft fans
doute que dans le dénombrement des gens de cet état
on trouve ordinairement en tête .certains magiftrats
ou officiers municipaux, tels que les prévôts des marchands
, les maires & échevins, capitouls, jurats,
confuls, & autres femblables officiers ; parce qu’ils
font établis pour repréfenter le peuple, qu’ils font à la
tête des députés du tiers-état pour lequel ils portent
la parole. On comprend aufli dans le tiers-état tous
les officiers de judicature & autres gens de robe non
nobles ; ôc même quelques-uns. qui font nobles, foit
d’extraftion ou par leur charge, lorfqu’en leur qualité
ils ftipulent pour quelque portion du tiers-état.
Il ne s’enfuit pas de-là que toute la robe indiftinc-
tement foit comprife dans le tiers-état ; les gens de
robe qui font nobles, foit de naiffance, ou à caufe
de leur office, ou autrement, doivent de leur chef
être compris dans Vétat de la nobleffe, de même que
les autres nobles.
Prétendrait- on que les .emplois de la robe font
incompatibles avec la nobleffe, ou que des maifons
dont l’origine eft toute militaire & d’ancienne chevalerie
, ayent perdu une partie de l’éclat de leur
nobleffe pour être entrées dans la magiftrature, comme
il y en a bëaucoup dans plufieurs cours fouve-
raines, & principalement dans les parlemens de Rennes
, d’Aix, & de Grenoble ? ce feroit avoir une idée
bien fauffe de la juftice, & connoître bien mal l’honneur
qui eft attaché à un fi noble emploi.
L’adminiftration de la juftice eft le premier devoir
des fouverains. Nos rois fe font encore honneur de
la rendre en perfonne dans leur confeil & dans leur
parlement: tous les juges la rendent en leur nom;
c’eft pourquoi l’habit royal avec lequel on les repréfente
, n’eft pas un habillement de guerre, mais
la toge ou robe longue avec la main de juftice, qu’ils
regardent comme un de leurs plus beaux attributs.
Les barons ou grands du royaume tenoient autrefois
feuls le parlement ; & dans les provinces la juftice
étoit rendue par des ducs, des comtes, des vicomtes,
& autres officiers militaires qui étoient tous
réputés nobles, & fiégeoient avec leur habit de guerre
& leurs armes.
Les princes du fang & les ducs & pairs concourent
encore à l’adminiftration de la juftice au parlement.
Ils y venoient autrefois en habit long ôc fans
épée; ce ne fut qu’en 15S1 qu’ils commencèrent à
en ufer autrement, maigre les remontrances du parlement,
qui repréfenta que de toute ancienneté ceta
étoit refervé au roi feul. Avant M. de Harlai, lequel
fous Louis X ï V. retrancha une phrafe de la formule
du ferment des ducs & pairs, ils juroient dé fe cornporter
comme de bons & fages confeillers au parle*-
ment. . . r . . .
Les gouverneurs de certaines provinces font corn
feillers nés dans les cours fouveraines du chef-lieu de leur gouvernement. . . .
Les maréchaux de France, qui font les premiers
officiers militaires, font les juges de la nobleffe dans
les affaires d’honneur. '
Les autres officiers militaires font tous la fonction
de juges dans les confeils de guerre.
Nos rois ont aufli établi dans leurs confeils des
confeillers d’épée, qui prennent rang & féance avec
les confeillers de robe du jour de leur réception.
Ils ont pareillement établi des chevaliers d honneur
dans les cours fouveraines, pour reprefenter
les anciens barons ou chevaliers qui rendoient autrefois
la juftice.
Enfin les baillis & fénéchaüx epu font à la tete des
jurifdiétions des bailliages & fénéchauffées, non-feulement
font des officiers d’épée, mais ils doivent etre
nobles. Ils fiégent l’épée au côté, avec la toque garnie
de plumes, comme les ducs & pairs ; ce font eux
qui ont l’honneur de conduire la nobleffe à l’armée,
lorfque le ban & l’arriere-ban font convoqués pour
le fervice du roi. Ils peuvent outre cet o ffice, remplir
en même tems quelque place militaire, comme
on en voit en effet plufieurs. ^ # .
Pourroit-on après cela prétendre que l’admimftra-
tion de la juftice fut une fonction au-deffous de la
nobleffe? .
L’ignorance des barons qui ne favoient la plupart
ni lire ni écrire, fut caufe qu’on leur affocia des gens
de loi dans le parlement ; ce qui ne diminua rien de
la dignité de cette cour. Ces gens de loi furent d a-
bord appellés les premiers fénateurs, maîtres du parlement
, & enfuite préjidens & confeillers. Telle fut 1 o-
rigine des gens de robe, qui furent enfuite multiplies
dans tous les tribunaux.
Depuis que l’adminiftration de la juftice fut confiée
principalement à des gens de lo i, les barons ou
chevaliers s’adonnèrent indifféremment, les uns à
cet emploi, d’autres à la profeflion des armes ; les
.premiers étoient appellés chevaliers en lois ; les Wjfe
très, chevaliers d?armes. Simon de B u c y premier pre
fident du parlement en 1344» eft qualifie de chevalier
en lois ; & dans le même tems Jean le Jay preli-
dent aux enquêtes , étoit qualifie de^ chevalier. Les
préfidens du parlement qui ont fuccédé dans cette
fonûion aux barons, ont encore retenu de-là le titre & l’ancien habillement de chevalier.
Non-feulement aucun office de judicature ne fait
décheoir de l’état de nobleffe, mais plufieurs de ces
offices communiquent la nobleffe à ceux qui ne 1 ont
pas, 6c à toute leur poftérité. _
Le titre même de chevalier qui diftingue la plus haute
nobleffe, a été accordé aux premiers magiftrats.
Ils peuvent pofféder des comtés, marquifats, baronnies
; & le roi en érige pour eux de même que
pour les autres nobles : ils peuvent en prendre le titre
non-feulement dans les aûes qu’ils paffent, mais
fe faire appeller du titre de ces feigneuries. Cet ufa-
ge eft commun dans plufieurs provinces, & cela n’eft
pas fans exemple à Paris : le chancelier de Chiverni
fe faifoit appeller ordinairement le comte de Chiyerni;
& fi cela n’eft pas plus commun parmi nous, c’eft que
nos magiftrats préfèrent avec raifon de fe faire appeller
d’un titre qui annonce la puiffance publique
dont ils font revêtus, plûtôt que de porter le titre
d’une fimple feigneurie.
Louis X IV . ordonna en 1665 qu’il y auroitdanS
fon ordre de S. Michel fix chevaliers de robe.
Enfin le duché-pairie de Villemor fut érigé pour
le chancelier Séguier , & n’a été éteint que faute
d’hoirs mâles.
Tome VI.
fo u t cela prouve bien que la nobleffe de robe ne
forme qu’un feul & même ordre avec la nobleffe
d’épée. Quelques auteurs regardent même la première
comme la principale : mais fans entrer dans
cette difeuflion, il fuffit d’avoir prouvé qu’elles tiennent
l’une & l’autre le même rang, & qu’elles participent
aux mêmes honneurs, aux mêmes privilèges,
pour que l’on ne puiffe renvoyer toute la robe dans
le tiers-éiat.
M. de Voltaire en fon hiftoire univerfelie, iom. I I .
pag. 240, en parlant du mépris que les nobles d’armes
font de la nobleffe de robe, ôc du refus que l’on
fait dans les chapitres d’Allemagne, d’v recevoir cette
nobleffe de robe, dit que c’eft un refte de l’ancienne
barbarie d’attacher de l’aviliffement à la plus belle
fonction de l’humanité, celle de rendre la juftice.
Ceux qui feroient en état de prouver qu’ils défi-
cendent de ces anciens Francs qui formèrent la première
nobleffe, tiendroient fans contredit le premier
rang dans l’ordre de la nobleffe. Mais combien y a-
t-il aujourd’hui de maifons qui puiffent prouver une
filiation fuivie au-deffus du xij. ou xiij. fiede ?
L’origine de la nobleffe d’épée eft à la vérité plus
ancienne que celle de la nobleffe de robe : mais tous
les nobles d’épée ne font pas pour cela plus anciens
que les nobles de la robe. S’il y a quelques maifons
d’épée plus anciennes que certaines maifons de robe
, il y a aufli des maifons de robe plus anciennes
que beaucoup de maifons d’épée.
Il y a même aujourd’hui nombre de maifons des
plus illuftres dans l’épée qui tirent leur origine de la
robe, & dans quelques - unes les aînés font demeurés
dans leur premier état, tandis que les cadets ont pris
le parti des armes : diroit-on que la nobleffe de ceux-
ci vaille mieux que celle de leurs aînés ?
Enfin quand la nobleffe d’épée en général tien-
droit par rapport à fon ancienneté le premier rang
dans l’ordre de la nobleffe, cela n’empêcherôit pas
que la nobleffe de robe ne fut comprife dans le même
ordre ; & il feroit abfurde qu’une portion de la
nobleffe aufli diftinguée qu’eft celle-ci, qui join t de
tous les mêmes honneurs & privilèges que lés autres
nobles, ffit exceptée du rôle de la nobleffe, qui n’eft
qu’une fuite de la qualité de nobles, & qu’on la renvoyât
dans le tiers état, qui eft la claffe des roturiers
, précifément à caufe d’un emploi qui donne
la nobleffe, ou du moins qui eft compatible avec la
nobleffe déjà acquife.
Si là magiftrature étoit dans le tiers-état, elle ferait
du moins à la tête; au lieu que ce corps a toû-
jours été repréfenté par les officiers municipaux feu-,
lement.
Qu’on ouvre les procès-verbaux de nos coûtu-
mes, on verra par-tout que le s gens de robe qui
étoient nobles par leurs charges ou autrement, font
dénommés entre ceux qui compofoient lY/<zf de nobleffe
, & que l’on n’a compris dans le tiers-état que
les officiers municipaux ou autres officiers de judicature
qui ifétoient pas nobles, foit par leurs charges
ou autrement.
Pour ce qui eft des états, il eft vrai que les magif-
trats ne s’y trouvent pas ordinairement, foit pour
éviter les difcuflîons qui pourraient furvenir entre
eux & les nobles d’épée pour le rang 6c la préféance *
foit pour conferver la fupériorité que les cours ont
fur les états.
Il y eut en 15 58 une affemblée de notables, tenue
en une chambre du parlement. La magiftrature y prit
pour la première fois féance ; elle n’y fut point ppn-*
tondue dans le tiers-état ; elle formoit un quatrième,
ordre diftingué des trois autres, & qui n’etoif point
inférieur à celui de la nobleffe. Mais cet arrangement
n’étoit point dans les principes, n’y ayant en.France
que trois ordres ou états, ôc qu’un feul ordre de no-.