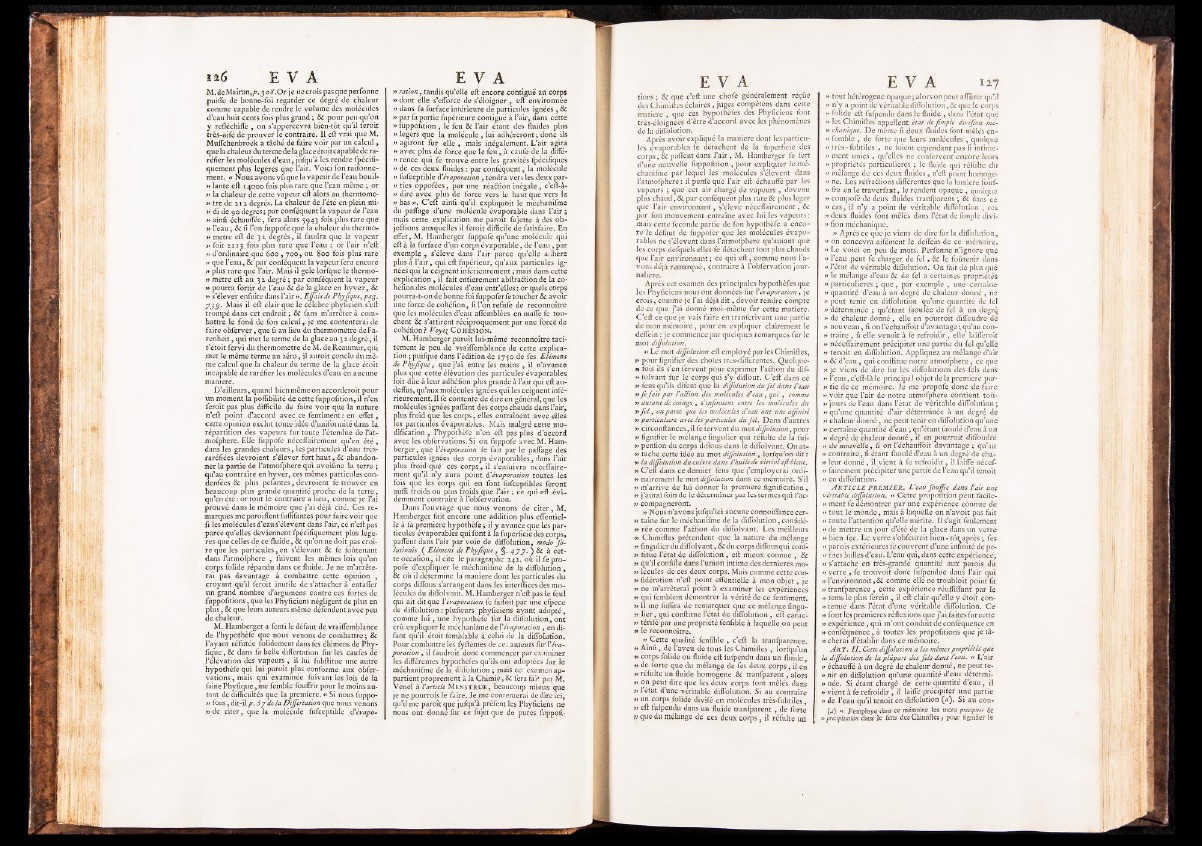
M. de Mairan,./». 30 8.Or je ne crois pas que perfonne
puiffe de bonne-foi regarder ce degré de chaleur
comme capable de rendre le volume des molécules
d’eau huit cents fois plus grand ; & pour peu qu’on
y refléchiffe , on s’appercevra bien-tôt qu’il feroit
très-aifé de prouver le contraire. Il eft vrai que M.
Muffchenbroek a tâché de faire voir par un calcul,
que la chaleur du terme de la glace étoit capable de raréfier
les molécules d’eau, jufqu’à les rendre fpécifi-
quement phis legeres que l’air. Voici fon rayonnement.
« Nous avons vu que la vapeur de l’eau bouil-
» Iante eft 14000 fois plus rare que l’eau même ; or
» la chaleur de cette vapeur eft alors au thermome-
»» tre de z i z degrés. La chaleur de l’été en plein mi-
» di de 90 degrés; par conféquent la vapeur de l’eau
» ainfi échauffée, fera alors 5943 fois plus rare que
» l’eau ; & fi l’on fuppofe que la chaleur du thermor
» métré eft de 3 z degrés, il faudra que la vapeur
» foit z i 13 fois plus rare que l’eau : or l’air n’eft
» d’ordinaire que 600,700, ou 800 fois plus rare
» que l’eau, & par conféquent la vapeur fera encore
» plus rare que l’air. Mais il gele lorfque le thermo-
» métré eft au 3 z degré ; par conféquent la vapeur
» pourra fortir de l’eau & de la glace en hyver, &
» s’élever enfuite dans l’air ». EJJais de Phyfique^pag.
7 3 9 . Mais il eft clair que le célébré phyficien s’eft
trompé dans cet endroit ; & fans m’arreter à combattre
le fond de fon calcul, je me contenterai de
faire obferver, que fi au lieu du thermomètre deFa-
renheit, qui met le terme de la glace au 3 z degré, il
s’étoit fervi du thermomètre de M. de Reaumur, qui
met le même terme au zéro, il auroit conclu du même
calcul que la chaleur du terme de la glace étoit
incapable de raréfier les molécules d’eau en aucune
maniéré.
D ’ailleurs, quand bienmêmeonaccorderoitpour
un moment la poflibilité de cette fuppofition,il n’en
feroit pas plus difficile de faire voir que la nature
n’eft point d’accord avec ce fentiment : en effet,
cette opinion exclut toute idée d’uniformité dans la
répartition des vapeurs fur toute l’étendue de l’at-
mofphere. Elle fuppofe néceffairement qu’en été ,
dans les grandes chaleurs, les particules a’eau très-
raréfîées devroient s’élever fort haut, & abandonner
la partie de l’atmofphere qui avoifine la terre ;
qu’au contraire en hyver, ces mêmes particules con-
denfées & plus pefantes, devroient fe trouver en
beaucoup plus grande quantité proche de la terre,
qu’en été: or tout le contraire a lieu, comme je l’ai
prouvé dans le mémoire que j’ai déjà cité. Ces remarques
me paroiffent fuffifantes pour faire voir que
fi les molécules d’eau s’élèvent dans l’air, ce n’eft pas
parce qu’elles deviennent fpécifiquement plus legeres
que celles de ce fluide, & qu’on ne doit pas croire
que les particules, en s’élevant & fe foûtenant
dans l’atmofphere , fuivent les mêmes lois qu’un
corps folide répandu dans ce fluide. Je ne m’arrêterai
pas davantage à combattre cette opinion ,
croyant qu’il feroit inutile de s’attacher à entaffer
un grand nombre d’argumens contre ces fortes de
fuppofitions, que les Phyficiens négligent de plus en
plus, & que leurs auteurs même défendent avec peu
de chaleur.
M. Hamberger a fenti le défaut de vraiffemblance
de l’hypothèfe que nous venons de combattre ; &
l’ayant réfutée lolidement dans fes élémens de Phy-
ficjue, & dans fa belle differtation fur les caufes de
l’élévation des vapeurs , il lui fubftitue une autre
hypothèfe qui lui paroît plus conforme aux obfer-
vations, mais qui examinée fuivant les lois de la
faine Phyfique, me femble fouffrir pour le moins autant
de difficultés que la première. « Si nous fuppo-
» fons, dit-il p. 5y de la Differtation que nous venons
» d e citer, que la molécule fufceptible à’évapo-
» ration, tandis qu’elle eft encore contiguë au corps
» dont elle s’efforce de s’éloigner , eft environnée
» dans fa furface intérieure de particules ignées , &
» par fa partie fupérieure contiguë à l’air, dans cette
» fiippofition, le feu & l’air étant des fluides plus
» légers que la molécule , lui adhéreront ; donc ils
» agiront fur elle , mais inégalement. L’air agira
» avec plus de force que le feu ,.à caufe de la diffé-
» rence qui fe trouve entre les gravités fpécifiques
» de ces deux fluides : par conféquent, la molécule
» fufceptible d'évaporation, tendra vers les deux par-
» ries oppofées, par une réaâion inégale , c’eft-à-
» dire avec plus de force vers le haut que vers le
» bas ». C ’eft ainfi qu’il expliquoit le méchanifme
du paffage d’une molécule évaporable dans l’air ;
•mais cette explication me paroît fujette à des ob-
jeftions auxquelles il feroit difficile de fatisfaire. En
effet, M. Hamberger fuppofe qu’une molécule qui
eft à la furface d’un corps évaporable, de l’eau, par
exemple , s’élève dans l’air parce qu’elle adhéré
plus à l’air, qui eft fupérieur, qu’aux particules ignées
qui la ceignent inférieurement ; mais dans cette
explication, il fait entièrement abftrattion de la co-
héfion des molécules d’eau entr’elles : or quels corps
pourra-t-on de bonne foi fuppofer fe toucher & avoir
une force de cohéfion, fi l’on refufe de reconnoître
que les molécules d’eau affemblées en maffe fe touchent
& s’attirent réciproquement par une force de
cohéfion? Voye^ COHESION.
M. Hamberger paroît lui-même reconnoître tacitement
le peu de vraiffemblance de cette explication
;puifque dans l’édition de 1750 de fes Elémens
de Phyfique , que j ’ai entre les mains , il n’avance
plus que cette élévation des particules évaporables
foit due à leur adhéfion plus grande à l’air qui eft au-
deffus, qu’aux molécules ignées qui les ceignent inférieurement.
Il fe contente de dire en général, que les
molécules ignées paffant des corps chauds dans l’air,
plus froid que les corps, elles entraînent avec elles
les particules évaporables. Mais malgré cette modification
, l’hypothèfe n’en eft pas plus d’accord
avec les obfervations. Si on fuppofe avec M. Hamberger,
que l’évaporation fe fait par le paffage des
particules ignées des corps évaporables, dans l’air
plus froid que ces corps, il s’enfuivra néceffairement
qu’il n’y aura point d’évaporation toutes les
fois que les corps qui en font fufceptibles feront
auffi froids ou plus froids que l’air ; ce qui eft évidemment
contraire à I’obfervation.
Dans l’ouvrage que nous venons de cite r, M.
Hamberger fait encore une addition plus effentiel-
le à fa première hypothèfe ; il y avance que les particules
évaporables qui font à la fuperficie des corps,
paffent dans l’air par voie de diffolution, modo fo~
lutionis ( Elémens de Phyfique, § . 4J7y . ) & à cette
occafion, il cite le paragraphe Z4Z. où il fe jpro-
pofe d’expliquer le méchanifme de la diffolution ,
& où il détermine la maniéré dont les particules du
corps diffous s’arrangent dans les interftices des molécules
du diffolvant. M. Hamberger n’eft pas le feul
qui ait dit que l’évaporation fe failoit par une efpece
de diffolution : plufieurs phyficiens ayant adopté,
comme lu i , une hypothèfe fur la diffolution, ont
crû expliquer le méchanifme de l’évaporation, en di-
fant qu’il étoit femblable à celui de la diffolution.
Pour combattre les fyftèmes de ces auteurs fur l’évaporation
, il faudroit donc commencer par examiner
les différentes hypothèfes qu’ils ont adoptées fur le
méchanifme de la diffolution ; mais cei examen appartient
proprement à la Chimie, & fera fait par M.
Venel à Y article Menstrue, beaucoup mieux que
je ne pourrois le faire. Je me contenterai de dire ici,
qu’il me paroît que jufqu’à préfent les Phyficiens ne
nous ont donne fur ce fujetque de puresjfuppofi-.
tîons ; & que c’eft une chofe généralement reçue
des Chimiftes éclairés, juges compétens dans cette
matière , que ces hypothèfes des Phyficiens font
très-éloignées d’être d’accord avec les phénomènes
de la diffolution.
Après avoir expliqué la maniéré dont les particules
évaporables fe détachent de la fuperficie des
corps, & paffent dans l’air , M. Hamberger fe fert
d’une nouvelle fuppofition, pour expliquer le méchanifme
par lequel les molécules s’élèvent dans
l ’atmofphere : il penfe que l’air eft échauffé par les
vapeurs ; que cet air chargé de vapeurs , devenu
plus chaud, & par conféquent plus rare & plus leger
que l’air environnant, s’élève néceffairement, &
par fon mouvement entraîne avec lui les vapeurs :
mais cette fécondé partie de fon hypothèfe a encore
le défaut de fuppofer que les molécules évaporables
ne s’élèvent dans l’atmofphere qu’autant que
les corps defquels elles fe détachent font plus chauds
que l’air environnant ; ce qui eft, comme nous l’avons
déjà remarqué, contraire à l’obfervation journalière.
Après cet examen des principales hypothèfes que
les Phyficiens nous ont données fur l’évaporation, je
crois, comme je l’ai déjà d it , devoir rendre compte
de ce que j’ai donné moi-même fur cette matière.
C ’eft ce que je vais faire en tranfcrivant une partie'
de mon mémoire, pour en expliquer clairement le
deffein : je commence par quelques remarques fur le
mot diffolution.
« Le mot diffolution eft employé par les Chimiftes,
» pour lignifier des choies tres-différentes. Quelque-
n fois ils s’en fervent pour exprimer l’aftion du dif-
» folvant fur le corps qui s’y diffout. C ’eft dans cé
» fens qu’ils difent que la diffolution dufel dans Peau
» fe fait par l'action des molécules (Peau , qui , comme
» autant de coings , s’infinuent entre les molécules du
» f e l , ou parce que les molécules d’eau ont une affinité
» particulière avec les particules du fel. Dans d’autres
» circonftances,iLfe fervent du mot diffolution, pour
» lignifier le mélange fingulier qui réfulte de la fuf-
» penfion du corps diffous dans le diffolvant. On at-
» tache cette idée au mot diffolution, lorfqu’on dit :
» la diffolution du cuivre dans l'huile dé vitriol efl bleue.
» C’eft dans ce dernier fens que j’employerai ordi-
» nairement le mot diffolution dans ce mémoire. S’il
» m’arrive de lui donner la première lignification,
» j ’aurai foin de le déterminer par les termes qui l’ae-
» compagneront.
» Nous n’avons jufqu’ici aucune connoiffance cér-
» taine fur le méchanifme de la diffolution, confidé-
» rée comme l’a&ion du diffolvant. Les: meilleurs
» Chimiftes prétendent que la nature du mélange
» fingulier du diffolvant, & du corps diffous qui confi
» titue l’état de diffolution , eft mieux connue &
» qu’il confifte dans l’union intime des dernieres mo-
» lécules de ces deux corps. Mais comme cette con-
» fidération n’eft point effentielle: à mon ob jet, je
» ne m’arrêterai point à? examiner les expériences
» qui femblent démontrer la vérité de ce fentiment.
» 11 me fuffira de remarquer que ce mélange fingu-
» lier, qui conftitue l’état de diffolution , eft carac-
» térifé par une propriété fenfible à laquelle on peut
» le reconnoître.
» Cette qualité fenfible , c’eft la tranfparence.
» Ainfi, de l’aveu de tous les Chimiftes , : lorfqu’un
» corps folide ou fluide eft fufpendu dans un fluide',
» de- forte que du mélange de fes deux corps-, il en
» réfulte un fluide homogène & tranfparent, alors
» on peut dire que les deux corps font mêlés dans
» l’état d’une véritable diffolution. Si au contraire
» un corps folide divifé en molécules très-fubtiles,
» eft fufpendu dans un fluide tranfparent , de forte
p que du mélange de ces deux corps, il réfulte un
» tout hétérogène Opaque ; alors on peut affûrer qu’il
» n’y a point de véritable diffolution, & que le corps
» folide eft fufpendu dans le fluide , dans l’état que
» les Chimiftes appellent état de fimple divijîoh mé-
» chanique. De même fi deux fluides font mêlés en-
» femble , de forte que leurs molécules , quoique
» très - fubtiles , ne foient cependant pas fi intime-
» ment unies , qu’elles ne confervent encore leurs
» propriétés particulières ; le fluide qui réfulte du
» mélange de ces deux fluides, n’eft point homoge-
» ne. Les réfractions différentes que la lumière foüfi-
» ffe en le traverfaat, le rendent opaque , quoiqii.é
» compofé de deux fluides tranfparens ; & dans ce
» cas, il n’y a point de véritable diffolution ; ces
» deux fluides font mêlés dans l’état de fimple divi-
» fiôn méchanique.
» Après ce que je viens de dire fur la diffolution,
» on concevra aifément le deffein de ce mémoire.
» Le voici en peu de mots. Perfonne n’ignore que
» l’eau peut fe charger de f e l , & le foûtenir dans
» l’état de véritable diffolution. On fait de plus que
» le mélange d’eau & de fel a certaines propriétés
» particulières ; que , par exemple , une certaine
» quantité d’eau a un degré de chaleur donné , né
» petit tenir en diffolution qu’une quantité de fel
» déterminée ; qu’étant faoufée de fel à un degré
» de chaleur donné , elle en pourroit diffoudre dê
» nouveau, fi on l’échauffoit d’avantage ; qu’au COn-
» traire , fi elle venoit à fe refroidir, elle laifferoit
» néceffairement précipiter une partie du fel qü’ellé
» tenoit en diffolution. Appliquez au mélange d’air
» & d’eau , qui conftitue notre atmofphere, ce que
» je viens de dire fur lés diffolutionS des fels dans
» l’eau, c’eft-là le principal objet de là première par-
» tie de ce mémoire. Je me propofe donc de faire
>■> voir que l’air de notre atmofphere contient toû-
» jours de l’eau dans l’état de véritable diffolution ;
» qu’une quantité d’air déterminée à un degré dé
» chaleur donné, ne peut tenir en diffolution qti’unè
» certaine quantité d’eau ; qu’étant faoulé d’eau à un
» degré de chaleur donné',, il en pourroit diffoudrê
» de nouvelle , fi on l ’échauffoit davantage' ; qu’au
» contraire, fi étant fabulé d?eau à un degré' de cha-
» leur donné , il vient à fe refroidir, il laiffe nécef-
» fairement précipiter une partie de l’eau qu’il tenoit
» en diffolution.
A r t ic l e p r em ie r . L ’eau foujfre dans Pair une
véritable diffolution. « Cette propofition peut facilé-
» ment fe démontrer par une expérience connue de
» tout le monde, mais à laquelle on n’avoit pas fait
» toute l’attention qu’elle mérite. Il s’agit feulement
» de mettre un jour d’été de la glace dans Un verre
» bien fec. Le verre* s’bbfcurcit bien - tôi^après ; fes
» parois extérieures fè couvrent d’une infinité de pe-
» rites bulles d’eau. L’eatt qui, dans cette expérience,
» s’attache en très-grande quantité' aux patois du
» verre , fe trouvoit donc fufpendUe dans l’air qui
» l’environnoit,& comme elle ne troubloit point fà
» tranfparence , cette expérience réuffiffarit par lé
» tems le plus ferein, il eft clair qu’elle y étoit con-
» tenue dans l’état d’une véritable diffolution. Cé
» font les premières réflexions que j’ai faites fur cette
» expérience, qui m’ont conduit de eonféquence en
» eonféquence, à toutes les propofitions que je tâ-
» cherai d?établir dans ce mémoire.
A r t . II. Cette diffolution aies mêmes propriétés que
la diffolution de la plupart des fels dans Peau. « L’air-
» échauffé à un degré de chaleur donné, ne peut te-
» nir en diffolution qu’une quantité d’eaii détermi-
» née. Si étant chargé de cette quantité d’eau, il
» vient à fe refroidir, il laiffe précipiter une partie
» de l’eau qu’il tenoit en diffolution (a). Si au con*
(<*) « J’employe dans ce mémoire les mots précipiter &
3) précipitation dafts le fens des Chimiftes, pour fignifier le