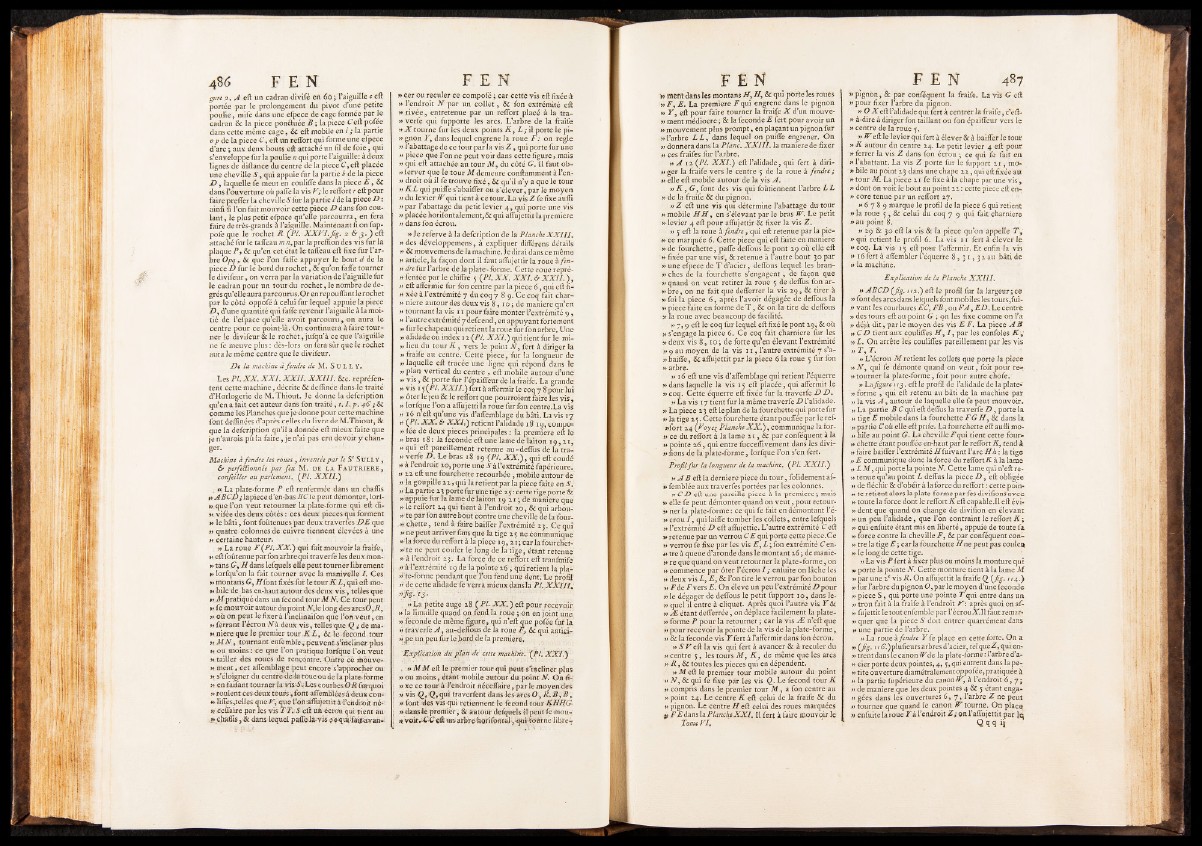
pire z . A eft un cadran divifé en 6ô ; l’aiguillé t eft
portée par le prolongement du pivot d’une petite
poulie, mile dans une efpece de cage formée par le
cadran & la piece pon&uée B ; la piece C eft pofée
dans cette même cage, èc eft mobile en i ; la partie
op de la piece C , eft un reflort qui forme une efpece
d’arc ; aux deux bouts eft attaché un fil de fo ie , qui
s’enveloppe fur la poulie n qui porte l’aiguille: à deux
lignes de diftance du centre de la piece C , eft placée
une cheville S , qui appuie fur la partie b de la piece
D , laquelle fe meut en couliffe dans la piece E , &
dans l’ouverture où paffe la vis V; le reffort r eft pour
faire preffer la cheville S fur la partie / de la piece D :
ainfi fi l’on fait mouvoir cette piece D dans fon coulant
, le plus petit efpace qu’elle parcourra, en fera
faire de très-grands à l’aiguille. Maintenant fi on fup-
pofe que le rochet R. (JPI. X X V I . fig. 2. 6* 3 . ) eft
attaché fur le tafleau m ra, par la preftion des vis fur la
plaque P , & qu’en cet état le tafleau eft fixe fur l’arbre
Opq, & que l’on fafle appuyer le bout d de la
piece D fur le bord du rochet, & qu’on fafle tourner
le divifeur, on verra par la variation de l’aiguille fur
le cadran pour un tour du rochet, le nombre de degrés
qu’elle aura parcourus.Or en repouflant le rochet
par le côté oppofé à celui fur lequel appuie la piece
D y d’une quantité qui fafle revenir l’aiguille à la moitié
de l’eipace qu’elle avoit parcouru, on aura le
centre pour ce point-là. On continuera à faire tourner
le divifeur & le rochet, jufqu’à ce que l’aiguille
ne fe meuve plus : dès-lors on fera sur que le rochet
aura le même centre que le divifeur.
D t la machine à fendre de M. SU L L Y .
Les PL X X . X X I . X X I I . X X I I I . &c. repréfen-
tent cette machine, décrite & deflïnée dans-le traité
d’Horlogerie de M.Thiout. Je donne la defeription
qu’en a fait cet auteur dans fon traité, t. I .p . 46',* &
comme les Planches que je donne pour cette machine
font deflinées d’après celles du livre de M.Thiout, &
que la defeription qu’il a donnée eft mieux faite que
je n’aurois pu la faire, je n’ai pas cru devoir y changer.
Machine à fendre les roues , inventée par le Sr SULLY,
& perfectionnée par feu M. DE LA FAUTRIERE,
confeiller au parlement. (PL X X I I .)
. « La plate-forme P eft renfermée dans un chaflis
» A B C D ; lapiece d’en-bas BCfe peut démonter, lorf-
» que l’on veut retourner la plate-forme qui eft di-
». vifée des deux côtés : ces deux pièces qui forment
» le bâti, font foûtenues par deux traverses D E que
» quatre colonnes de cuivre tiennent élevées à une
w certaine hauteur.
» La roue F (PL X X .) qui fait .mouvoir la fraife,
»> eft foûtenue par fon arbre qui traverfe les deux mon-
»tans Gy Zf dans lefquels elle peut tourner librement
» lorfqu’on la fait tourner avec la manivelle /. Ces
» mont ans Gy H (ont fixés fur le tour ÜC Z,, qui eft mo-
» bile de bas en-haut autour.des deux vis., telles que
» M pratiqué dans un fecond.tour M N. Ce tour peut :
» fe mouvoir autour du point N,le long desarcsO,A,
» oh on peut le fixer à l’inelinaifon que l’ofi veut, en
» ferrant l ’écrou -Nk deux v is , telles que Q_ ,• de ma-
» nière que le premier tour K L , & le|fécond tour
nM N y tournant enfemble, peuvent, s’incliner plus
» ou moins : ce que l’on pratique lorfque l ’on, veut
« tailler des roues de rençqntre. Outre ce rirâuve--
« ment, cet aflemblage peut encore s’approcher ou
» s’éloigner du centrè.deia roue ou de la plate-forme
» en faSant tourner Ja VisiS* Les courbes;0 :ft fiærquoi
» roulent ces deux tours y fiant aflembléesà deux cou-
♦ » liflèsjîelles queF, queFoha'flujcttit à l’en droit né-
« eefiaire par les vis T T.-S eft ufi écrou quipieftt au
« chaflis , & dans lequel pafle la-vis ç^quiifafcavan--
» cer ou reculer ce compofé ; car cette vis eft fixée à
» l ’endroit H par un c o lle t, & fon extrémité eft
» r iv é e , entretenue par un reflort placé à la tra-
» verfe qui fupporte les arcs. L’arbre de la fraife
» X tourne fur les deux points K , L ; il porte le pi-
» gnon T , dans lequel engrene la roue F : on réglé
» l’abattage de ce tour par la vis Z , qui porte fur une
» piece que l’on ne peut voir dans cette figure, mais
» qui eft attachée au tour M , du côté G. 11 faut ob-
» lerver que le tour M demeure conftamment à l’en-
» droit où il fe trouve fixé, & qu’il n’y a que le tour
» K L quipuiffes’abaiffer ou s ’élever, par le moyen
» du levier JF qui tient à ce tour. La vis Z fe fixe aufli
»par l’abattage du petit levier 4 , qui porte une vis
» placée horifontalement,& qui aflujettit la première
» dans fon écrou.
» Je referve à la defeription de la Planche X X I I I .
» des développemens, à expliquer différens détails
» &mouvemens de la machine. Je dirai dans ce même
» article, la façon dont il faut affujettir la roue kfen-
» dre fur l’arbre de la plate-forme. Cette roue repré-
» fentée par le chiffre 5 (JPL X X . X X I . & X X I I . ) ,
» eft affermie fur fon centre par la piece 6 , qui eft fi-
» xée à l’extrémité 7 du coq 7 8 9. C e coq fait char-
» niere autour des deux vis 8 , 1 0 ; de maniéré qu’en
» tournant la vis 11 pour faire monter l’extrémité 9 ,
» l’autre extrémité 7 defeend, en appuyant fortement
» fur le chapeau qui retient la roue fur fon arbre. Une
» afidade ou index 1 z (P L X X I .) qui tient fur le mi-
» lieu du tour K , vers, le point N , fert à diriger la
» fraife au centre. Cette piece, fur la longueur de
»laquelle eft tracéé‘une ligne qui répond dans le
» plan vertical du centre , eft mobile autour d’une
» v is , & porte fur l’épaiffeur de la fraife. La grande
» vis 15 (PL X X I I .) fert à affermir le coq 7 $ pour lui
» ôter le jeu & le reffort que pourraient faire les vis ,
» lorfque l’on a affujetti la roue fur fon centre.La vis'
» 16 n’eft qu’une vis d’affembïage du bâti. La vis 1 7
» (PL X X . & X X I .) retient l’alidade 18 19, compo-
» lee de deux pièces principales : la première eft le
» bras 18 : la fécondé eft une lame de laiton 1 9 ,2 1 ,
»qui eft pareillement retenue au-deffus de là tra-
» verfe D . Le bras 18 19-(P L X X . ) , qui eft coudé
» à 1 endroit 20, porte une >£ à l’extrémité fupérieure.
> f 22 eft une fourchette recourbée, mobile autour de
» la goupille 22, qui la retient.par la piece faite en S.
» La partie 23 porte fur une tige 2 5 : cette tige porte &
»appuie fur la lame de laiton 19 21 ; de ùiâniefe que
» le reflort 24 qui tient à Tendrait 20, & qui arbou-
» fe par fon autre bout contre Une cheville dé la four-
.» chette, tend à faire baiffer l’extrémité 23. Ce qui
» ne peut arriver fans que la tige 2 5 ne èommimique
» la force du reffort à la piece 19,2 i; car la fourchet-
» te ne peut couler le long de la tige, étant retenue
» à l’endroit 23; La force de ce reffort eft tranfmifë
» à l’extrémité 19 delà pointe 2t5 , qui retient la pla-
>f te-forme pendant que Ton fend une dent. L e prpfil
» de cette alidadeffe verra mieux dansla Pl.JXXÎII.
)
. » La petite auge 28 ( PL X X . ) eft pour recevoir
» la limaille quand pn. fend la roue ; on en jpint iiné
» fécondé de même fig111"6» qui n’eft que pofée Cuf la
» frayërfe A , au-deflous de la roue F , & qui antiçi-
»\pe un peu fur le bord de la première.
~Explïcà’tibh du plHd de cette ma'chhh. FPl. X X I .)
. » M M eft le premier tour qui peitt-S’incliner {)liis
» ou moins, étant mobile autour du point N-. On fi-
» xe ce touYà Tendrait néceffaire, par le moyen des
» v is Q , Q, qui traverfent dans les arcs O , R. B , 5 ,
» fiant des vis qui retiennent le feeond tour IÇHHG.
» dans le premier, & autour defquéls -il peut fe mou-
n v o i t u n - arbre horilbntal libre«
» ment dans les montans Hy Zf, & qui porte les rodes
» F , E. La premiere F qui engrene dans le pignon
» T , eft pour faire tourner la fraife X d’un moiive-
» ment médiocre ; & la fécondé E fert pour avoir un
» mouvement plus prompt, en plaçant un pignon fur
» l’arbre L L , dans lequel on puiffe engrener. On
» donnera dans la Plane. X X I I I . la maniéré de fixer
» ces fraifes fur Tarbre.
» A 12 (PL X X I .) eft l’alidade, qui fert à diri-
» ger la fraife vers le centre 5 de la roue à fendre ;
» elle eft mobile autour de la vis A .
» K , G , font des vis qui foùtiennent Tarbre L L
» de la fraife & du pignon.
» Z eft une vis qui détermine l’abattage du tour
»mobile H H , en s’élevant par le bras W. Le petit
» levier 4 eft pour affujettir & fixer la vis Z .
» 5 eft la roue à fendre, qui eft retenue par la pie-
» ce marquée 6. Cette piece qui eft faite en maniéré
» de fourchette, paffe deffons le pont 29 où elle eft
» fixée par une vis*, & retenue à l’autre bout 30 par
» une efpece de T d’acier, deffbus lequel les bran-
» ches de la fourchette s’engagent, de façon que
•»qnand on veut retirer la roue 5 de deffus fon ar-
» bre, on ne fait que defferrer la vis 29, & tirer à
» foi la piece 6 , après l’avoir dégagée de deffous la
» piece faite en forme de T , & on la tire de deffous
» la roue avec beaucoup de facilité.
» 7 ,9 eft le coq fur lequel eft fixé le pont 29, & où
» s’engage la piece 6. Ce coq fait charnière fur les
» deux vis 8 ,10 ; de forte qu’en élevant l’extrémité
» 9 au moyen de la vis 1 1 , l’autre extrémité 7 s’a-
»baiffe, & aflujettit par la piece 6 la roue 5 fur fon
» arbre.
» 16 eft une vis d’affemblage qui retient l’équerre
» dans laquelle la vis 15 eft placée, qui affermit le
» coq. Cette équerre eft fixée fur la traverfe D D .
» La vis 17 tient fur la même traverfe D l’alidade.
» La piece 23 eft le plan de la fourchette qui porte fur
*> la tige 2 5. Cette fourchette étant pouflee par le ref-
»fort 24 (Voye£ Planche X X . ) , communique la fbr-
» ce du reffort à la lame 2 1 , & par conféquent à la
» pointe 26, qui entre fucceflivement dans les divi-
» fions de la plate-forme, lorfque Ton s’en fert.
Profil fur la longueur de la machine. (Pl. X X I I .)
» A B eft la derniere piece du tour, folidement af-
» femblée aux traverfes portées par les colonnes.
" » C D eft une pareille piece à la premiere; mais
» elle fe peut démonter quand on v eu t, pour retour-
» ner la plate-forme : ce 'qui fe fait en démontant l’é-
» crou I , qui laiffe tomber les collets, entre lefquels
» l’extrémité D eft affujettie. L’autre extrémité C eft
» retenue par un verrou C E qui porte cette piece.Ce
» verrou fe fixe par les vis Z , L ; fon extrémité C en-
*> tre à queue d’aronde dans le montant 26 ; de manie-
» re que quand on veut retourner la plate-forme, on
» commence par ôter l’écrou I ; enfuite on lâche les
» deux vis L , Z , & Ton tire le verrou par fon bouton
» .F de F vers E. On éleve un peu l’extrémité D pour
» le dégager de deffous le petit fupport 10, dans le-
» quel il entre à cliquet. Après quoi l’autre vis Y &
» Æ étant defferrée, on déplace facilement la plate-
» forme P pour la retourner ; car la vis Æ n’eft que
» pour recevoir la pointe de la vis de la plate-forme,
» & la fécondé vis T fert à l’affermir dans fon écrou.
» «S F eft la v is qui fert à avancer & à reculer du
»centre 5, les tours M , K , de même que les arcs
» R , & toutes les pieces qui en dépendent.
» M eft le premier tour mobile autour du point
» N y & qui fe fixe par les vis Q. Le fécond tour K
» compris dans le premier tour M , a fon centre au
» point 24. Le centre K eft celui de la fraife & du
» pignon. Le centre H eft celui des roues marquées
# F E dans la Planche X X I , Il fert à faùe mouvoir le
Tome V I«
» pignon, & par conféquent la fraife. La vis G eft
» pour fixer l’arbre du pignon.
» O AT eft l’alidade qui fert à centrer la fraife, c’eft-
» à-dire à diriger fon taillant ou fon épaiflëur vers le
» centre de la roue 5 .
» W eft le levier qui fert à élever & à baiffer le tout
» K autour du centre 24. Le petit levier 4 eft pour
» ferrer la vis Z dans fon écrou ; ce qui fe fait en
» 1 abattant. La vis Z porte fur le fupport 2 1 , mc^
» bile au point 23 dans une chape 22, qui eft fixée au
» tour M\ La piece 21 fe fixe à la chape par une vis',
» dont on voit le bout au point 22 : cette piece eft en-,
» core ténue par un reffort 27.
» 6 7 8 9 marque le profil de la piece 6 qui retient
» la roue 5 , & celui du coq 7 9 qui fait charnier©
»au point 8.
» 29 & 30 eft la vis & la piece qu’on appelle Tÿ
» qui retient le profil 6. La vis 11 fert à élever lè
»coq. La vis 15 eft pour l’affermir. Et enfin-la vis
» 16 fert à affembler l’équ.erïe 8 ,3 1 ,3 2 au bâti de
» la machine.
Explication de la Planche X X I I I .
» A B CD (fig. 1 iz.) eft le profil fur la largeur ; ce
» font des arcs dans leiquels font mobiles les tours,fui-
» vant les courbures EC, F B , ou F A , ED . Le centre
» des tours eft au point G ; on les fixe comme on l’a
» déjà dit, par le moyen des vis E F . La piece A B
» C D tient aux couliffes H f 7, par les confoles ZC ,‘
» L. On arrête les couliffes pareillement par les vis
» T , T ,
» L ’écrou M retient les collets que porte la piece
» N , qui fe démonte quand on veu t, foit pour re-^
» tourner la plate-forme, foit pour autre chofe.
» La figure 113. eft le profil de l’alidade de la plate»'
» forme , qui eft retenu au bâti de la machine par
» la vis A , autour de laquelle elle fe peut mouvoir.
» La partie B C qui eft deffus la traverfe D , porte la
» tige E mobile dans la fourchette F G H 9 & dans la
» partie C où elle eft prife. La fourchette eft aufli mo-
» bile au point G. La cheville Fqui tient cette four-
» chette étant pouflee en-haut par le reffort K f tend à
» faire baiffer l’extrémité Tffuivant l’arc H h : la tige
» E communique donc la force du reffort i f à la lame
» LM y qui porte la pointe N. Cette lame qui n’eft re-
» tenue qu’au point L deffus la piece D , eft obligée
» de fléchir & d’obéir à la force du reffort : cette poin-
» te retient alors la plate-forme par fes divifionS avec
» toute la force dont le reflort A eft capable.il eft ëvi-
» dent que quand on change de divifion en élevant
» un peu l’alidade, que Ton contraint le reffort K ;
» qui enl'uite étant mis en liberté, appuie de toute fa
» force contre la cheville F , & par conféquent con-
» tre la tige E ; car la fourchette H ne peut pas couler
» le long ae cette tige. .
» La vis P fert à fixer plus ou moins la monture qui
» porte la pointe N. Cette monture tient à la lame M
» par une 2e vis R. On aflujettit la fraife Q Çfig. 114.)
» fur Tarbre du pignon O, par le moyen d’une fécondé
» piece S , qui porte une pointe T qui entre dans un
» trou fait à la fraife à l’endroit V: après quoi on af-
» fujettit le tout enfemble par TécrouÂf.Il faut remar-
» quer que la piece S doit entrer quarrément dans
» une partie de Tarbre.
» La roue à fendre Y fe place en cette forte. On a
» (fig. 11 C.)plufieurs arbres d’acier, telqueZ, quien-
» trent dans le canon IVde la plate-forme : l’arbre d’a-
» cier porte deux pointes, 4, 5, qui entrent dans la pe-
» tite ouverture diamétralement oppofee, pratiquée à
» la partie fupérieure du canon JF, à l’endroit 6 , 7 ;
» de maniéré que les deux pointes 4 & 5 étant enga-
» gées dans les ouvertures 6 ,7 » Tarbre Z ne peut
» tourner que quand le canon JF tourne. On place
» enfuite la roue Y à Tendrait Z ; on l’affujettit par le
Qqq >i