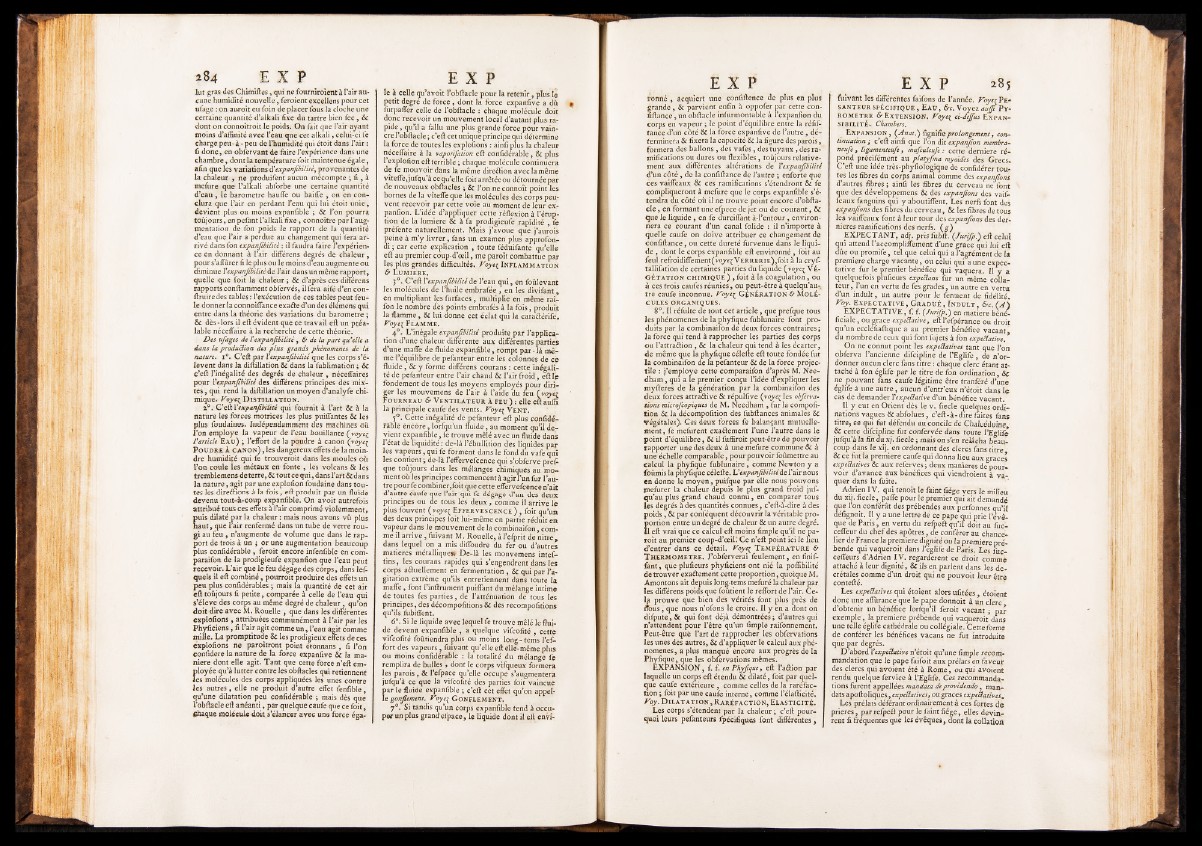
lut gras des Chimiftes, qui ne fourniraient à Pair aucune
humidité nouvelle, feraient excellens pour cet
ufage : on auroit eu foin dé placer fous la cloche une
certaine quantité d’alkali fixe du tartre bien fec , &
dont on connoîtroit le poids. On fait que l’air ayant
moins d'affinité avec l’eau cjue cet alkali, celui-ci fe
charge peu- à - peu de l’humidité qui étoit dans l’air :
fi donc, en obfervant de faire l'expérience dans une
chambre,. dont la température foit maintenue égale,
afin que les variations d' expanjibilitè^ provenantes de
la chaleur , ne produisent aucun mécompte ; fi , à
mefure que l’alkali abforbe une certaine quantité
d’e a u , le baromètre hauffe ou baiffe , on en conclura
que l’air en perdant l’eau qui lui étoit unie,
devient plus ou moins expanfible ; & l’on pourra
toujours, en pefant l’alkali fixe, connoître par l’augmentation
de fon poids le rapport de la quantité
d ’eau que l’air a perdue au changement qui fera ar-
rivé dans fon expanjibilitè : il faudra faire l ’expérience
en donnant à l’air différens degrés de chaleur,
pour s’aflïïrer fi le plus ou le moins d’eau augmente ou
diminue l’expanjibilitè de l’air dans un même rapport,
quelle que foit la chaleur ; & d’après ces différens
rapports conftamment obfervés, il fera aifé d’en con-
ftruire des tables : l’exécution de ces tables peut feule
donner la connoiffance exade d’un des élémens qui
entre dans la théorie des variations du baromètre ;
& dès-lors il eft évident que ce travail eft un préalable
néceffaire à la recherche de cette théorie.
Des ufages de Vexpanjibilitè, & de la part qu’elle a
dans la production des plus grands phénomènes de la
nature. i° . C ’eft par 1’'expanjibilitè que les corps s’élèvent
dans la diftillation & dans la fublimation ; &
c’eft l’inégalité des degrés de chaleur , néceffaires
pour l'expanjibilitè des différens principes dès mixtes
, qui rend la diftillation un moyen d’analyfe chimique.
Voyez D i s t i l l a t io n .
G’eft Vexpanjibilitè qui fournit à l’art & à la
nature les forces motrices les plus puiffantes & les
plus foudaines. Indépendamment des machines où
l ’on employé la vapeur de l’eau bouillante (voyez
Varticle E a u ) ; l’effort de la poudre à canon (voyez
P o u d r e à c a n o n ) , les dangereux effets de la moindre
humidité qui fe trouverait dans les moules où
l’on coule les métaux en fonte , les volcans & les
tremblemens de terre, & tout ce qui, dans Part & dans
la nature, agit par une explofiori foudaine dans toutes
les direétions à la fois, eft produit par un fluide
devenu tout-à-coup expanfible. On avoit autrefois
attribué tous ces effets à Pair comprimé violemment,
puis dilaté par la chaleur : mais nous avons vû plus
haut, que Pair renfermé dans un tube de verre rougi
au feu , n’augmente de volume que dans le rapport
de trois à un ; or une augmentation beaucoup
plus confidérable , ferait encore infenfible en com-
paraifon de la prodigieufe expanfion que Peau peut
recevoir. L’air que le feu dégage des corps, dans lef-
quels il eft combiné, pourrait produire des effets un
peu plus confidérables ; mais la quantité de cet air
eft toujours fi petite, comparée à celle de Peau qui
s’élève des corps au même degré de chaleur, qu’on
doit dire avec M. Rouelle , que dans les différentes
exploitons , attribuées communément à Pair par les
Phyficiens, fi Pair agit comme un, Peau agit comme
mille. La promptitude & les prodigieux effets de ces
éxplofions ne paraîtront point étonnans , fi l’on
confidere la nature de la force expanfive & la maniéré
dont elle agit. Tant que cette force n’eft employée
qu’à lutter contre les obftades qui retiennent
les molécules des corps appliquées les unes contre
les autres, elle ne produit d’autre effet fenfible
qu’une dilatation peu confidérable ; mais dès que
Pobftacle eft anéanti, par quelque caufe que ce foit,
fhaque molécule doit s’élancer avec une force égale
à celle qu’avoit Pobftacle pour la retenir, plus le
petit degre de force, dont la force expanfive a. dû «
furpaffer celle de Pobftacle : chaque molécule doit
donc recevoir un mouvement local d’autant plus rapide
, qu’il a fallu une plus grande force pour vaincre
Pobftacle ; c’eft cet unique principe qui détermine
la force de toutes les éxplofions : ainfi plus la chaleur
néceffaire à la vaporifation eft confidérable, & plus
l’explofion eft terrible ; chaque molécule continuera
de fe mouvoir dans la même direction avec la même
vîteffe,jufqu’à ce qu’elle foit arrêtéeou détournée par
de nouveaux obftacles ; & l’on ne connoît point les
bornes de la viteffe que les molécules des corps peuvent
recevoir par cette voie au moment de leur expanfion.
L’idée d’appliquer cette réflexion à l’éruption
de la lumière & à fa prodigieufe rapidité , fe
préfente naturellement. Mais j’avoue que j’aurais
peine à m’y livrer, fans un examen plus approfondi
; car cette explication , toute féduifante qu'elle
eft au premier coup-d’oeil, me paraît combattue par
les plus grandes difficultés. Voyez Inflammation
& LUMIERE.
3°.. C ’eft Vexpanjibilitè de l'eau qui, en foûlevant
les molécules de l’huile embrafée , en lç.s divifant,
en multipliant les furfaces , multiplie en même rai-
fon le nombre des points embrafés à la fois, produit
la flamme, & lui donne cet éclat qui la cara&érife.
Voyez Flamme.
4°. L’inégale expanjibilitè produite par l’application
d’une chaleur différente aux différentes parties
d’une maffe de fluide expanfible, rompt par-là même
l’équilibre de pefanteur entre les colonnes de cè
fluide , & y forme différens courans : cette inégalité
de pefanteur entre l’air chaud & l’air froid , eft le
fondement de tous les moyens employés pour diriger
les mouvemens de l’air à l’aide du feu f voyez Fourneau & Ventilateur à feu.) : elle eft auflî
la principale caufe des vents. Voyez Vent.
5°. Cette inégalité de pefanteur eft plus confidérable
encore, lorfqu’un fluide, au moment qu’il devient
expanfible, fe trouve mêlé avec un fluide dans
l ’état de liquidité : de-là l’ébullition des liquides par
les vapeurs, qui fe forment dans le fond du vafe qui
les contient ; de-là l’effervefcence qui s’obferve presque
toujours dans les mélanges chimiques au moment
où les principes commencent à agir l’un fur l ’autre
pour fe combiner,foit que cette effervefcence n’ait
d’autre caufe que l’air qui fè dégage d’un des deux
principes ou de tous les deux, comme il arrive le
plus fouvent (voyez Effervescence) , foit qu’un
des deux principes foit lui-même en partie réduit en
vapeur dans le mouvement de la combinaifon, comme
il arrive, fuivant M. Rouelle, à l’efprit de n itre,
dans lequel on a mis diffoudre du fer ou d’autres
matières métalliques* De-là les mouvemens intestins
, les courans rapides qui s’engendrent dans les
corps a&uellement en fermentation, & qui par l'agitation
extrême qu’ils entretiennent dans toute la
maffe, font l’inftrument puiffant du mélange intime
de toutes fes parties, de l’atténuation de tous les
principes, des décompofitions & des recompofitions
qu’ils 6°. fubiflënt. Si le liquide avec lequel fe trouve mêlé le fluj-
vifcdoefviteén de fuo ûetxipeanndfriab lpel u,s ao uq umeloqiunes vloifncgo f itteém , sc le’ettfe
foour tm doeisn vs acpoenufirdsé, rfaubilvea n:tl aq uto’etlaleli etéft delule -mméêlmaneg - pe lufçs
remplira de bulles , dont le corps vifqueux formera
ljeusf qpua’àr ocies ,q &ue l ’leaf pvaicfec oqfuit’ée ldlee so pccaurtpiees sf’aouitg vmaeinntceurea plea r le fluide expanfible Voyez Gonflement.
; c’eft cet effet qu’on appelgonjlement.
y° . Si tandis qu’un corps expanfible tend à occuper
un plus grand elpace, le liquide dont il eft envigrornannéd
e,, a&c qpuairevrti eunnt ee ncfionn fài fotepnpcoef edre p aprl ucse tetne cpoluns-
cïiofrtapns ceen, vuna poebuftra ;c llee ipnofiunrtm do’énqtaubillieb ràe l ’eenixtrpea nlafi ornéf difu-
ttaernmcein de’ruan & c ôfitxée &ra llaa cfoarpcaec ietxép &an lfai vfeig duere l ’daeust prea,r odiés,
fmoirfmiceartaio dness o bua dlluorenss ,o due fsl vexaifbelse,s d, etso tuujoyuarus xre, ldaetsi vraement
aux différentes altérations de l’expanjibilitè cde’usn v caiôffteéa, udxe &la ccoens frifatmanicfiec adteio ln’asu st’réet e; nednrfoonrtt e& q ufee
compliqueront à mefure que le corps expanfible s’éctelned,
rean a fuo rcmôtaén to uùn iel enfep tercoeu dvee jepto ionut dene ccooreu rda’onbt,f t&a- que le liquide, en fe durciffant à-l’entour, environnera
ce courant d’un canal folide : il n’importe à quelle caufe on doive attribuer ce changement de
dcoen , fidfotannt clee, coour pcse ettxep danufriebtlée feufrtv eennvuier odnannés ,l ef oliiqt uaiu
tfaelulilf raetfirooni ddifef ecmeretnati(nvets> ypea^r Vtieesr drue lriqieu)id,feo it à la cryf- (voyez Végétation
chimique) , foit à la coagulation, ou
tàr ec ecsa turofeis i ncacuofnensu reé.u nies, ou peut-être à quelqu’au- CULES ORGANIQUESV.oyez GÉNÉRATION & MOLÉ8°.
Il réfulte de ^out cet article, que prefque tous
les phénomènes de la phyfique fublunaire font produits
par la combinaifon de deux forces contraires ;
la force qui tend à rapprocher les parties des corps
ou l’attraâion, & la chaleur qui tend à les écarter,
de même que la phyfique célefte eft toute fondée fur
la combinaifon de la pefanteur & de la force projectile
: j’employe cette comparaifon d’après M. Nee-
dham, qui a le premier conçu l’idée d’expliquer les
myfteres de la génération par la combinaifon des
deux forces attrattive & répulfive (voyez les obferva-
tions microfcopiques de M. Needham , fur la compofi»
tion & la décompofition des fubftances animales &
végétales). Ces deux forces fe balançant mutuellement
, fe mefurent exactement l’une l’autre dans le
point d’équilibre, & il fuffiroit peut-être de pouvoir
rapporter une des deux à une mefure commune & à
une échelle comparable, pour pouvoir foûmettre au
calcul la phyfique fublunaire, comme Newton y a
foûmis la phyfique célefte. \Jexpanjibilitè de l’air nous
en donne le moyen, puifque par elle nous pouvons
mefurer la chaleur depuis le plus grand froid juf-
qu’au plus grand chaud connu, en comparer tous
les degrés à des quantités connues, c’eft-à-dire à des
poids, & par conféquent découvrir la véritable proportion
entre un degré de chaleur & un autre degré.
Il eft vrai que ce calcul eft moins fimple qu’il ne paraît
au premier coup-d’oeil.* C e n’eft point ici le lieu
d’entrer dans ce detail. V o y e z T e m p é r a t u r e &
T h e r m o m è t r e . J’obferverai feulement, enfinif-
fant, que plufieurs phyficiens ont nié la poffibilité
de trouver exactement cette proportion, quoique M.
Amontons ait depuis long-tems mefuré la chaleur par
les différens poids que foûtient le reffort de l’air. Cela
prouve que bien des vérités font plus près de
ifous, que nous n’ofons le croire. Il y en a dont on
difpute, & qui font déjà démontrées ; d’autres qui
n’attendent pour l’être qu’un fimple raifonnement.
Peut-être que l’art de rapprocher les obfervations
les unes des autres, & d’appliquer le calcul aux phénomènes,
a plus manqué encore aux progrès de la
Phyfique, que les oblervations mêmes.
EXPANSION, f. f. en Phyjîque, eft l’aCtion par
laquelle un corps eft étendu & dilaté, foit par quelque
caufe extérieure, comme celles de la raréfaction
; foit par une caufe interne, comme l’élafticité.
V y . Dilatation , Raréfaction, Elasticité.
Les corps s’étendent par la chaleur ; c’eft pourquoi
leurs pefanteurs fpécifiquqs font différentes,
fuivâftt ïès différentes faifons de l’année. Voyez Pesanteur
spécifique, Eau, &c.VoyezauJJi Py -
rometrë & Extension. Voyez ci-dejjus Expan- SIBILITÉ» Chambers.
Expansion, (Anatf) lignifie prolongement, COTIa•
tinuation ; c’eft ainfi que l’on dit expanjion membra-
neufe , ligamenteuje, mufculeufe : cette derniere répond
précifément au platyfma myoidès des Grecs*
C ’eft une idée très-phyfiologique de confidérer toutes
les fibres du corps animal comme des expanjioni
d’autres fibres ; ainfi les fibres du Cerveau né font
que des développemens & des expanjions des vaiffeaux
fanguins qui y aboutiffent. Les nerfs font des
expanjions des fibres du cerveau, & les fibres de tous
les vaiffeaux font à leur tour des expanjions des dernières
ramifications des nerfs. (g')
EXPECTANT, adj. pris fiibft. (.Turifp.) eft celuï
qui attend l ’accompliffement d’une grâce qui lui eft
due ou promife, tel que celui qui a l’agrément de la
première charge vacante, ou celui qui a une expectative
fur le premier bénéfice qui vaquera. Il y a
quelquefois plufieurs expectans fur un même colla-
teur, l’un en vertu de fes grades, un autre en vertu
d’Un induit, un autre pour le ferment de fidélité*
Voy. Expectative, Gradué, Indult, & c. (A )
EXPECTATIVE, f. f. (Jurifp.) en matière bénéf
ic i a i , ou grâce expectative, eft l’efpérance ou droit
qu’un eccléfiaftique a au premier bénéfice vacant *
du nombre de ceux qui font fujets à fon expectative. *
On ne connut point les expectatives tant que l’on
obferva l’ancienne difcipline de l’Eglife, de n’ordonner
aucun clerc fans titre : chaque clerc étant attaché
à fon églife par le titre de fon ordination, &
ne pouvant fans caufe légitime être tranféré d’une
églife à une autre, aucun d’entr’eux n’étoit dans le
cas de demander l'expectative d’un bénéfice vacant.
Il y eut en Orient dès le v . fiecle quelques ordinations
vagues & abfolues, c’eft-à-dire faites fans
titre, ce qui fut défendu au concile de Chalcédoine 1
& cette difcipline fut confervée dans toute l’Eglife
jufqu’à la En du xj. fiecle ; mais on s’en relâcha beaucoup
dans le xij. en ordonnant des clercs fans titre
& ce fut la première caufe qui donna lieu aux grâces
expectatives ÔC aux referves ; deux maniérés de pourvoir
d’avance aux bénéfices qui viendraient à vaquer
dans la fuite.
Adrien IV . qui tenoit le faint fiége vers le milieu
du xij. fiecle, paffe pour le premier qui ait demandé
que l’on conférât des prébendes aux perfonnes qu’il
défignoit. Il y a une lettre dé ce pape qui prie l’evâ-
que de Paris, en vertu du refpeét qu’il doit au fuc-
ceffeur du chef des apôtres, de conférer au chancelier
de France la première dignité ou la première prébende
qui vaqueroit dans l’églife de Paris. Les fuc-
ceffeurs d’Adrien IV . regardèrent ce droit comme
attaché à leur dignité, & ils en parient dans les décrétales
comme d’un droit qui ne pouvoit leur être
contefté.
Les expectatives qui étoient alors ufitées , étoient
donc une aflurance que le pape donnoit à un clerc
d’obtenir un bénéfice lorfqu’il ferait vacant ; par
exemple, la première prébende qui vaqueroit dans
une telle églife cathédrale ou collégiale. Cette forme
de conférer les bénéfices vacans ne fut introduite
que par degrés.
D ’abord l’expectative n’étoit qu’une fimple recommandation
que le pape faifoit aux prélars en fa veur
des clercs qui avoient été à Rome, ou qui avoient
rendu quelque fervice à l’Eglife. Ces recommandations
furent appellées mandata de providendo, mandats
apoftoliques., expectatives, ou grâces expekatives.
Les prélats déférant ordinairement à ces fortes de
prières, par refpeft pour le faint fiége, elles devinrent
fi fréquentes que les évêques, dont la collation