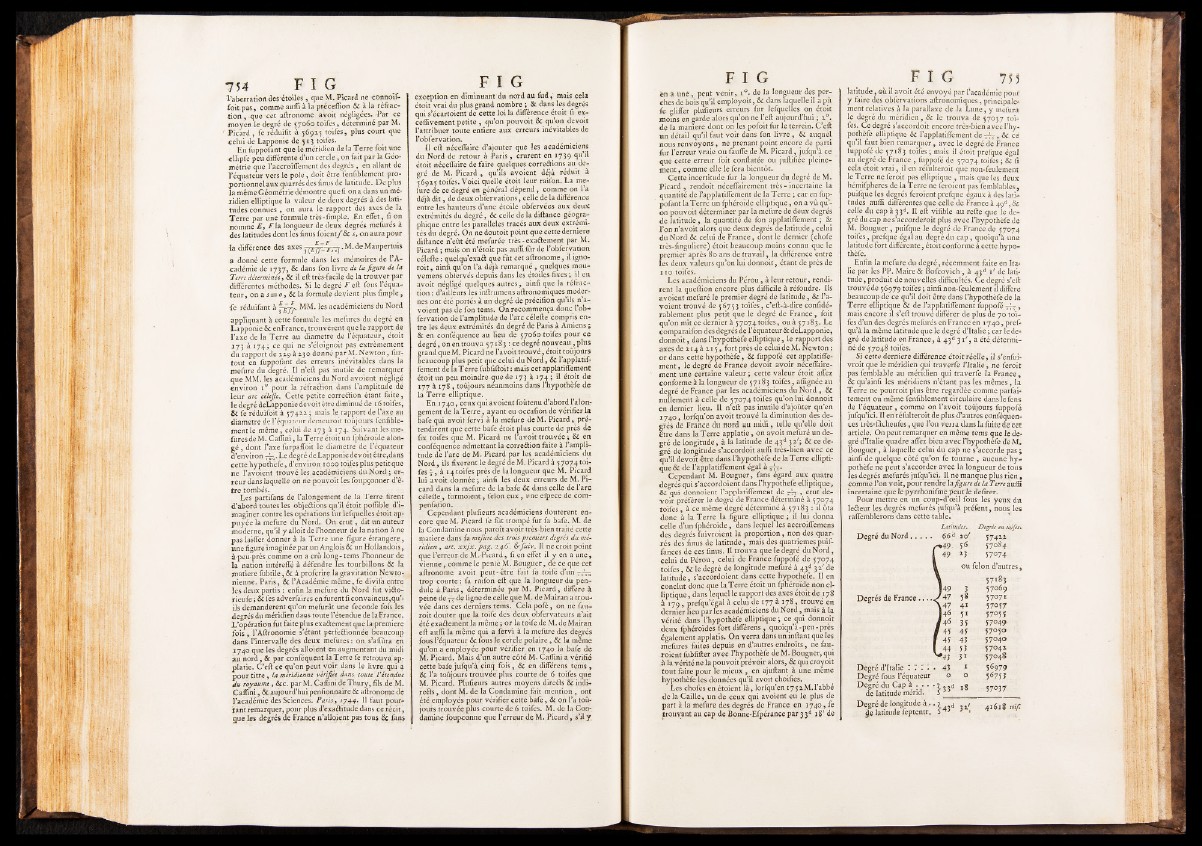
l ’aberration des étoiles , que M. Picard ne connoif-
foitpas., comme aufli à la préceflion & .à la réfraction
, -que «et aftronome avoit négligées. Par ce
moyen le degré de 57060 toifes, déterminé par M.
’ Picard , fe reduifit à 56915 toifes, plus court que
celui de Lapponie de 513 toifes.
En fuppofant que le méridien de la Terre foit une
-ellipfe peu différente d’un cercle, on fait par la Géométrie
que l’accroiffement des degrés , en allant de
l’équateur vers le pôle, doit être fenfiblement proportionnel
aux quarrés des finus de latitude. De plus
la même Géométrie démontre que fi on a dans un méridien
elliptique la valeur de deux degres à des latitudes
connues , on aura le rapport des axes de la
Terre par une formule très-fimple. En effet, fi on
nomme E , F la longueur de deux degrés mefurés A
des latitudes dont les finus foient/& s , on aura pour
la différence des aces, .M-deManpatm»
a donné cette formule dans les mémoires de l’Académie
de 1737, & dans fon livre de la figure de la
Terre déterminée, & il eft très-facile de la trouver par
différentes méthodes. Si le degré F eft fous l’equa-
teur, on a s = .o , & la formule devient plus fimple,
■ fe réduifant à ^es académiciens du Nord
appliquant à cette formule les mefures du degré en
Lapponie 8t enFrance, trouvèrent que le rapport de
l’axe de la Terre au diamètre de l’équateur, étoit
J 7 3 à 1 7 4 ; ce qui ne s’éloignoit pas extrêmement
du rapport de 229 à 230 donné par M- Newton, fur-
tout en fuppofant des erreurs inévitables dans la
mefure du degré. Il n’eft pas inutile de remarquer
que MM. les académiciens du Nord avoient négligé
environ 1" pour la réfraâion dans l’amplitude de
leur arc célejle. Cette petite corre&ion étant faite,
le degré deLapponie de voit être diminué de 16 toifes,
& fe réduifoit à 5 7 4 22 ; mais le rapport de l’axe au
diamètre de l’équateur demeuroit toujours fenfiblement
le même , celui de 17 3 à 1 7 4. Suivant les .mesures
de M. Caflini, la Terre étoit un fphéroïde alon-
g é , dont l’axe furpaffoit le diamètre de l’équateur
d’environ tjv Le degré de Lapponie devoit être,dans
cette hypothèfe, d’environ; 1000 toifes plus petit que
ne l’avoient trouvé ^académiciens.dii Nord; erreur
dans laquelle on ne pouvoit les foupçonner d’être
tombés.
Les partifans de l’alongement de la Terre firent
d’abord toutes les obje&ions qu’il étoit poflible d’imaginer.
contre les opérations fur lefquelles étoit appuyée
la mefure du Nord. On crut, dit un auteur
moderne, qu’il y alloit de l’honneur de la nation à ne
paslaifler donner à la Terre une figure étrangère ,
une figure imaginée par un Anglois& un Hollandois,
à-peu-près comme on a crû long-tems l’honneur de
la nation intéreffé à défendre lés tourbillons &c la
matière fubtile, & à profçrire la gravitation Newtonienne.
Paris, & l’Académie même, fe divifa entre
les deux partis enfin la mefure du Nord fut vifto-
rieufe ; & fes adverfaires en furent fi convaincus,qu’ils
demandèrent qu’on mefurât une fécondé fois les
degrés du méridien dans toute l’étendue de laFrance.
L’opération fut faite plus exactement que laipremiere
fois , l’Aftronomie s’étant perfectionnée beaucoup
dans l’intervalle des deux mefures : on s’aflïira en
1740 que.les degrés alloient en augmentant dumidi
au nord, & par conféquent la Terre fe retrouva ap-
plarie. C’eft ce qu’on peut voir dans le livre qui À
pour titre , la méridienne verifiee dans toute l ' étendue
du royaume, &c. parM. Caflini.de Thury, fils de M.
Caflini, & aujourd’hui penfionnaire & aftronome de
l’académie des Sciences. Par is, 1744. Il faut pourtant
remarquer, pour plus d’exaCtitude dans ce récit,
que les degrés de France n’alloient pas tous fans
exception en diminuant du nord au fud,' mais cela
étoit vrai du plus grand nombre ; & dans les degrés
qui s’écartoient de cette loi la différence étoit fi ex-
ceffivement petite , qu’on pouvoit & qu’on devoit
l’attribuer toute entière aux erreurs inévitables de
i’obfervation.
Il eft néceffaire d’ ajouter que les académiciens
du Nord de retour à Paris , crurent en 1739 qu’il
étoit néceflaire de faire quelques correClions au degré
de M. Picard , qu’ils avoient déjà réduit à
56925 toifes. Voici quelle étoit leur raifon. La mefure
de ce degré en général dépend, comme on l’a
déjà dit, de deux obfervations, celle delà différence
entre les hauteurs d’une étoile obfervées aux deux:
extrémités du degré, & celle de la diftance géographique
entre les parallèles tracés aux deux extrémités
du degré. On ne doutoit point que cette derniere
diftance n’eut été mefurée très - exactement par M.
Picard ; mais on n’étoit pas aufli fur de l’obfervation
célefte : quelqu’exaû que fût cet aftronome, il igno-
roit, ainu qu’on l’a déjà remarqué , quelques mou-
vemens oblèrvés depuis dans les étoiles fixes il en
avoit négligé quelques autres, ainfi que la refraction
: d’ailleurs les inftrumens aftronomiques modernes
ont été portés à un degré de précifion qu’ils n’a-
voient pas de fon tems. On recommença donc l’obfervation
de l’amplitude de l’arc célefte compris entre
les deux extrémités du degré de Paris à Amiens ;
& en conféquence au lieu de 57060 toifes pour ce
degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau, plus
grand que M. Picard ne l’avoit trouvé, étoit toûjours
beaucoup plus petit que celui du Nord, & l’applatif-
fement de la Terre fubfiftoit : mais cet applatiffement
étoit un peu moindre cjue de 173 à 174 » il étoit de
177 à 178 , toûjours neanmoins dans l’hypothèfe de
la Terre elliptique.
En 1740, ceux qui avoient foûtenu d’abord l’alongement
de la Terre, ayant eu occafion de vérifier la
bafe qui avoit.fervi à la mefure deM. Picard, prétendirent
que cette bafe étoit plus courte de près de
fix toifes que M. Picard ne l’avoit trouvée ; & en
conféquence admettant la correftion faite à l’amplitude
de l’arc de M. Picard par les académiciens du
Nord, ils fixèrent le degré de M. Picard à 57074 toi-
fes 7, à 14 toifes près de la longueur que M. Picard
lui avoit donnée ; ainfi les deux erreurs de M. Picard
dans la mefure de la bafe & dans celle de l’arc
célefte, formoient, félon eux, une efpece de com-
penfation.
Cependant plufieurs académiciens doutèrent encore
que M. Picard fe fût trompé fur fa bafe. M. de
la Condamine nous paroît avoir très-bien traité cette
matière dans fa mefure des trois premiers degrés du méridien,
art. x x jx . pag. 24 6 . & fu iv . Il ne croit point
que l’erreur de M. Picard, fi en effet il y en a une,
vienne, comme le pente M. JBouguer, de ce que cet
aftronome avoit peut-être fait fa toife d’un 7775
trop courte: fa raifon eft qpè. la longueur du pendule
à Paris, déterminée par M. Picard, différé à
peine de 77 de ligne de celle que M. de Mairan a trouvée
dans ces derniers tems. Cela pofé, on ne fau-
roit douter que la toife des deux obfervateiirs n’ait
été exaâement la même ; or la toife de M. de Mairan
eft aufli la meme qui a fervi à la mefure des degrés
fous l’équateur & fous le cercle polaire, & la meme
qu’on a employée pour vérifier en 1740 la bafe de
M. Picard. Mais d’un autre côté M. Caflini a vérifié
cette bafe jufqu’â/cinq fois, & en différens tems,
& l’a toûjpurs trouvée plus courte de 6 toifes que
M. Picard. Plufieurs autres moyens diretts & indirecte,
dont M. de la Condamine .fait mention , ont
été employés pour vérifier cette bafe, & on l’a toû-
joufs trouvée plus courte de 6 toifes. M, de la Con-
daminc foupconnc que l’erreur de M. Picard, s’il y
en a tinè, peut venir, I°. de la longueur des perches
de bois qu’il employoit, Sc dans laquelle il a pu
fe gliffer plufieurs erreurs fur lefquelles on étoit
moins en garde alors qu’on ne l’eft aujourd’hui ; 20.
de la manière dont on les pofoit fur le terrein. C’eft
un détail qu’il faut voir dans fon livre , & auquel
nous renvoyons, ne prenant point encore de parti
fur l’erreur vraie ou fauffe de M. Picard, jufqu’à ce
que cette erreur foit conftatée ou juftifiée pleinement
, comme elle le fera bientôt.
Cette incertitude fur la longueur du degré de M.
Picard, rendoit néceflairement très - incertaine la
quantité de i’applatiflement de la Terre ; car en fuppofant
la Terre un fphéroïde elliptique, on a vû qu’on
pouvoit déterminer par la mefure de deux degrés
de latitude, la quantité de fon applatiffement ; &
l’on n’avoit alors que deux degrés de latitude, celui
du Nord & celui de France, dont le dernier (chofe
très-finguliere) étoit beaucoup moins connu que le
premier après 80 ans de travail, la différence entre
les deux valeurs qu’on lui donnoit, étant de près de
110 toifes.
Les académiciens du Pérou, à leur retour, rendirent
la queftion encore plus difficile à réfoudre. Ils
avoient mefuré le premier degré de latitude, & l’avoient
trouvé de 56753 toifes, c’eft-à-dire confidé-
rablement plus petit que le degré de France, foit
qu’on mît ce dernier à 57074 toifes, ou à 57183. Le
comparaifon des degrés de l’équateur & deLapponie,
donnoit, dans l’hypothèfe elliptique, le rapport des
axes d e2 i4 à 2 i5 , fort près de celui de M. Newton :
or dans cette hypothèfe, & fuppofé cet applatifle-
ment, le degré de France devoit avoir néceflairement
une certaine valeur ; cette valeur étoit affez
conforme à la longueur de 57183 toifes, aflignée au
degré de France par les académiciens du Nord , &
nullement à celle de 57074 toifes qu’on lui donnoit
en dernier lieu. Il n’eft pas inutile d’ajoûter qu’en
1740, lorfqu’on avoit trouvé la diminution des degrés
de France du nord au midi, telle qu’elle doit
être dans la Terre applatie, on avoit mefuré un degré
de longitude, à la latitude de 43d 32/; & ce degré
de longitude s’accordoit aufli très-bien avec ce
qu’il devoit être dans l’hypothèfe de la Terre elliptique
& de l’applatiflement égal à
Cependant M. Bouguer, fans égard aux quatre
degrés qui s’accordoient dans l’hypothefe elliptique,
& qui donnoient l’applatiffemeHt de 775 , crut devoir
préférer le degré de France déterminé à 57074
toifes, à ce même degré déterminé à 57183 : il ôta
donc à la Terre la figure elliptique ; il lui donna
celle d’un fphéroïde, dans lequel les accroiflemens
des degrés fuivroient la proportion, non des quarrés
des finus de latitude, mais des quatrièmes puif-
fances de ces finus. Il trouva que le degré du Nord,
celui du Pérou, celui de France fuppofé de 57074
toifes, & le degré de longitude mefuré à 43d 32' de
latitude, s’accordoient dans cette hypothèfe. Il en
conclut donc que la Terre étoit un fphéroïde non elliptique
, dans lequel le rapport des axes étoit de 178
à 179, prefqu’égal à celui de 177 à 178, trouvé en
dernier lieu par les académiciens du Nord, mais à la
vérité dans l’hypothèfe elliptique; ce qui donnoit
deux fphéroïdes fort différens , quoiqu’à-peu -près
également applatis. On verra dans un inftant que les
mefures faites depuis en d’autres endroits, ne fau-
roient fubfifter avec l’hypothèfe de M. Bouguer, qui
à la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit
tout faire pour le mieux , en ajuftant à une même
hypothèfe les données qu’il avoit choifies.
Les chofes en étoient là, lorfqu’en 17 5 2 M. l’abbé
de la Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de
part à la mefure des degrés de France en 1740 , fe
trouvant au cap de Bonne-Efpérance par 33d 18' de
latitude, oh il avoit été envoyé par ^académie pouf
y faire des obfervations aftronomiques, principale*
ment relatives à la parallaxe de la Lune, y mefuri
le degré du méridien, & le trouva de 57037 toi*
fes. Ce degré s’accordoit encore très-bien avec l’hy*
pothèfe elliptique & l’applatiffement de -— j , & ce
qu’il faut bien remarquer, avec le degré de France
fuppofé de 57183 toiles; mais il étoit prefque égal
au degré de France , fuppofé de 57074 toifes ; & fi
cela étoit vrai, il en réfulteroit que non-feulement
le Terre ne feroit pas elliptique , mais que les deux
hémifpheres de la Terre ne ïeroient pas femblâbles*
puifque les degrés feroient prefque égaux à des lati*
tuiles aufli différentes que celle de France à 49d, &£
celle du cap à 33d. Il eft vifible au refte que le de*
gré du cap ne s’accordefoit plus avec l’hypothèfe de
M. Bouguer, puifque le degré de France de 57074
toifes, prefque égal au degré du cap, quoiqu’à une
latitude fort differente, étoit conforme à cette hypothèfe.;
Enfin la mefure du degré, récemment faite en Ita*
lie par les PP. Maire & Boteovich, à 43d i ' de latitude
, produit de nouvelles difficultés. Ce degré s’eft
trouvéde 56979 toifes ; ainfi nom-feulement il différé
beaucoup de ce qu’il doit être dans l’hypothèfe de la
Terre elliptique & de l’applatiflement fuppofé 777,
mais encore il s’eft trouvé différer de plus de 70 toifes
d’un des degrés mefurés en France en 1740, pref*
qu’à la même latitude que le degré d’Italie ; car le degré
de latitude enFrance, à 43d 31 ' , a été.déterminé
de 57048 toifes.
Si cette derrtiefe différence étoit réelle -, il s’enfui*
vroit que le méridieii qui traverfe l’Italie, ne feroit
pas femblable au méridien qui traverfe la France ,
& qu’ainfi les méridiens n’étant pas les mêmes, la
Terre ne pourroit plus être regardée comme parfaitement
ou même fenfiblement circulaire dans le fens
de l’équateur, comme on l’avoit toûjours fuppofé
jufqu’ici. Il en réfulteroit de plus d’autres conféquen-
ces très-fâcheufes, que l’on verra dans la fuite de cet
article. On peut remarquer en même tems que le degré
d’Italie quadre affez bien avec l’hypothèfe de M.
Bouguer, à laquelle celui du cap ne s’accorde pas ;
ainfi de quelque côté qu’on fe tourne , aucune hypothèfe
ne peut s’accorder avec la longueur de tous
les degrés mefurés jufqu’ici. Il ne manque plus rien ,
comme l’on voit, pour rendre la figure de la Terre auflî
incertaine que le pyrrhonifmè peut le defirer.
Pour mettre en un coup-d’oeil fous les yeux dit
le&eur les degrés mefurés jufqu’à prêtent, noiis les
raflemblerons dans cette table. Latitudes.. Degrés en. toifes. Degré du Nord.......... 66 d 20' 574*ï .
1 57084 \ /-•49 49 ■ 13 57°74 ou félon d’autres ,
57183
849 3 57069
Degrés de France. . . .y 47 5* 57071-
4I 57057
J46 5» ■ 5705s
/4Ö 35 57049.
# 45 41 57050
I 45 43 57040
1 44 53 57042
V*43 3 * 57048 .
Degré d’Italie 1 1 7 I . 43
Degré fous l’équateur 0
I 56979
O 56753
Degré du Cap à . . . . ? . -d
de latitude mérid. S .
18 •57037
Degré de longitude à . . ? .-d
<Je latitude feptentr. 3*' 41618 toifi