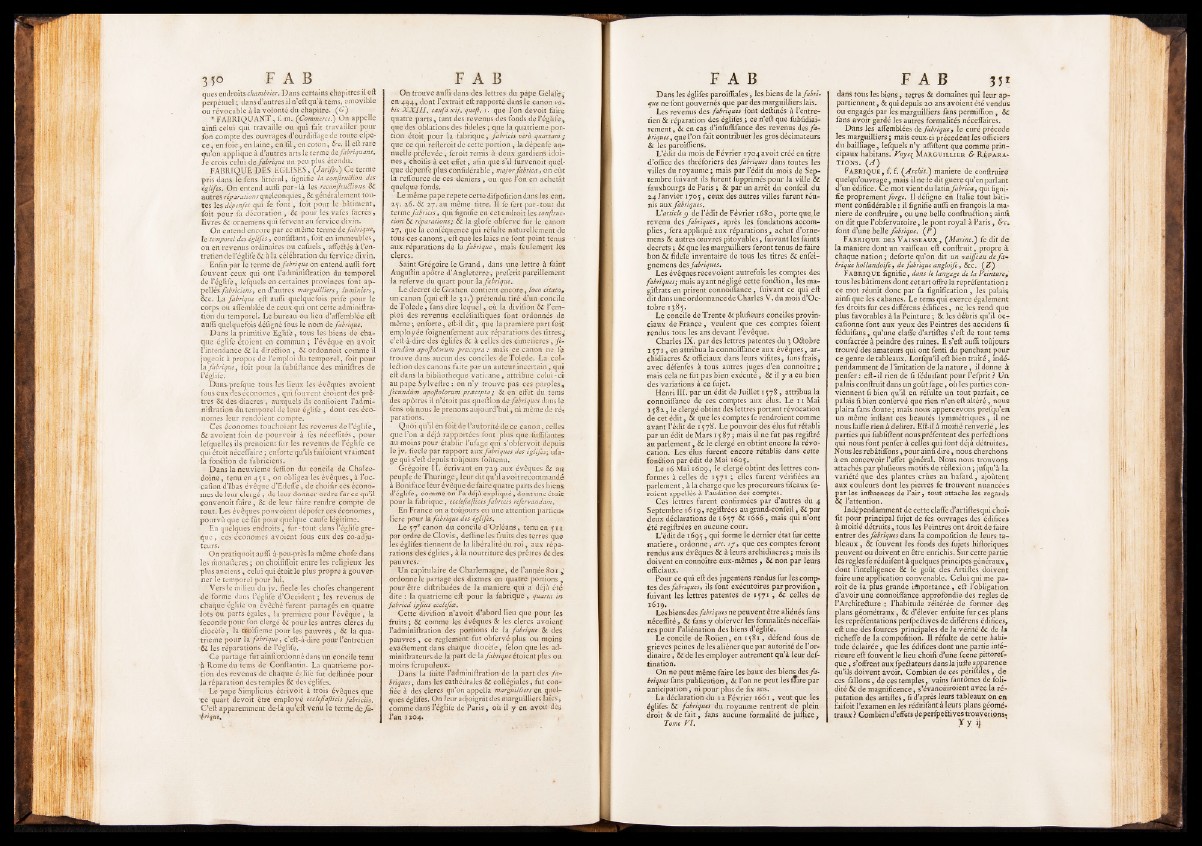
3 5° F A B
ques endroits ckambrier. Dans certains chapitres il eft
perpétuel ; dans d’autres.il n’eft qu’à teins, amovible
ou révocable à la volonté du chapitre. (G)
* FABRIQUANT, f. m. (Commerce.) On appelle
ainfi celui qui travaille ou qui fait travailler pour
fon compte des ouvrages d’ourdiffage de toute efpe-
c e , en foie, en laine, en f il, en coton, &c. Il eft rare
qu’on applique à d’autres arts le terme de fabriquant.
Je crois celui de fabrique un peu plus étendu.
. FABRIQUE DES EGLISES, (Jurifp.) Ce terme
pris dans le fens littéral, fignifie la conflruction des
églifes. On entend aufli par-là les reconftruclions 6c
autres réparations quelconques, 6c generalement toutes
les dépenfes qui fe fo n t , foit poux le bâtiment,
foit pour fa décoration , 6c pour les vafes facrés,
livres 6c ornemens qui fervent au fervice divin.
On entend encore par ce même terme de fabrique,
Je temporel des églifes, confiftant, foit en immeubles,
ou en revenus ordinaires ou cafuels, affeâés à l’entretien
de l’églife & à la célébration du fervice divin.
Enfin par le terme de fabrique on entend aufli fort
fouvent ceux qui ont l’adminiftration du temporel
de l’églife, lefquels en certaines provinces font appelles
fabriciens, en d’autres marguilliers, luminiers,
& c . La fabrique eft aufli quelquefois prife pour le
corps ou aflembiée de ceux qui ont cette adminiftra-
tion du temporel. Le bureau ou lieu d’affemblée eft
aufli quelquefois défigné fous le nom de fabrique.
Dans la primitive Eglife, tous les biens de chaque
églife étoient en commun ; l’évêque en avoit
l’intendance 6c la direction , & ordonnoit comme il
jugeoit à propos de l’emploi du temporel, foit pour
la fabrique, foit pour la fubfiftance des miniftres de
l’églife.
Dans-prefque tous les lieux les évêques avoient
fous eux des économes, qui fouvent étoient des prêtres
6c des diacres , auxquels ils confioient l’adminiftration
du temporel de leur églife , dont ces économes
leur rendoient compte.
Ces économes touchoient les revenus de l’églife,
& avoient foin de pourvoir à fes néceflîtés, pour
lefquelles ils prenoient fur les revenus de l’églife ce
qui étoit néceffaire ; enforte qu’ils faifoient vraiment
la fon&ion de fabriciens.
Dans la neuvième feflion du concile de Chalce-
doine, tenu en 4 5 1 , on obligea les évêques, à l’oc-
cafion d’Ibas évêque d’Edeffe, de choifir ces économes
de leur cierge ; de leur donner ordre fur ce qu’il
convenoit faire, & de leur faire rendre compte de
tout. Les évêques pouvoient dépofer ces économes,
pourvu que ce fût pour quelque caufe légitime.
En quelques endroits, fur - tout dans l’églife gre-
que., ces économes avoient fous eux des co-adju-
teurs.
On pratiquoit aufli à-peu-près la même chofe dans
les monafteres ; on choififloit entre les religieux les
plus anciens, celui qui étoit le plus propre à gouverner
le temporel pour lui.
Vers le milieu du jv. fieele les chofes changèrent
de forme dans l’églife d’Occident ; les revenus de
chaque églife ou évêché furent partagés en quatre
dots ou parts égales, la première pour l’évêque, la
fécondé pour fon clergé 6c pour les autres clercs du
diocèfe, la tsoifieme pour les pauvres , 6c la quatrième
pour la fabrique, c’eft-à-dire pour l’entretien
& les réparations de l’églife.
"Ce partage fut ainfi ordonné dans un concile tenu
à Rome du tems de Conftantin. La quatrième portion
des revenus de chaque églife fut deftinée pour
la réparation des temples ôc des églifes. <
Le pape Simplicius éerivoit à trois évêques que
ce quart devoit çtre employé ecclefiaflicis fabriciis.
C ’eft apparemment de-là qu’eft venu le terme de fa-
\brique.
F A B
On trouve aufli-dans des lettres du pape Gelàfér
en 494 , dont l’extrait eft rapporté dans le canon vo.
bis X X I I I . caufà xij. quejl. 1. que l’on devoit faire
quatre parts, tant des revenus des fonds de l’églife,
que des oblations des fidèles ; que là quatrième portion
étoit pour la fabrique, fabricis verà quartam ;
que ce qui refteroit de cette portion, la dépenfe annuelle
prélevée, feroit remis à deux gardiens idoines
, choifis à cet effet, afin que s’il furvenoit quelque
dépenfe plus confidérable, major fabrica, on eût
la reflource de ces deniers, ou que l’on en achetât
quelque fonds.
Le même pape répété cette difpofition dans les cari.
25. - 2 . 6 . 6c 27. au même titre. Il f e fert par-tout du
terme fabricis, qui fignifie en cet endroit les conflruction
ÔC réparations; & la glofe obferVe fur le canon
27, que la conféquence qui réfulte naturellement de
tous ces canons, eft que les laïcs ne font point tenus
aux réparations de la fabrique , mais feulement les
•clercs.
Saint Grégoire le G rand, dans une lettre à faint
Auguftin apôtre d’Angleterre, prefcrit pareillement
la referve du quart pour la fabrique.
Le decret de Gratien contient encore, loco citato,
un canon (qui eft le 31.) prétendu tiré d’un concile
deToIede, fans dire lequel, où la divifion 6c l’emploi
des revenus eccléfiaftiques font ordonnés de
même ; enforte, eft-il dit, que la première part foit
employée foigneufement aux réparations des titres,'
c’eft-à-dire des églifes 6c à celles des cimetières, fe-
cundùm apoflolorum prcecepta : mais ce canon ne fe
trouve dans aucun des conciles de Tolede. La col-
leftion des canons faite par un auteur incertain, qui
eft dans la bibliothèque vaticane, attribue celui-ci
au pape Sylveftre : on n’y trouve pas ces paroles ,
fecunditm apoflolorum prcecepta ; & en effet du tems
des apôtres il n’étoit pas queftion de fabriques dans le
fens où nous le prenons aujourd’hui, ni même de ré?
parations.
Quoi qu’il en foit de l’autorité de ce canon, celles
que l’on a déjà rapportées font plus que fuffifantes
au moins pour établir l’ufage qui s’obfervoit depuis
le jv. fieele par rapport aux fabriques des églifes; ufa-
ge qui s’eft depuis toujours foûtenu.
Grégoire IL écrivant en 729 aux évêques ôc au
peuple de Thuringe, leur dit qu’il avoit recommandé
à Boniface léur évêque de faire quatre parts des biens
d’églife, comme on l’a déjà expliqué, dont une étoit.
pour la fabrique, ecclefiaflicis fabricis refervandam.
En France on a toujours eu une attention particu*
liere pour la fabrique des eglifes.
Le 57e canon du concile d’Orléans, tenu en 511
par ordre de Clovis, deftine les fruits des terres que
les églifes tiennent de la libéralité du ro i, aux réparations
des églifes, à la nourriture des prêtres 6c des
pauvres.’
Un capitulaire de Charlemagne, de l’année 801 *
ordonne le partage des dixmes en quatre portions ,
pour être diftribuées de la maniéré qui a déjà été
dite : la quatrième eft pour la fabrique , quarta in
fabrica ipjius eccleflce.
Cette divifion n’avoit d’abord lieu que pour les
fruits ; 6c comme les évêques & les clercs avoient
l’adminiftration des portions de la fabrique & des.
pauvres , ce reglement fut obfervé plus ou moins
exactement dans chaque diocèfe, félon que les ad-
miniftrateurs de la part de la fabrique étoient plus ou
moins fcrupuleux.
Dans la fuite l’adminiftration de la part des fabriques,
dans les cathédrales & collégiales, fut confiée
à des clercs qu’on appella marguilliers en quelques
églifes. On leur adjoignit des marguilliers laïcs,
comme dans l’églilè de Paris, où il y en avoit dès
l’ an 1204. j
F A B
Dans les églifes paroiffiales, les biens de 1 * fabrique
ne font gouvernés que par des marguilliers laïs.
Les revenus des fabriques font deftinés à l’entretien
& réparation des églifes,; ce n’eft que fubfidiai-
rement & en cas d’infuffifance des revenus des fabriques,
que l’on fait contribuer les gros décimateurs
& les paroifliens.
L’édit du mois de Février 1704 avoit créé en titre
d’office des thréforiers des fabriques dans toutes les
villes du royaume ; mais par l’édit du mois de Septembre
fuivarit ils furent fùpprimés pour la ville Ôc
fauxbourgs de Paris ; & par un arrêt du confeil du
24 Janvier 1705, ceux des autres villes furent réunis
aux fabriques.
Y?article c) de l ’édit de Février 1680, porte que. le
revenu des fabriques, après les fondations accomplies
,. fera appliqué aux réparations, achat d’orne-
mens & autres oeuvres pitoyables, fuivant les faints
decrets ; ôc que les marguilliers feront tenus de faire
bon ôc fideïe inventaire de tous les titres ôc enfei-
gnemens des fabriques.
Les évêques recevoient autrefois les comptes des
fabriques; mais ayant négligé cette fonction, les ma-
giftrats en prirent connoiflance, fuivant ce qui eft
dit dans une ordonnance de Charles V . du mois d’Oc-
tobre 1385.
Le concile de Trente & plufieurs conciles provinciaux
de France, veulent que ces comptes foient
rendus tous les ans devant l’évêque.
Charles IX. par des lettres patentes du 3 Oftobre
15 7 1 , en attribua la connoiflance aux évêques, archidiacres
ôc officiaux dans leurs vifites, fans frais,
avec défenfes à tous autres juges d’en connoître ;
mais cela ne fut pas bien exécuté, & il y a eu bien
des variations à ce fujet.
Henri III. par un édit de Juillet 1578, attribua la
connoiflance de ces comptes aux élus. Le 11 Mai
1582, le clergé obtint des lettres portant révocation
de cet édit, & que les comptes fe rendroient comme
avant l’édit de 1578. Le pouvoir des élus fut rétabli
par un édit de Mars 1587; mais il ne fut pas regiftré
au parlement, & le clergé en obtint encore la révocation.
Les élus furent encore rétablis dans cette
fon&ion par édit de Mai 1605.
Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres conformes
à celles de 1571 ; elles furent vérifiées au
parlement, à la charge que les procureurs fifeaux fe-
roient appellés à l’audition des comptes.
Ces lettres furent confirmées par d’autres du 4
Septembre 1619, regiftrées au grand-confeil, ôc par
deux déclarations de 1657 6c 1666, mais qui n’ont
été regiftrées en aucune cour.
L’édit de 169 5, qui forme le dernier état fur cette
matière, ordonne, art. /y, que ces comptes feront
rendus aux évêques 6c à leurs archidiacres ; mais ils
doivent en connoître eux-mêmes, 6c non par leurs
officiaux.
Pour ce qui eft des jugemens rendus fur les comptes
des fabriques, ils font exécutoires par provifion,
fuivant les lettres patentes de 1571 , 6c celles de
i 6 ï 9.
Les biens des fabriques ne peuvent être aliénés fans
néceflité, 6c fans y obferver les formalités néceflai-
res pour l’aliénation des biens d’églife.
Le concile de Roiien, en 1581, défend fous de,
grieves peines de les aliéner que par autorité de l’ordinaire
, & de les employer autrement qu’à leur destination.
On ne peut même faire les baux des biens des fa*
briques fans publication, & l’on ne peut les faire par
anticipation, ni pour plus de fix ans.
La déclaration du 12 Février 16 61, veut que les
églifes & fabriques du royaume rentrent de plein
droit & de fa it , fans aucune formalité de juftice,
Tome FI.
F A B 3 5* dans toits les biens, teçres & domaines qui leur appartiennent
, & qui depuis 20 ans avoient été vendus
ou engagés par les marguilliers fans permiflion , ôc
fans avoir gardé les autres formalités néceffaires.
Dans les affemblées de fabrique, le curé précédé
les marguilliers ; mais ceux-ci précèdent les officiers
du bailliage, lefquels n’y afliftent que comme principaux
habitans. Voye1 M a r g u il l ie r & R é p a r a t
io n s . ( A )
Fabr iq u e , f. f. ('Archit.) maniéré de conftruire
quelqu’ouvrage, mais il ne fe dit guere qu’en parlant
d’un édifice. Ce mot vient du latin fabrica, qui fignifie
proprement forge. II défigne eh Italie tout bâtiment
confidérable : il fignifie aufli en françois la maniéré
de conftruire, ou une belle conftruftion ; ainfi
on dit que l’obfervatoire, le pont royal à Paris,
font d’une belle fabrique. ( P )
Fa b r iq u e des V a is s e a u x , (Marine.') fe dit de
la maniéré dont un vaiffeau eft conftruit, propre à
chaque nation ; deforte qu’on dit un vaiffeau de fabrique
hollandoife , de fabrique angloife , ÔC c. ( Z )
Fa b r iq u e fignifie, dans le langage de la Peinture
tous les bâtimens dont cet art offre la repréfentation ;
ce mot réunit donc par fa lignification, les palais
ainfi que les cabanes. Le tems qui exerce également
fes droits fur ces différens édifices, ne. les rend que
plus favorables à la Peinture ; & les débris qu’il ocr
cafionne font aux yeux des Peintres des accidens fi
fédüifans, qu’une claffe d’artiftes s’eft de tout tems
confacrée à peindre des ruines. Il s’eft aufli toujours
trouvé des amateurs qui ont fenti du penchant pour
ce genre de tableaux. Lorfqu’il eft bien traité, indépendamment
de l ’imitation de la nature, il donne à
penfer : eft-il rien de fi féduifant pour l ’efprit ? Un
palais conftruit dans un goutfage, où les parties, conviennent
fi bien qu’il en réfulte un tout parfait, ce
palais fi bien confervé que rien n’en eft altéré, nous
plaira fans doute ; mais nous appercevons prefqu’en
un même inftant ces beautés fymmétriques, il ne
nous laiffe rien à defirer. Eft-il à moitié renverfé, les
parties qui fubfiftent nous préfentent des perfeûions
qui nous font penfer à celles qui font déjà détruites.
Nous les rebâtiffons, pour ainu dire, nous cherchons
à en concevoir l’effet général. Nous nous trouvons
attachés par plufieurs motifs de réflexion ; jufqu’à la
variété que des plantes crues au hafard, ajoutent
aux couleurs dont les pierres fe trouvent nuancées
par les influences de l’air, tout attache les regards
ôç l’attention.
Indépendamment de cette claffe d’artiftes qui choir
fit pour principal fujet de fes ouvrages des édifices
à moitié détruits, tous les Peintres ont droit de faire
entrer des fabriques dans la compofition de leurs tableaux
, & fouvent les fonds des fujets hiftoriques
peuvent ou doivent en être enrichis. Sur cette partie
les réglés fe réduifent à quelques principes généraux ,
dont l’intelligence & le goût des Artiftes doivent
faire une application convenable. Celui qui me pa-
roît de la plus grande importance , eft l’obligation
d’avoir une connoiflance approfondie des réglés de
l’Architeâure : l’habitude réitérée de former des
plans géométraux, 6c d’élever enfuite fur ces plans
les repréfentations perfpeûives de différens édifices,
eft une des fources principales de la vérité 6c de la
richeffe de la compofition. Il réfulte de cette habitude
éclairée, que les édifices dont une partie intérieure
eft fouvent le lieu choifi d’une feene pittorefe
que, s’offrent aux fpedateurs dans la jufte apparence
qu’ils doivent avoir. Combien de ces périftiles, de
ces fallons, de ces temples, vains fantômes de foli-
dité 6c de magnificence, s’évanoüiroient avec la réputation
des artiftes, fi d’après leurs tableaux on en
faifoit l’examen en les réduifant à leurs plans géométraux?
Combien d’effets deperfpeftives trouverions*