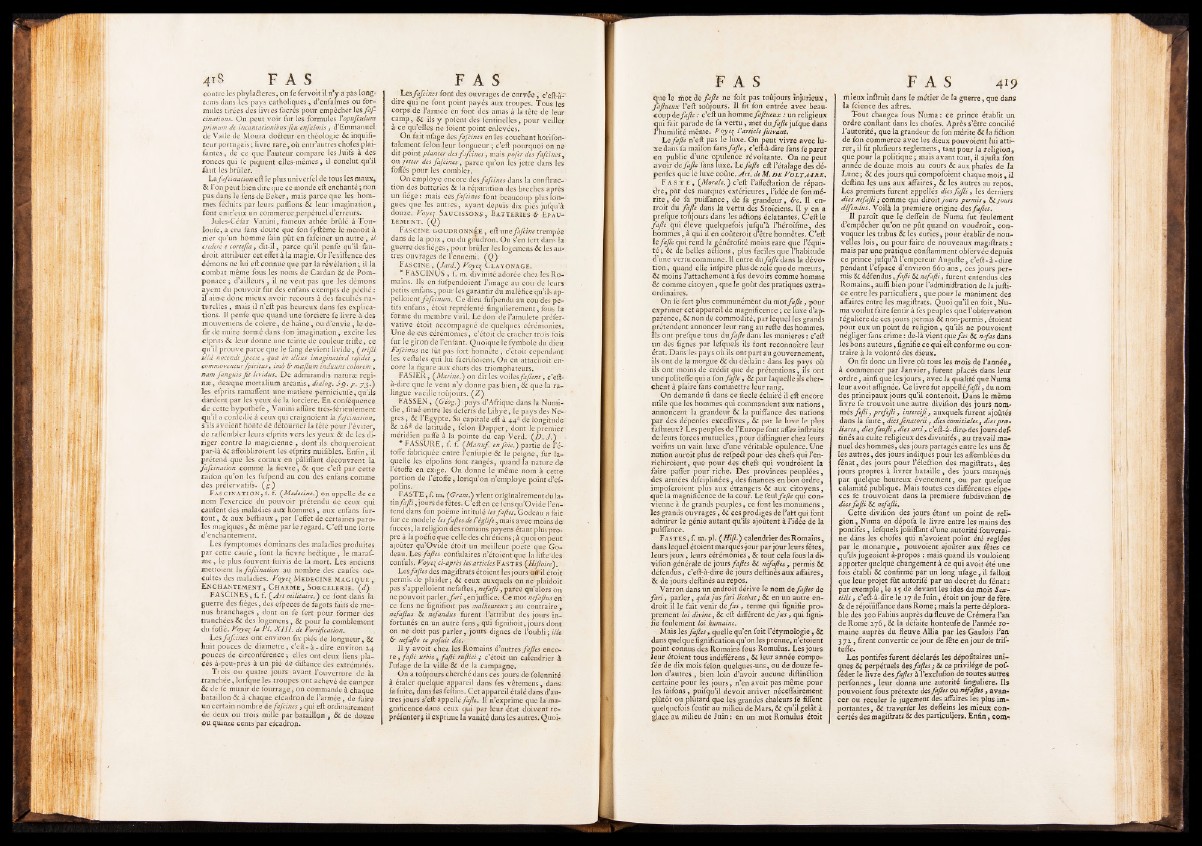
contre les phylaéleres, on fe fervoit il nV a pas long-
tcms dans les pays catholiques, d’enfalmes ou formules
tirées des livres facres pour empêcher les faj-
cinations. On peut voir fur les formules Vopufculum
primum de incantationibus Jeu enfalmis , d’Emmanuel
de Va Ile de Moura doêleur'en théologie &inquifi-
teur portugais ; livre rare-, oii entr’autres chofes plai-
fantes, de ce que l’auteur compare les Juifs à des
ronces qui fe piquent elles-mêmes , il conclut qu’il
faut les briller.
La fafdnation eft le plus univerfel de tous les maux,
& l’on peutbien dire que ce monde eft enchanté ; non
pas dans le fens de Beker, mais parce que les hommes
féduits par leurs pallions & leur imagination,
font entr’eux un commerce,perpétuel d’erreurs.
Jules-Céfar Vanini, fameux athée brûlé à Tou-
loufe, a cru fans doute que fon fyftème le menoit à
nier qu’un homme fain pût en fafciner un autre, il
credere e cortefia, dit-il, parce qu’il penfe qu’il faudrait
attribuer cet effet à la magie. Or l’exiftence des
démons ne lui eft connue que par la révélation ; il la
combat même fous les noms de Cardan & de Pom-
ponace ; d’ailleurs , il ne veut pas que les démons
ayent du pouvoir fur des enfans exempts de péché :
il aime donc mieux avoir recours à des facultés naturelles
, mais il n’eft pas heureux dans fes explications.
Il penfe que quand une forciere fe livre à des
mouvemens de colere, de haine, ou d’envie, le de-
fir de nuire formé dans fon imagination, excite les
efprits & leur donne une teinte de couleur trifte, ce
qu’il prouve parce que le fang devient livide, {trifti
ULâ nocendi J'pecie, qute in Uhus imaginativd refidet ,
commovencur Jpiritus, imb & mceflum induunt colorent ,
nam J'anguis fit lividus. De admirandis naruræ régime,
deæque mortalium arcanis, dialog. 6 g .p . j$ . )
les efprits ramaffent une matière pernicieufe, qu’ils
dardent par les yeux de la forciere. En conféquence
de cette hypothèfe, Vanini aflûre très-férieufement
qu’il a confeilié à ceux qui craignoient la Jajcination,
s’ils a voient honte de détourner la tête pour l’éviter,
de raffembler leurs efprits vers les yeux & de les diriger
contre la magicienne , dont ils choqueraient
par-là & affoibliroient les efprits nuifibles. Enfin, il
prétend que les coraux en pâliffant découvrent la
fajcination comme la fievre, & que c’eft par cette
raifon qu’on les fufpend au cou des enfans comme
des préfervatifs. ( g )
F a s c i n a t i o n , 1. f. (Médecine.) on appelle de ce
nom l’exercice du pouvoir prétendu de ceux qui
caufent des maladies aux hommes, aux enfans fur-
tout , & aux beftiaux, par l’effet de certaines paroles
magiques, & même par le regard. C’eft une forte
d’enchantement.
Les fymptomes dominans des maladies produites
par cette caufe, font la fievre heâique, le maraf-
me, le plus fouvent fuivis de la mort. Les anciens
mettoient la jajcination au nombre des caufes occultes
des maladies. Voye[ MED E CIN E M AG IQ U E ,
E n c h a n t e m e n t , C h a r m e , So r c e l e r ie . ('d )
FASCINES, f. f. {Art militaire.') ce font dans la
guerre des fiéges, des efpeces de fagots faits de menus
branchages , dont on fe fert pour former des
tranchées & des ;logemens, & pour le comblement
du folle, Voye^ Ifi PL. 3CIII, de Fortification.
Les JaJdnes ont environ fix piés de longueur, &
huit pouces de diamètre, c’eft-à -d ire environ 24
pouces de circonférence ; elles ont deux liens placés
à-peu-près à un pié de diftance des extrémités.
Trois ou quatre jours avant l’ouverture de la
tranchée, lorfque les troupes ont achevé de camper
& de fe munir de fourrage , on commande à chaque
bataillon & à chaque efeadron de l’armée, de faire
un certain nombre de JaJcines , qui eft ordinairement
de deux ou trois mille par bataillon , & de douze
pu quinze cents par elcadron.
Les JaJcines font des ouvrages de corvée,' c’efbà-
dire qui ne font point payés aux troupes. Tous les
corps de l’armée en font des amas à la tête de leur
camp, & ils y pofent des fentinelles, pour veiller
à ce qu’elles ne foient point enlevées.
On fait ufage des JaJcines en les couchant horifon-
talement félon leur longueur ; c’eft pourquoi on ne
dit .point planter des JaJcines, mais pojer des Jafcines ,
ou jener des JaJcines, parce qu’on les jette dans les
foffés pour les combler.
On employé encore des JaJcines dans la conftruc-
tion des batteries & la réparation des breches après
un fiege: mais ces JaJcines font beaucoup plus longues
que les antres, ayant depuis dix piés jufqu’à
douze. V o y e { Sa u c i s s q n s , Ba t t e r ie s & Ep a u -
LEMENT , (<2)
Fa s c in e g o u d r o n n é e , e ftxmejajdnctrempée
dans de la poix, ou du g o u d r o n . On s’en fert dans la
guerre des fiéges, pour brûler les logemens & les autres
ouvrages de l’ennemi. (Q)
F a s c in e , (Jard.) Voye^ C l a y o n a g e .
* FASCINÜS, f. m. divinité adorée chez les Romains.
Ils en fufpendoient l’image au cou de leurs
petits enfans, pour les garantir du maléfice qu’ils ap-
pelloient JaJcinum. Ce dieu fufpendu au cou des petits
enfans, étoit repréfenté fingulierement, fous la
forme du membre viril. Le don de l’amulete préfer-
vative étoit accompagné de quelques cérémonies.
Une de ces cérémonies, c’étoit de cracher trois fois
fur le giron de l’enfant. Quoique le fymbole du dieu
Fajcinus ne fût pas fort honnête , c’étoit cependant
les veftales qui lui facrifioient. On en attachoit encore
la figure aux chars des triomphateurs.
FASrER, {Marine.') on dit les voilesJafient, c’eft-
à-dire que le vent n’y donne pas bien, & que la ralingue
vacille t o u j o u r s . (Z )
FASSEN, (Géog.) pays d’Afrique dans la Numi-
die, fitué entre les deferts de Libye, le pays des Nègres
, & l’Egypte. Sa capitale eft à 4411 de longitude
t e de latitude, félon Dapper, dont le premier
méridien paffe à la pointe du cap Verd. {D . J.)
* F ASSURE, f. f. {Manuf. en Joie.) partie de l’étoffe
fabriquée entre l’enfuple & le peigne, fur laquelle
les efpolins font rangés, quand la nature de
l’étoffe en, exige. On donne le même nom à cette
portion de l’étoffe, lorfqu’on n’employe point d’ef-
polins.
FASTE, f. m. {Gram.) vient originairement du latin
jours de fêtes. C ’eft en ce fens qu’Ovide l’entend
dans fon poème intitulé les Jaftes. Godeau a fait
fur ce modele les Jafies de l'cglije, mais avec moins de
fuccès, la religion des romains payens étant plus propre
à la poéfie que celle des chrétiens ; à quoi on peut
ajoûter qu’Ovidé étoit un meilleur poète que Godeau.
Les Jafies confulaires n’étoient que la lifte des
confuls. Voye^ ci-après les articles Fa s t e s {Hifioire).
Les Jafies des magiftrats étoient les jours oif il étoit
permis de plaider; & ceux auxquels on ne plaidoit
pas s’appelloient nefaftes, nejafii , parce qu’alors on
ne pouvoit parler, Jari, en juftice. Ce mot nejaflus en
ce fens ne fignifioit pas malheureux ; au contraire ,
nejaflus & nejandus furent l’attribut des jours infortunés
en un autre fens, qui fignifioit, jours dont
on ne doit pas parler, jours dignes de l’oubli ; illc
& nejaflo te pojuit die.
Il y a voit chez les Romains d’autres Jafles encore
, Jafli urbis, Jafli ruftici ; c’étoit un calendrier à
l’ufage de la ville & de la campagne.
On a toûjours cherché dans ces jours de folennité
à étaler quelque appareil dans fes vêtemens, dans,
fa fuite, dans les feftins. Cet appareil étalé dans d’autres
jours s’eft appellé flafle. Il n’exprime que la magnificence
dans ceux qui par leur état doivent représenter
, il exprime la vanité dans les autres. Quoiöue
le rfiot de faßt ne foit pas toujours injurieux,
Jaflueux l’eft toûjours. Il fit fon entrée avec beaucoup
de Jafle : c’eft un homme Jaflueux .-un religieux
qui fait parade de fa v ertu , met du Jafle jufque dans
l ’humilité même. Foye[ l'article Juivatit.
Le Jafle n’eft pas le luxe. On peut vivre avec luxe
dans fa maifon fans Jafle, e’eft-à-dire fans fe parer
en public d’une opulence révoltante. On ne peut
avoir de Jafle fans luxe. Le Jafle eft l’étalage des dé-
penfes que le luxe coûte. Art. dcM.DE Vo l t a ir e ,
F a s t e , {Morale, j c’eft l’affeélation de répandre,
pàr des marques extérieures, l’idée de fon mérite
, de fa puiffance, de fa grandeur, &c. Il entrait
du fajle dans la vertu des Stoïciens. Il y èn a
prefque toujours dans les afrions éclatantes. C’eft le
Jafle qui élève quelquefois jufqu’à l’héroïfme, des
hommes, à qui il en coûterait d’être honnêtes. C ’eft
le Jafle qui rend la généralité moins rare que l’équité
; & de belles a étions, plus faciles que l’habitude
d’une vertu commune. Il entre àwjafle dans la dévotion
, quand elle infpire plus de zele que de moeurs,
& moins Rattachement à fes devoirs comme homme
& comme citoyen, que le goût des pratiques extraordinaires.
'
On fe fert plus communément du mot Jafle, pour
exprimer cet appareil de magnificence ; ce luxe d’apparence,
& non d,e commodité, par lequel les grands
prétendent annoncer leur rang au refte des hommes.
Ils ont prefque tous du Jafle dans les maniérés : c’eft
lin des lignes par lefquels ils font reconnoître leur
état. Dans les pays où ils ont part au gouvernement,
ils ont de la morgue & du dédain : dans les pays où
ils ont moins de crédit que de prétentions, ils ont
une politeffe qui a fon Jafle, & par laquelle ils cherchent
à plaire fans commettre leur rang.
On demande fi dans ce liecle éclairé il eft encore
utile que les hommes qui commandent aux nations ,
annoncent la grandeur & la puiffance des nations
par des dépenfes exceflives, & par le luxe le plus
faftueux ? Les peuples de l’Europe font affez inftruits
de leurs forces mutuelles, pour diftinguer chez leurs
voifins un vain luxe d’une véritable opulence. Une
nation aurait plus de refpeéi pour des chefs qui l’enrichiraient,
que pour des chefs qui voudraient la
faire paffer pour riche. Des provinces peuplées,
des armées difciplinées, des finances en bon ordre^
impoferoient plus aux étrangers & aux citoyens,
que la magnificence de la cour. Le feul Jafle qui convienne
à de grands peuples , ce font les monumens,
les grands ouvrages , & ces prodiges de l’ait qui font
admirer le génie autant qu’ils ajoutent à l’idée de la
puiffance.
F a s t e s , f . m. pl. {Hifl.) calendrier des Romains,
dans lequel étoient marqués ■ jour par jour leurs fêtes,
leurs jeux, leurs cérémonies, & tout cela fous la di-
.vifion générale de jours Jafles & nefafles , permis &
défendus, c’eft-à-dire de jours deftinésaux afiàires,
& de jours deftinés au repos.
Varron dans un endroit dérive le nom de Jafies de
Jari, parler, quia ju s Jari liubat; & en un autre endroit
il le fait venir de Jas, terme qui fignifie proprement
loi divine, & eft différent de ju s , qui fignifie
feulement loi humaine.
Mais les Jaftes, quelle qu’en foit l’étymologie, &
dans quelque lignification qu’on les prenne, n’étoient
point connus des Romains fous Romulus. Les jours
leur étoient tous indifférens, & leur année compo-
fée de dix mois félon quelques-uns, ou de douze félon
d’autres , bien loin d’avoir aucune diftinûion
certaine pour les jours, n’en avoit pas même pour
les faifons , puifqu’il devoit arriver néceffairement
plûtôt ou plûtard que les grandes chaleurs fe fiffent
quelquefois fentir au milieu de Mars, & qu’il gelât à
glace au milieu de Juin: en un mot Romulus étoit
mieux inftruit dans le métier de la guerre, que dans
la fcience des aftres.
Tout changea fous Numa : ce prince établit un
ordre confiant dans les chofes. Après s’être concilié
l’autorité, que la grandeur de fon mérite & la fiétion
de fon commerce avec les dieux pouvoient lui attirer,
il fit plufieurs reglemeris, tant pour la religion,
que pour la politique ; mais avant tout, il ajufta fon
année de douze mois au cours & aux phafès de la
J-une ; & des jours qui compofoient chaque mois, il
deftina les uns aux affaires, & les autres au repos.
Les premiers furent appellés dies Jafli , les derniers
Aies nejafti ; comme qui dirait jours permis , & jours
défendus. Voilà la première origine des Jafles.
Il paraît que le deffein de Numa fut feulement
d’empêcher qu’on ne pût quand on voudrait, convoquer
les tribus & les curies, pour établir de nouvelles
lois , ou pour faire de nouveaux magiftrats :
mais par une pratique conftamment obfervée depuis
ce prince jufqu’à l’empereur Augufte, c’eft-à-dire
pendant l’efpace d’environ <560 ans, ces jours permis
& défendus rJafii & nefafli, furent entendus des
Romains, auffi bien pour radminiftration de la juftice
entre les particuliers, que pour le maniment des
affaires entre les magiftrats. Quoi qu’il en foit, Numa
voulut faire fentir à fes peuples que l’obfervation
régulière de ces jours permis & non-permis, étoient
pour eux un point de religion, qu’ils ne pouvoient
négliger fans crime : de-là vient que Jas & ntjas dans
les bons auteurs, fignifie ce qui eft conforme ou contraire
à la volonté des dieux.
On fit donc un livre où tous les mois de l’année,
à commencer par Janvier , furent placés dans leur
ordre, ainfi que les jours, avec la qualité que Numa
leur avoit affignée,. Ce livre fut appellé/«/?ï, du nom
des principaux jours qu’il contenoit. Dans le même
livre fe trouvoit une autre divifion des jours nom*
més fefti, prefefli, interciji, auxquels furent ajoûtés
dans la fuite, aies Jenatorii t dies comitiales, diespra-
liares, dies Jaufli > dies atri , c’eft-à-dire» des jours défi
tinés au culte religieux des divinités, au travail ma«
nuel des hommes, des jours partagés entre les uns ÔC
les autres, des jours indiqués pour les affemblées du
fénat, des jours pour l’éleûion des magiftrats,. des
jours propres à livrer bataille, des jours marqués
par. quelque heureux événement, ou par quelque
calamité publique. Mais toutes ces différentes efpeces
fe trouvoient dans la première fubdivifion de
dies Jafli & nefafli.
Cette divifion des jours étant un point de religion
, Numa en dépofa le livre entre les mains des
pontifes, lefquels joüiffant d’une autorité fouverai-
ne dans les chofes qui n’avoient point été réglées
par le monarque, pouvoient ajoûter aux fêtes ce
qu’ils jugeoient à-propos : mais quand ils vouloient
apporter quelque changement à ce qui avoit été une
fois établi & confirmé par un long ufage , il falloir
que leur projet fût autorifé par un decret du fénat;
par exemple, le 15 de devant les ides du mois Sex-
tilis, c’eft-à-dire le 17 de Juin, étoit un-jour de fête.
& de réjoiiiffance dans Rome ; mais la perte déplorable
des 300 Fabius auprès du fleuve de Crémera l’an
de Rome 276, & la défaite honteufe de l’armée romaine
auprès du fleuve Allia par les Gaulois l’an
3 72 , firent convertir ce jour de fête en jour de trif-
teffe.
Les pontifes furent déclarés les dépofîtaires uniques
& perpétuels des Jaftes; & ce privilège de p o t
féder le livre des Jafles à l’exclufionde toutes autres
perfonnes , leur donna une autorité finguliere. Ils
pouvoient fous prétexte des Jafles ou nefaftes , avancer
ou reculer le jugement des affaires les plus importantes
, & traverfer les deffeins les mieux concertés
des magiftrats & des particuliers. Enfin » com*