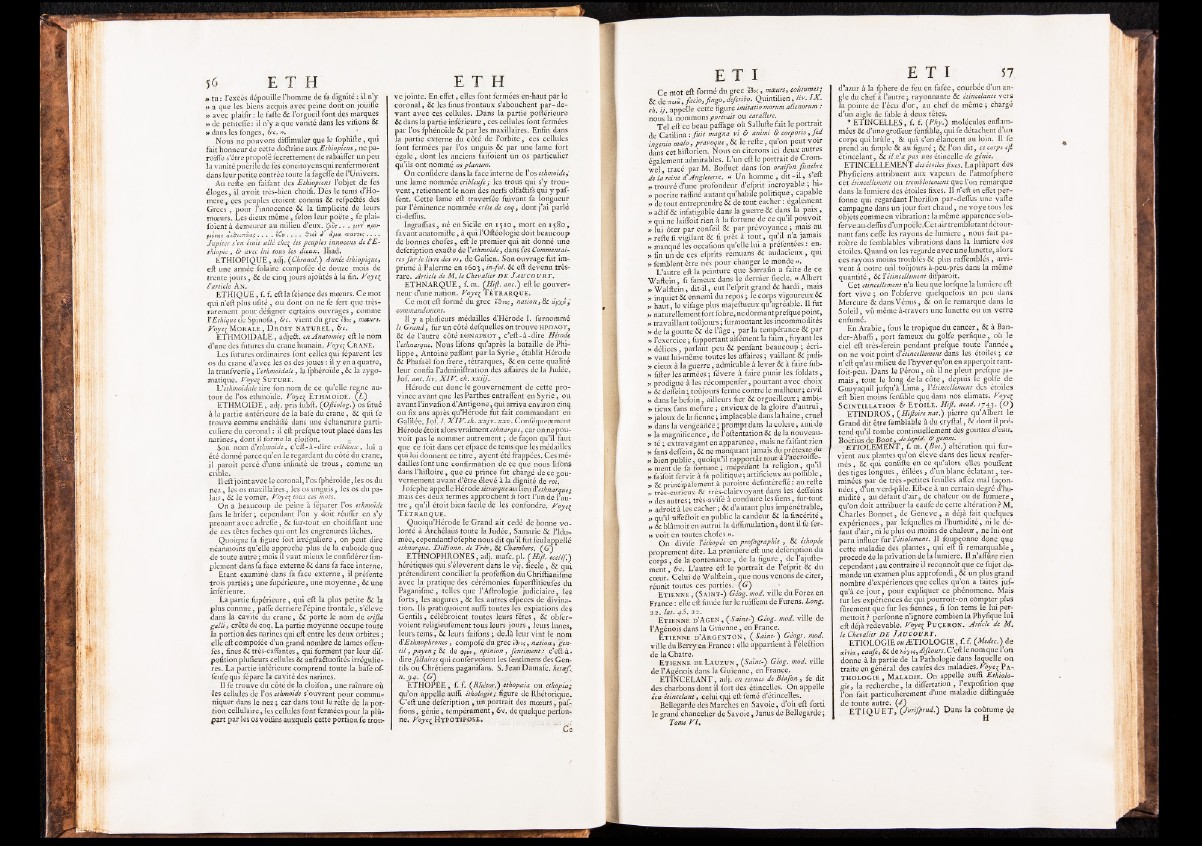
56 E T H
h tu : l’excès dépouille l’homme de la dignité : il n’y
», a que les biens acquis avec peine dont on joiiiffe
» avec plailir : le faite & l’orgueil font des marques
», de petitelfe: il n’y a que vanité dans les vifions &
» dans les fonges, &c. ». '
Nous ne pouvons diffimuler que le fophifte, qui
fait honneur de cette doctrine aux Ethiopiens, ne pa-
roiffe s’être propofé fecrettement de rabaiffer un peu
la vanité puérile de fes concitoyens qui renfermoient
dans leur petite contrée toute la fageffe de l’Univers.
Au refte en faifant des Ethiopiens l’objet de fes
éloges, il avoit très-bien choili. Dès le tems d’Ho-
mere, ces peuples étoient connus & refpeétés des
Grecs , pour l’innocence & la limplicité de leurs
moeurs. Les dieux même, félon leur p oète, fe plai-
foient à demeurer au milieu d’eux. Çiîiç. . . p t i a/xvfiovaç
àld-IOTTHctÇ . .. . tClt . . . . &toï I a/ML ‘BetVTtÇ ....
Jupiter s'en étoit allé che£ les peuples inno cens de VE-
thiopie , & avec lui tous les dieux. Iliad.
ETHIOPIQUE, adj. ( Chronol'.) Année èthiopique,
eft une année folaire compofée de douze mois de
trente jours, & de cinq jours ajoutés à la fin. Vye^
Varticle An.
ETHIQUE, f. f. elt la fcience des moeurs. C e mot
qui n’elt plus ufité, ou dont on ne fe fert que très-
rarement pour déligner certains ouvrages, comme
VEthique de Spinofa, &c. vient du grec îùoç, maurs.
Voye%_Morale, Droit naturel, & c.
ETHMOID A L E , adjeét. en Anatomie; elt le nom
d’une des futures du crâne humain. Voye[ Crâne.
Les futures ordinaires font celles qui féparent les
os du crâne d’avec les os des joues : il y en a quatre,
la tranfverfe, l’ethmoïdale , la Iphéroïde, & la zygomatique.
Voye^ SUTUR E.
\Jethmoïdale tire fon nom de ce qu’elle régné autour
de l’os ethmoïde. Voye^ Ethmoïde. (L)
ETHMOIDE, adj. prisfublt. ( Ofiéolog.) osfitué
à la partie antérieure de la bafe du crâne, & qui fe
trouve comme enchâfl’é dans une échancrure particulière
du coronal : il elt prefque tout placé dans les
narines, dont il forme la cloifon.
Son nom d’ethmoïde, c’elt-à-dire cribleux, lui a
été donné parce quen le regardant du côté du crâne,
il paraît percé d’une infinité de trous, comme un
crible.
Il elt joint avec le coronal, l’os fphèroîde, les os du
nez, les os maxillaires, les os unguis, les os du palais
, & le vomer. Voye^ tous ces mots.
On a beaucoup de peine à féparer l’os ethmoïde
fans le brifer ; cependant l’on y doit réulïir en s’y
prenant avec adreffe, & fur-tout en choififfant une
de ces têtes feches qui ont les engrenures lâches.
Quoique fa figure foit irrégulière, on peut dire
néanmoins qu’elle approche plus de la cuboïde que
de toute autre ; mais il vaut mieux le conlidérer Amplement
dans fa face externe & dans fa face interne.
Etant examiné dans fa face externe, il préfente
trois parties ; une fupérieure, une moyenne, & une
inférieure.
La partie fupérieure, qui elt la plus petite & la
plus connue, palfe derrière l’épine frontale, s’élève
dans la cavité du crâne, & porte le nom de crijla
gaLli, crête de coq. La partie moyenne occupe toute
la portion des narines qui elt entre les deux orbites ;
elle elt compofée d’un grand nombre de lames offeu-
fes, fines & très-caffantes, qui forment par leur dif-
pofition plulieurs cellules & anfraétuolités irrégulières.
La partie inférieure comprend toute la bafe of-
feufe qui fépare la cavité des narines.
11 fe trouve du côté de la cloifon, une rainure où
les cellules de l’os ethmoïde s’ouvrent pour commur
niquer dans le nez ; car dans tout le relie de la portion
cellulaire, les cellules font fermées pour la plur
part par les os voifins auxquels cette portion fe trouv
e jointe. En effet, elles font fermées en-haut par le
coronal, & les linusfrontaux s’abouchent par-devant
avec ces cellules. Dans la partie poftérieure
& dans la partie inférieure, ces cellules font fermées
par l’os fphénoïde & par les maxillaires. Enfin dans
la partie externe du côté de l’orbite, ces cellules
font fermées par l’os unguis & par une lame fort
égale, dont les anciens faifoient un os particulier
qu’ils ont nommé os planum.
On confidere dans la face interne de l’os ethmoïde>
une lame nommée cribleufe ; les trous qui s’y trouvent
, retiennent le nom des nerfs olfaétifs qui y paf-
fent. Cette lame eft traverfée fuivant fa longueur
par l’éminence nommée crête de coq, dont j’ai parlé
ci-deffus.
Ingraffias, né en Sicile en 15 10, mort en 1580,
favant anatomifte, à qui l’Oftéologie doit beaucoup
de bonnes chofes, eft le premier qui ait donné une
defeription exafte de Y ethmoïde, dans fes Commentaires
fur le livre des os, de Galien. Son ouvrage fut imprimé
à Palerme en 1603, infol. & eft devenu très-
rare. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
ETHNARQUE, f. m. (Hift. anc.) eft le gouverneur
d’une nation. Voye^ Tétrarque.
Ce mot eft formé du grec , nation, & JpX” 9
commandement.
Il y a plufieurs médailles d’Hérode I. furnommé
le Grand, fur un côté defquelles on trouve hphaot,
& de l’autre côté eqnapkot , c’eft-à-dire Hérode
Y ethnarque. Nous lifons qu’après la bataille de Philippe
, Antoine paffant par la Syrie, établit Hérode
& Phafaël fon frere, tétrarques, & en cette qualité
leur confia l’adminiftration des affaires de la Judée.
Jof. ant. liv. X IV . ch. xxiij.
Hérode eut donc le gouvernement de cette province
avant que lesParthes entraffent en Syrie, ou
avant l’invalion d’Antigone, qui arriva environ cinq
ou fix ans après qu’Hérode fut fait commandant en
Galilée. Jof . I. X IV . ch. xxjv.xxv. Conféquemment
Hérode étoit alors vraiment ethnarque, car on ne pou-
voit pas le nommer autrement ; de façon qu’il faut
que ce foit dans cet efpace de tems que les médailles
qui lui donnent ce titre, ayent été frappées. Ces médailles
font une confirmation de ce que nous lifons
dans l’hiftoire, que ce prince frit chargé de ce gouvernement
avant d’être élevé à la dignité de roi.
Jofephe appelle Hérode tétr arque au lieu à!ethnarque;
mais ces deux termes approchent fi fort l’un de l ’autre
, qu’il étoit bien facile de les confondre. Voye^ Tétrarque.
Quoiqu’Hérode le Grand ait cédé de bonne v o lonté
à Archélaüs toute la Judée, Samarie & l’Idu-»
mée, cependantjofephe nous dit qu’il fut feul appellé
ethnarque. Dictionn. de Trév. & Chambers.
ETHNOPHRONES, adj. mafe. pi. (AS/?, ecclêf )
hérétiques qui s’élevèrent dans le v ij. fiecle, & qui
prétendirent concilier la profeftion du Chriftianifme
avec la pratique des cérémonies fuperftitieufes du
Paganifme, telles que l’Aftrologie judiciaire, les
forts -, les augures , & les autres efpeces de divina-
. tion. Ils pratiquoient auffi toutes les expiations des
Gentils, célébroient toutes leurs fêtes, & obfer-
voient religieufement tous leurs jours , leurs lunes,
leurs tems, & leurs faifons ; de.là leur vint le nom
| d’Ethnophrones, compofé du grec ilôvoç, nation, gen-
\ t il , payen; &C d e ippny, opinion , fentiment : c’eft-à«
| dire feclaires qui confervoient les fentimens des Gentils
ou Chrétiens paganifans. S. Jean Damafc, heraC
W Ê Ê (G)
ETHOPÉE, f. f. ( Rhétor.) ethopoeia ou ethopia;
qu’on appelle auffi éthologie; figure de Rhétorique.
C ’eft une defeription , un portrait des moeurs, paf-
fions, génie, tempérament, &c. de quelque perlon-
ne. Voye^ HyPOTiPOSE.
Ce
Ce mot eft formé du grec »8«, moeurs, c o i tu n u s j
& de ™ S , fa c to , f in g o , d tferibo. Quintilien, U v . I X .
eh . l j . appelle cette figure imitatwmorum a lu n orum :
Uous la nommons p o r trait ou carackrc.
Tel eft'ce beau paffage oii Sallufte fait.le portrait
de Catilina : f u i t magna v i & m irn i & corporis, f t d
in g e n iom a lo , p r a v o qm , & le refte, qu’on peut voir
dans cet hiftorien. Nous en citerons ici deux autres
également admirables. L’un eft le portrait de Crom-
lyel , tracé^par M. Boffuet dans fon oraifon funèbre
,de la reine £ Angleterre. « Un homme , dit - i l , s’eft
» trouvé d’une profondeur d’efprit incroyable ; lu-
>1 pocrite raffine autant qu’habile politique, capable
« de tout entreprendre S t de tout cacher : egalement
>> aâif & infatigable dans la guerre 8c dans la paix,
» qui ne laiffoit rien h la fortune de ce qu’il pouvoit
» lui ôter par confeil 8c par prévoyance ; mais au
» refte fi vigilant 6c fi prêt h tout, qu’il n’a jamais
» manqué les occafiôns qu’elle lui'a préfentées : en-
» fin un de ces efprits remuans 8c audacieux, qui
,i femblent être ne's pour changer le monde ».
L’autre eft la peinture que Sarralin a faite de ce j
Waflein, fi fameux dans le dernier fiecle. « Albert
» Walftein, dit-il, eut l’efprit grand 8c hardi, mais
» inquiet 8c ennemi du repos ; le corps vigoureux 8c
» haut, le vifage plus majeftueux qu’agréable. Il fut
s> naturellement fortfobre, ne dormant prefque point,
» travaillant toujours ; furmontant les incommodités
» de la goutte 8c de l’âge,.par la tempérance 6ç par
» l’exercice ; fupportant aifement la faim, fuyant les
» délices , parlant peu 8c penfant beaucoup ; écri-
» vant lui-même toutes les affaires ; vaillant 8c judi-
» cieux à la guerre, admirable à lever 8c à faire fub-
» fifter les armées ; févere à faire punir les foldats,
» prodigue à les: récompenfer, pourtant avec choix
„ & deffein ; toujours forme contre le malheur ; civil
» dans le befoin, ailleurs fier 8c orgueilleux ; ambi-
» lieux fans mefure ; envieux de la gloire d’autrui,
» jaloux de la fienue ; implacable dans la haine, crael
», dans la vengeance ; prompt dans la colere; ami de
» la magnificence, dé l’oftentation 8c de la nouyeau-
» té ; extravagant en apparence, mais ne faifant rien
» fans deffein, 8c ne manquant jamais du prétexte*.
» bien public, quoiqu’il rapportât tout à l’aCcroifiSr ’
» ment de fa fortune ; méprifant la religion, qu il
» faifoit fervir à fa politique ; artificieux au poffible,
» & principalement à paroitre defintereffe : au relie
» très-curieux & tres-clairvoyant dans les deffeins
» des autres ; très-avifé à conduire les liens, fur-tout
» adroit à les cacher ; & d’autant plus impénétrable,
», qu’il affeûoit en public la candeur & la fmcérité,
», & blâmoit en autrui la diffimulation, dont il fe fer-
», voit en toutes chofes ».
On divife l’ èthopèe en profographie , & éthopée
proprement dite. La première eft une defeription du
corps, de la contenance , de la figure, de l’ajufte-
ment, & c . L’autre eft le portrait de l’efprit & du
coeur. Celui'de Walftein, que nous venons de citer,
réunit toutes ces parties. ( G ) Etienne , (Saint-) Géog . mod. ville du Forez en
France : elle eft fttuée fur le ruiffeau de Furens. L o n g .
2 2 . l a t . 4 S . 2 2 . f Etienne d’Agen, ( S a in t - ) G e og . mod. ville de
l’Agénois dans la Guienne, en France. : l : ’. 7 Etienne d’Argenton, ( S a i n t - ) G éogr. mod.
ville du Berry en France : elle appartient à l’eleétion
de la Châtre. Etienne de Lauzun , (S a in t- ) Géog. mod. ville
de l’Agénois dans la Guienne, en France.
ETINCELANT, adj. en termes de B la f o n , fe dit
des charbons dont il fort des étincelles. On appelle
écu étin ce la n t, .celui qiü eft femé d’étincelLes.
Bellegarde des Marches en Savoie, d’ôii eft forti
le erand chancelier de Savoie, Janus de Bellegarde;
Tome VI.
d’azur à la fphere de feu en fafee, courbée d’un angle
du chef à l’autre ; rayonnante & étincelante vers
la pointe de l’écu d’or , au chef de même ; chargé
d’un aigle de fable à deux têtes.
* ETINCELLES, f. f. (Phy-) molécules enflammées
& d’une groffeur fenuble, quife détachent d’un
corps qui b ride, & qui s’en élancent au loin. Il fe
prend au fimple & au figuré ; & l’on dit, ce corps ej£
étincelant, & il ri a pas une étincelle de génie.
ETINCELLEMENT des étoiles fixes. La plupart des
Phyficiens attribuent aux vapeurs de l’atmofphere
cêt étincellemmt ou tremblotement que l’on remarque
dans la lumière des étoiles fixes. Il n’eft en effet per-
fonne qui regardant l’horifon par-deffus une vafte
campagne dans un jour fort chaud, ne voye tous les
objets comme en vibration : la même apparence s ob-
ferve au-defliis d’un poële.Cet air tremblotant détournant
fans cefle les rayons de lumière, nous fait paraître
de femblables vibrations dans la lumière des
étoiles. Quand on les regarde avec une lunette, alors
ces rayons moins troublés & plus raffemblés , arrivent
a notre oeil toujours à-peu-près dans la même
quantité, &cVétincellement dilparoit.
Cet etincellement n’a lieu que lorfque la lumière eft
fort v iv e ; on l’obferve quelquefois un peu dans
Mercure & dans Vénus, & on le remarque dans le
Soleil, vu même à-travers une lunette ou un verre
enfumé.
En A rabie, fous le tropique du cancer, & à Bander
Abaffi , port fameux du golfe perfique, oh le
ciel eft très-lerein pendant prefque toute l’année,
on ne voit point d'étincellement dans les étoiles ; ce
n’eft qu’au milieu de l’hy ver qu’on en apperçoit tant-
foit-peu. Dans le Pérou, oh il ne pleut prefque jamais,
tout le long de la c ô te , depuis le golfe de
Guayaquil jufqu’à Lima, Yédncellement des étoiles
eft bien moins fenfible que dans nos climats. Voye^ Scintillation & Etoile. Hift. acad. 1743. (O )
ETINDROS, (Hiftoire nat.) pierre qu’Albert le
Grand dit être femblable à du cryftal, & dont" il prétend
qu’il tombe continuellement des gouttes d’eau•
Boëtius de B oot, de lapid. & gemm. I ETIOLEMENT, f. m. (Bot.) alteration qui fur-
vient aux plantes qu’on éle.ve dans des lieux renfermés,
qui confifte en ce qu’alors elles pouffent
des tiges longues, éfilées, d’un blanc éclatant, terminées
par de très -petites feuilles affez mal façonnées
, d’un verd-pâle. Eft-ce à un certain degré d’humidité
, au défaut d’air, de chaleur ou de lumière,
qu’on doit attribuer la caufe de cette altération ? M.
Charles Bonnet, de G en evç, a déjà fait quelques
expériences, par lefquelles ni l’humidité, ni le défaut
d’air, ni le plus ou moins de chaleur, ne lui ont
paru influer fur l’étiolement. Il foupçonne donc que
cette maladie des plantes, qui eft fi remarquable,
procédé de la privation de la lumière. Il n’affure rien
cependant ; au contraire il reco.nnoît que ce fujet demande
un examen plus approfondi, & un plus grand
nombre d’expériences que celles qu’on a faites jufqu’à
ce jour, pour expliquer ce phénomène. Mais
lur les expériences de qui pourroit-on compter plus
Jurement que fur les fiennes, fi fon tems le lui per-
mettoit ? perfonne n’ignore combien la Phyfique lui
eft déjà redevable. Voyt{ PuçERON. Article de M.
le Chevalier D E J A U C O U R T .
ETIOLOGIE ou ÆTIOLOGIE, f. f. (Mcdcc.) de
aiTia. , caufe, & de xôyoç, difcours .C ’eft le nom quel on
donne à la partie de la Pathologie dans laquelle on
traite en général des caufes des maladies. Voyefft a-v
thologie , Maladie. On appelle auffi Etkiolo-
gie, la recherche, la differtation , l’expofition que
l’on fait particulièrement d’une maladie diftinguée
de toute autre., (d)
E T IQ U E T » (Jurifprud.) Dans la coûtume 4«,