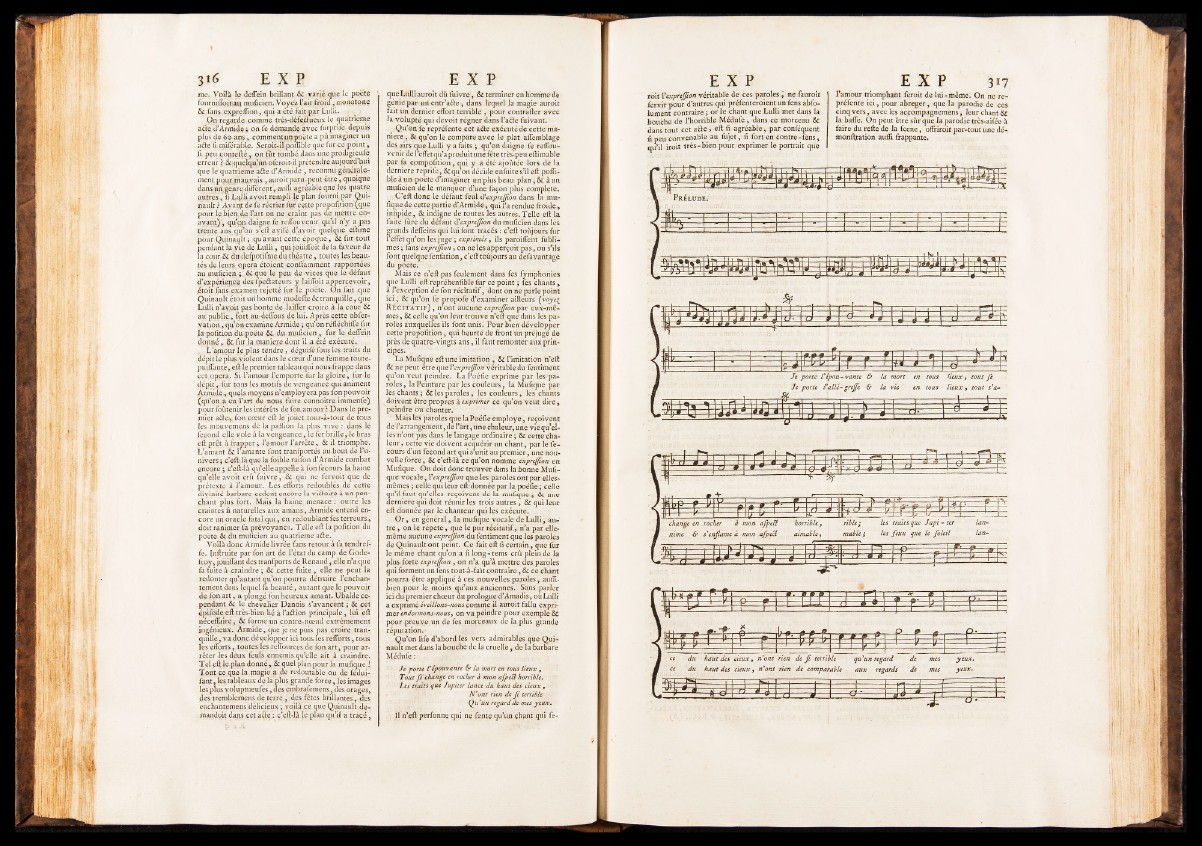
me. Vpijàj l$deffein brillant & varié que le poëte
fourniffoitjait muficieri. Voyez j’air froid, monotone
& fans exjxreflîon, qui a: été fait-par Lulli. -
On regarde comme tr,ès-dé£e$ueux le quatrième
a^e, d’^rmjd^i on fe demande avec f'urprii'e depuis
plus de^ôo^y^ cpmmeqtunpoëte a pû imaginer un
aâ e li misérable, ^erpit-iijpplîible que fur ce point ',
li,peiijqopte^é,..on fut tombé,.dans une prodigieufe
erreur £ &ique)qui’un oferoit-il prétendre aujourd’hui
que le quatrième a£te d’Armide , reconnu generaler
mçnj; pqu^, pouvais -, auroit pam^peut être, qpoîque
dans pn^genre,-différept, auffi .agréable que les quatrg
autres , fi rempli .lç plan fourni par Qpinault
? n i de fe-récrierifpr capte proportion (que
pour lç,bien;de. l’art on ne ,craint pas. de ipettre.en-
avant)^ qvf-pp daigne feyelfpiiyenir qu’il n’y a pas
trente ansqu’q n s ’eft avilé.d’ayoir quelque eftime
pour Quinaylt ; qu’avant cette„éppque, & fur-tout
pendant la y ie de Lu lli, qui jpiiiffoit de la faveur de
la cour ôç du defpotifme du théâtre, toutes les beautés
de leurs qpera étoient conftamment rapportées
au muficiei},;..&: que le peu de,;vices que le défaut
d’expéricnfiê des fpe&atçurs y laiffoit appercevoir,
étoit fans examen rejette fur le .poète. On fait que
Quinault étoit un honime madefte Sç tranquille, que
Lulli n’aypjt pas honte de iaiffer croire à la cour &
au public., fort.au-deffous de lui. Après çette obfer-
vation,.qu’oiyexamineArmide; qu’on réfléchiffe fur
la,pofition.d^ppët:e &. du>mwficien, fur le deffein
donné,. fur la maniéré,dont il .a été exéctitç.,
i L'amour _lp. plus tendre , déguifé fous les traits du
dépit le plus violent dans le coeur d’une:femme, tqute-
puifTaot,ç,,eft le premier tableau qui nous,frappe dans
cet ppera. Si l’amour l’emporte fur la gloire, fur le
dépitiJ; fur tous les motifs de vengeance qui animent
Arinide , quels moyens n’empipyera pas fon pouvoir
(qù’on a eu l ’art de nous faire connoître immenfe)
pour foûtçnir lçs intérêts de fon amour ? Dans; le premier
afre^fon coeur eft le joiiet tour-à-tour de tous
les mouvemens de la paflion la plus vive : dans le
fécond elle vole à la vengeance, le fer brille, le bras
efl: prêt à frapper ; l’amour l’arrête, & il triomphe.
L ’amant & l’amante font tranfportés au bout de l’univers
; c-’efl-là que la foible raifon d’Armide combat
encore ; c’eft-là qu’elle appelle à fon fecours la haine
qu’elle avoit crû fuivre, & qui ne fervoit que de
prétexte à l’amour. Les efforts redoublés de cette
divinité barbare cederit encore la viftoire à un penchant
plus fort. Mais la haine menace : outre les
craintes fi naturelles aux amans, Armide entend encore
un oracle fatal qui, en redoublant fes terreurs.,
doit ranimer fa prévoyance. Telle efl la pofition du
poète & du muficien au quatrième a£le.
Voilà donc Armide livrée fans retour à fa tehdref-
fe. Inftruite par fon art de l’état du camp de Godefroy,
joiiiffant des tranfports de Renaud, elle n’a que
fa fuite à craindre ; & cette fuite , elle ne peut la
redouter qu’autant qu’on pourra détruire l’enchantement
dans lequel fa beauté, autant que le pouvoir
de fon-art, a plongé fon heureux amant. Ubalde cependant
& ;le chevalier Danois s’avancent ; & cet
épifo.de eft.tr ès-bien lié à l’a&ion principale , lui efl
néceffaire, & forme :un contre-noeud extrêmement
ingénieux. Armide, que je ne puis pas croire tranquille,
va donc développer ici tous les refforts, tous
les efforts, toutes les.reffources de fon,art, pour arrêter
les deux feuls ennemis qu’elle ait à craindre.
Telçflle.plan donné, & quel plan pour la mufique !
Tout.ce que la magie,a de redoutable ou de fédui-
fant, lès.tableaux de la plus grande force, les images
les plus yoluptueufes, des embrafemens, des orages,
des tremblemens de terre, ides fêtes brillantes, des
enchantemeps délicieux ; voilà ce que Quinault. demandent
dans cet a fie : ç’eft-là le plan qu’il a tracé,
queLiiUlauroit dû fuivré, & terminer en homme de
génie par- uri entr’a fte, dans lequel la magie auroit
fait un dernier effort terrible. ,opour contrafter avec
la volupté qui deyoit régner dans l’aèfe fuivant.
Qu’on :fe repréfente cet aâie exécuté de cette maniéré
, & qii’on le compare avec le plat affemblage
des airs que Lulli y a faits ; qu’on daigne fe reffou-
venir de l’effet qu’a produit une fête très-peu eftimable
par fa „epmpofition, qui y a été ajoûtée lors de la
derniere reprife, & qu’on décide enfuite s’il efl pofîi-
ble à un-poète d’imaginer un plus beau plan, & à un
muficien de: le manquer d’une façon plus complété.
C ’eft donc le défaut feùl d'expreJJion dans la mu-
fiqiie de cette partie d’Armide, qui l’a rendue froide,
infipide , & indigne de toutes les autres. Telle efl la
fuite Tûrë (Tu défaut d’exprejjion du muficien dans les
grands dëffeihs qui lui font tracés : c’eft toujours fur
l’effet qu’on les juge ; exprimés , ils paroiffent fubli-
més ; fans expreJJion, on ne les apperçoit pas, ou s’ils
font quelque fenfation, c’eft tôûjours au defavantagé
du poète;
Mais ce n’eft pas feulement dans fes fymphonies
que Lulli eft repréhenfible fur ce point ; les chants,
à l’exception de foi? récitatif, dont on ne parle point
ic i , &c‘ qu’on fe propofe d’examiner ailleurs (yoye^ Récitatif) , n’ont aucune expreJJion par eux-mêmes
, & celle qu’on leur trpuve n’eft que dans les par-
rôles auxquelles ils font unis. Pour bien développer
cette pfopofition, qui heurte de front un préjuge de
près de quatre-vingts ans , il faut remonter aux principes^
V V: '
La Mufique eft une imitafion , & l’imitation ri’eft
& ne peut etre que l’expreJJion véritable du fentimënt
qu’on veut peindre.. La Poéfie exprime par les -paroles,
la Peinture parles couleurs, la Mufique par
les chants; & les paroles; les couleurs, les chants
doivent être.propres à exprimer ce qu’on Veut dire,
peindre ou chanter.
Mais lès paroles que la Poéfie employé , reçoivent
de l’arrangement,de l’art, une chaleur, une vie qu’el-
les'n’ont pas dans le langage ordinaire ; & cette chaleur
, cette v ie doivent acquérir un chant, par le fe-
coiirs d’un fécond art qui s’unit au premier, une nouvelle
force, & c’eft-là ce qu’on nomme expreJJion en
Mufique. On doit donc trouver dans la bonne Mufique
vocale, l’expreJJion que les paroles ont par elles-
mêmes ; celle qui leur eft donnée par la poéfie ; celle
qu’il faut qu’elles reçoivent dé la mufique ; & une
derniere qui doit réunir les trois autres , & qui leur
eft donnée par le chanteur qui les exécute.
O r , en général, la mufique vocale de Lulli, autre
, on le répété, que le pur récitatif, n’a par elle-
même aucune expreJJion du fentiment que les paroles
de Quinault ont peint. Ce fait eft fi certain, que fur
le même chant qu’on a fi long - tems crû plein de la
plus, forte expreffion , on n’a qu’à mettre des paroles
qui forment un fens tout-à-fait contraire, & ce chant
pourra être appliqué à ces nouvelles paroles, auflx-
bien pour le moins qu’ aux anciennes. Sans parler
ici du premier choeur au prologue d’Amadis, où Lulli
a exprimé éveillons-nous comme il auroit fallu exprimer
endormons-nous, on va peindre pour exemple &c
pour preuve un de fes morceaux de la plus grande
réputation.-
Qu’on life d’abord les vers admirables que Quinault
met dans la bouche de la cruelle, de la barbare
Médufe : •
• Je porte l'épouvante & la mort en tous lieux ,
Tout fe change en rocher à mon afpecl horrible.
Lès traits que ' Jupiter lance du haut des deux ,
N'ont rien de J i terrible
Qu'un regard de mes yeux.
Il n’eft perfonne qui ne fente qu’un chant qui feroit
VexpreJJion véritable de ces paroles ÿ ne fauroit
fervir pour d’autres qui préfenteroiént un fens abfo-
lument contraire ; or le chant que Lulli met dans la
bouche de l’horrible Médufe, dans ce morceau &
dans tout cet afte , eft fi. agréable, par conféquent
fi peu convenable au fujet, fi fort en contre-lens,
qu’il iroit très-bien pour: exprimer le portrait que
l’amour triomphant feroit de lui-même. On ne repréfente
ic i, pour abréger, que la parodie de ces
cinq vers, avec les accompagnemens, leur chant &
la baffe. On peut être sûr que la parodie très-aifée à
faire du refte de la feene, offriroit par-tout une dé-
monftration aufli frappante.