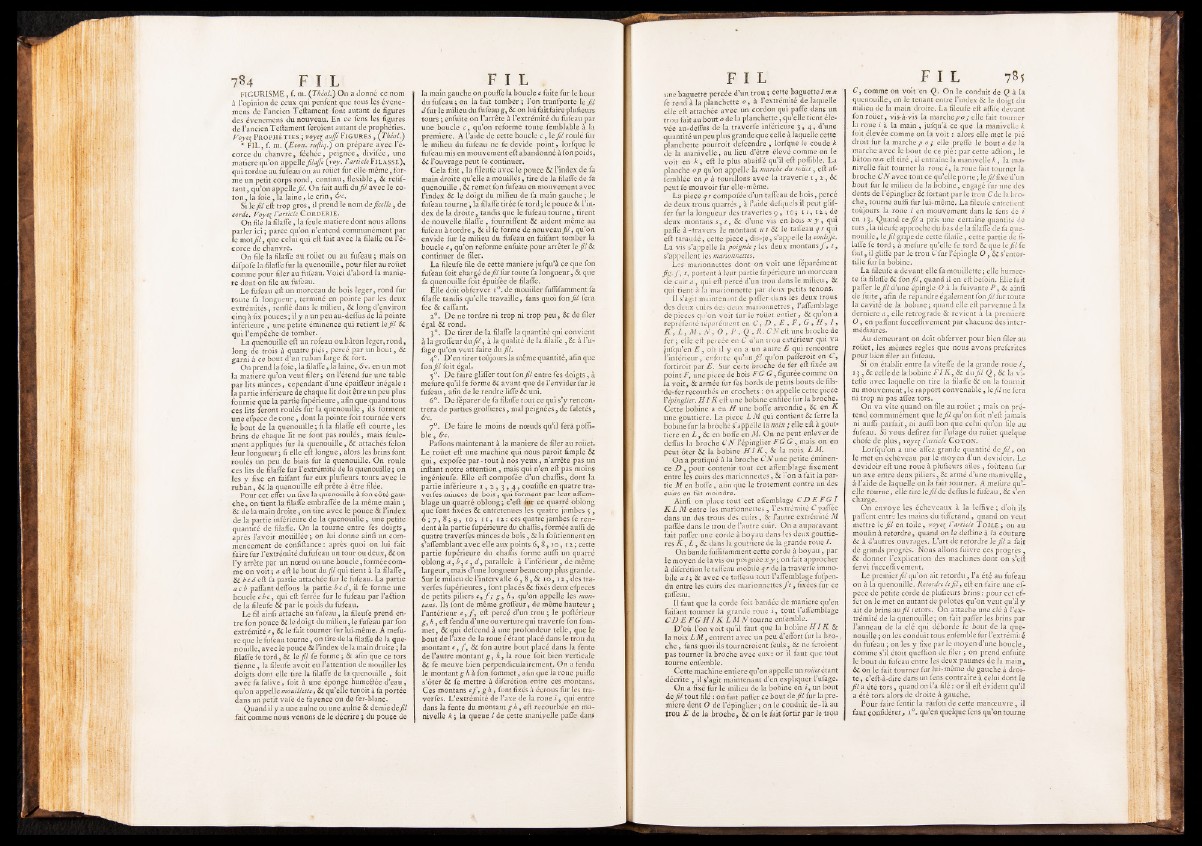
784 F I L
FIGURISME, f. m. (Théol,') On a donné ce nom
à l’opinion de ceux qui penfent que tous les évene-
mens de l’ancien Teftament font autant de figures
des évenemens du noùveau. En ce fens les figures
de l’ancien Teftament feroient autant de prophéties.
Voy&{ Prophéties ; voye^ aujfi Figures , ( Théol.)
* FIL, f. m. (Econ. rujliq.) on prépare avec l’écorce
du chanvre, féchée, peignée, divifée, une
matière qu’on appelle filqjfi (voy. 1'article Filasse),
qui tordue au fufeau ou au roiiet fur elle-même, forme
un petit corps rond, continu, flexible, & refif-
tant, qu’on appelle f il. On fait aufli du f i l avec le coton
, la foie, la laine ,.le crin, &c.
Si le f i l eft trop gros, il prend le nom de ficelle, de
corde. Voye{ l'article CO RD ERIE.
On file la filafle, la feule matière dont nous allons
parler ici ; parce qu’on n’entend communément par
le mot f i l , que celui qui eft fait avec la filafle ou l’écorce
de chanvre.
On file la filafle au roiiet ou au fufeau ; mais on
difpofe la filafle fur la quenouille, pour filer au roiiet
comme pour filer au fufeau. Voici d’abord la maniéré
dont on file au fufeau.
Le fufeau eft un morceau de bois leger, rond fur
toute fa longueur, terminé en pointe par les deux
extrémités, renflé dans le milieu, & long d’environ
cinq à fix pouces ; il y a un peu au-defîus de là pointe
inférieure , une petite éminence qui retient le f i l &
qui l’empêche de tomber.
La quenouille eft un rofeau ou bâton leger, rond,
long de trois à quatre piés, percé par un bout, &
garni à ce bout d’un ruban large ôc. fort.
On prend la foie, la filafle, la laine, &c. en un mot
la matière qu’on veut filer ; on l’étend fur une table
par lits minces, cependant d’une épaiffeur inégale :
la partie inférieure de chaque lit doit être un peu plus
fournie que la partie fupérieure, afin que quand tous
ces lits feront roulés fur la quenouille, ils forment
une efpece de cône, dont la pointe foit tournée vers
le bout de la quenouille ; fi la filafle eft courte, les
brins de chaque lit ne font pas roulés, mais feulement
appliqués fur la quenouille, & attachés félon
leur longueur ; fi elle eft longue, alors les brins font
roulés un peu de biais fur la quenouille. On roule
ces lits de filafle fur l’extrémité de la quenouille ; on
les y fixe en faifant fur eux plufieurs tours avec le
ruban, & la quenouille eft prête à être filée.
Pour cet effet on fixe la quenouille à fon côté gauche,
on tient la filafle embraffée de la même main ;
èc de la main droite, on tire avec le pouce & l’index
de la partie inférieure de la quenouille, une petite
quantité de filafle. On la tourne entre fes doigts,
après l’avoir mouillée ; on lui donne ainfi un commencement
de confiftance : après quoi on lui fait
faire fur l’extrémité du fufeau un tour ou deux, &on
l’y arrête par un noeud ou une boucle, formée comme
on voit ; a eft le bout du f il qui tient à la filafle,
& b c d eft fa partie attachée fur le fufeau. La partie
a c b paffant deffous la partie b c d 9 il fe forme une
boucle cb c , qui eft ferrée fur le fufeau par l’aâion
de la fileufe & par le poids du fufeau.
Le fil ainfi attaché au fufeau, la fileufe prend entre
fon pouce & le doigt du milieu, le fufeau par fon
extrémité c, & le fait tourner fur lui-même. A mefu-
re que le fufeau tourne, on tire de la filafle de la quenouille,
avec le pouce & l’index de la main droite ; la
filafle fe tord, & le f il fe forme ; & afin que ce tors
tienne, la fileufe avoit eu l’attention de mouiller les
doigts dont elle tire la filafle de la quenouille , foit
avec fa falive, foit à une éponge humeftée d’eau,
qu’on appelle mouillette, & qu’elle tenoit à fa portée
dans un petit vafe de fayence ou de fer-blanc.
Quand il y a une aulne ou une aulne & demie de f il
fait comme nous venons de le décrire ; du pouce de
la main gauche on pouffe la boucle c faite fur le bout
du fufeau ; on la fait tomber ; l’on tranfporte le fil
d fur le milieu du fufeau g, &C on lui fait faire plufieurs
tours ; enfuite on l’arrête à l’extrémité du fufeau par
une boucle c , qu’on reforme toute femblable à la
première. A l’aide de cette boucle c 9 l e f i l roulé fur
le milieu du fufeau ne fe dévidé point, lorfque le
fufeau mis en mouvement eft abandonné à fon poids,
Ôc l’ouvrage peut fe continuer.
Cela fa it, la fileufe avec le pouce & l’index de fa
main droite qu’elle a mouillés, tire de la filafle de fa
quenouille, & remet fon fufeau en mouvement avec
l’index & le doigt du milieu de fa main gauche ; le
fufeau tourne j la filafle tirée fe tord; le pouce & l ’index
de la d roite, tandis que le fufeau tourne, tirent
de nouvelle filafle , fourniffent & aident même au
fufeau à tordre, & il fe forme de nouveau f i l , qu’on
envide fur le milieu du fufeau en faifant tomber la
boucle c, qu’on reforme enfuite pour arrêter le f i l &
continuer de filer.
La fileufe file de cette maniéré jufqu’à ce que fon
fufeau foit chargé de f i l fur toute fa longueur, & que
fa quenouille foit épuifée de filafle.
Elle doit obferver i° . de mouiller fuffifamment fa
filafle tandis qu’elle travaille, fans quoi fon f i l fera
fec & caffant.
z°. De ne tordre ni trop ni trop peu, & de filer
égal & rond.
3°. De tirer de la filafle la quantité qui convient
à la grofi'eur du ƒ / , à la qualité de la filafle , & à l’u-
fage qu’on veut faire du f i l .
40. D ’en tirer toujours la même quantité, afin que
fon f i l foit égal.
50. De faire gliffer tout fon f i l entre fes doigts, à
mefure qu’il fe forme & avant que de l’envider fur le
fufeau, afin de le rendre liffe & uni.
6°. De féparer de fa filafle tout ce qui s’y rencontrera
de parties groffieres, mal peignées, de faletés,
& c .
70. D e faire le moins de noeuds qu’il fera pofli-
b le , & c .
Paffons maintenant à la maniéré de filer au roiiet.
Le roiiet eft une machine qui nous paroît fimple &
qui, expofée par - tout à nos y e u x , n’arrête pas un
inftant notre attention, mais qui n’en eft pas moins
ingénieufe. Elle eft compofée d’un chaflis, dont la
partie inférieure 1 , 2 , 3 , 4 , confifte en quatre tra-
verfes minces de bois, qui forment par leur affem-
blage un quarré oblong ; c’eft fur ce quarré oblong
que font fixées & entretenues les quatre jambes 5 ,
6 ; 7 , 8 ; 9 , 10 ; 1 1 , 12 : ces quatre jambes fe rendent
à la partie fupérieure du chaflis, formée aufli de
quatre traverfes minces de bois, & la foûtiennent en
s’affemblant avec elle aux points 6 ,8 , 1 0 , 12; cette
partie fupérieure du chaflis forme aufli un quarré
oblong a 9b 9c , d , parallèle à l’inférieur, de même
largeur, mais d’une longueur beaucoup plus grande.
Sur le milieu de l’intervalle 6 , 8 , & i o , i 2 , des traverfes
fupérieures, font placés & fixés deux efpeces
de petits piliers e , f ; g , h , qu’on appelle les mon-
tans. Ils font de même groffeur, de même hauteur ;
l’antérieur e , ƒ , eft percé d’un trou ; le poftérieur
g, h , eft fendu d’une ouverture qui traverfe fon fom-
met, & qui defeend à une profondeur telle, que le
bout de l’axe de la roue i étant placé dans le trou du
montant e , ƒ , & fon autre bout placé dans la fente
de l’autre montant g , A, la roue foit bien verticale
& fe meuve bien perpendiculairement. On a fendu
le montant g A à fon fommet, afin que la roue puiffe
s’ôter & fe mettre à diferétion entre ces montans.
Ces montans e f , g A, font fixés à écrous fur les traverfes.
L’extrémité de l’axe de la roue i , qui entre
dans la fente du montant g A, eft recourbée en manivelle
k ; la queue l de cette manivelle paffe dans
une baguette percée d’un trou ; cette baguette l m n
fe rend à la planchette o , à l’extrémité de laquelle
elle eft attachée avec un cordon qui paffe dans un
trou fait au bout o de la planchette, qu’elle tient élevée
au-deffus de la traverfe inferieure 3 > 4> dune
quantité un peu plus grande que celle à laquelle cette
planchette pourroit defeendre , lorfque le coude k
de la manivelle, au lieu d’être élevé comme on le
voit en k , eft le plus abaifle qu’il eft poflible. La
planche 0p qu’on appelle la marche du roiiet, eft af-
femblée en p à tourillons avec la traverlè 1 ,2 , &
peut fe mouvoir fur elle-même.
La piece q r compofée d’un taffeau de bois, percé
de deux trous quarrés , à l’aide defquels il peut gliffer
fur la longueur des traverfes 9 , 10; 1 1, 12 ; de
deux montans s , t , & d’une vis en bois x y , qui
paffe à-travers le montant «r & le taffeau q r qui
eft taraudé, cette piece, dis-je, s’appelle la coulijje.
La vis s’appellera poignée ; les deux montans ƒ , r,
s’appellent les marionnettes.
Les marionnettes dont on voit une feparement
f ig . f , t , portent à leur partie fupérieure un morceau
de cuir a , qui eft percé d’un trou dans le milieu, &
qui tient à la marionnette par deux petits tenons.
Il s’agit maintenant de paffer dans les deux trous
des deux cuirs des deux marionnettes, l’affemblage
de pièces qu’on voit fur le roiiet entier, & qu’on a
repréfenté léparément en C , D , E , F , G , H , I ,
K , L , M , N , 0 , P , Q , R . CNe f t une broche de
fer ; elfe eft percée en C d’un trou extérieur qui va
jufqu’èn E , oîi il y en a un autre E qui rencontre
l’intérieur, enforte qu’un f i l qu’on pafferoit en C 9
fortiroit par E. Sur cette broche de fer eft fixee au
point F, une piece de bois F G G , figurée comme on
la voit, & armée fur fes bords de petits bouts de fils-
•de-fer recourbés en crochets : on appelle cette piece
Yépinglier. H I K eft une bobine enfilée fur la broche.
Cette bobine a en H une boffe arrondie, & en if
une gouttière. La piece L M qui contient & ferre la
bobine fur la broche s’appelle la n o ix ; elle eft à gouttière
en L , ôc en boffe en M. On ne peut enlever de
deffus la broche C N l’épinglier F G G , mais on en
peut ôter & la bobine H I K , & la noix LM .
On a pratiqué à la broche CW une petite éminence
D , pour contenir tout cet affemblage fixement
entre les cuirs des marionnettes, & l'on a fait la partie
M en boffe, afin que le frotement contre un des
cuirs en fût moindre.
Ainfi on place tout cet affemblage C D E F G I
K L M entre les marionnettes , l’extrémité Cpaffee
dans un des trous des cuirs, & l’autre extrémité M
paffée dans le trou de l’autre cuir. On a auparavant
fait paffer une corde à boyau dans les deux gouttières
K , L , & dans la gouttière de la grande roue /.
On bande fuflilamment cette corde à boyau , par
le moyen de lavis ou poignée x y ; on fait approcher
à diferétion le taffeau mobile q-r de la traverfe immobile
& avec ce taffeau tout l’aflémblage fufpen-
du entre les cuirs des marionnettes f i t , fixées fur ce
taffeau.
Il faut que la corde foit bandée de maniéré qu’en
faifant tourner la grande roue i , tout l’affemblage
C D E F G H I K L M N tourne enfemble. '
D’oû l’on voit qu’il faut que la bobine H I K &
la noix L M , entrent avec un peu d’effort fur la bro-,
che, fans quoi ils tourneroient feuls, & ne feroient
pas tourner la broche avec eux: or il faut quei tout
tourne enfemble.
Cette machine entière qu’on appelle un roiiet étant
décrite , il s’agit maintenant d’en expliquer l’ufage.
On a fixé fur le milieu de la bobine en i, un bout
de f i l tout filé : on fait paffer ce bout de f i l fur la première
dent O de l’épinglier ; on le conduit de-là au
trou E de la broche, & on le fait fortir par le trou
C, comme on voit‘en Q. On le conduit de Q à la
quenouille, en le tenant entre l’index & le doigt du
milieu de la main droite. La fileufe eft aflife devant
fon roiiet, vis-à-vis la marchep o ; elle fait tourner
la roue i à la main , jufqu’à ce que la manivelle k
foit élevée comme on la voit : afors elle met le pié
droit fur la marche p o ; elle preffe le bout o de la
marche avec le bout de ce pié: par cette a&ion, le
bâton m n eft tiré, il entraîne la manivelle k , la manivelle
fait tourner la roue i , la roue fait tourner la
broche C N avec tout ce qu’elle porte ; le f i l fixé d’un
bout fur le milieu de la bobine, engagé fur une des
dents de l’épinglier & fortant par le trou C de la broche,
tourne aufli fur lui-même. La fileufe entretient
toujours la roue i en mouvement dans le fens de i
en 13. Quand ce f i l a pris une certaine quantité de
tors, la fileufe approche du bas de la filafle de fa quenouille
, le f i l gripe de cette filafle, cette partie de fi-
laffe fe tord ; à mefure qu’elle fe tord & que le f il fe
fait, il gliffe par le trou C fur l’épingle O , & s’entortille
fur la bobine.
La fileufe a devant elle fa mouillette ; elle humecte
fa filafle & fon f i l , quand il en eft befoin. Elle fait
paffer le f i l d’une épingle O à la fui vante P , & ainfi
de fuite, afin de répandre également fon f i l fur toute
la cavité de la bobine ; quand elle eft parvenue à la
dernier en, elle rétrogradé & revient à la première
O , en paffant fucceflivement par chacune des intermédiaires.
Au demeurant on doit obferver pour bien filer au
roiiet, les mêmes réglés que nous avons preferites
pour bien filer au fufeau.
Si on établit entre la yîteffe de la grande roue /,
13 , & celle de la bobine F I K , & du f i l Q , & la vî-
teffe avec laquelle on tire la filafle & on la fournit
au mouvement, le rapport convenable, le f i l ne fera
ni trop ni pas affez tors.
On va vite quand on file au roiiet ; mais on prétend
communément que le f i l qu’on fait n’eft jamais
ni aufli parfait, ni aufli bon que celui qu’on file au
fufeau. Si vous defirez fur l’ufage du roiiet quelque
chofe de plus, voye^ l'article C o t o n .
Lorfqu’on a une affez grande quantité de f i l , on
le met en échêveau par le moyen d’un dévidoir. Le
dévidoir eft une roue à plufieurs aîles , foutenu fur
un axe entre deux piliers, & armé d’une manivelle,
à l’aide de laquelle on la fait tourner. A mefure qu’elle
tourne, elle tire le f i l de defl'us le fufeau, & s’en
charge.
On envoyé les écheveaux à la leffive ; d’oii ils
paffent entre les mains du tifferand, quand on veut
mettre le f i l en toile, voye^ l'article T o il e ; ou au
moulin à retordre, quand on le deftine à la couture
& à d’autres ouvrages. L’art de retordre le f i l a fait
dè grands progrès. Nous allons fuivre ces-progrès,
& donner l’explication des machines dont on s’eft
fervi fucceflivement.
Le premier f i l qu’on ait retordu, l’a été au fufeau
ou à la quenouille. Retordre le f i l , eft. en faire une efpece
de petite corde de plufieurs brins : pour cet effet
on le met en autant de pelotes qu’on veut qu’il y
ait de brins au f i l retors. On attache une clé à l’extrémité
de la quenouille ; on fait paffer les brins par
l’anneau de la clé qui déborde le bout de la quenouille
; on les conduit tous enfemble fur l’extrémité
du fufeau ; on les y fixe par le moyen d’une boucle,
comme s’il étoit queftion de filer ; on prend enfuite
le bout du fufeau entre les deux paumes de la main ,
& on le fait tourner fur lui-même de gauche à droite
, c’eft-à-dire dans un fens contraire à celui dont le
f i l a été tors, quand on l’a filé : or il eft évident qu’il
a été tors alors de droite à gauche.
Pour faire fentir la raifon de cette manoeuvre, il
faut confidérer, i°. qu’en quelque fens qu’on tourne