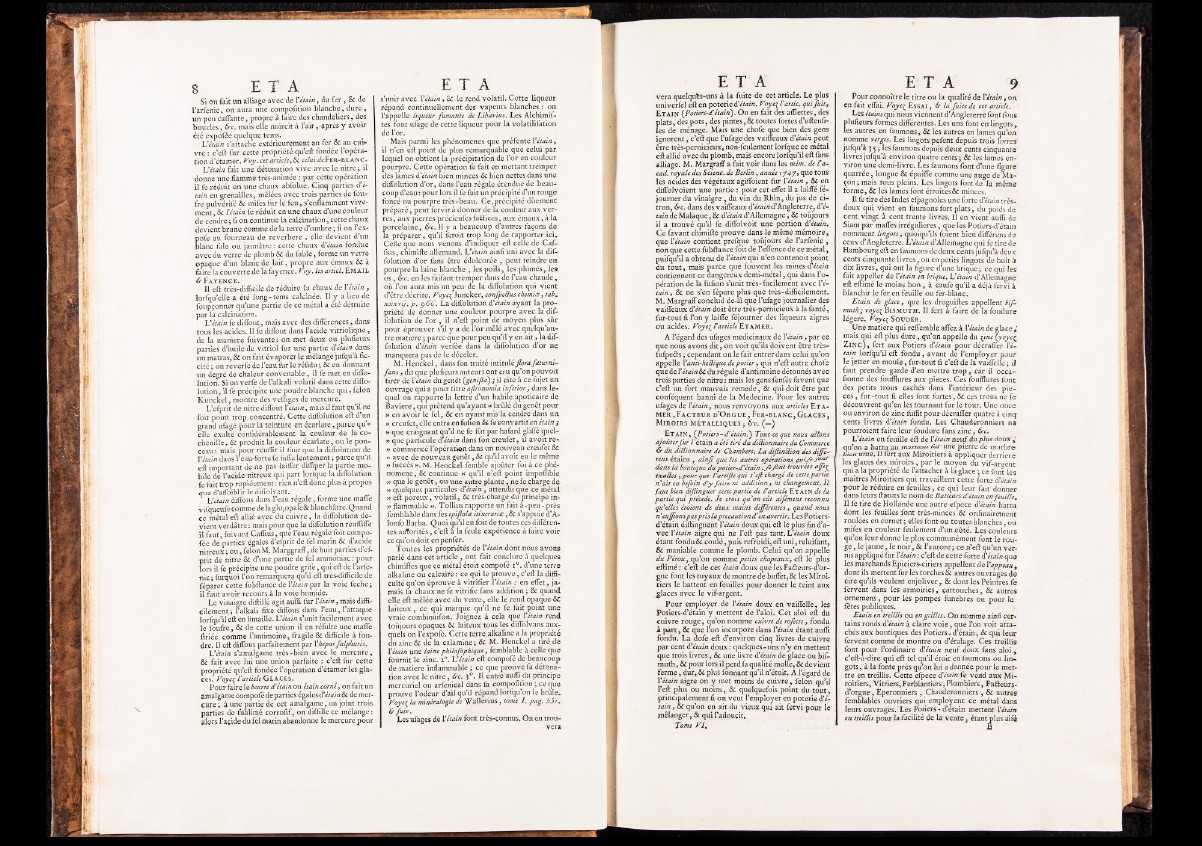
Si on fait un alliage avec de 1*étain, du fer , & de
l’arfenic, on aura une compofition blanche, dure,
un peu caftante, propre à faire des chandeliers , des
boucles, &c. mais elle noircit à l’a ir , après y avoir
été expofée quelque tems.
Vétain s’attache extérieurement au fer au cuivre
tion : d’étamfeurr.c’eft cette propriété qu’eft fondée & l’opéraVoy.
cet article, 6c celui de Fer-BLaNC.
Vétain fait une détonation vive avec le nitre ; il
donne une flamme très-animée : par cette opération
il fe réduit en une chaux abfolue. Cinq parties d e-
tain-çn grenailles, mêlées avec trois parties de fou-
fre pulvérifé & mifes fur le feu, s’enflamment v ivement
, & 1 * étain fe réduit en une chaux d’une couleur
de cendre ; fi on continue la calcination, cette chaux
devient brune comme de la terre d’ombre ; fi on l’ex-
ofe au fourneau de reverbere , elle devient d’un
lanc fale ou jaunâtre : cette chaux d* étain fondue
avec du verre de plomb & du fable, forme un verre
opaque d’un blanc de la it , propre aux émaux & à
faire la couverte de la fayence. V?y. les articl. Email
& Fayence. Il eft très-difficile de réduire la chaux de Y étain ,
lorfqu’elle a été long-tems calcinée. Il y a lieu de
foupçonner qu’une partie de ce métal a été détruite
par la calcination.
Vétain fe diffout, mais avec des différences, dans
tous les acides. Il fe diflout dans l’acide vitriolique,
de la maniéré fuivantec on met deux ou plufieurs
parties d’huile de vitriol fur une partie d’étain dans
un matras, & on fait évaporer le mélange jufqu’à fic-
cité ; on reverfe de l’eau fur le réfidu ; & en donnant
un degré de chaleur convenable, il fe met én diffo-
lution. Si on verfe de l’alkali volatil dans cette diffo-
lution, il fe précipite une poudre blanche qui, félon
Kunckel, montre des veftiges de mercure.
L’efprit de nitre diffout Y étain, mais il faut qu’il ne
foit point trop concentré. Cette diffolution eft d’un
grand ufage pour la teinture en écarlate, parce quelle
exalte confidérablement la couleur de la cochenille,
& produit la couleur écarlate, ou le ponceau
: mais pour réuffir il faut que la diffolution de
Y étain dans l’eau-forte fe faffe lentement ; parce qu’il
eft important de ne pas laiffer diffiper la partie mobile
de l’acide nitreux qui part lorfque la diffolution
fe fait trop rapidement : rien n’eft donc plus a propos
que d’affoiblir le diffolvant.
Vétain diffous dans l’eau régale, forme une maffe
vifqueùfe comme de la glu,opale& blanchâtre. Quand
ce métal eft allié avec du cuivre, la diffolution devient
verdâtre : mais pour que la diffolution réuffiffe
il faut, fuivant Caflius, que l’eau régale foit composée
de parties égales d’efprit de fel marin & d’acide
nitreux ; ou, félon M. Marggraff, de huit parties d’efprit
de nitre & d’une partie de fel ammoniac : pour
lors il fe précipite une poudre grife, qui eft de l’arfe-
nic ; furquoi l’on remarquera qu’il eft très-difficile de
féparer cette fubftance de Y étain par la voie feche ;
il faut avoir recours à la voie humide. -
Le vinaigre diftillé agit auffi fur Y étain, mais difficilement;
l’alkali fixe diffous dans l’eau, l’attaque
lorfqu’il eft en limaille. L’étain s’ unit facilement avec
le foufre, & de cette union il en réfulte une maffe
ftriée comme l’antimoine, fragile & difficile à fondre.
Il eft diffous parfaitement par Yhepar.fulphuris.
L’étain s’amalgame très-bien avec le mercure,
& fait avec lui une union parfaite : c’eft fur cette
propriété qu’eft fondée l’opération d’étamer les glaces.
Foyei l ’article GLACES.
Pour faire le beurre d’étain ou étain corné, on fait un
amalgame cpmpofé de parties égales d’étain & de mercure
; à une partie de cet amalgame, on joint trois
parties de fublimé corrofif, on diftillé ce mélange :
«ilors l’acide du fel marin abandonne le mercure pour
s’unir avec Yétain, & le rend volatil. Cette liqueur
répand Continuellement des vapeurs blanches : on
l’appelle liqueur fumante de Libavius. Les Alchimif-
tes font ufage de cette liqueur pour la volatilifation
de l’or.
Mais parmi les phénomènes que préfente Y étain
il n’en eft point de plus remarquable que celui par
lequel on obtient la précipitation de l’or en couleur
pourpre. Cette opération fe fait en mettant tremper
des lames d’étain bien minces & bien nettes dans une
diffolution d’o r, dans l’eau régale étendue de beaucoup
d’eau : pour lors il fe fait un précipité d’un rouge
foncé ou pourpre très-beau. Ce.précipité dûement
préparé, peut fervir à donner de la couleur aux verres,
aux pierres précieufes factices, aux émaux, à la
porcelaine, &c. Il y a beaucoup d’autres façons de
la préparer, qu’il leroit trop long de rapporter ici.
Celle que nous venons d’indiquer eft celle de Caf-
fius, chimifte allemand. L’étain ainfi uni avec la diffolution
d’or fans être édulcorée , peut teindre en
pourpre la laine blanche , les poils, les plumes, les
o s , &c. en les faifant tremper dans de l’eau chaude ,
où l’on aura mis un peu de la diffolution qui vient
d’être décrite. Voye{ Juncker, confpeclus chemioe, tab.
xxxvij. p . c) 6'6'. La diffolution à?étain ayant la propriété
de donner une couleur pourpre avec la diffolution
de l’or , il n’eft point de moyen plus sûr
pour éprouver s’il y a de l’or mêlé avec quelqu’au-
tre matière ; parce que pour peu qu’il y en a it, la diffolution
d’étain verfée dans la diffolution d’or ne
manquera pas de le déceler.
M. Henckel, dans fon traité intitulé flora faturni-
fans , dit que plufieurs auteurs ont cru qu’on pouvoit
tirer de Y étain du genêt (genijla) ; il cite à ce fujet un
ouvrage qui a pour titre ajlronomia inferior , dans lequel
on rapporte la lettre d’un habile apoticaire de
Bavière, qui prétend qu’ayant « brûlé du genêt pour
» en avoir le fel, & en ayant mis la cendre dans un
» creufet, elle entra en fuüon & fe convertit en étain ;
» que craignant qu’il ne fe fût par hafard glifi'é quel-
» que particule d’étain dans fon creufet, il avoit re-
» commencé l’opération dans un nouveau creufet &
»» avec de nouveau genêt, & qu’il avoit eu le même
» fuccès ». M. Henckel femble ajoûter foi à ce phénomène,
& continue « qu’il n’eft point impoflible
» que le genêt, ou une autre plante, n efe charge de
» quelques particules $ étain, attendu que ce métal
» eft poreux, volatil, & très-chargé du principe in-
» flammable ». Tollius rapporte un fait à -peu - près
femblable dans fes epifiolce itinérante, & s’appuie d’A-
lonfo Barba. Quoi qu’il en foit de toutes ces différentes
avftorités, c’eft a la feule expérience à faire voir
ce qu’on doit en penfer.
Toutes les propriétés de l’étain dont nous avons
parlé dans cet article , ont fait conclure à quelques
chimiftes que ce métal étoit compofé i° . d’une terre
alkaline ou calcaire : ce qui le p rouve, c’eft la difficulté
qu’on éprouve à vitrifier Y étain : en effet, jamais
fa chaux ne fe vitrifie fans addition ; & quand
elle eft mêlée avec du verre, elle le rend opaque &
laiteux, ce qui marque qu’il ne fe fait point une
vraie combinaifon. Joignez à cela que Y étain rend
toûjours opaques & laiteux tous les diffolvans auxquels
on l’expofe. Cette terre alkaline a la propriété
du zinc & de la calamine; & M. Henckel a tiré de
Y étain une laine philofophique, femblable à celle que
fournit le zinc. z°. L’étain eft compofé de beaucoup
de matière inflammable ; ce que prouve fa détonation
avec le nitre, &c. 30. Il entre auffi du principe
mercuriel ou arfenical dans fa compofition ; ce que
prouve l’odeur d’ail qu’il répand lorfqu’on le brûle.
Foye%_ la minéralogie de Wallerius, tome I , pag. 551.
& fuiv.
Les ufages de Y étain font très-connus, On en trouvera
vera quelqufes-uns à la fuite de cet article. Le plus
univerfel eft en poterie à’étain. Voye{ l ’artic. qui fuit, Etain (Potiers-d’étain). On en fait des affiettes, des
plats, des pots, des pintes, & toutes fortes d’uftenfi-
les de ménage. Mais une chofe que bien des gens
ignorent, c’eft que l’ufage des vaiffeaux d’étain peut
être très-pernicieux, non-feulement lorfque ce métal
eft allié avec du plomb, mais encore lorfqu’il eft fans
alliage. M. Margraff a fait voir dans les mém. de l ’a-
cad. royale des Scienc. de Berlin, année que tous
les acides des végétaux agiffoient fur Y étain, & en
diffolvoient une partie : pour cet effet il a laiffé fé-
journer du vinaigre, du vin du Rhin, du jus de citron,
&c. dans des vaiffeaux dYétain d’Angleterre, d’étain
de Malaque, & d’étain d’Allemagne, & toûjours
il a trouvé qu’il fe diffolvoit une portion $ étain.
Ce favant chimifte prouve dans le même mémoire,
que Y étain contient prefque toûjours de l’arfenic ,
non que cette fubftance foit de l’effence de ce métal,
puifqu’il a obtenu de Y étain qui n’en contenoit point
du tout, mais parce que fouvent les mines d’étain
contiennent ce dangereux demi-métal, qui dans l’o-*
pération de la fufion s’unit très-facilement avec l’e-
tain, & ne s’en fépare plus, que très-difficilement.
M. Margraff conclud de-là que l’ufage journalier des
vaiffeaux d!étain doit être très-pernicieux à la fanté,
fur-tout fi l’on y laiffe féjourner des liqueurs aigres
ou acides. Voye^Varticle Etamer.
A l’égard des ufages médicinaux de Y étain, par ce
que nous avons dit, on voit qu’ils doivent être très-
fufpeôs ; cependant on le fait entrer dans celui qu’on
appelle Yanti-heclique de potier , qui n’eft autre chofe
que de Y étain & du régule d’antimoine détonnés avec
trois parties de nitre : mais les gens fenfés favent que
c’eft un fort mauvais remede, & qui doit être par
conféquent banni-de la Medecine. Pour les autres
ufages de Y étain, nous renvoyons aux articles EtamMer,
Facteur d’Orgue, Fer-blanc, Glaces, iroirs métalliques , &c. (—)
Etain, (Potiers-d’étain.) Tout ce que nous allons
ajouter fur /’étain a été tiré du dictionnaire du Commerce
& du dictionnaire de Chambers. La diftinclion des diffè-
rens étains , ainji que les autres opérations
dans la boutique dupotier-d’étain,,fi-Jànï trouvées ajft£
exactes , pour que l ’artifte qui s’eji chargé de cettej>artie
n’ait eu befoin d'y faire ni addition , ni changement. I l
faut bien dijiinguer cette partie de l’article Et AIN de la
partie qui précédé. Je crois qu’on eût aifément reconnu
qu’elles étaient de deux mains differentes , quand nous
n’eujjîons pas pris la précaution d’en avertir. Les Potiers-
d’étain distinguent Y étain doux qui eft le plus fin d’av
e c Y étain aigre qui ne l’eft pas tant. L’étain doux
étant fondu & coulé., puis refroidi, eft uni, reluifant,
& maniable comme le plomb. Celui qu’on appelle
du Pérou, qu’on nomme petits chapeaux, eft le plus
eftimé : c’eft de cet étain doux que les Fa&eurs-d’or-
gue font les tuyaux de montre de buffet, & les Miroitiers
le battent en feuilles pour donner le teint aux
glaces avec le vif-argent.
Pour employer de Y étain doux en vaiffelle, les
Potiers-d’étain y mettent de l’aloi. Çet aloi eft du
cuivre rouge, qu’on nomme cuivre de rofette, fondu
à part, & que l’on incorpore dans Y étain étant auffi
fondu. La aofe eft d’environ cinq livres de cuivre
par cent Y?étain doux : quelques-uns n’y en mettent
que trois livres, & une livre d’étain de glace ou bif-
muth, & pour lors il perd fa qualité molle, & devient
ferme, dur, & plus fonnant qu’il n’étoit. A l’égard de
Y étain aigre on y met moins de cuivre, félon qu’il
l’eft plus ou moins, & quelquefois point du tout,
principalement fi on veut l’employer en poterie dV-
tain, &c qu’on en ait du vieux qui ait fervi pour le
jnêlanger, & qui l’adoucit.
Tome VI.
Pour connoître le titre ou la qualité de Y étain, on '
en fait effai. Voyc{ Essai , 0 la fuite de cet article. ■
Les étains qui nous viennent d’Angleterre font fous
plufieurs formes différentes. Les uns font en lingots ,
les autres en faumons, & les autres en lames qü’oxr
nomme verges. Les lingots pefent depuis trois livres'
jufqu’à 3 5 ; les faumons depuis deux cents cinquante
livres jufqu’à environ quatre cents; & les lames environ
une demi-livre. Les faumons font d’une figure
quarrée, longue & épaiffe comme une auge de Maçon;
mais tous pleins. Les lingots font de la même
forme, & les lames font étroites & minces.
Il fe tire des Indes efpagnoles une forte d’étain très-
doux qui vient en faumons fort plats, du poids de
cent vingt à cent trente livres. Il en vient auffi de
Siam par maffes irrégulières, que les Potiers-d’étain
nomment lingots, quoiqu’ils foient bien différons de
ceux d’Angleterre. L ’étain d’Allemagne qui fe tire de
Hambourg eft en faumons de deux cents jufqu’à deux
cents cinquante livres, ou en petits lingots de huit à
dix livres, qui ont la figure d’une brique ; ce qui les
fait appeller de Y étain en brique. L’étain d’Allemagne
eft eftimé le moins bon, à caufe qu’il a déjà fervi à
blanchir le fer en feuille ou fer-blanc.
Etain de glace , que les droguiftes appellent bif-
mléguèthre; .v oyei Bismuth. Il fert à faire de là foudure Voye{ Souder.
Une matière qui reffemble affez à Y étain de glace,*
mais qui eft plus dure, qu’on appelle du çinc (yoyeç Zinc), fert aux Potiers d’étain pour décraffer IV-
tain lorfqu’il eft fondu, avant de l’employer pour
le jetter en m oule, fur-tout fi c’eft de la vaiffelle ; il
faut prendre garde d’en mettre trop, car il occa-
fionne des foufflures aux pièces. Ces foufflures font
des petits trous cachés dans l’intérieur des pièces
, fur-tout fi elles font fortes, & ces trous ne fe
découvrent qu’en les tournant fur le tour. Une once
ou environ de zinc fuffit pour décraffer quatre à cinq
cents livres d?étain fondu. Les Chauderonniers ne
pourroient faire leur foudure fans zinc, &c.
L’étain en feuille eft de Y étain neuf du plus doux ,
qu’on a battu ru 'mâ&kp** f uf line pierre de marbre
bxcrrunré: fl fert aux Miroitiers à appliquer derrière
les glaces des miroirs, par le moyen du vif-argent
qtii a la propriété de l’attacher à la glace ; ce font les
maîtres Miroitiers qui travaillent cette forte d’étain
pour le réduire en feuilles, ce qui leur fait donner
dans leurs ftatuts le nom de Batteursetétain en feuille.
Il fe tire de Hollande une autre efpece d’étain battu
dont les feuilles font très-minces & ordinairement
roulées en cornet ; elles font ou toutes blanches, ou
mifes en couleur feulement d’un côté. Les couleurs
qu’on leur donne le plus communément font le rouge
, le jaune, le noir, & l’aurore ; ce n’eft qu’un vernis
appliqué fur Y étain : c’eft de cette forte d’étain que
les marchands Epiciers-ciriers appellent de Y appeau.
dont ils mettent fur les torches & autres ouvrages de
cire qu’ils veulent enjoliver, & dont les Peintres fe
fervent dans les armoiries, çartouches, & autres
, ornemens, pour les pompes funèbres ou pour le
fêtes publiques.
Etain en treillis ou en grilles. Om nomme ainfi certains
ronds ^ 8 étain à claire v o ie , que l’on voit attachés
aux boutiques des Potiers-d’étain, & qui leur
fervent comme de montre pu d’étalage. Ces treillis
font pour l’ordinaire d’étain neuf doux fans aloi ,
c’eft-a-dire qui eft tel qu’il étoit en faumons ou lingots,
à la fonte près qu’on lui a donnée pour le mettre
en treillis. Cette efpece d’écain~fe vend aux Miroitiers,
Vitriers, Ferblantiers /Plombiers, Faûeurs-
d’orgue, Eperoriniers , Chauderonniers , & autres
femblables ouvriers qui employent ce métal-dans
leurs ouvrages.. Les Potiers-d?étain mettent Yétain
en treillis pour la.facilité de la vente,, étant plus aifé