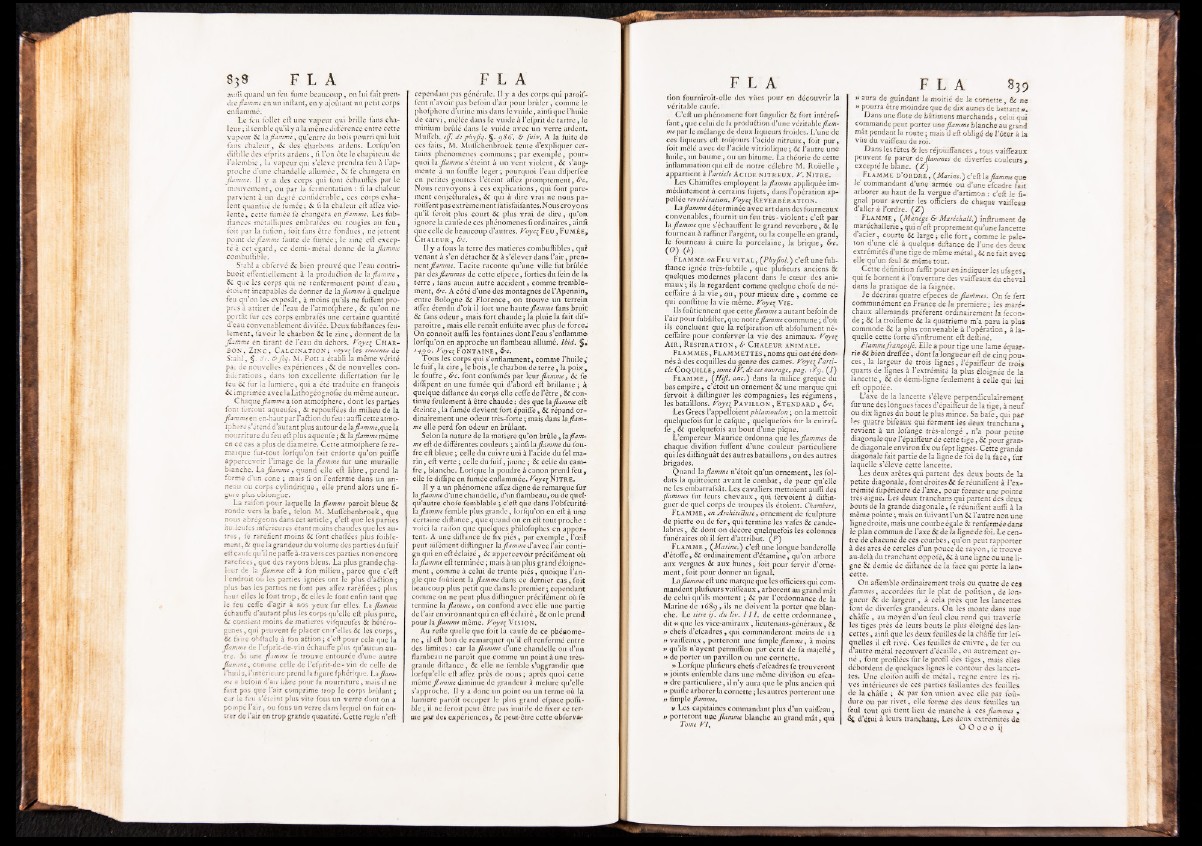
auiu quand un feu fume beaucoup, on lui fait prendreflamme
en un inilant, en y ajoutant un petit corps
enflammé.
Le feu follet ell une vapeur qui brille fans chaleur
; il femble qu’il y a la meme différence entre cette
vapeur & la flamme, qu’entre du bois pourri qui luit
fans chaleur, & des charbons ardens. Loriqu’on
diftille des efprits ardens, li l’on ôte le chapiteau de
l’alembic, la vapeur qui s’élève prendra feu à l’approche
d'une chandelle allumée, & le changera en
flamme. Il y a des corps qui l'ont échauffés par le
mouvement, ou par la fermentation : fi la chaleur
parvient à un degré confidérable, ces corps exhalent
quantité de fumée; & ii la chaleur ell allez violente
, cette fumée fie changera en flamme. Les fub-
fitances métalliques embralées ou rougies au feu,
fioit par la fufion, foit fians être fondues, ne jettent
point de flamme faute de fumée ; le zinc eft excepté
à cet égard, ce demi-métal donne de la flamme
combufiible.
Stahl a obfervé ôc bien prouvé que l’êau contri-
buoit elfentiellement à la production de la flamme,
& que les corps qui ne renfermoient point d’eau,
étoient incapables de donner de la flamme à quelque
fieu qu’on les exposât, à moins qu’ils ne fulfent propres
à attirer de l’eau de l’atmolphere, & qu’on ne
portât fur ces corps embrafés une certaine quantité
d'eau convenablement divifée. Deux fubftances feulement,
lavoir le charbon & le zinc, donnent de la
flamme en tirant de l’eau du dehors. f^oye{ C harb
o n , Z in c , C a l c in a t io n ; vo yelles treetnta de
Stahl, 5 - $'• & f e q . M. Pott a établi la même vérité
pat de nouvelles expériences , ôc de nouvelles con-
ilderations, dans Ion excellente differtation fur le
teu 6c fur la lumière, qui a été traduite en ffançois
& imprimée aveclaLithogéognofie du même auteur.
Chaque flamme a Ion atmol'phere, dont les parties
font Ibrtout aqueufes, & repoulfées du milieu de la
flamme en en-haut par Faction du feu : aulîï cette atmo-
iphere s’étend d’autant plus autour de la flamme,que la
nourriture du feu eft plus aqueufe ; & laflamme même
en ce cas a plus de diamètre. Cette atmoljphere fie remarque
fur-tout lorfqu’on fait enforte qu’on puilfie
appercevoir l’image de la flamme fur une muraille
blanche. La flamme, quand elle eft libre, prend la
forme d’un cône ; mais fi on l’enferme dans un anneau
ou corps cylindrique, elle prend alors une figure
plus oblongue.
La raifon pour laquelle 1%. flamme paroît bleue ÔC
ronde vers la bafe, félon M. Muflchenbroek, que
nous abrégeons dans cet article, c’eft que les parties
hu.lentes inférieures étant moins chaudes que les autres
, fe raréfient moins & font châtrées plus foible-
ment, & que la grandeur du volume des parties du fuif
eft caufe qu’il ne parte à-travers ces parties non encore
raréfiées, que des rayons bleus. La plus grande^ha-
leur de la flamme eft à fon milieu, parce que c’eft
l’endroit où les parties ignées ont le plus d’aûion ;
plus bas les parties ne font pas aflez raréfiées ; plus
haut elles le font trop, ôc elles le font enfin tant que
le feu cefle d’agir à nos yeux fur elles. La flamme
échauffe d’autant plus les corps qu’elle eft plus pure,
6c contient moins de matières vifqueufes & hétérogènes,
qui peuvent fe placer emr’elles ôc les corps,
& faire obftacle à fon adtion ; c’eft pour cela que la
flamme de l’efprit-de-vin échauffe plus qu’aucun autre.
Si une flamme fe trouve entourée d’une autre
flamme, comme celle de l’efprit-de-vin de celle de
l’huile, l’intérieure prend la figure fphérique. La flamme
a befoin d’air libre pour fa nourriture, mais il ne
faut pas que l’air comprime trop le corps brûlant ;
c:ir le feu s’éteint plus vite fous un verre dont on a
pompé l’air, ou fous un verre dans lequel on fait entrer
de l’air en trop grande quantité. Cette réglé n’eft
cependant pas générale. Il y a des corps qui paroif-
lent n’avoir pas befoin d’air pour briller, comme le
phof phore d’urine mis dans le vuide, ainfi que l’huile
de carvi, mêlée dans le vuicle à l’efprit de tartre, le
minium brûlé dans le vuide avec un verre ardent.
Muflch. ejj'. de phyfiq. §. $ 8 6 . & f'uiv. A la fuite de
ces faits, M. Muflchenbroek tente d’expliquer certains
phénomènes communs ; par exemple, pourquoi
la flamme s’éteint à un vent violent, & s’augmente
à un fouftle leger ; pourquoi l’eau difperfee
en petites gouttes l’éteint aflez promptement, &c.
Nous renvoyons à ces explications, qui font purement
conje&urales, Ôc qui à dire vrai ne nous pa-
roifl'ent pas extrèmementfatisfaifantes.Nous croyons
qu il feroit plus court 6c plus vrai de dire, qu’on,
ignore la caufe de ces phénomènes fi ordinaires, ainft
que celle de beaucoup d’autres. Voye^F e u , F u m é e ,"
C h a l e u r , & c.
Il y a fous la terre des matières combuftibles, qui
venant à s’en détacher 6c à s’élever dans l’air, prennent
flamme. Tacite raconte qu’une ville fut brûlée
par des flammes de cette efpece, forties du fein de la
terre, làns aucun autre accident, comme tremblement,
&c. A côté d’une des montagnes de l’Apennin,
entre Bologne ôc Florence, on trouve un terrein
aflez étendu d’oii il fort une haute flamme fans bruit
ôc fans odeur, mais fort chaude ; la pluie la fait dif-
paroître, mais elle renaît enfuite avec plus de force.:
On connoît auflî les fontaines dont l’eau s’enflamma
lorfqu’on en approche un flambeau allumé. Ibid. §•
• 4$ ° . Voye^ FONTAINE, & c .
Tous les corps qui s’enflamment, comme l’huile,’
le fuif, la cire, le bois, le charbon de terre, la poix ,
le foufre, &c. font confumés par leur flamme, 6c fe
diflipent en une fumée qui d’abord eft brillante ; k
quelque diftance du corps elle cefle de l’être, ôc continue
feulement à être chaude : dès que la flamme eft:
éteinte, la fumée devient fort épaifle, 6c répand ordinairement
une odeur très-forte ; mais dans la jlam~
me elle perd fon odeur en brûlant.
Selon la nature de la matière qu’on brûle, la flamme
eft de différentes couleurs ; ainfi la flamme du foufre
eft bleue ; celle du cuivre uni à l’acide du fel marin
, eft verte ; celle du fuif, jaune ; 6c celle du cam-
fre, blanche. Lorfque la poudre à canon prend feu ,
elle fe diflipe en fumée enflammée. /^oyeçNiTRE.
Il y a un phénomène aflez digne de remarque fur
la flamme d’une chandelle, d’un flambeau, ou de quel-
qu’autre chofe femblable ; c’eft que dans l’obfcurité'
laflamme femble plus grande, lorfqu’on en eft à une
certaine diftance, que quand on en eft tout proche :
voici la raifon que quelques philofophes en apportent.
A une diftance de fîx pies, par exemple, l’oeil
peut aifément diftinguer \a flamme d’avec l’air contigu
qui en eft éclairé, 6c appercevoir précifément où
la flamme eft terminée ; mais à un plus grand éloignement
, comme à celui de trente piés, quoique l’angle
que foûtient la flamme dans ce dernier cas, foit
beaucoup plus petit que dans le premier ; cependant
comme on ne peut plus diftinguer précifément oii fe
termine la flamme, on confond avec elle une partie
de l’air environnant qui en eft éclairé, 6c on le prend
pour la flamme même, f^oye^ V i s i o n .
Au refte quelle que foit la caufe de ce phénomène
, il eft bon de remarquer qu’il eft renfermé entre
des limites : car la flamme d’une chandelle ou d’un
flambeau ne paroît que comme un point à une très-
grande diftance, ôc elle ne femble s'aggrandir que
lorfqu’elle eft aflez près de nous ; apres quoi cette
même flamme diminue de grandeur à mefurc qu’elle
s’approche. Il y a donc un point ou un terme oii la
lumière paroît occuper le plus grand efpace pofli*
ble ; il ne feroit peut' être pas inutile de fixer ce terme
par des expériences, 6c peut-être cette obforvar
tion fourniroit-elle des vûcs pour en découvrir la
véritable caufe.
C’eft un phénomène fort fingulicr 6c fort intéref-
fant, que celui de la production d’une véritable flam-
me par le mélange de deux liqueurs froides. L’une de
ces liqueurs eft toûjours l’acide nitreux, foit pur,
foit mêlé avec de l’acide vitriolique ; 6c l’autre une
huile, un baume, ou un bitume. La théorie de cette
inflammation qui eft de notre célèbre M. Roïielle ,
appartient à Varticle A c i d e n i t r e u x , y . N i t r e .
Les Chimiftes employent la flamme appliquée immédiatement
à certains fujets, dans l’opération ap-
pellée reverbération. Voyt{ R é v e r b é r a t i o n .
La flamme déterminée avec art dans des fourneaux
convenables, fournit un feu très - violent : c’eft par
la flamme que s’échauffent le grand réverbéré, & le
fourneau à raffiner l’argent, ou la coupelle en grand,
le fourneau à cuire la porcelaine, la brique, &c.
(O ) (b)
F l a m m e ou F e u v i t a l , ( Phyjiol.) c’eft une fub-
ftance ignée très-fubtile , que plufieurs anciens 6c
quelques modernes placent dans le coeur des animaux
; ils la regardent comme quelque chofe de né-
ceffaire à la vie, ou, pour mieux dire , comme ce
qui conftitue la vie même. Voye%_ V ie .
Ils fo u t ie n n e n t q u e c e t te flamme a a u tan t b e fo in de
1 a ir p o u r fu b fifte r , q u e notre flamme com m u n e ; d’o ù
i l s c o n c lu e n t q u e l a r e fp i r a t io n e ft a b fo lum en t n é -
c e f fa i r e p o u r c o n f e r v e r la v i e d e s a n im a u x . Voye^
A ir , R e s p i r a t i o n , & C h a l e u r a n im a l e .
F l a m m e s , F l a m m e t t e s , n om s q u i o n t é té donnés
à d e s c o q u i lle s d u g en re d e s c am e s . Voye[ Carticle
CO Q U IL L E , tom e iy . de cet ouvrage, pag. 1 8 . (/)
F l a m m e , (Hifl. anc.) dans la milice greque du
bas empire, c’étoit un ornement ôc une marque qui
fervoit à diftinguer les compagnies, les régimens,
les bataillons, yoye^ P a v i l l o n , E t e n d a r d , &c.
Les Grecs l’appelloient phlamoulon ; on la mettoit
quelquefois fur le cafque, quelquefois fur la cuiraf-
f e , oc quelquefois au bout d’une pique.
L’empereur Maurice ordonna que les flammes de
chaque divifion fuffent d’une couleur particulière
qui les diftinguât des autres bataillons, ou des autres
brigades.
Quand la flamme n’étoit qu’un ornement, les fol-
dats la quittoient avant le combat, de peur qu’elle
ne les embarrafsât. Les cavaliers mettoient auflî des
flammes fur leurs chevaux, qui fervoient à diftinguer
de quel corps de troupes ils étoient. Chambers.
F l a m m e , en Architecture, ornement de fculpture
de pierfe ou de fer, qui termine les vafes ôc candélabres
, ôc dont on décore quelquefois les colonnes
funéraires où il fert d’attribut. (P)
F l a m m e , (Marine. ) c’eft une longue banderolle
d’étoffe, ôc ordinairement d’étamine, qu’on arbore
aux vergues & aux hunes, foit pour fervir d’ornement
, foit pour donner un lignai.
La flamme eft une marque que les officiers qui commandent
plufieurs vaiffeaux, arborent au grand mât
de celui qu’ils montent ; & par l’ordonnance de la
Marine de 1689 > ne doivent la porter que blanche.
Le titre ij. du liv. I I I . de cette ordonnance ,
dit « que les vice-amiraux, lieutenans-généraux, Ôc
» chefs d’efeadres, qui commanderont moins de 11
» vaiffeaux, porteront une fimple flamme, à moins
» qu’ils n’ayent permiffion par écrit de fa majefté,
» de porter un pavillon ou une cornette.
» Lorfque plufieurs chefs d’efeadres fe trouveront
» joints enfemble dans une même divifion ou efea-
» dre particulière, il n’y aura que le plus ancien qui
» puifl'e arborer la cornette ; les autres porteront une
» fimple flamme.
» Les capitaines commandant plus d’un vaiffeau,
» porteront une flamme blanche au grand niât, qui
Tonte y i ,
» aura de guindant la moitié de la cornette ôc ne
» pourra être moindre que de dix aunes de battant ».
Dans une flote de bâtimens marchands, celui qui
commande peut porter une flamme blanche au grand
mât pendant la route ; mais ii eft obligé de l’ôter à la
vue du vaiffeau du roi.
Dans les fêtes 6c les réjoüiflances, tous vaiffeaux
peuvent fe parer de flammes de diverfes couleurs ,
excepté le blanc. ( Z )
Flamme d’o rd re, (Marine.) c’eft la flamme que
le" commandant d’une armée ou d’une efeadre fait
arborer au haut de la vergue d’artimon : c’eft le lignai
pour avertir les officiers de chaque vaiffeau
d’aller à l’ordre. ( Z )
Flamme , (Manège & Maréchall.) inftrument de
maréchallerie, qui n’eft proprement qu’une lancette
d’acier, courte & large ; elle fort, comme le pale-
ton d’une clé à quelque diftance de l’une des deux
extrémités d’une tige de même métal, & ne fait avec
elle qu’un feul Ôc même tout.
Cette définition fuffit pour en indiquer les ufages ,
qui fe bornent à l’ouverture des vaifleaux du cheval
dans la pratique de la faignée.
Je décrirai quatre efpeces de fianïmes. On l é fert
communément en France de la première ; les maréchaux
allemands préfèrent ordinairement la fécondé
; ôc la troifieme ôc la quatrième m’a paru la plus
commode 6c la plus convenable à l’opération, à laquelle
cette forte d’inftrument eft deftiné.
Flammefrançoife. Elle a pour tige une lame équar-
rie & bien dreffee, dont la longueur e ll de cinq pouces
, la largeur de trois lignes, l’épaiffeur de trois
quarts de lignes à l’extrémité la plus éloignée de la
lancette, & de demi-ligne feulement à celle qui lui
eft oppofée.
L’axe de la lancette s’élève perpendiculairement
fur une des longues faces d’épaiffeur de la tige, à neuf
ou dix lignes du bout le plus mince. Sa bafe, qui par
les quatre bifeaux qui forment les deux tranchans ,
revient à un lofange très-alongé , n’a pour petite
diagonale que i’épaiffeur de cette tige, & pour grande
diagonale environ fix ou fept lignes. Cette grande
diagonale fait partie de la ligne de foi de la face, fur
laquelle s’élève cette lancette.
Les deux arêtes qui partent des deux bouts de la
petite diagonale, font droites & fe réunifient à l'extrémité
fupérieure de l’axe, pour former une pointe
très-aiguë. Les deux tranchans qui partent des deux
bouts de la grande diagonale, fe réunifient auflî à la
même pointe ; mais en fuivant l’un 6c l’autre non une
ligne droite, mais une courbe égale 6c renfermée dans
le plan commun de l’axe ôc de Ta ligne de foi. Le centre
de chacune de ces courbes, qu’on peut rapporter
à des arcs de cercles d’un pouce de rayon, fe trouve
au-delà du tranchant oppofé, & à une ligne ou une ligne
ôc demie de diftance de la face qui porte la lancette.
On aflëmble ordinairement trois ou quatre de ces
flammes, accordées fur le plat de pofition, de longueur
& de largeur , à cela près que les lancettes
lont de diverfes grandeurs. On les monte dans une
charte , au moyen d’un feul clou rond qui traverfe
les tiges près de leurs bouts le plus éloigné des lancettes
, ainfi que les deux feuilles de la châfle fur lef-
uelles il eft rivé. Ces feuilles de cuivre, de fer ou
’autre métal recouvert d’écaille, ou autrement orné
, font profilées fur le profil des tiges, mais elles
débordent de quelques lignes le contour des lancettes.
Une cloifon auflî de métal, régné entre lès rives
intérieures de ces parties faillantes des feuilles
de la châfle ; & par fon union avec elle par fou-
dure ou par rivet, elle forme des deux feuilles un
feul tout qui tient lieu de manche à ces flammes ,
d’étui à leurs tranchans. Les deux extrémités de
O O o o 0 ij