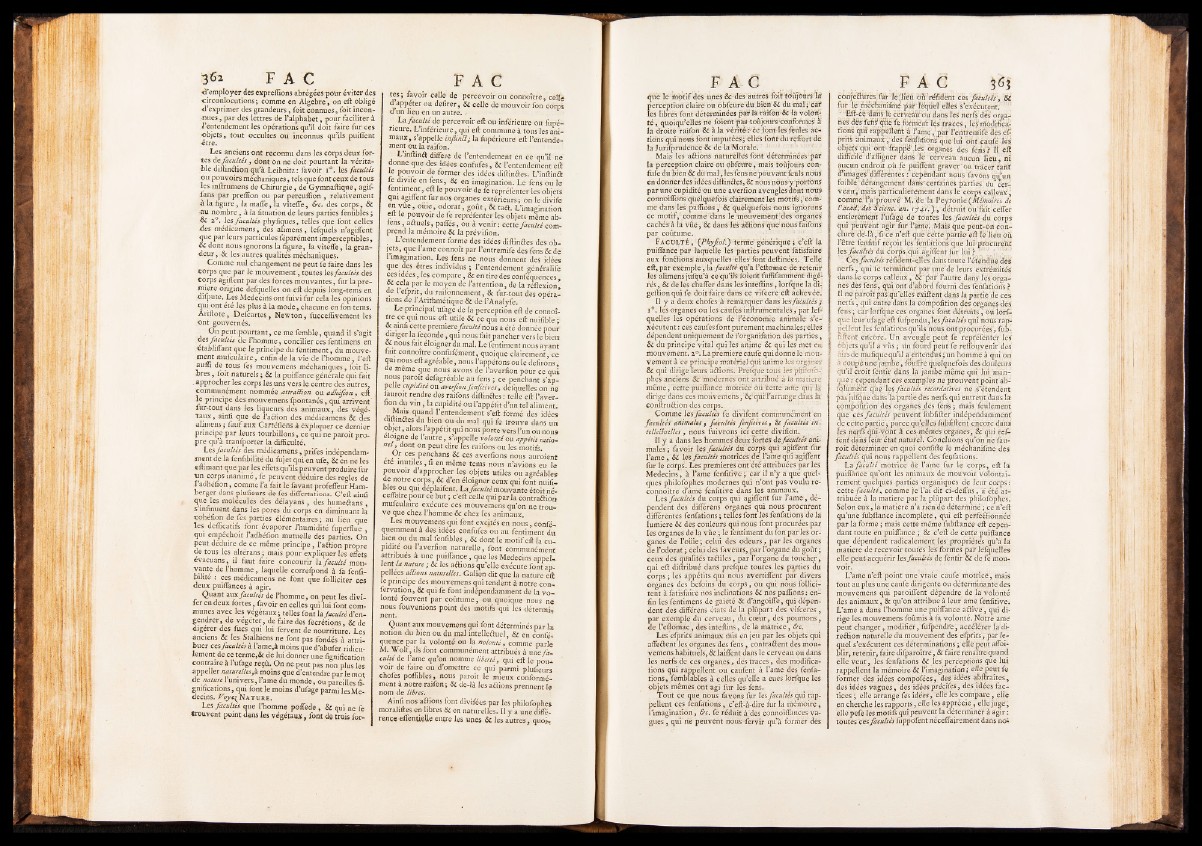
lÉf F A C
«l’employer des expreffions abrégées pour éviter des
circonlocutions; comme en Algèbre, on eft obligé
<Texprimer des grandeurs, foit connues, loit incon-
Jiues, par des lettres de l’alphabet, pour faciliter à
l ’entendement les opérations qu’il doit faire fur ces
■ objets , tout occultes ou inconnus qu’ils puiffent
,^tre.
Les anciens-ont reconnu dans les corps deux forâtes
de facultés y dont On ne doit pourtant la véritable
diftin&ion qu’à Leibnitz : favoir i° . les facultés
ou pouvoirs méchaniques, tels que font ceux de tous
les inftrumens de Chirurgie, de Gymnaftique, ag it
ians par preffion ou par perculîion , relativement
à la figure, la maffe, la vîteffe, &c. des corps, &
au nombre, à la fituation de leurs parties fenfibles ;
& 2°. les facultés phyfiques, telles que font celles
<ies médicamens, des alimens, lefquels n’agiffent
que par leurs particules féparément imperceptibles,
&C dont nous ignorons la figure, la vîteffe, la grandeur,
& les autres qualités méchaniques.
Comme nul changement ne peut le faire dans les
corps que par le mouvement, toutes les facultés des
corps agiffent par des forces mouvantes, fur la pre-
sniere origine defquelles on eft depuis long-tems en
•difpute. Les Médecins ont fuivi fur cela les opinions
qui ont été les plus à la mode, chacune en fon tems.
Àriftote, Defcartes, Newton, fucceffivement les
Ont gouvernés.
On peutbpouftant, ce me femble, quand il s’agit
des facultés de l’homme, concilier ces fentimens en
ctabiiffant que le principe du fentiment, du mouvement
mufculaire, enfin-de -la vie de l’homme, Feft
auffi de tous fes mouvemens méchaniques, foit libres
, foit naturels ; & la puiffance générale qui fait
. approcher les corps les uns vers le centre des autres, j
communément nommée attraction ou adhéfion, eft 3e principe des mouvemens fpontanés, qui arrivent
fur-tout dans les liqueurs des animaux, des végétaux
, ainfi que de l’a dion des médicamens & des
alimens ; fàuf aux Cartefiens à expliquer ce dernier
principe par leurs tourbillons, ce qui ne paroît propre
qu’à tranfporter la difficulté.
Les facultés des médicamens, prifes indépendamment
de la fenfibilité du fujet qui en ufe, Sc en ne les
eftimant que par les effets qu’ils peuvent produire fur
lin corps inanimé, fe peuvent déduire des réglés de
l ’adhéfion, comme l’a fait le favant profeffeur Ham-
berger dans plufieurs de fes differtations. C ’eft ainfi
que les molécules des délayans , des hume&ans
s infinuent dans les pores du corps en diminuant la
cohéfion de les parties élémentaires ; au lieu que
les^ defficatifs font evaporer l’humidité foperflue ,
qui empêchoit l’adhéfion mutuelle des parties. On
peut déduire de ce même principe, l’aûion propre
de tous les altérans ; mais pour expliquer les effets
evacuans, il faut faire concourir la faculté mouvante
de l’homme, laquelle correfpond à fa fenfibilité
: ces médicamens ne font que folliciter ces
deux puiffances à agir.
Quant aulx facultés de l’homme, on peut les d ivi-
fer en deux fortes, favoir en celles qui lui font communes
avec les végétaux ; telles font la faculté d’engendrer,
de végéter, de faire des fecrétions, & de
digerer des fucs qui lui fervent de nourriture. Les
anciens Sc les Stalhiens ne font pas fondés à attribuer
ces facultés à l’ame,à moins que d’abufer ridiculement
de ce terme,& de lui donner une lignification
contraire à l’ufage reçu. On ne peut pas non plus les
appeller naturelles,à moins que d’entendre par le mot
àe nature l’univers, l’ame du monde, ou pareilles lignifications
, qui font le moins d’ufage parmi les Médecins.
V o y t { N a t u r e .
Les facultés que l’homme poffede, & qui ne fe
trouvent point dans les végétaux, font de trois for-
F A C
tes; favoir celle de percevoir ou connoître, celle
d appeter ou defirer, & celle de mouvoir fon corps
d un lieu en un autre. /
La faculté de percevoir eft ou inférieure ou fupé-
rieure. L’inférieure, qui eft commune à tous les animaux,
s’appelle injtincl; la lupérieure eft l’entendement
ou la raifon.
L ’inftinft différé de l’entendement en ce qu’il né
donne que des idées confufes, Sc l’entendement eft
le pouvoir de former des idées diftinftes. L’inftinft
le dmfe en fens, Sc en imagination. Le fens ou le
fentiment, eft le pouvoir de le repréfenter les objets
qui agiffent fur nos organes extérieurs ; on le divife
en v u e , oiiie, odorat, goût, Sc taô. L’imagination
elt le pouvoir de fe repréfenter les objets même ab-
lens, aéhiels, paffés, ou à venir: cette faculté comprend
la mémoire & la prévifion.
L’entendement forme des idées diftinéles des objets,
que l’ame connoît par l’entremife des fens & de
l’imagination. Les fens ne nous donnent des idéés
que des êtres individus ; l’entendement généralife
ces idees, les compare, & en tire des conféquences ,
& cela par le moyen de l’attention, de la réflexion,
de 1 efprit, du raifonnement, & fur-tout des opérations
de l’Arithmétique & de l’Analyfe.
Le principal ufage de la perception eft de connoî-
tre ce qui nous eft utile & ce qui nous eft nuifible ;
& ainfi cette première faculté nous a été donnée pour
diriger la fécondé, qui nous fait pancher vers le bien
& nous fait éloigner du mal. Lefentiment nous ayant
fait connoître confufément, quoique clairement, ce
qui nous eft agréable, nous l’appétons ou le délirons,
de meme que nous avons de l’averfion pour ce qui
nous paroît defagréable au fens ; ce penchant s’appelle
cupidité ou avtrfonfenfitives, defquelles on ne
fauroit rendre des raifons diftinftes : telle eft l’aver-
fion du v in , la cupidité ou l’appétit d’un tel aliment.:
Maw quand l’entendement s’eft formé des idées
diitinCtes du bien ou du mal qui fe trouve dans un
objet, alors l’appétit qui nous porte vers l’un ou nous
éloigné de 1 autre, s’appelle volonté ou appétit ratio-
ne l, dont on peut dire les raifons Ou les motifs.
, ,° r ces penchans & ces averfions nous auraient
ete inutiles, fi en même tems nous n’avions eu le
pouvoir d’appràcher les objets utiles ou agréables
de notre Corps, Sc d’en éloigner ceux qui font nuifi-
bles ou qui deplaifent. La faculté mouvante étoit né-
ceffaire pour ce but ; c’eft celle qui par la contraction
mufculaire exécute ces mouvemens qu’on ne trouv
e que chez l’homme & chez les animaux.
Les mouvemens qui font excjtés en nous, confé-
quemment à des idées confufes ou au fentiment du
bien ou du mal fenfibles , Sc dont le m otif eft la eu-,
pidité ou l’averfion naturelle, font communément
attribués à une puiffance, que les Médecins appeU
lent la nature j Sc les adions qu’elle exécute font ap-
pellees actions naturelles. Galien dit que la nature eft
le principe des mouvemens qui tendent à notre con-
fervation, & qui fe font indépendammènt de la v o lonté
fouvent par coutume, ou quoique nous ne
nous fouyenions point des motifs qui les détermiT
nent.
Quant aux mouvemens qui font déterminés par la
notion du bien ou du mal intelleduel, Sc en confé-
quence par la volonté ou la nolonté, comme parle
M. Wolf, ils font communément attribués à une faculté
de l’ame qu’on nomme liberté y qui eft le pou-
voir de faire ou d’omettre ce qui parmi plufieurs
chofes poffibles, nous paroît le mieux conformément
à notre raifon; & de-là les adions prennent Iç
nom de libres.
Ainfi nos aâions font divifées par les philofophés.
moralises en libres & en naturelles. Il y a une différence
effenwUe entfe les upes Se les autres, quoi.
F A C que le imbfif des unes •&'dé$'àùtres -foit fctöjbfn'S' rç
perception claire ou ôbfcure dü.biferi & dtimàl - dtf
les libres font déterminées pardâjràtfôp-&: Ik volé#1,
t é , quoiqifëllcs rrë fôlentp&S tôûjotirS'c'dpfbfmés a
la droite raifon & à la vérité-^êèTont-lès-^ttléS âc*
lions qui nous font imputée^; elles-fodf dit'téffôrt de
la Jurisprudence & de la Morale; ' J1
Mais les adions naturélléà foiit déterminée^par
la perception claire oü dbfoi'i're, mais toujours eon-
fiifedubien Sic dttmal,les'fensnepôuvântfeûls nbüs
en donner des idées diftindçs, Sc nous nôus'y/pp'rtb'rté
par une cupidité ou une averfion aveuglés qônt n'oits
connoiffoftsqüélqiiefois Clairement’les motifsycomme
dans les paffiohs,: Sc quelquefois rio.tts ignbrons
ce motif, comihe dans le mOuveméntides ôrgàrtës
cachés à la vûé , & dans lësàdiônsrque1ndus: faifbns
par coutume.
Fa c u l t é , f P h y f i o t f ) termer générique ; c’eft la
puiffance par laquelle les 'parties peuvent fàtisfaire
aux fondions auxquelles -ëîlésforit deftinées. Tellp
eft, pâr exemple, la faculté l’eftomac de retèriiV
les alimens jufqu’à ce qu’ils foîerit fuffifamniëfit digé^
rés, & de les cnâffer darts les inteftins, lorfqne la di--
geftionqui fe doit faire-dans ce vifeere eft achevée.
Il y a deux chofes 'à remarquer dans’ leà'facultés ^
i ° . les organes où les caufos inftrumentalés, par lef-
quelles les opérâtionis dé Técononrie aniriiale s’e-J
xéçutent: ces cajifes font purement machinalesj’elles
dépendent uniquement de i’organHation dés parties,
& du prinçipie v ital qui lès anime & qui lés mët en.
mouvement. z°. La première caufe qui donne le motir
vement à ée principe matériel qui anime les organes1
& qui' dirige, l e u r s : adions. Prefque tous les p h i i o i o - ’
phes anciens 8c modernes ôtit attribue à la matière
même, cette puiffance motrice1 ô u Jéette aifie qui
dirige dans ces m b i i v e m e n s , ’êt‘qü?l’arrange dans fa.
conftrudion des corps.. .
Comme les facultés fe divifent communément en
facultés animales y facultés fenjitiv es y 8c facultés' iri-,
tellectiàilcs, nous fuivrons ici cette divifion. .
Il y a dans les hommes deux fortes àé facultés animales
; fayoir les facultés du corps qui agiffent fût
l ’ame, & lès facultés motrîées dé l’ame qui agiffent
fur le cofps. Les premières ont été attribuées pafiéS
Médecins, à l’ame fenfitive ; car il n’y â qüë quelques
philofophés modernes qui n’ont pas voulu reconnaître
d’amë fenfitive dans les animaux.
Les facultés du corps qui agiffent fur l’ame, dépendent
dés différens orgânës qui nous procurent
différentes ferifaiions ; telles font lès fenfations de là
lumière & dès couleurs qui nous font procurées par
les organes de la vue ; lé fentiment'du fort par les organes
de l’oüie ; celui des odeurs, par lés organes
de l’odorat ; celui des faveurs, par Forgané du goût ;
ceux dès qualités ta&iles, par l’organe du toucher,
qui eft diftribué dans prefque toutes les parties du
corps ; les appétits qui nous aVértiffent par divers
organes dès béfôins du corps, Où qiii nous follici-
tent à fatisfaire nos inclinations & nos paffiOrts : enfin
les fentimens de gaieté & d’ângoiffe, qui dépendent
des différens états de la plûpart dés vifcéres,
par exemple du cerveau, du coeur, des poumons,
de l’eftomàc, deis intéftins, de la matrice, &c.
Les efprits animaux mis en jéu par les objets qui
affeûent lès.organes des fens, contraétent des mouvemens
habituels, &laiffent dans le cerveau ou dans
les nerfs de ces organes,.déis traces, des modifications
qui rappellent ou çaufent .à l’ame des fenfations,
femblables à celles qu’elfe a eues lorfque les
objets mêmes ont agi fur les fens.
Tout ce que nous favons fur les facultés qui rappellent
ces fenfations, c’eft-à-dire fur la méritoire,
î’imaginatiôn, &c. fe réduit à.des connoiffances vagues
, qui rie peuvent nous fervir qu’à forirLet dés
F A C ÿsf
conjéfHires, for -fe Jliéü iftfréMknt ces falulds ', St
for foiWéÆariifriié jiari-ïéijiiièl_ elles ^’éx,ëçiitéritVorn
. °dàHs-lè cérvèàïPôu dans leS nerfs dès' orga-
h ' è ÿ d ë s ' f e f i y ' ^ f t é ï è t r a c e s , les'riïodifica-
rioris p ? rapçréiiétitTarit<?,1 p>ar l’eritremife^és ef?
que lui Ont caufe les1
dès iens? Il êft
diffièilè'd’aïligner dàris f è ' cêry‘éâu âùc^uri1 lieu , ni
aucun endroit .où .fe puijCfent g ràveïJ où^tracéf fariŸ
d imagei1 'différentes [i Céfièndant noffs favons qü’un
foible , dérangement dàris'cerfairiéS p'art'ièsfdù cër-
véàir/ipais pàrticuiietémertt dans le C0rp§^'calleux1 j
commé’Fa prouvé' M.^de la FéyfOnie (Mèhioifis dé
rdcâHi'des 'Sciéuf an. i f f i . •détruit oiFFait’ceffer
éntierèmérit ïfofâgé de toutes lés facultés <iu corps
qu^ j)eü\rènt agir fut i ’âmëFMàiÿ que péüt-bn con-
clutë dé-là, fi'ce n’eft quë'cétte partie eft le lien où
l’être fèrtfitif reçoit l'es .rerifâtiofts que lui’ OTbciirenï
les fàaiîtès dii corps.qui.àgïffenf fur lui ^
: 'Çésjkcidlés' réfidêrit-eïfè^’ddiis' tbiftë Féfendjiédës
nerfs, qui Té tetmîiiént pà'r tiriè^dé leurs exfoëmités
dans.le corps calféuX, Fâliire danVleS organes
dès fëitt^ qui ont d’^Sord fourni dés fènfatidris >
Il Wé piro^'jpâi^u^tlës &tiftènt dans la pai tiè'cfë ces
nerfsqui'e'fitïedà'rtS'là-^b’ifip'ààtipn dés' organes dès'
fens | càrfofftjüe céS bfgâlïéS font détruits',‘ ou lorf-
qué lènrufàgé ëft'fofpenduylës^ifcw/iw qui ridüs'f àp'*
pellent lé<»‘ fenfations qu’ils rtbus. oiif procuféës”, fub-
fiifênt éiïçbfe. Un aveugjè peut fe feprérérife'f les
bb'jéts qu’il à vûs ; lin fbûrd peùt fe reflouVénir de-s
àirsde mufiquequ’il a éntendus;un homme à qui on
à çoiipé une' jambe , foùffié quelquefois dés doulèurs
qu’il craît féritir 'dârivla 'jânibé.niême qui lui màn-
cmè ce'pêndartt'cês exériiplés rie pfouvcfitpôint'àb-
iqlûmént que, les ficülte's yèéôrdàtives ne .s’étendent
pas jiuquédans fâpaftië.dés riérfs.quiènt'r'entdàrisla
compofiffon des Ofgaries'des féris; mais feulement
que" cés facultés péuvéhf fobfiftër indépendamment
dé cëriépârfié ,. parce qu’elles fubfiftent ericofe dans
fës nérrs. qiii"-vont $ ces- memes çtrfeànes, Sc qùi ref-
fent dans lèitr état naturel .'Concluons qu’on ne fàu-
fôit défermiriér eh quoi çbnfifté le méchanifmë des
facultés qui nous rappellent dés fënfations'.
La faculté xnbtxieè de Famé fur lé corps, eft la
puiffàricë qu’ont lès animaux de mouvoir votent a i-
rerneht quëlqüës parties organiques de leur corps :
cette' faculté, comme je l’ai dit ci-dëflus, a* été attribuée
à la matière par, la plûpart des philofophés.
Selon eux, la matierë.n’a rien'dè déterminé ; ce n’eft
qu’une fiibftârice incomplète , qui eft peffèâ'ioririéé
par la forme ; mais cette même fubftancé eft* cependant
toute én puiffance ; oc c’éftdë cette puiffance
que dépénderit radicalement lés propriétés , qu’a la
matière de recevoir toutes' feV formes par Ièfqüélles
elle peut- acquérir les facultés dé féntir & de fé mouvoir.
L’ame n’eft point Une vraie câufe motfîcë, mais
fout au plus une caufe difigent'è ou déterminante des
mouvemens qui paroiffént dépëndre dé là volonté
des animaux, & qu’on attribue à leur âme fërifîtive.
L’ame a dans l’homme une puiffance â&ivë', qui dirige
les mouvemens foûmis à fa volonté. Nptfë âme
peut changer,-modifier, fofpëndrè, accélérer la df
rettion naturelle du mouvement des éfprifs, par lequel
s’exécutent ces défèrminafions ; elle peut affoi-
blir, retenir, faire difparoître, & faire renaître quand
elle v eu t, les fenfations & les' perceptions que lui
rappellent la mémoire & l’imagination ; elle peut fe
former dès idées composées, dès ideés abftrâités,
des idées vagues, des idées précifès , des idees factices';
elle arrange fës idées, elle lés compare, elle
en cherche les rapports, elle les apprécié, elle jugé,
elle pefe les motifs qui peuvent la déterminer à agir :
toutes ces facultés fuppofent néceffâiremërit dans ncA