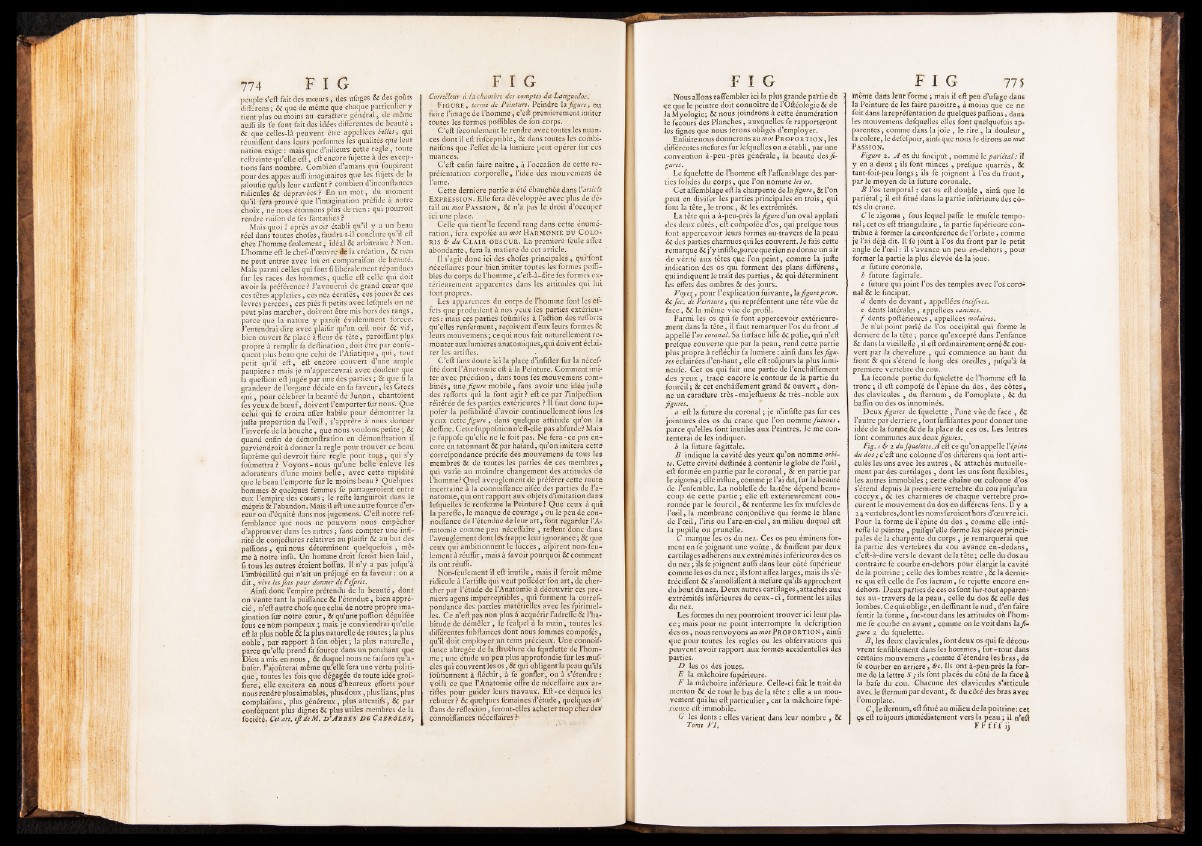
peuplé s’eft fait des moeurs, des ufageS & des goûts
différens ; & que de même que chaque particulier y
tient plus ou moins au caraftere général, de même
auffi ils fe font fait des idées différentes de beaute ;
& que celles-là peuvent être appellees belles, qui
réunifient dans leurs perfonnes les qualités que leur
hation exige : mais que d’ailleurs cette réglé, toute
reftreinte qu’elle eft, eft encore fujette à des excep tions
fans nombre. Combien d’amans qui foupirent
pour des appas auffi imaginaires que les fujets de la
jaloiifie qu ils leur caufent ? combien d’inconftances
ridicules & dépravées ? En un mot, du moment
qu’il fera prouvé que l’imagination prefide à notre
choix, ne nous étonnons plus de rien : qui pourroit
rendre raifon de fes fantaifiés '?' j
Mais quoi ! après avoir établi qu’il y a un beau
réel dans toutes chofes, faudra-t-il conclure qu’il eft
chez l’homme feulement, idéal & arbitraire ?'Non.
L’homme eft le chef-d’oeuvre dfc la création, & rien
ne peut entrer avec lui en comparaifon de beaute.
Mais parmi celles qui font fi libéralement répandues
fur les races des hommes, quelle eft celle qui doit
avoir la préférence ? J’avouerai de grand coeur que
ces têtes applaties, ces nez écrafés, ces joues & ces
levres percees, ces piés fi petits avec lefquels on ne
peut plus marcher, doivent être mis hors des rangs,
parce que la nature y paroît évidemment forcée.
J’entendrai dire avec plaifir qu’un oeil noir & vif,
bien ouvert & placé à fleur de tête, paroiffant plus
propre à remplir fa deftination, doit être par çonfé-
quent plus beau que celui de l’Afiatique, qui, tout
petit qu’il eft, eft encore couvert d’une ample
paupière : mais je m’appercevrai avec douleur que
la queftion eft jugée par une des parties ; & que fi la
grandeur de l’organe décide en fa faveur, les Grecs
qui, pour célébrer la beauté de Junpn, chantoient
les yeux de boeuf, doivent l’emporter fur nous. Que
celui qui fe croira affez habile pour démontrer la
jufte proportion de l’oe il, s’apprête à nous donner
Finverfe de la bouche, que nous voulons petite ; &
quand enfin de démonftration en démonftration il
parviendroit à donner la réglé pour trouver ce beau
fuprème qui devroit faire réglé pour tou£ , qui s’y
foûmettra? Voyons-nous qu’une belle ënleve les
adorateurs d’une moins belle, avec cette rapidité
que le beau l’emporte fur le moins beau ? Quelques
hommes & quelques femmes fe partageroient entre
eux l’empire des coeurs ; le refte languiroit dans le
mépris & l’abandon. Mais il eft une autre fource d’erreur
ou d’équité dans nos jugemens. C’eft notre ref-
femblance que nous ne pouvons nous empêcher
d’approuver dans les autres ; fans compter une infinité
de conjeâures relatives au plaifir & au but des
paffions, qui nous déterminent quelquefois , même
à notre infû. Un homme droit feroit bien laid,
fi tous les autres étoient boffus. Il n’y a pas jufqu’à
Fimbécillité qui n’ait un préjugé en fa faveur : on a
dit, vive les fois pour donner de Vefprit.
Ainfi donc l’empire prétendu de la beauté, dont
on vante tant la puiffance & l’étendue, bien apprécié,
n’eft autre chofe que celui de notre propre imagination
fur notre coeur, & qu’une paffion déguifée
fous ce nom pompeux ; mais jè conviendrai qu’elle
eft la plus noble & la plus naturelle de toutes ; la plus
noble, par rapport à fon objet ; la' plus naturelle,
parce qu’elle prend fa fource dans un penchant que
Dieu a mis en nous, & duquel nous ne faifons qu’a-
bufer. J’ajoûterai même qu’ellèfera une vertu politique,
toutes les fois que dégagée de toute idée grof-
nere, elle excitera en noirs d’heureux efforts pour
nous rendre plus aimables, plus doux, plus lians, plus
complaifans, plus généreux, plus attentifs, & par
conféquent plus dignes & plus utiles membres de la
fo C ié té . Cit art. ejl de M. D ’AB B E S DE ÇAB RÔLES,
Corrtcleur à la chambre des comptes du Languedoc '.
F i g u r e , terme de Peinture. Peindre la figure, ou
faire l’image de l’homme, c’eft premièrement imiter
toutes les formes poffibles de fon corps.
C’eft fecondement le rendre avec toutes les nuances
dont il eft fufceptible, & dans toutes les combi-
naifons que l’effet de la lumière peut opérer fur ces
nuances.
C’eft enfin faire naître, à l’occafion de cette re-
préfentation corporelle, l’idée des mouvemens de
l’ame.
Cette derniere partie a été ébauchée dans 1'article
E x p r e s s i o n . Elle fera développée avec plus de dé*
tail au mot P a s s i o n , & n’a pas le droit d’occuper
ici une place.
Celle qui tient'le fecond’rang dans cette énumération,
fera expofée au mot H a r m o n i e d u C o l o *
r i s & du C l a i r o b s c u r . La première feule affez
abondante, fera la matière de cet article.
Il s’agit donc ici des chofes principales , qui*font
néceflaires pour bien imiter toutes les formes poffibles
du corps de l’homme, c’eft-à-dire fes formes extérieurement
apparentes dans les attitudes qui lui
font propres.
Les apparences du corps de l’homme font les’êf-
fets que produifent à nos yeux fes parties extérieures
: mais ces parties foûmifes à l’a&ion des reflorts
qu’elles renferment, reçoivent d’eux leurs formes &
leurs mouvemens ; ce qui nous fait naturellement remonter
aux lumières anatomiques, qui doivent éclairer
les artiftes.
C’eft fans doute ici la place d’infifter fur la nécef-
fité dont l’Anatomie eft à la Peinture. Comment imiter
avec précifion, dans tous fes mouvemens combinés,
une figure mobile, fans avoir une idée jufte
des reflorts qui la font agir? eft-ce par l’infpeétion
réitérée de fes parties extérieures ? Il faut donc fup-
pofer la poffibilité d’avoir continuellement fous le®
yeux cet te figure , dans quelque attitude qu’on la
aeffine. Cette fuppofitionn’eft-elle pas abfurde? Mais
je fuppofe qu’elle ne le foit pas. Ne fera-ce pas encore
en tâtonnant & par hafard, qu’on imitera cette
correfpondance précife des mouvemens de tous les
membres & de toutes les parties de ces membres,
qui varie au moindre changement des attitudes de
l ’homme? Quel aveuglement de préférer cette route
incertaine à la connoiffance aifée des parties de l’anatomie,
qui ont rapport aux objets d’imitation dans
lefquelles fe renferme la Peinture 1 Que ceux à qui
la pareffe, le manque de courage, ou le peu de connoiffance
de l’étendue de leur art, font regarder l’Anatomie
comme peu néceffaire , relient donc dans
l’aveuglement dont les frappe leur ignorance ; & que
ceux qui ambitionnent le fuccès , afpirent non> feulement
à réuffir, mais à favoir pourquoi & comment
ils ont réuffi.
Non-feulement il eft inutile, mais il feroit même
ridicule à l’artifte qui veiit pofféder fon art, de cher-'
cher par l’étude de l’Anatomie à découvrir ces premiers
agens imperceptibles, qui forment la correl-
pondance des parties matérielles avec les fpirituel-
Ies. Ce n’eft pas non plus à acquérir l’adreffe & l’habitude
de démêler , le fcalpel à la main, toutes les
différentes fubftances dont nous fommes compofés,
qu’il doit employer un tems précieux. Une connoif*
lance abrégée de la ftruéhire du fquelette de l’homme
; une étude un peu plus approfondie fur les mufi
clés qui couvrent les os, & qui obligent la peau qu’ils
foütiennent à fléchir, à fe gonfler, ou à s’étendre :
voilà ce que l’Anatomie offre de néceffaire aux artiftes
pour guider leurs travaux. Eft-ce dequoi les
rebuter ? & quelques femaines d’étude, quelques in-'
flans de réflexion, feront-elles acheter trop cher des'
connoiffances néceffaires ?'•
Nous allons raffembler ici la plus grande partie cte
Ce que le peintre doit connoître de l’Oftéologie & de
la Myologie; & nous joindrons à cefte énumération
îe fecours des Planches, auxquelles fe rapporteront
-les lignes que nous ferons obligés d’employer.
Enfuite nous donnerons au mot P r o p o r t i o n , les
différentes mefures fur lefquelles on a établi, par une
convention à-peu-près générale, la beauté des f i gures.
Le fquelette de l’homme eft l’afTemblage des parties
folides du corps, que l’on nomme les os.
Cet affemblage eft la charpente de la figure, & l’on
peut en divifer les parties principales en trois, qui
font la tête, le tronc, & les extrémités*
La tête qui a à-peu-près la figure d’un oval applati
des deux côtés, eft compofée d’os, qui prefque tous
font appercevoir leurs formes au-travers de la peau
& des parties charnues qui les couvrent. Je fais cette
remarque & j’y infifte,parce que rien ne donne un air
de vérité aux têtes que l’on peint, comme la jufte
indication des os qui forment des plans différens,
qui indiquent le trait des parties, & qui déterminent
les effets des ombres & des jours.
Voye^, pour l’explication fuivante, la figure prem.
& fec. de Peinture, qui repréfentent une tête vue de
face, & la même vue de profil.
Parmi les os qui fe font appercevoir extérieure-
ment dans la tête, il faut remarquer l’os du front A
appellé l’or coronal. Sa furface liffe & polie, qui n’eft
prefque couverte que par la peau, rend cette partie
plus propre à réfléchir fa lumière : ainfi dans les figu~
res éclairées d’en-haut, elle eft toûjours la plus lumi-
neufe. Cet os qui fait une partie de l’enchâffement
des yeux , trace encore le contour de la partie du
fourcil ; & cet enchâffement grand & ouvert, donne
un caraétere très -majeftueux & très-noble aux
figures-,
a eft la future du coronal ; je n’infifte pas fur ces
jointures des os du crâne que l’on nomme futures,
parce qu’elles font inutiles aux Peintres. Je me contenterai
de les indiquer.
b la future fagittale.
B indique la cavité des yeux qu’on nomme orbite.
Cette cavité deftinée à contenir le globe de l’oe il,
eft formée en partie par le coronal, & en partie par
le zigoma ; elle influe, comme je l’ai dit, fur la beauté
de l’enfemble. La nobleffe de la«tête dépend beaucoup
de cette partie ; elle eft extérieurement couronnée
par le fourcil, & renferme les fix mufcles de
l’oeil, la membrane conjonélive qui forme le blanc
de l’oeil, l’iris ou l’arc-en-ciel, au milieu duquel eft
la pupille ou prunelle.
C marque les os du nez. Ces os peu éminens forment
en fe joignant une voûte, & finiffent par deux
cartilages adherens aux extrémités inférieures des os
du nez ; ils fe joignent auffi dans leur côté fupérieur
comme les os du nez ; ils font affez larges, mais ils s’é-
tréciffent & s’amolliffent à mefure qu’ils approchent
du bout du nez. Deux autres cartilages, attachés aux
extrémités inférieures de ceux-ci , forment les ailes
du nez.
Les formes du nez pourroient trouver ici leur place
; mais pour ne point interrompre la defeription
des os, nous renvoyons au mot P r o p o r t i o n , ainfi
que pour toutes les réglés ou les obfervations qui
peuvent avoir rapport aux formes accidentelles des
parties.
D les os des joues.
E la mâchoire fupérieure.
F la mâchoire inférieure. Celle-ci fait le trait du
menton & de tout le bas de la tête : elle a un mouvement
qui lui eft particulier, car la mâchoire fupé-
xieure eft immobile.
G les dents : elles varient dans leur nombre , &
Tome V I ,
Wieiiîè dànis leur forme ; mais il eft peü d’ufage dans
la Peinture de les faire paroître, à moins que ce ne
foit dans la repréfentation de quelques paffions, dans
les mouvemens delquelles elles font quelquefois apparentes,
comme dans la joie , le rire -, la douleur,
la colere, le defefpoir, ainfi que nous le dirons au mot
P a s s i o n .
Figure x . A os du finciput, nommé le pariétal: il
y en a deux ; ils font minces , prefque quarrés, &
tant-foit-peu longs ; ils fe joignent à Fos du front,
par le moyen de la future coronale.
B l’ôs temporal : cet os eft double , ainfi que le
pariétal ; il eft fitué dans la partie inférieure des côtés
du crâne.
C le zigoma , fous lequel paffe le tnufcle temporal
; cet os eft triangulaire, fa partie fupérieure contribue
à former la circonférence de l’orbite, comme
je l’ai déjà dit. Il fe joint à l’os du front par le petit
angle de l’oeil : il s’avance un peu en-dehors, pour
former la partie la plus élevée de la joue,
a future coronale.
b future fagittale.
c future qui joint l’os des temples avec l’os coronal
& le finciput.
d dents de devant, appellées incijives.
e dents latérales, appellées canines,
f dents poftérieures, appellées molaires,
Je n’ai point parlé de l’os occipital qui formé le
derrière de la tête ; parce qu’excepté dans l’enfance
& dans la vieilleffe, il eft ordinairement orné & couvert
par la chevelure , qui commence au haut du
front & qui s’étend le long des oreilles, jufqu’à là
première vertebre du cou-.
La fécondé partie du fqitelettè de l’homme eft le
tronc ; il eft compofé de l’épine du dos, des côtes ,
des clavicules , du fternum, de l’omoplate , & du
baffin ou des os innommés.
Deux figures de fquelette , l’unè vue de face , &
l’autre par derrière, font fuffifantes pour donner une
idée de la forme. & de la place de ces os. Les lettres
font communes aux deux figures. _
Fig. i & o. du fquelette. A eft ce qu’On appelle Yépine
du dos ; c’eft une colonne d’os différens qui font articulés
les uns avec les autres, & attachés mutuellement
par des cartilages, dont les uns font flexibles,
les autres immobiles ; cette chaîne ou colonne d’os
s’étend depuis la première vertebre du côü jufqu’au
coccyx, & les charnières de chaque vertebre procurent
le mouvement du dos en différens fens. Il y a
14 vertebres,dont les noms feroienthors d’oeuvre ici.
Pour la forme de l’épine du dos , Comme elle inté-
reffe le peintre , puisqu’elle forme les pièces principales
de la charpente du corps , je remarquerai que
la partie des Vertèbres du cou avance en-dedans,
c’eft-à*-dire vers le devant de la tête; celle du dos au
contraire fe courbe en-dehors pour élargir la cavité
de la poitrine ; celle des lombes rentre, & la derniere
qui eft celle de l’os facrum, fe rejette encore en-
dehors. Deux parties de ces os font fur-tout apparentes
au-travers de la peau, celle du dos & celle des
lombes. Ce qui oblige, en deffinant le nud, d’en faire
fentir la forme, fur-tout dans les attitudes oh l’homme
fe courbe en avant, comme on le voit dans la f i gure
x du fquelette.
B , les deux clavicules, font deux os qui fe découvrent
fenfiblement dans les hommes, fur-tout dans
certains mouvemens , comme d’étendre les bras. de
fe courber en arriéré, &c. Ils ont à-peu-près la forme
de la lettre S ; ils font placés du côté de la face à
la bafe du cou. Chacune des clavicules s’articule
avec le fternum par devant, & du côté des bras àvec
l’omoplate.
C , le fternum, eft fitué au milieu de là poitrine: cet os eft toujours immédiatement vers la peau ; il n’eft
F F f f f i j