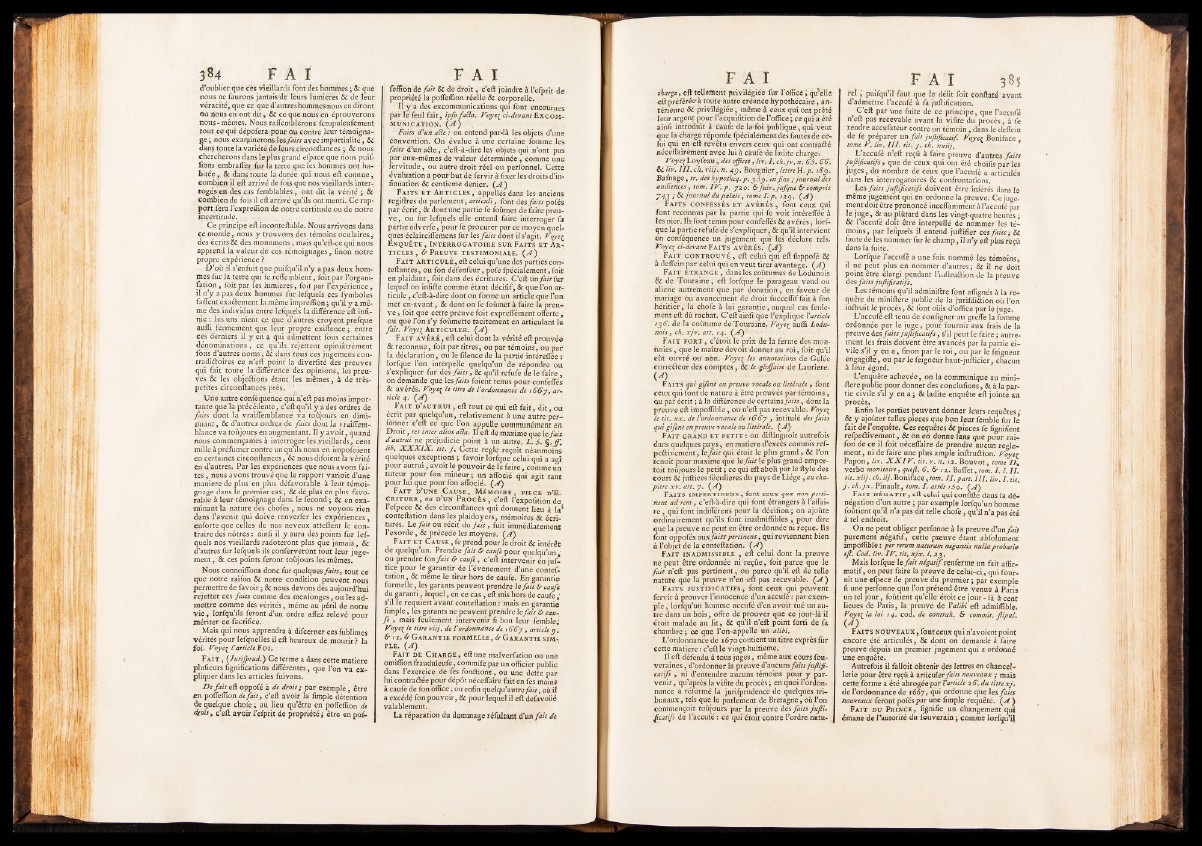
cFoublief que ces vieillards font des hommes ; & que
nous ne faurons jantais'dé leurs lumières & de leur
véracité, que ce que d’autres hommesrnous en diront
ou nous en ont dit, & ce que nous en éprouverons
nous-mêmes. Nous raflemblerons fcr'upuleufement
tout ce qiuf dépofera pour ou contre leur témoignage
; nous examinerons les./«/« avec impartialité, &
dans toute; la variété de leürscirconftançes; & nous
chercherons dans le plus grand efpace que nous puif-
lîons embrafler fur la terre que les hommes pnt habitée
,, & dans toute la durée qui nous eft connue,
combien il eft arrivé de fois que nos vieillards interrogés
en des cas fejnblables, ont dit la vérité ; &
combien de fois il eft arrivé, .qu’ils ont menti. Ce rapport
.fera l ’expreflion de notre certitude ou de notre
incertitude..... ^ ,
. Ce principe eft incpnteftable. Nous arrivons dans
ce monde , nous y trpuvons-.des témoins. ociilaires,
des écrits & dés monumens ; mais qu’eft-ce qui nous
apprend la valeur de c.es témoignages, linon notre
propre expérience ?
D ’où il s’enfuit que puifqu’il n’y a pas deux hommes
fur la .terre qui fe refîemblent, foitpar l’organi-
fation , foit par les lumières, foit par l’expérience,
il n’y a pas deux hommes fur lefquels ces fymboles
faflentexaâement la même impreffion; qu’il y a même
des individus entre lelquels la différence eft infinie
: les.uns nient çè que d’autres croyent prefque
miffi., fermement que leur propre exiftence; entre
ces derniers il y en a qui admettent fous certaines
dénominations, ce qu’ils, rejettent opiniâtrément
fous d’autres noms ; & dans tous ces jugemens contradictoires
ce n’eft point la diverfité des preuves
qui fait toute la différence des opinions, les preuves
& les objections étant les mêmes, à de très-
petites circonftances près. ’
Une autre conféqüence qui n’eft pas moins importante
que la précédente, c’eft qu’il y a des ordres de
faits dont la vraisemblance va toujours en diminuant
, & d’autres ordres de faits dont la vraiffemblance
va toujours en augmentant. Il y avoit, quand
nous commençâmes à interroger les vieillards, cent
mille à préfumer contre un qu’ils nous en impofoient
en certaines circonftances, & nous difoient la vérité
en d’autres. Par les expériences que nous avons faites
, nous avons trouvé que le rapport varioit d’une
maniéré de plus en plus défavorable à leur témoignage
dans le premier ca s, & de plus.en plus favorable
à leur témoignage dans le fécond ; & en e x a -.
minant la nature des çhofes , nous ne voyons rien
dans l’ avenir qui doive renverfer les expériences
enforte que celles de nos neveux attellent le contraire
des nôtres : ainfi il y aura des points fur lefquels
nos vieillards radoteront plus que jamais, &
d’autres fur lefquels ils conferveront tout leur jugement
, & ces points feront toujours les mêmes.
Nous connoiffons donc fur quelques faits, tout ce
que notre raifon & notre condition peuvent nous
permettre de favoir ; & nous devons dès aujourd’hui
rejetter ces faits comme des menfonges, ou les admettre
comme des vérités, même au péril de notre
v i e , lorfqu’ils feront d’un ordre affez relevé pour
mériter ce facrifice.
Mais qui nous apprendra à difcerner ces fublimes
vérités pour lefquelles il eft heureux de mourir ? la
foi. Voye? l'article F o i.
F a i t , ([Jurifprud. ) Ce terme a dans cette matière
plufieurs lignifications différentes, que l’on va expliquer
dans les articles fuivans.
De fait eft oppofé à de droit; par exemple, être
fin poffeflion de fait, c’eft avoir la limple détention
de quelque chofe ; au lieu qu’être en poffeflion de
dfoie, c’eft avoir l’efprit de propriété ; être en poffeffioh
èé fait & de droit, c’eft joindre à l’efprit de
: propriété la poffeffion réelle & corporelle.
Il y à des excommunications qui font encourues
5 par le foui fait, ipjb facto. Voye{ ci-devant Ex com -
; MUM CATION. ÇA y -
Faits d'un acte .von entend par-là les objets d’une
> convention. On évalue à une certaine fomme les
faits d’un aCte, c’eft-à-dire les objets qui n’ont pas
4 par eux-mêmes de valeur déterminée, comme une
t fervitude, ou autre droit réel ou perfonnel. Cette
■ évaluation a pour but dé fervir à fixer les droits d’in-
- imitation & centième denier. ÇA )
F a i t s e t A r t i c l e s , appellésdans les anciens
; regillres du parlement * articuli, font des faits pofés
par écrit, & dont une partie fe foûmet de faire preuv
e , ou fur lefquels elle entend faire interroger fa
partie adverfe, pour fe procurer par ce moyen quelques
éclaircilTemehs fur les faits dont il s’agit. Voye^
E n q u ê t e , In t e r r o g a t o ir e su r Fa i t s e t A r t
i c l e s , & P r e u v e t e s t im o n ia l e . ÇA)
F a i t a r t i c u l é , eft celui qu’une des parties contenantes
, ou fon défenfeur, pofe fpécialement, foit
en plaidant, foit dans des écritures. C ’eft un f a i t fur
lequel on infifte comme étant décifif, & que l’on articule
, c’eft-à-dire dont on forme un article que l’on
met en-avant, & dont on fe foûmèt à faire la preuv
e , foit que cette preuve foit expreffément offerte ;
ou que l’on s’y foûmette tacitement en articulant le
f a i t . V o y e ^ A r t i c u l e r . Ç A )
F a i t a v é r é ,-eft celui dont la vérité eft prouvée
& reconnue, foit par titres, ou par témoins, ou par
la déclaration, ou le filence de la partie intéreffée :
lorfque l’on interpelle quelqu’un de répondre ou
s?expliquer fur des faits , & qu’il refiife de le faire ,
on demande que les faits foient tenus pour confeffés
& avérés. Voyelle titre dè L’ordonnance de 166y , ar-
ticle 4. ÇA)
F a i t d ’a u t r u i , eft tout ce qui eft fait , d it , ou
écrit par quelqu’un, relativement à une autre per-
fonrie: c eft ce que l’on appelle communément en
D ro it , r« interalios acta. Il eft de maxime que le fait
d’autrui ne préjudicie point à un autre. L .5. $ .f f .
lib. X X X IX . tit. j . Cette réglé reçoit néanmoins
quelques exceptions ; favoir lorfque celui qui a agi
pour autrui, avoit le pouvoir de le faire, comme un
tuteur pour fon mineur; un affocié qui agit tant
pour lui que pour fon aftocié. ÇA)
F a i t d ’u n e C a u s e , M é m o i r e , p iè c e d ’E-
c r i t u r e , ou d ’u n P r o c è s , c’eft l’expofitionde
l’efpece & des circonftances qui donnent lieu à la1
conteftation dans les plaidoyers, mémoires & écritures.
Le fait ou récit du fa i t , fuit immédiatement
l’exorde, & précédé les moyens. ÇA)
F a i t e t C a u s e , fe prend pour le droit & intérêt
de quelqu’un. Prendre fait & caufe pour quelqu’un;
ou prendre (on fait & caufe, c ’eft intervenir en juf-
tice pour le garantir de l’évenement d’une conteftation,
& même le tirer hors de caufe. En garantie
formelle, les garants peuvent prendre le fait & caufe
du garanti, lequel, en ce c a s , eft mis hors de caufe ;
s’il le requiert avant conteftation: mais en garantie
limple, les' garants ne peuvent prendre le fait & eau-*
fe , mais feulement intervenir fi bon leur femble j
Ÿoye^ le titre viij. de Vordonnance de i66 y , article 0.'
6 i z . & G a r a n t ie f o r m e l l e , & G a r a n t ie s im p
l e . ÇA)
Fa i t d e C h a r g é , eft une malverfation ou une
ômiflion Irauduleufe, commife par un officier public
dans l’exercice de fes fondions, ou une dette par
lui contractée pour dépôt néceffaire fait en fes mains
à caufe de fon office ; ou enfin quelqu’autre fa it, où il
a excédé fon pouvoir, & pour lequel il eft defavoiié
valablement.
La réparation du dommage réfultant d’un fait de.
charge, eft tellement privilégiée fur l'o ffic eq u e lle
eft préférée à toute;autre créailcé hypothécaire ■, antérieure
& privilégiée, même à' cëüx qui ont prêté
leur argent pour l’acquifition de l’office ; ce qui a été
ainfi introduit a- c’aùie de lâToi publique, qui vèut
que la charge réponde fpéeiàlertîent des fautes dè celui
qui en eft revetu envers ceux qui ont contracté
héfceffairêfiient avec lui à câüfé;dè ladite charge-.
Voyé( Loyfeatig des offices ,• liv. I. ck.jv. n. 63. 66\,
& liv. I I I ; ch. viij. n. 4$. Bôùguier, lettre H . p. iS<).
Bafnage, tr. dèi liypotheq. p. 3 5 c). in fine ; journal des
audiences 5 tom. IV . p. y zo . &fu ir . jufque & compris
y 43 S & journal du palais, tome T.p. izq . ÇA)
Fa i t s c o n f e s s é s e t a v é r é s font ceux qui
font reconnus par la partie qui fe voit intéreffée à
les nier. Ils fonttenus pour confelfés & avérés, lorfque
la partie refufe de s’expliquer , & qu’il intervient
en conféqüence un jugement qui les déclare tels.
Voye{ ci-devant F a i t s AVÉRÉS. ÇA)
Fa i t c o n t r o u v é , eft celui qui eft fuppofé &
à deflein par celui qui en veut tirer avantage. ÇA)
Fa i t é t r à n g ;è , dans les coutumes de Lodunois
& de Touraine, eft lorfque lé parageau vend ou
aliéné autrement que par donation, en faveur de
mariage ou avancement de droit fucceflif fait à fon
héritier, la chofe à lui garantie j auquel cas feulement
eft dû rachat. C ’eft ainfi qiie-l’explique l’article
136. de la coûtume de Touraine, Voye^ auffi Lodunois,
ch. xjv. art. 14. ÇA) ' ■
Fa it f o r t , c’étoit le prix de là ferme des mon-
ifioiés, que le maître devoit donner au ro i, foit qu’il
eût ouvré ou: non. Voye% tes annotations de Gelée
corredèur des comptes, bc le gloffaire de Laurierë.
■ . ■ ■ . WÊË
F a i t s qui gifetit en preuve vocale ou littérale , font
ceux qui font de nature à être prouvés par témpins,
ou paf écrit ; à la différence de certains./«»«, dont la
preuve eft impoffible, ou- n’eft pas recevable. Voye^
le tit, x x . de l ’ordonnance de 16 6y g intitulé des faits
qui gifent en preuve vocale ou littéraUi ÇA)
F a i t g r a n d e t p e t i t : On diftinguoit autrefois
dans quelques pa ys , en matière d’excès commis ref-
peélivement, lofait qui étoit le plus grand, & l’on
tenoit pour maxime que lé-fait Je plus grand empor-
toit toûjours le petit ; ce qui eft aboli par le ftyle des
cours & juftices féculieres du pays de Liège, au chapitre
xv. art. y. ÇA)
F a i t s im p e r t in è NS , font ceux quæ non pertinent
ad rem , e ’eft-à-dire qui font étrangers à l’affaire
, qui font indifférens pour la décilion ; on ajoûte
Ordinairement qu’ils font inadmiffibles , pour dire
que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils
font oppôfés aux faits pertinens, qui reviennent bien
à l’objet de la conteftation. ÇA)
F a i t in a d m i s s ib l e , eft celui dont la preuve
ne peut être ordonnée ni reçûe, foit parce que le
fait n’eft pas pertinent, ou parce qu’il eft de telle
nature que la preuve n’en-eft pas recevable. ÇA )
Fa i t s j u s t i f i c a t i f s , font ceux qui peuvent
fervir à prouver l’innocence d’un accufé : par exem- .
p ie , lorlqu’un homme accûfé d’en avoir tué un autre
dans un b ois, Offre de prouver que ce jour-là il
étoit malade au lit , & qu’il n’eft point forti de fa
chambre ; ce que i’on-'appelle un alibi.
L’ordonnance de 1670 contient un titre exprès fur
cette matière : c’eft le vingt-huitieme*
Il eft défendu à tous juges, même aux cours fou-
veraines, d’ordonner la preuve d’aucuns faits jujtifi-
catifs , ni d’entendre aucuns témoins pour y parvenir
, qu'après la vifite du procès ; en quoi l’ordonnance
a réformé la jurifprudencè de quelquès tribunaux
, tels que le parlement de Bretagne, où l’on
commençoit toûjours par la preuve des faits jujti-
ficatifs de l’accufé : ce qui étoit contre l’ordre natur
e lp u i fq u ’il faut qüé le délit foit cônftaté avant
d’admettre l’accufé à fa juftification.
C ’eft paf Une fuite de ce principe, que l’accüfé
n’eft pas recevable avant la vifite du procès, à fe
tendre accufateur contre un témoin, dans le deflein
de fé préparer un fait juftificatif. Voyei Bonifece 9
tome V. liv. I I I . lit. j . ch. xxiij. _ •
L’accüfé n’eft reçû à faire preuve d’autrés faits
jufiificatifs, que de ceux qui ont été choifis paf les
juges, du nombre de ceux que l’accufé a articulés
dans les interrogatoires & confrontations.
Les faits jufiificadfs AoxvenX être inférés dans le
même jugement qui en ordonne la preuve. Ce jugement
doit être prononcé inceflamment à l’accufé par
le juge, & au plûtard dans les vingt-quatre heures ;
& l’accufé doit être interpellé de nommer les témoins,
par lefquels il entend juftifier ces faits ; &
faute de les nommer fur le champ, il n’y eft plus reçû
dans la fuite.
Lorfque l’açcüfé a une fois nommé les témoins;
il ne peut plus en nommer d’autres ; & il ne doit
point être élargi pendant l’inftruâion de la preuve
des faits jufiificatifs.
Les témoins qu’il adminiftre font affignés à la requête
du miniftere public de la jurifdiélion oit l’on
inftruit lé procès, & font oüis d’office par le juge.
L’accufé eft tenu de configner au greffe la fomme
ordonnée par le juge, polir Fournir aux frais de la
preuve des faits jufiificatifs, s’il peut le faire ; autrement
les frais doivent être avancés par la partie civile
s’il y en a , linon par le ro i, ou par le feigneur
engagifte, ou par le feignêur haut-jufticier, chacun
à leur égard.
L’enquête achevée, on la communiqué au miniftere
public pour donner des conclufions, & à la partie
civile s’il y en a ; & ladite enquête eft jointe au
procès.
Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes;
& y ajoûter telles pièces que bon leur femble fur le
fait de l’enquête. Ces requêtes & pièces fe lignifient
refpeÛivement, & ôn en donne fans que pour raifon
de ce il foit néceffaire de prendre aucun reglement
, ni de faire une plus ample inftruétion. Voyeç
Papon, liv. X X I V . tit. v. n; iz . Bouvot, tome I h
verbO monitoire, quefi. 6. & iz . Ballet, tom. 1. 1. II .
tit. x iij. ch. iij. Bonirace, tom. I I . part. I I I , liv. I . tit.
j . ch .jx. Pinault, tom. /. arrêt 1S0. ÇA)
F a i t n é g a t i f , e f t c e lu i q u i c o n lif t e d an s la d é n
é g a t io n d ’u n a u t r e ; p a r e x em p le lo r fq u ’u n h om m e
fo û t ie n t q u ’i l n’ a p a s d it t e l le c h o f e , q u ’i l n ’ a p a s é t é
à t e l e n d r o it .
On ne peut obliger perfonne à la preuve d’un fait
purement négatif, cette pïeüve étant abfolument
impoffible : per rerum naturam negantis nulla probatio
ejt. Cod. liv. IV . tit, x jx . I. z j .
Mais lorfque le fait négatif renfermé un fait affirmatif,
on peut faire la preuve de celui-ci, qui fournit
une efpece de preuve du premier; par exemple
li une perfonne que l’on prétend être venue à Paris
un tel jour, foûtient qu’elle étoit ce jour - là à cent
lieues de Paris, la preuve de Y alibi eft admiffible*
Voyer la loi 14. cod. de contrah. & commit. (lipuL ■ HH .. Fa i t s n o u v e a u x , font ceux qui n’avoient point
encore été articulés, & dont on demande à faire
preuve depuis un premier jugement qui a ordonné
une enquête.
Autrefois il falloit obtenir dés lettres en éharicel*
lerie pour être reçû à articuler faits nouveaux ; mais
cette forme a été abrogée par Y article z6 . du titre xj*
de l’ordonnance de 1667, qui ordonne qüe les faits
nouveaux feront pofés par une limple requête. ÇA )
F a i t d u P r i n c e , lig n ifie u n ch an g em e r tt q u i
ém a n e de l ’a u to r ité du f o u v e r a in ; com m e lo r fç ju ’i l