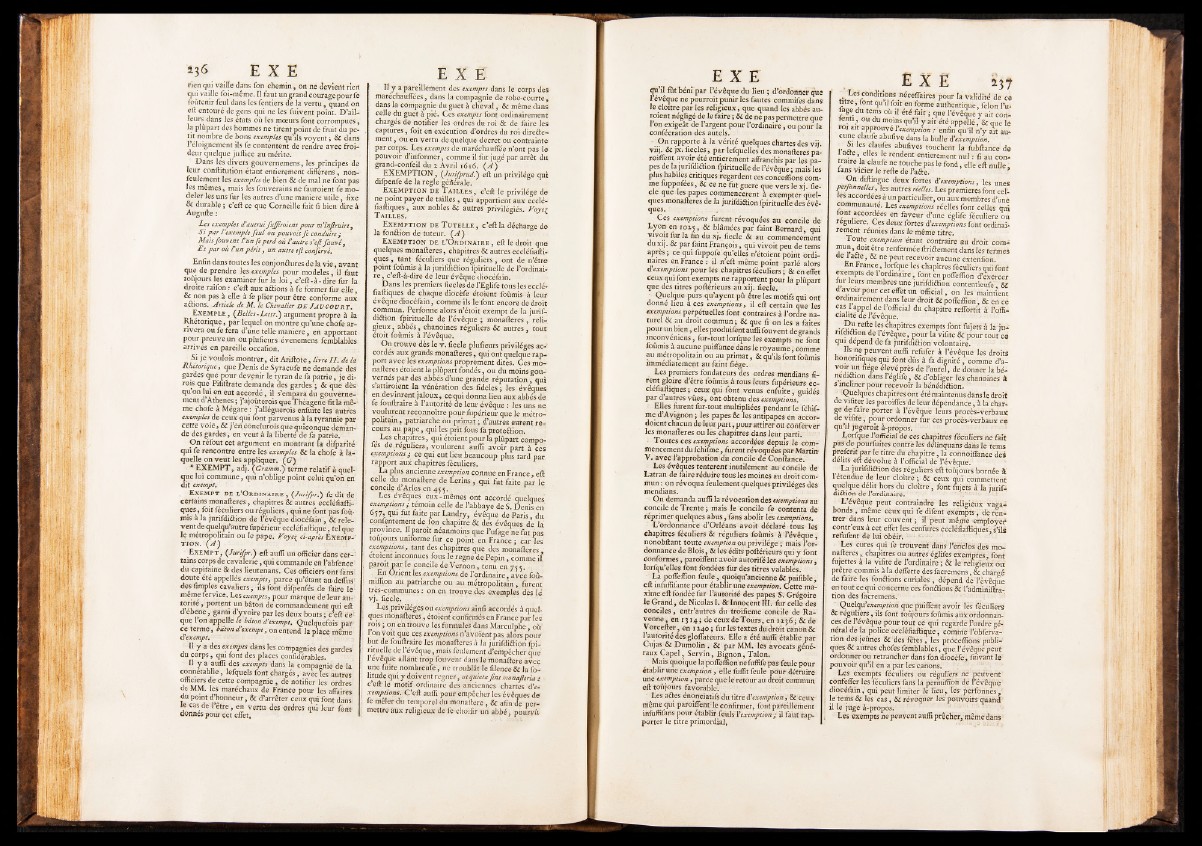
rien qui vaille dans fon chemin, ôn ne devient rien
qui vaille foi-même. Il faut un grand courage pour fe
loûtenir feul dans les fentiers de la vertu, quand on
eft entouré de gens qui ne les 'fuivent point. D ’ailleurs^
dans les états oii les moeurs font corrompues,
la plupart des hommes ne tirent point de fruit du petit
nombre de bons exemples qu’ils voyent ; & dans
I eloignement ils fe contentent de rendre avec froideur
quelque juftice au mérite.
Dans les divers gouvernemens, les principes de
leur conftitution étant entièrement différens, non-
feulement les exemples de bien & de mal ne font pas
les mêmes, mais les fouverains ne fauroient fe modeler
les uns fur les autres d’une maniéré u tile, fixe
& durable ; c’eft ce que Corneille fait fi bien dire à
Augufte :
Les exemples <Tautrui fuffiroient pour m'infiruire,
- Si par l'exemple feul on pouvoit fe conduire }
Maisfouvent Vunfe perd ou Vautre s'efl fauve,
E t par ou Vun périt, un autre eft confervé.
Enfin dans toutes les conjonctures de la v ie , avant
que de prendre les exemples pour modèles, il faut
toujours les examiner fur la lo i , c’eft-à-dire fur la
droite raifon : c’eft aux allions à fe former fur elle,
& non pas à elle à fe plier pour être conforme aux
allions. Article de M . le Chevalier D E J A V COU R T ,
Ex em p le , (Belles-Leur.} argument propre à la
Rhétorique, par lequel on montre qu’une chofe arrivera
ou fe fera d’une telle maniéré, en apportant
poiir preuve un ou plufieurs é venemens femblables
arrivés en pareille occafion.
Si je voulois montrer, dit A riftote, livre I I . de la
Rhétoriquey que Denis de Syracùfe ne demande des
gardes que pour devenir le tyran de fa patrie, je di-
rois que Pififtrate demanda des gardes ; & que dès
qu on lui en eut accordé, il s’empara du gouvernement
d Athènes ; j’ajoûterois queThéagene fit lame-1
me chofe à Mégare : j’alléguerois enfuite les autres
exemples de ceux qui font parvenus à la tyrannie par
cette voie* & j en.concluroisquequiconque demande
des gardes, en veut à la liberté de fa patrie.
On réfout cet argument en montrant la difparité
qui fe rencontre entre les exemples & la chofe à laquelle
on veut les appliquer. ((?)
* EXEMPT, adj. (Gràmm.') terme relatif à quelque
loi commune, qui n’oblige point celui qu’on en
dit exempt.
Exempt de l’Ordinaire , (lurifpr,) fe dit de
certains monafteres, chapitres & autres eccléfiàfti-
ques, foit féculiers ou réguliers, qui ne font pas fournis
à la jurifdi&ion de l’évêque diocéfain , & relèvent
de quelqu’autre fupérieur eccléfiaftique, tel que
le métropolitain ou le pape. Foyer ci-après ExeMp-' tion. (A )
Ex em p t , ( Jurifpr.) eft auffi un officier dans cër-:
tains corps de cavalerie, qui commande en l’abfence
du capitaine & des lieutenans. Ces officiers ont fans
doute été appellés exempts, parce qu’étant au-défliré: i des-fimples cavaliers, ils font difpenfés de faire le meme fer vice. Les exempts, pour marque de leur au-
torite , portent un bâtoii de commandement qui eft
d ebene, garni d’yvoire par les deux bouts ; c’eft cë * i
que 1 on appelle le bâton d'exempt. Quelquefois pat ’
ce terme, bâton <Vexempt, on entend la place même
cl exempt.
II y a des exempts dans les compagnies des gardes
du corps, qui font des places cpnfidérables.
Il y a auffi des exempts dans la compagnie de la
connetablie , lefquels font chargés, avec les autres
officiers de cette compagnie , de notifier les ordres
de MM. les maréchaux de France pour les affaires
du point d’honneur, & d’arrêter ceux qui font dans !
le cas de l’être, en vertu des ordres qui leur font
donnes pour-cet effet,
Il y a pareillement des exempts dans le corps des
marechauffées, dans la compagnie de robe-courte,
dans la compagnie du guet à cheval, & même dans
celle du guet à pié. Ces exempts font ordinairement
chargés de notifier les ordres du roi & de faire les
> captures, foit en exécution d’ordres du roi direlte-
ment, ou en vertu de quelque decret ou contrainte
par corps. Les exempts de maréchauffée n’ont pas le
pouvoir d’informer, comme il fut jugé par arrêt du
grand-confeil du 2 Avril 1616. {A )
EXEMPTION, ( Jurifprud.) eft un privilège qui
difpenfe de la réglé générale. Exemption de Tailles, c’eft le privilège de
ne point payer fiaftiques, aux dneo tbalielsle &s, qauutir easp pparritviielnétg iaéusx. ecclé- Foyer Tailles.
Exemption de Tutelle, c’eft la décharge de
la fon&ion de tuteur. (A } Exemption de l’Ordinaire , eft le droit que
quelques monafteres, chapitres & autres eccléfiafti-
ques, tant féculiers que réguliers, ont de n’être
point fournis à la jurifdiltion fpirituelle de l’ordinaire
, c’eft-à-dire de leur évêque diocéfain.
E)ans les premiers fiecles de l’Eglife tous les ecclé-
fiaftiques de chaque diocèfe étoient fournis à leur
évêque diocéfain, comme ils le font encore de droit
commun. Perfonne alors n’étoit exempt de la jurif-
diltion fpirituelle de l’évêque ; monafteres, reli-,
gieux, abbés, chanoines réguliers & autres, tout
etoit foûmis à l’évêque. •
On trouve dès le v . fiecle plufieurs privilèges accordes
aux grands monafteres, qui ont quelque rapport
avec lés exemptions proprement dites. Ces mo-
: nafteres étoient la plupart fondés, ou du moins gou-
: yernés par des abbés d’une grande réputation, qui
j s’attiroient la vénération des fideles ; les évêques
en devinrent jaloux, ce qui donna lieu aux abbés de
' fe fouftraire à l’autorité de leur évêque : les uns ne
voulurent reconnoître pour fupérieur que le métropolitain
, patriarche ou primat ; cl’autres eurent recours,
au pape, qui les prit fous fa protellion.
Les chapitres, qui étoient pour la plûpart compo-
fes de. réguliers, voulurent auffi avoir part à ces
exemptions ,• ce qui eut lieu beaucoup plus tard par
rapport aux chapitres féculiers.
La plus ancienne exemption connue en France, eft
ceüe du monaftere de Lerins, qui fut faite par le
; concile d Arles en 45;$.
: Les évêques eux - mêmes ont accordé - quelques
exemptions / témoin celle de l’abbaye de S. Denis en
: $57> qui fut: faite par Landry, évêque de Paris du
contentement de fon chapitre & des évêques de la
province. Il paroit neanmoins que l’ufage ne fut pas
toujours uniforme fur ce point en France ; car les
exemptions, tant des chapitres que des monafteres
etoient inconnues fous le régné de Pépincomme il
paroit par le concile de Vernon, tenu en 755.
En Orient les,exemptions de l’ordinaire, avec foû-,
million au patriarche ou au métropolitain, furent
tres-communes : on en trouve, .çljés exemples dès le*
vj. fiecle.
Les .privilèges ou exemptions ainfi accordés à quelques
monafteres, étoient confirmés en France par les
rois ; on en trouve les formules dans Marcülphe, oit’
l’on voit que ces exemptions n’avoient pas alors pour
but de fouftraire lés monafteres à la jurifdilbion fpirituelle
de l’évêque, mais feulement d’empêcher que
l’évêque allant trop foiivént dans le monaftere avec
une fuite nombreufe, ne troublât le filence & la fo->
litude qui y doivent regner, ut quieta ftnt monafteria•
c’eft'le motif ordinaire des anciennes chartes dV*
xemptiOns. C ’eft auffi pouf empêcher les évêques de'
fe mêler du temporel du monaftere, & afin de permettre
aux religieux de fe-choifir un abbé, pourvu
çt, il fur béni par l’évêque du lieu ; d’ordonner que
l’evêque ne pourrait punir les fautes commifes dans
le cloître par les religieux, que quand les abbés au-
roient négligé de le faire ; & de ne pas permettre que
fon exigeât de l’argent pour l’ordinaire , ou pour la
confécration des autels. ‘
- On rapporte à la vérité quelques chartes des vit.
viij. & jx . fiecles, par lefquelles des monafteres pa-
noiflent avoir été entièrement affranchis par les papes
de la jurifdiétion fpirituelle de l’évêque ; mais les
plus habiles critiques regardent ces conceflions comme
fuppofees, & ce ne fut guère que vers le xj. fie-
cle que les papes commencèrent a exempter quelques
monafteres de la jurifdiltion fpirituelle des évêques.
g ,.
Ces exemptions furent révoquées au concile de
Lyon en 1015, & blâmées par faint Bernard , qui
vivoit fur la fin du xj. fiecle & au commencement
du xi j. & par faint François, qui vivoit peu de tems
apres; ce qui fuppofe qu’elles n’étoient point ordinaires
en France : il n’eft même point parlé alors
$ exemptions pour les chapitres féculiers ; & en effet
ceux qui font exempts né rapportent pour la plûpart
que des titres poftérieurs au xij. fiecle.
' Quelque purs qu’ayent pû être les motifs qui ont
donne lieu à ces exemptions, il eft certain que les
exemptions perpétuelles font contraires à l’ordre naturel
& au droit commun ; & que fi on les a faites
pour un bien, elles produifent auffi fou vent de grands
inconvéniens, fur-tout lorfque les exempts ne font
foûmis à aucune püiffance dans le royaume; comme
au métropolitain ou au primat, & qu’ils font foûmis
immédiatement au faint fiége.
Les premiers fondateurs des ordres mendians firent
gloire d’être foûmis à tous leurs fupérieurs ec-
cléfiaftiques ; ceux qui font venus enfuite, guidés
par d’autres vûes ,' ont obtenu des exemptions.
Elles furent fur-tout multipliées pendant le fehif-
me d’Avignon ; les papes & les antipapes en accor-
doient chacun de leur part, pour attirer ou confervëf
les monafteres ou les chapitres dans leur parti.
- Toutes ces exemptions accordées depuis le commencement
du fchifme, furent révoquées par Martin'
V . avec l’approbation du concile de Confiance.
Les évêques tentèrent inutilement au concile de
Latran de faire réduire tous les moines au droit commun
: on révoqua feulement quelques privilèges des
mendians.
On demanda auffi la révocation des exemptions au
concile de Trente ; mais le concile fe contenta de
réprimer quelques abus, fans abolir les exemptions.
L’ordonnancé d’Orléans avoit déclaré tous les
chapitres féculiers & réguliers foûmis à l’évêque,
nonobftant toute exemption ou privilège ; mais l’or-
dônnâncè de Blois, & les édits poftérieurs qui y font
Conformes, paroiffent avoir autoriféles exemptions,
lorfqu’eîles font fondées fur des titres valables.
La poffeffion feule, quoiqu’ancienne & paifible,
eft infuffifante pour établir une exemption. Cette maxime
eft fondée fur l’autorité des papes S; Grégoire
le Grand, de Nicolas I. & Innocent III. fur celle des
conciles, entr’autres du troifieme concile de Ra-
venne, én 1314 ; de ceux de Tours , en i 23 6 ; & de
Vorcefter, en 1240 ; fur les textes du débit çanbn &
l’autorité des gloflateurs. Elle a été auffi établie par
Cujas & Dumolin . & par MM. les avocats généraux
Capel, Servin, Bignon, Talon.
Mais quoique la pofTémon ne fuffife pas feule pour
établir une exemption, elle fuffit feule pour détruire
une exemption, parce que le retour au droit commun
eft toujours favorable.
Les ailes enonciatifs du titre à?exemption, & ceux- i
même qui paroiffent le confirmer, fotrf pareillement
infuffifans pour établir feuls l’exemption, il faut rapporter
le titre primordial,
I ititgre iJ (oSnt qu® il fo iht éecné ffolarimrees apuothuer nlati qvualei,d fiétélo dne I ’cue-
(age du tems oh il été fait que l’évêqui y ait cori-
rieoni atii,t oapup druo umvoéi ns qu’il y ait été appellé, & pue le cunq daufe abufilv’eex sdmanpst iloati b :u ellnef in qu’il ft’y ait au* A’txcmptiàn. • •
il> a atte lese lles le reanbduefnivt eeèn ttioèurcehmeenntt lnau l( u: bffi taanuc ceo nd*e ltaranisr ev ilcai ecrla lue free nftee tdoeu cl’haell ep.as le fond, elle eft nulle .
On diltingue deux fortes d’exemptions, les unes
ptrJonmlUs, les autres ridlcs. Les premières fout ceb
tceosm, amccuonrdauéetés. à L uens particulier, ou aux membres d’unè exemptions réelles font celles qui
r(éognut laicècreo-rCdéeess d eenu xf aveur d’une églife féculiere ou rement reunies dansf ortes d'exemptions foht ordinaù le même titre.
muTno, udtoei t eêxterem rpetniofne r^maénet f trcièfntetmraeirnet daaun sd lreosi tt ecrOmmesa de 1 atte, & ne peut recevoir aucune extenfioh. '
exefcmn pFtrsa dnec e1 ,o lrodrifnqauiere l,e sf ocnhta epnit rpeosf ffeéfcluiôlîne tds’ qéxuèi frocenrt tur leurs membres une jurifdiaion contentïeufe’ «î
ddn advinoairi rpeomuern ct edta enfsf elet uunr doroffiitc &ia lp, ooffne ffleios nm, &ai netnie cnèt cciaasl i1t éa pdpee ll’ édveê lq’oufef.icial du chapitre reffortit â l’offi-
rivld?iAlt-iorenf tdee l el’sé<cv*êîaqPuietr, épso euxre mlap vtisf iftoen &t f ipijoeutsr àto lua tj tcte- qui dépend de fa jurifdillion volontaire.
Ils ne peuvent auffi refiifer à l’évêque les droits
hvo?n*ourinfi qfiuéegse q éulei vféo nptr èdsû ds eà F faau dteig!,n diteé ,d ocnonmemr lea db’éa-- sn eindcillihnoeir1 pdoaunrs rl’eécgelvifoei,r &la bdé’onbéldigiletri olne.s chanoines à
dj e Qvi.f^itqeru leess cphaaropiiftfreess odne tl eéutér mdéapinentednaunsc dea,n às llae cdhraori*t ge dç fàire porter à l’évêque leurs procès-verbaux
qàùe viliû jitïeg e, rpooitu àr -oprrdoopnons.e r f• •ut ces procès-verbaux ce
Lorfque l’official de ces chapitres féculiers ne fait
pàS de pourfuites contre les delinquans dahs le tems
Çaerheftcs reitf tp daré vléo tliuteré à d lu’o cffhiacipailt rdee, ll’aé vcêoqnuneo.iffance dei letLerat djuurei fddeil llieounr dcelso îrtérge u;l i&er s ceefut xto uqjuoiu crso mbomrneéttee nàt qduileliloqune d deé ll’iotr hdionrasi dreu. cloître , font fujets à la jurifL’évêque
peut contraindre les religieux vaga-
tbroenrd ds a,n sm êlemuer ccoeuuxv eqnuti ;f eidl i'fpeenutt emxeêmmep tse,m dpe^ oreynèé
contr’eux à cet effet les cenfurès ecclëlîaftidues , s’ils rèfufent de lui obéir.
nafLteerse sc u, rcehsa qpuitir efse oturo auuvterenst édgalnîfse sV eëfxieclmùsp tdeéss, fmoont
ftijettes à la vifite de l’ordinaire ; & le religieux ou
prêtre commis à la defterte cj.es facremens, fi. chàrgé
edné ftaoiurte c lee qs ufio cnollniocefirsn ec,u créisa lFeôsn,l tdioérptse n,&d l’daéc llm’ëivnêilqfruae- tion dés facremens.
&“ rQéguuellileere sx, eimls pftoionnt tqouûej opuiirisff feonût maviso airü llcé os rfdéocnunliaenrs
nceésr adie d le’é lvaê pqoulei cpeo eucrc tloéufita fctéiq quuei, rceogmartdrféë fF’oôrbdferérv vaé-
tqiuoens d&és a jueturnese sc h&o fedse sf efmêtbelsa b, lleess j pqruôeé.e FféfivÔênqsù ep pubeluit
oproduovnonire rq ouu’i lr eentr aan pcahre lré dsa cnasr tfoonrts .diocefe, fuivant le
conLfeesf feerx elems pfétsc ufléiecrusl ifearnss loau p erérmguilfifeiorsh ndeé Fpëevuêvqeiniet
ldéi otecméfsa in, qui peut limiter le lieu ^ le's perfonnes , il le jug&ec àl-epsr ocpaoss, .& révoquer lés pouvoirs quand
Les exempts ne peuvent auffi prê cher, même dans