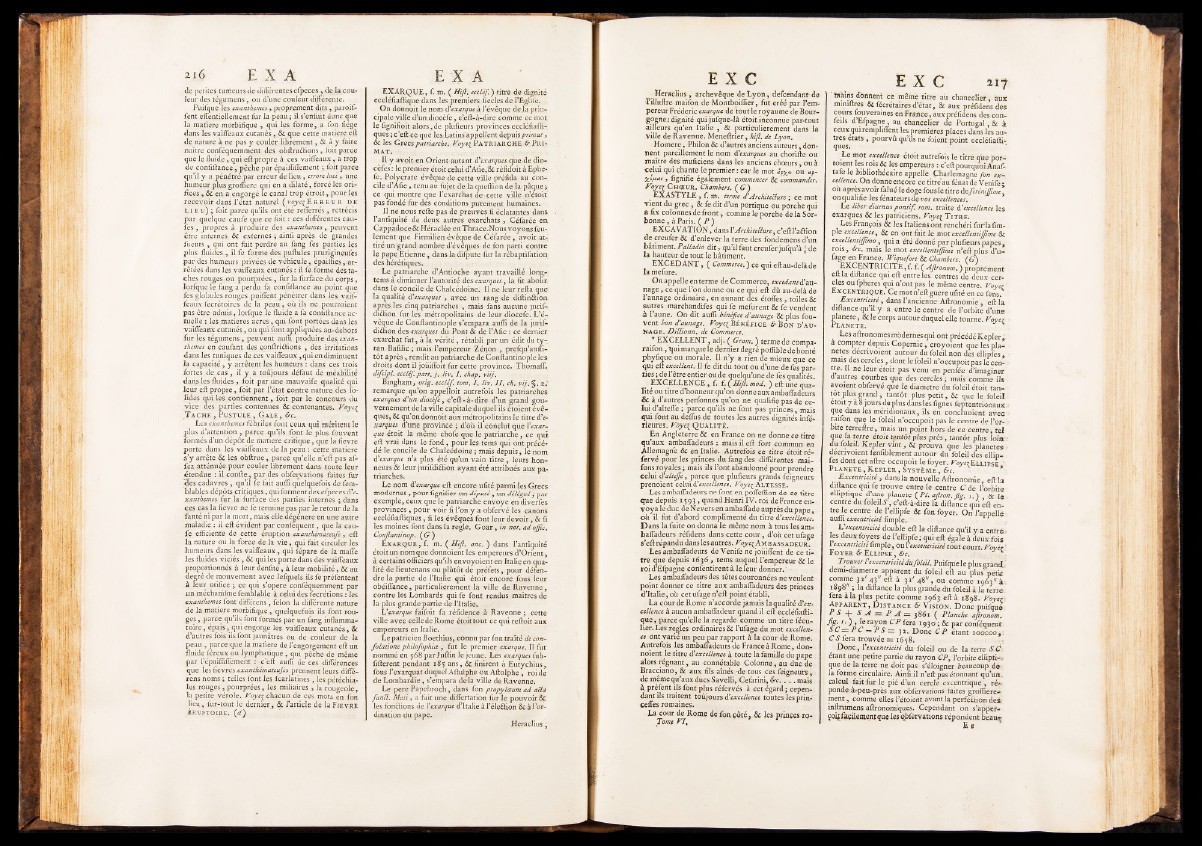
j P E X A de petites tume leur des tégumeunrss ,d eo ud idff’uérneen tceosu elfepuerc deisf f,é dreenlate.c.ou-
fenPt ieiifffqeunet ileelsle emxaenntt hfèumr elas, pperaoup ;r eilm se’ennt fduiitts- d,o pnacr oquife-.
la matière morbifique , qui les forme, a fon fiége
ddaen nsa lteusr ev aài fnléea upxas c yu tcaonuélse,r &lib qrueem ceenttt,e &m atière eft naître conféquemment des obftruélions, foài ty p faaricree que le fluide, qui eft propre à ces vaiffeaux, a trop
qdue’ icl oyn fai fptaénncéetr, ep pêacrh ee rpraeru ré pdaei flliieffue,m ent ; foit parce crrore loti, une
humeur plus grofliere qui en a dilaté , forcé les orifriecceesv
, o&ir edna nas, eln’egtoartg né alteu crealn a(l trop étroit, pour les voyeç E R R E U R d e
l ie u ) ; foit parce qu’ils ont été refferrés- , rétrécis
fpeasr , qpureolpqruees càa upfreo qduueir cee dfeosi t : ces différentes cau- exanthèmes, peuvent
fêutreeu risn ,t eqrnuei so n&t feaxitt eprenredsr e; aaiun ffia anpgr èfse s dpea rgtrieasn dleess
plus fluides , il fe forme des pullules prurigineufes
rpêatré edse sd ahnusm leesu rvsa ipfrfievaéuexs cduet avnééhsi c: uill efe, féopramilelî edSejs. atarches
rouges ;Ou pourprées , fur la furface du corps,
ïfoesr fgqluoeb ulel efsa nrogu ag epse rpduui fffae nct opnéfnifétatrnecre d aaun sp loeisn tv qaiufe
feaux fecrétoires de la peau, oii ils ne pourraient
pas être admis, Ïorfque le fluide a fa confiftance actvuaeifllfee
a: ulxe sc .umtaantiéèrse,s o auc qreusi f, oqnuti afpopnlti qpuoéretés easu d-daenhs olerss fur les tégumens, peuvent aulïi produire des, lse se ntu cnaiuqfuaenst ddee cse çso vnafitrfif&eaiounxs, q,u di eesn dirirmitiantuioennst
exandthaènmse
lfao rcteasp adceit éc a, sy, airl rêyt ean tt oleusj ohuurms eduérfsa :u td adnes mceésa btirloitiés
dan^ les fluides , loit par une mauvaife qualité qui
lneduers e qftu pi rloesp rceo,n ftoieitn pneanr tl-’,é tfaoti tc opnartr ele n actounrceo duerss dfou
vice Tache des , Pustule parties contenues , Gale, & contenantes. 'Voye^ plusL eds’a etxteannttihoènm e, s pfaérbcreil eqsu f’oilnst & fcoenutx c. l eq upi lumsé froitue vnet nlet formés d’un dépôt de matière critique, que la fievre
porte dans les vaiffeaux de la peau : cette matière
sfe’yz aartrtêétneu &ée lpeosu or bcfotruuleer, lpibarrecme eqnut’ edllaen ns ’etoftu ptea sl eaufr- étendue : il confie, par.des obfervations faites fur
•des cadavres , qu’il le fait aufli quelquefois de fem-
xanthemes blables, dépôts fur la critiques,furface qui des forment parties internes des efpeces ; dans
d’e-
fcaens tcéa nsi lpaa fri elav rme onret f em taeirsm eilnlee dpéags épnaérr éle e rne tuonuer a duet rlea fmea leafdfiicei e: nilte e-dfte é vciedtteen ,t épruarp tcioonnf isquent, que la ,cauexanthémateufe
eft
hlau mnaetuurrse doaun sl al efso vrcaeif fdeea luax v, iqeu,i qléupi afareit dceir clau lmera lfefes
les fluides viciés , & qui les porte dans des vaiffeaux
proportionnés à leur denfité, à leur mobilité, & au
dàe lgeruér d oer mifioceu v; ecmee qnut ia vs’eocp èlerefq cuoenlsf éilqsu feem pmréefnent tpeanrt un méchanifme femblable à celui des fecrétions : les
exanthèmes font différens félon la différente nature
dgees l ,a pmaarctieè rqeu m’ilos rfboinfti qfuoerm, éqsu pelaqru uenfo fiasn igls i nffolnamt rmoautoire
, épais, qui engorge les vaiffeaux cutanés, &
dp’eaauut r,e sp aforcise iqlsu feo lnat mjauatniâètrree ds eo lu’e ndgeo rcgoeumleeunrt edfet ulna fplaurid le’ éfpéariefulixff oemu elynmt :p hca’teifqtu ea u, fqf udi ep cêecsh ed idfefé rmenêmcees que les fievres exanthémateufes prennent leurs différleesn
sr onuogmess ,; pteolulersp rfoéenst ,l else sl cmarillaiatiinreess ,, llaes r opéutgéecohliea,
la petite vérole. Voye^ chacun de ces mots en fon
lieu, fur-tout le dernier, & l’article de la Fievre éruptoire. (d)
E X A
EXARQUE, f. m. ( Hifl;eccléf.) titré de dignité
eccléfiaftique dans les premiers fiecles d e l’Eglife.
On donnait le nom d’exarque k l’évêque de la principale
ville d’un diocèfe, c’eft-à-dire comme ce mot;
le figmfioit alors,de plufieurs provinces eccléfiafti-
ques ; ç ’eft ce que lesLatins appellent depuis primat,
& les Grecs patriarche,Voye^ Patriarche # Primat.
Il y avoit en Orient-autant düexqrques que de dio-
cèfies : le premier étoit celui d’Àfie,&réfidoit à Ephe-
fie. Polycrate évêque de cette Mille préfida au concile
d’Afie , tenu au fujet de la qiieftion de la- pâque
ce qui montre que l’exarchat de-cette ville n’etoit
pas fondé fur des conditions purement humaines.
II ne nous relie pas de preuves fi éclatantes dans
l’antiquité de deux autres exarchats , Céfarée en.
Cappadoce & Héracléè enThrace.Nous voyons feu-
lemènt que Firmilien évêque de Céfarée, avoit attiré
un rgrand" nombre d’éveques de fön parti contre
le pape Etienne, dans Ia,difpute fur la rébaptifation
des hérétiques.
Le patriarche d’Antioche aÿant travaillé long-
tems à diminuer l’autprité des exarques, la fit abolir
dans, le concile de Chalcédojne. Il ne leur relia que
la qualité d’exarques , avec un rang de diftin&ion
aprçs les cinq patriarches , mais fans aucune jurif-
diétion fur les métropolitains de leur dioeefe. L’é-.
vêque de Conftantinople s’empara aufli de la jurif-
diétion des exarques du Pont & de l’Afie : ce dernier
exarchat fi.it, à la vérité, rétabli par un édit du tyran
Bafilic ; mais l’empereur Zénon , prefqu’auffi-
tôt après, rendit au patriarche de Conftantinople les
droits dont il joiiiffoit fur cette province. Thomaff.
difcipl. eccléf. part. j . liv. I. chap. vïij.
Bingham, orig. eccléf. tom. I. liv. I I . ck.yij. § . z i
remarque qu’on appelloit autrefois les patriarches
exarques d'un diocèfe, c’eft-à-dire d’un grand gouvernement
de la ville capitale duquel ils étoient évêques,
& qu’on donnoit aux métropolitains le titre d’e-
xarques d’une province ; d’oli il conclut que Yexarque
étoit la même chofe que le patriarche, ce qui
eft vrai dans le fond, pour les tems qui ont précédé
le concile de Chalcédoine ; mais depuis, le nom
d'exarque n’a plus été qu’un vain titre , leurs honneurs
& leur jurifdiélion ayant été attribués aux pa».
triarches.
Le nom d'exarque eft encore ufité parmi les Grecs
modernes, pour lignifier un député, un délégué ; par
exemple, ceux que le patriarche envoyé en diverfes
provinces, pour voir fi l’on y a obfervé les canons
eccléfiaftiques, fi les évêques font leur d evoir, & fi
les moines font dans la regle. G oa r , in not. ad offic.
Conßantinop. (G ) . Exarque , f. m. ( Hiß. anc. ) dans l’antiquité
étoit un nom que donnoient les empereurs d’Orient,
à certains officiers qu’ils envoyoient en Italie en qualité
de lieutenans ou plûtôt de préfets, pour défendre
la partie de l’Italie qui étoit encore fous leur
obéiffance, particulièrement la ville de Ravenne,
contre les Lombards qui fe font rendus maîtres de
la plus grande partie de l ’Italie.
Vexarque faifoit fa réfidenee à Ravenne ; cette
ville avec celle de Rome étoit tout ce qui reftoit aux
empereurs en Italie.
Le patricien Boethius, connu par fon traité de con-
folatione philofophice , fut le premier exarque. Il fut
nommé en 568 par Juftin le jeune. Les exarques fub-
fifterent pendant 185 ans, & finirent à Eutychius,
fous l’exarquat duquel Aftulphe ou Aftolphe , roi de
de Lombardie, s’empara de la ville de Ravenne.
Le pere Papebroch, dans fon propylaum ad acta
fanct. Maii, a fait une differtation fur le pouvoir Sc
les fondions, de Vexarque d’Italie à l’éleûion & à l ’ordination
du pape.
Heraçlius ,
E X C Heraçlius , archevêque de L y on , descendant de
l ’illuftre maifon de Montboiflier, fut créé par l’empereur
Frédéric exarque de tout le royaume de Bourgogne
: dignité qui jufque-là étoitinconnue par-tout
ailleurs qu’en Italie , & particulièrement dans la
Ville de Ravenne. Meneftrier, hiû. de Lyon.
Homere, Philon & d’autres anciens auteurs, donnent
pareillement le nom d’exarques au chorifte ou
maître des muficiens dans les anciens choeurs, ou à
celui qui chante le premier : car le mot *pxw ou ap-
xlpa* , lignifie également commencer & commander..
Foyei Choeur. Chambers. ( G )
EXASTYLE > f. na. terme d?Architecture ; ce mot
vient du g rec , & fe dit d’un portique ou porche qui
a fix colonnes de front, comme le porche de la Sorbonne
, à Paris. ( P )
EXCAVATION, dans Y Architecture, c’eft I’aflion
de creufer & d’enlever la terre des fondemens d’un
batiment. Palladio dit, qu’il faut creufer jufqu’à^ de
la hauteur de tout le bâtiment.
EX C ED AN T , ( Commerce.') ce qui eft au-delà de
la mefure»
On appelle enferme de Commerce, excedantd’aii-
nage, ce que l’on donne ou ce qui eft dû au-delà de
l’aunage ordinaire, en aunant des étoffes , toiles &
autres marchandifes qui fe mefurent & fe vendent
à l’aune. On dit aufli bénéfice d'aunage & plus fou-
NVeAnGtE b. on d'aunage. Voye^ BÉNÉFICE & Bon d’au- Diclionn, de Commerce.
* EXCELLENT, adj. ( Gram. ) terme de compa-
raificm , tjui marque le dernier degré poffible de bonté
phylique ou morale. Il n’y a rien de mieux que ce
qui eft excellent. Il fe dit du tout ou d’une defes par-
îies ; de l’être entier ou de quelqu’une de fes qualités.
litéE oXuC tiEtrLeL dE’hNonCnEeu, rf q. uf’.o ÇnH diofin. nmeo adu. x)a mefbt aufnfaed qeutiars
l&ui àd ’da’lateuftfree s; ppearrfcoen qnues’i lqsu n’oen f onnet qpuaas lipfriein pcaess d, em caeis
qriueiu froens.t au deffus de toutes les autres dignités inféFdyei
Qualité.
En Angleterre & en France on ne donne ce titre
qu’aux ambaffadeurs mais il eft fort commun en
Allemagne & en Italie. Autrefois ce titre étoit ré-
fervé pour les princes du fang des différentes mai-
fons royales ; mais ils l’ont abandonné pour prendre
celui à'altefie, parce que plufieurs grands feigneurs
prenoient celui d?excellence. Voye{ Altesse.
Les ambaffadeurs ne font en poffeflion de ce titre
que depuis 1593, quand Henri IV. roi de France envo
y a le duc de Nevers en ambaffade auprès du pape,
oit il fut d’abord complimenté du titre d’excellence.
Dans la fuite on donna le même nom à tous les ambaffadeurs
réfidens dans cette cour, d’oîi cet ufage
s’eft répandu dans les autres, Ambassadeur.
Les ambaffadeurs de Venife ne joiiiffent de ce titre
que depuis 16 36, tems auquel l’empereur & le
roi d’Efpagne confentirent à le leur donner.' ■
Les ambaffadeurs des têtes couronnées ne veulent
point donner ce titre aux ambaffadeurs des princes
d’Italie, où cet ufage n’eft point établi*
La cour de Rome n’accorde jamais la qualité d’excellence
à aucun ambaffadeur quand il eft eccléfiaftique
, parce qu’elle la regarde comme un titre fécu-
lier. Les réglés ordinaires & l’ufage du mot excellence
ont varié un peu par rapport à la cour de Rome.
Autrefois les ambaffadeurs de France à Rome, donnoient
le titre d?excellence à toute la famille du pape ;
alors régnant, au connétable Colonne, au duc de
Bracciano, & aux fils aînés d e tous ces feigneurs,
de même qu’aux ducs Savelli, Gefarini, & c .. . .mais
à, préfent ils font plus réfervés à cet égard ; , cependant
ils traitent toûjours dû excellence toutes les prin-
ceffes romaines.
La cour de Rome de fon côté, & les princes ro-
Tomt VI%
Ë X C ai? ïnâins donnent ce même titre au chancelier, aux
miniftres & fécrétairesd’état, & aux préfidens des
cours fouveraines en France, aux préfidens des confiais
d’Efpagne, au chancelier de Portugal, & à
ceux qui rempliffent les premières places dans les au-,
très états , pourvu qu’fis ne foient point eccléfiaftii
ques.
Le mot excellence étoit autrefois lé titré que pôr-
toient les rois & les empereurs : c’eft pourquoi Anaf-
tafe le bibliothécaire appelle Charlemagne fon excellence.
On donne encore ce titré’au fénatde Venife -
où après avoir falué le doge fouslè titre deférénijfimc*
on qualifie les fénateurs de vos excellences.
Le liber diurnus pontif. rom. traite d?excellence les
exarques & les patriciens. Foye^ Titre.
Les François & les Italiens ont renchéri fur^la Ample
excellence, & en ont fait le mot excellentijfime &
excellentijjimo9 quia été donné par plufieurs papes ,
rois, &c. mais le mot excellentijfime n’eft plus d’u-
fage en France. Wiquefort & Chambers. (G)
EXCENTRICITÉ, f. f. ( Afironom. ) proprement
ell la diftance qui eft entre les centres de deux cercles
ou fpheres qui n’ont pas le même centre. Voyez Excentrique* Ce motn’eftguere ufité en ce fens.
^ Excentricité, dans l’ancienne Aftronomie , eft la
diftance qu’il y a entre le centre de l’orbite d’une
planete, & le corps autour duquel elle tourne. Voyez
P L A N E T E ;
Les aftronomesmodernes qui ont précédé Kepler^
à compter depuis Copernic, croyoient que les planètes
décrivoient autour du foleil non des ellipfes ,
mais des cercles, dont le foleil n’occupoit pas le cen- ■
tre* Il ne leur etoit pas venu en penfée d’imaginer
d autres courbes que des. cercles ; mais comme ils
avoient obfervé que le diamètre du foleil étoit tantôt
plus grand , tantôt plus petit, & que le foleil
etoit 7 à 8 jours de plus dans les lignes feptentribnaux.
que dans les méridionaux, ils en concluoient avec
raifon que le foleil n’occupoit pas le centre de l’or- j
bite terreftre, mais un point hors de ce centre, tel
que la terre étoit tantôt plus près, tantôt plus loin':
du foleil. Kepler v in t , & prouva que les planètes •
decnvoient fenfiblement autour du foleil des ellipfes
dont cet aftre occupoit le foyer. Foyer Ellipse ' Planete , Kepler , Système , &c.
, Excentricité , dans la nouvelle Aftronomie, eft la
diftance qui fe trouve entre le centre <7 de l’orbite
elliptique d’une planete ( PI. afiron.fig. & j e .
centre du foleil Y , c’eft-à-dire la diftance qui eft entre
le centre de l’ellipfe & fon foyer. On l’appelle
aufli excentricité fimple. ' : .
L excentricité double eft la diftance qu’il y a entré»
les dèuxfcïÿers de l’ellipfe; qui ell égale à deux fois
1 excentricité fimple, ou Y excentricité tout court» Voyez' Foyer & Ellipse , &c> _
Trouver l excentricité du foleil. Puifqué le plus grandi •
denii-diametre apparent du foleil eft au plus petit
comme 3’*•' eft à 3 V 48% ou comme 19.63^ à.
1898 ; la diftance la plus grande du foleil à la terré,
fera à la plus petite comme 1963 eft à 1898. Voyezr Apparent, Distance 6* Vision. Donc puifquè
P S S A — P A — 3861 ( Planche afironom.
fië- /k ) » le r®yon C P fera 1930 ; & par conféquent
■ SÇ— P C — P S — 31. Donc CP étant 100000*:
C S fera trouvée =1658*
Donc, Y excentricité du foleil ou de la terre S,C:
étant une petite partie du rayon CP, l’orbite ellipti-j
que de la terre ne doit pas s’éloigner beaucoup de
la forme circulaire» Ainfi il n’eft pas étonnant qu’un,
calcul fait fur le pié d’un cercle excentrique , ré**
ponde à-peu-près aux obfervations faites graffiere**
ment, comme elles Yétoïent avant la perfection deA
inftrumens aftronomiques. Cependant on s’appef-
çofi facilement quç les oblervations répondent beau*