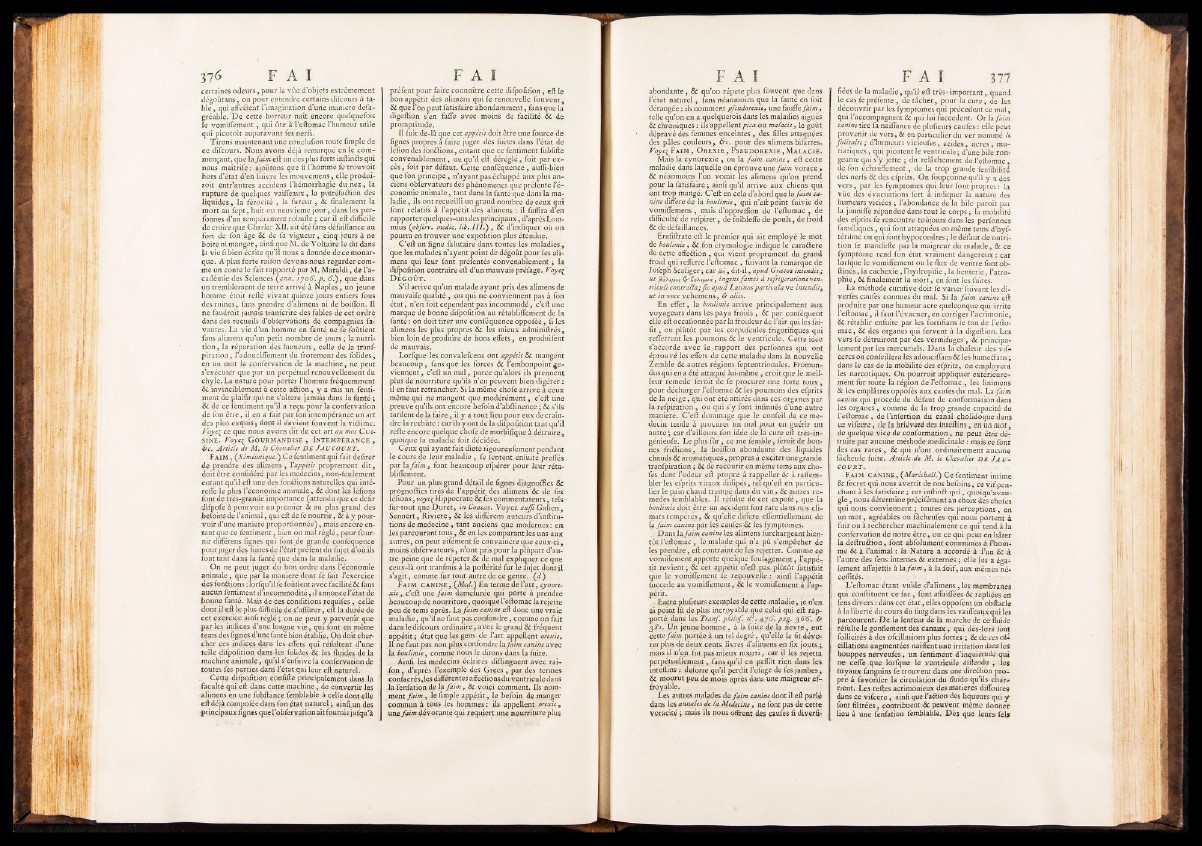
certaines od,eurs, pour la vue d’objets extrêmement
dégoûtans, ou pour entendre certains difcours à table
, qui affeûent l’imagination d’une maniéré defa-
gréable. De cette horreur naît encore quelquefois
le vomiffement, qui ôte à l’eftomac l’humeur utile
qui picotoit auparavant fes nerfs.
Tirons maintenant une conclufion toute fimpîe de
ce difcours. Nous avons déjà remarqué en le commençant,
que la faim, eft un des plus forts inftin&s qui
nous maîtrife : ajoutons que fi l’homme fe trouvoit
hors d’état d’en fuiyre les mouvemens, elle produi-
roit entr’autres acçidens l’hémorrhagie du nez, la
rupture de quelques vailfeaux, la putréfaôion des
liquides, la férocité , la fureur, & finalement la
njort au fept, huit ou neuvième jour, dans les personnes
d’un tempérament robufte ; car il eft difficile
de croire que Charler-XII. ait été fans défaillance au
fort de fon âge & de fa vigueur, cinq jours à ne
boire ni manger, ainfi que M. de Voltaire le dit dans
la v ie fi bien écrite qu’il nous a donnée de ce monarf
que. A plus forte raifon devons-nous regarder comme
un conte le fait rapporté par M. Maraldi, de l’académie
des Sciences (ann. lyoC. p. <?.), que dans
un tremblement de terre arrivé à Naples, un jeune
homme étoit relié vivant quinze joiurs entiers fous
des ruines, fans prendre d’alimens ni de boifton. 11
ne faudroit jamais tranfcrire des fables de cet ordre
dans des recueils d’oblervations de compagnies fa-
vantes. La vie d’un homme en fanté ne fe foûtient
fans alimens qu’un petit nombre de jours ; la nutrition
, la réparation des humeurs, celle de la tranf-
piration, l’adoucilTement du frotement des folides,
en un mot la çonfervation de la machine, ne peut
s’exécuter que par un perpétuel renouvellement du
chyle. La nature pour porter l’homme fréquemment
& invinciblement à cette aârion, y a mis un fenti-
ment de plaifir qui ne s’altère jamais dans ia fanté ;
& de ce fentiment qu’il a reçu pour la çonfervation
de fon être, il en a fait par fon intempérance un art
des plus exquis, dont il devient fouvent la viftime.
F o y e ^ ce que nous avons dit de cet art a u m o t C u i s
in e . Foyc{ G o u r m a n d is e , In t e m p é r a n c e ,
& c . A r t i c l e d e M. le C h e v a l i e r D E J A U C O U R T .
F a im , (Séméiotique.) Ce fentiment qui fait defirer
de prendre des alimens , l’appétit proprement dit,
doit être confidéré par les médecins, non-feulement
entant qu’il eft une des fondions naturelles qui inté-
reire le plus l’économie animale, & dont les léfions
font de très-grande importance (attendu que ce defir
.difpofe à pourvoir au premier & au plus grand des
befoins de l’animal, qui eft de fe nourrir, & à y pourvoir
d’une maniéré proportionnée), mais encore entant
que ce fentiment, bien pu mal réglé, peur fournir
différens lignes qui font de grande c.onféquence
pour juger des fuites de l’état prefent du fujet d’où ils
font tant dans la fanté que dans la maladie.
On ne peut juger du bon ordre dans l’économie
animale, que par la maniéré dont fe fait 1’exerci.ce
des fonctions : lorfqu’ii fe foûtient avec facilité 8ç fans
aucun fentiment d’incppimodité, il annonce l’état de
bonne fanté. Mais de ces conditions requifes , celle
dont il §ft le plus difficile de s’affûrer, elt la durée de
çe t exercice ainfi réglé ; on-ne peut y parvenir que
par les indices ff’une longue v ie , qui font en même
tems des fignes d’une fanté bien établie. On doit chercher
ces indices dans les effets qui résultent d’une
telle difpofition dans les. folides & les fluide de la
machine animale, qu’il s’enfuive la çonfervation de
toutes fes parties dans l’état qui leur eft naturel. .
6 Cette difppfiîipn çonfifte principalement dans la
faculté qui eft dans cette machine,. de. convertir les
alimens en une fubftance femblable à celle dont elle
eft déjà cpmpofée dans fon état naturel ainfiun des
principaux fignes que rpbferv.ationait fournis jufqu’à
préfent pour faire connoître cette difpofition, eft le
bon appétit des aliijiens qui fe renouvelle fouvent,
& que l’on peut fatisfaire abondamment, fans que la
digeftion s’en faffe avec moins de facilité 8c de
promptitude.
Il fuit de-là que cet appétit doit être une fource de
fignes propres à faire juger des fuites dans l’état de
léfion des fondions, entant que ce fentiment fubfifte
convenablement, ou qu’il eft déréglé, foit par excès
, foit par défaut. Cette conféquençe, auffi-bien
que fon principe, n’ayant pas échappé aux plus anciens
observateurs des phénomènes que préfente l’économie
animale, tant dans la fanté que dans la maladie
, ils ont recueilli un grand nombre de ceux qui
font relatifs à l’appétit des alimens : il fuffira d’en
rapporter quelques-uns des principaux, d’après Lom-
mius (obferv. medic. lib. ///,) , 8c d’indiquer où on
pourra en trouver une expofition plus étendue.
C ’eft un ligne falutaire dans toutes les maladies ,
que les malades n’ayent point de dégoût pour les alimens
qui leur font préfentés convenablement ; la
difpofition contraire eft d’un mauvais préfage. Foye^
D é g o û t .
S’il arrive qu’un malade ayant pris des alimens dp
mauvaife qualité , ou qui.ne conviennent pas à fon
état, n’en foit cependant pas incommodé, c’eft une
marque de bonne difpofition au rétabliffement de la
fanté : on doit tirer une conféquence oppofée, fi les
alimens les plus propres 8c les mieux adminiftrés,
bien loin de produire de bons effets, en produifent
de mauvais.
Lorfque les convaléfcens ont appétit & mangent
beaucoup, fans que les forces 8c l’embonpoint Reviennent
, c’eft un m al, parce qu’alors ils prennent
plus de nourriture qu’ils n’en peuvent bien digérer :
il en faut retrancher. Si la même chofe arrive à ceux
même qui ne mangent que modérément, c’eft une
preuve qu’ils ont encore befoin d’abftinence ; 8c s’ils
tardent de la faire, il y a tout lieu pour eux de craindre
la rechûte : car ils y ont de la difpofition tant qu’il
refte encore quelque chofe de morbifique à détruire ,
quoique la maladie foit décidée.
Ceux qui ayant fait diete rigoureufement pendant
le cours de leur maladie , fe fentent enfuite preffés
par la faim , font beaucoup efpérer pour leur rétabliffement.
Pour un plus grand détail de fignes diagnoffics &
prognoftics tirés de l’appétit des alimens 8c de fes
léfions, yoye{ Hippocrate 8c fes commentateurs, tels
fur-tout qne Duret, in Coacas. Voyez aufjî Galien ,
Sennert, Rivière, 8c les différens auteurs d’inftitu-
tioRsdemedecine, tant anciens que modernes: en
les parcourant tous, 8c en les comparant les uns aux
autres, on peut aifémentfe convaincre que ceux-ci,
moins obfervateurs, n’ont pris pour la plûpart d’autre
peine que de répéter.& de mal explique^ ce que
ceux-là ont tranfmis à la poftérité fiir le fujet dont jl
s’agit, comme fur tout autre de ç,e genre. (</)
Fa im c a n in e ,(.Med.) En terme de l’art, cynore-
x ie , c’eft une faim demefurée qui porte à prendre
beaucoup de nourriture, quoique l’eftomac la rejette
•peu de. tems après. La faim canine eft donc une vraie
maladie, qu’il ne faut pas confondre, comme on fajt
dans le difcours ordinaire, avec le grand & fréquent
appétit; état que les gens de l’art appellent orexie.
Jl ne faut pas non plus confondre la faim canine avec
U }oulimie, comme nous le dirons dans la fuite.
; Ainfi les médecins éclairés diffinguent avec rai-
.fon, d’après,l’exemple des Grçcs , par.des termes
con&crés,les différentes affections du ventricule dans
^ladénfationde la faim, & vofoi comment. Ils nomment
faim, le fimple appétit, le befoin démanger
commun à tous les hppimes : ils appellent orexie ,
une faim dévorantç qui requiert une nourriture plus
abondante, & qu’on répété plus fouvent que dans
l’état naturel, fans néanmoins que la fanté en foit
dérangée : ils nomment pfeudorexie, une fauffe faim,
telle qu’on en a quelquefois dans les maladies aiguës
8c chroniques : ils appellent pica ou malade, le goût
dépravé des femmes enceintes., des filles attaquées
des pâles couleurs , &c. pour des alimens bifarres»
Foyei F a im , O r e x ie , Ps e u d o r e x ie , Ma l a c i é .
Mais la. cynorexie , ou la faim canine , eft cette
maladie dans laquelle on éprouve une faim vorace ,
8c néanmoins l’on vomit les alimens qu’on prend
pour la fatisfaire ; ainfi qu’ii arrive aux chiens qui
ont trop mangé. C ’eft en cela d’abord que la faim canine
différé de la boulimie, qui n’eft point fuivie de
Vomjffemens , mais d’oppreffion de l’eftomac , de
difficulté de refpirer, de fbibleffe de pouls, de froid
ôc de défaillances.
Erafiftrate eft le premier qui ait employé le niôfc
de boulimie, 8c fon étymologie indique le cara&ere
de cette affeâion , qui vient proprement du grand
froid qui refferre l’euonaac , fuivànt la remarque de
Jofeph Scaliger ; car /3», dit-il, apud Grcecos intendit ;
ut livX/uoç & €ts*//xict, ingens famés à refrigerationeven-
triculi contracta,• fie apud Latinos partitula v e intendit,
ut in voce vehemens, & aliis.
En effet , la boulimie arrive principalement aux
Voyageurs dans les pays froids , & par conféquent
elle eft occafionnée par la froideur de l’air qui les fai-
f i t , ou plûtôt par les çorpufçules frigorifiques qui
refferrent les poumons & le ventricule. Cette idée
s’accorde avec le rapport des perfpnnes qui ont
éprouvé les effets de cette maladie dans la nouvelle
Zemble & autres régions feptentrionales. Fromun-
dus qui en a été attaqué lui-même, croit que le meilleur
remede feroit de fe procurer une forte toux,
pour décharger l’eftomac & les poumons des efprits
de la neige, qui ont été attiras fians ces organes par
la refpiratipn , ou qui s’y font infinités d’une autre
maniéré. C ’eft dommage que le confeil de ce médecin
tende à procurer un mal pour en guérir un
autrel, car d’ailleurs fon idée de la cure eft très-in-
génieufe. Le plus fu r , ce me femble, feroit de bonnes
friétipns, la boiffon abondante des liquides
chauds & aromatiques, propres à exciter une grande
tranfpiration.3 &c de recourir en même tems aux cho-.
fes dont l’odeur eft propre à rappeller & à rafl'em-
bler les efprits vitaux difiipés » tel qu’eft en particulier
le pain chaud trempé daps du v in , & autres re-
medes femblables. Il réfijlte de cet expofé, que la
boulimie d^it être un accident fprj fare dans .nos climats
tempérés, & qu’elle diffère efl’entiellement de
la faim canine par les caules :& les fymptomes.
.D a n s la faim canine les alimens furchargeant bientôt
l ’eftomac , le malade qui u’a pû s’empêcher ,de
les prendre, eft contraint de les rejerter. Conime c.e
vomiffement apporte quelque Ibulagetnent, l’appé-.
fit revient ; & cet appétit n’eft pas plûtôt fatisfait
que le vomiffement fe reçouvelle,: ainfi. l’appétit
fiiçcede au VQmiflenient, & le yonûffemeijt àTap-
p(é,tit.
. Eujr.e plufieurs exemples de,cette maladie , je n’en.
ai point lû de-plus incroyable que .celui qui eft rapporté
dans les Tranf. pkilof. n?,.-,4ÿ(î+ pag.
3#/. Un jeune homme, à la fuite d,e la fieyre, eut
cette faim portée à u n te l degré, qu’elle le fit dévorer
phis dé deux cents livres d’aîuue.ns en fix jours »
mais il n’en fut pas mieux nourri» car il les rej.etta
perpétueUepierd » fans qu’il en ;paffât rien dans. les.
inteftins ; deforte qu’il perdit l’ufage de fes jambes ,
& mourut peu d^ mois après dans, une maigreur ef-.
froyable.
Les autres malades de faim canine dont il eft parlé
dans les ^annales 4$ Içt Médecine , ne font pas de cette
voracité i mais ils nous offrent des caufes û diyerfifiées
de la maladie, qu’il eft très-important, quand
le cas fe préfente, de tâcher, pour la cure, de les
découvrir par les fymptomes qui precedent ce mal,
qui l’accompagnent &c qui lui fuccedent. Or la faim
canine tire fa naiffance de plufieurs caufes : elle peut
provenir de vers, & en particulier du ver nommé le
folitaire ; d’humeurs vicieufes, acides, acres . muriatiques
, qui picotent le ventricule ; d’une bile rongeante
qui s’y jette ; du relâchement de l’eftomac,
de fon échauffement, de la trop grande fenfibilité
des nerfs & des efprits. On foupçonne qu’il y a des
v e r s , par les fymptomes qui leur font propres : la
vûe des évacuations l’ert à indiquer la nature des
humeurs viciées ; l’abondance de la bile paroît par
la jauniffe répandue dans tout le corps ; la mobilité
des efprits fe rencontre toûjours dans les perfortnes
faméliques, qui font attaquées en même tems d’hyff.
térilme ou qui font hypocondres ; le défaut de nutrition
fe manifefte par la maigreur du malade, & ce
fymptome rend fon état vraiment dangereux : car
lorlque le vomiffement ou le flux de ventre font ob-
ftinés., la cachexie, i’hydropifie, la lienterie, l’atrophie,
8c finalement la mort, en font les fuites.
La méthode curative doit fe varier fuivant les di-
yerfes caufes connues du mal. Si la faim canine eft
produite par une humeur acre quelconque qui irrite
l’eftomac, il faut l’évacuer, en corriger l’acrimonie,
8c rétablir enfuite par les fortifians le ton de l’efto*
mac, 8c des organes qui fervent à la digeftion. Les
yers fe détruiront par des vermifuges , & principalement
par les mercuriels. Dans la chaleur des vif-
ceres on confeillera les adouciffans 8c les hume&ans ;
dans le cas de la mobilité des efprits, on employerâ
les narcotiques. On pourrait appliquer extérieurement
fur toute la région de l’eftomac , les linimens
& le$ emplâtres oppofés aux caufes du mal. La faim
canine qui procédé du défaut de conformation'dans
les organes comme de la trop grande capacité de
l’eftomac , de l’infertion du canal cholidoque dans
ce vifeere, de la brièveté des inteftins, en un mot,
de quelque vice de conformation, ne peut être détruite
par aucune méthode médicinale : mais ce font
des cas rares, & qui: n’ont ordinairement auc,une
fâcheufe fuite. Article Ae M. le Chevalier DE Ja u -
C O U R T . . ■ , .
F a im c a n i n e , (Maréchall.) Ce fentiment intime
& fecret qui nous avertit de nos befoins, ce v if penchant
à les fatisfaire ; cet inftinâ qui, quoiqu’aveu-
g le , nous détermine précifément au choix des chofes
qui nous conviennent ; toutes ces perceptions , en
un m ot, agréables ou fâcheufes qui nous portent à
fuir ou à rechercher machinalement ce qui tend à la
çonfervation dé notre être, ou ce qui peut en hâter
la deftruftion, font abfolurhent communes à; l’homme
8c à l’animal : la Nature a. accordé à l’un & à
l’autre des fens internes & externes ; elle les a également
affuj ettis à la faim , k iaffôif, aux mêmes në*
ceffités.
- L’eftomac étpnt vuidé d’alimens, les membranes
qui conftituent ce fa c , font affaiffées & repliées en
(eus divers : dans cet état, elles oppofent Un ôbiîacle
à la liberté du cours du faqg dans les vaiffeafixqui les
parcourent; D e la lenteur de la marche de- ce fluide
réfulte le gonjflement des caxiauxy ;qui dès-lors font
follicités à des ofcillarions plus fortes ; & de ces of^
dilations augmentées nàiffent une irritation dans les
houppes nerveufes, un fentiment d’inquiétude.qui
ne ceffe que lorfque le ventricule oiiffôndu , : les
tuyaux fanguins fe trouvent dans une direélion propre
à fàvorifer la circulation du fluide qu’ils- charrient.
Les telles acrimonieux des matières diflpiîte9
dans ce vilcere, ainfi que i’aélion des liqueurs qui y
font filtrées, contribuent & peuvent même donner
lieu à une fenfation femblable. Dès que leurs-lels