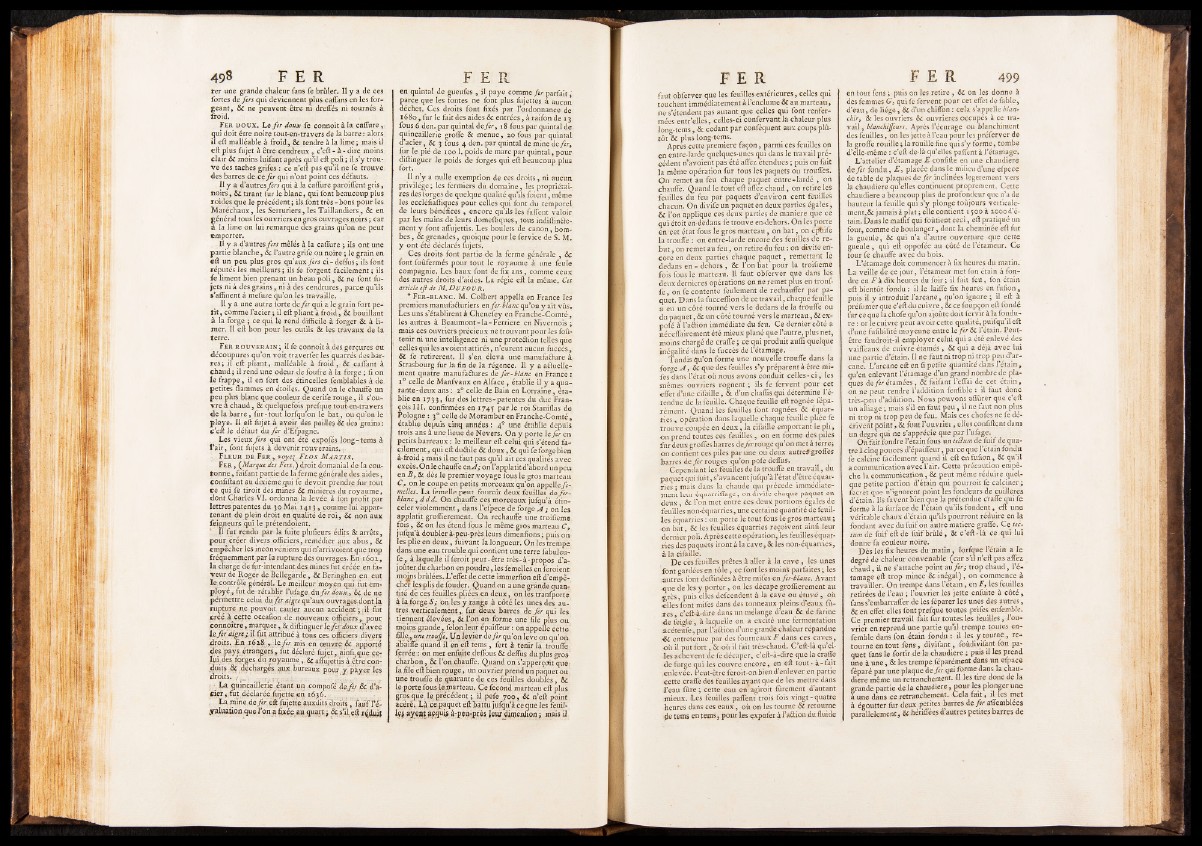
rer une grande chaleur fans fe brûler. Il y a de ces
fortes de fers qui deviennent plus caffans en les forgeant,
8c ne peuvent être ni drelfés ni tournés à
froid.
Fer d ou x . Le fer doux fe connoît à la caflure
qui doit être noire tout-en-travers de la barre : alors,
il eft malléable à froid, 8c tendre à la lime ; mais il
eft plus fujet à être cendreux, c’eft - à - dire moins.
clair 8c moins luifant après qu’il eft poli ; il s’y trouv
e des taches grifes : ce n’eft pas qu’il ne fe trouve
des barres de ce fer qui n’ont point ces défauts. ‘
Il y a. d’autres fe rs qui à la caflure paroiffent gris,
noirs, & tirant fur le blanc, qui font beaucoup plus
roides que le précédent; ils font très-bons pour les
Maréchaux, les Serruriers, les Taillandiers, & en
général tous les ouvriers en gros ouvrages noirs ; car
à la lime on lui remarque des grains qu’on ne peut
Emporter.
. Il y a d’autres fe rs mêlés à la caffufe ; ils ont une
partie blanche, 8c l’autre grife ou noire ; le grain en
e f t un peu plus gros qu’aux fe rs ci-deffus; ils font
réputés les meilleurs ; ils fe forgent facilement ; ils
fe liment bien prenant un beau poli, 8c ne font fujets
ni à des grains,; ni à des cendrures, parce qu’ils
s’affinent à mefure qu’on les travaille.
Il y a une autre forte de fe r qui a le grain fort petit
, comme l’acier ; il eft pliant à froid, f e bouillant
à la forge ; ce qui le rend difficile à forger & à limer.
Il eft bon pour les outils & les travaux de la
terre.
Fer ro u v e r a in ; il fe connoît à des gerçures ou
découpures qu’on voit traverfer les quarrés des barres;
il eft pliant, malléable à froid, & caftant à
chaud; il rend une odeur de foufre à la,forge ; fi on
le frappe , il en fort des étincelles femblables à de,
petites flammes en étoiles. Quand on le chauffe un
peu plus blanc que couleur de cerife rouge, il s’ouvre
à chaud, & quelquefois prefque tout-en-travers
«le la barre, fur-tout lorfqu’on le b a t, ou qu’on le
ployé. Il eft fujet à avoir des pailles 8c des grains :
ç ’eu le défaut du fer d’Efpagne.
. Les vieux fers qui ont. été expofés long-tems à
l ’air, font fujets à devenir rouverains. -
- Fleur de Fer , voye^ JFl o s M a r t i s .
Fe r , (Marque des F ers.) droit domanial de la couronne
, faifant partie de la ferme générale des aides,
confiftant au dixième,,qui fe devoit prendre fur tout
c e qui fe tirojt des mines fe minières du royaume,
dont Charles VI. ordonna la levée à fon profit par
lettres patentes du 30 Mai 1413 , comme lui appartenant
de plein droit en qualité de ro i, 8c non aux
feigneurs qui le prétendoient.
II fut rendu par la fuite plufieurs édits &.arrêts,
pour créer divers officiers, remédier aux abus, 8c
empêcher les inconvéniens qui n’arriyoient que trop
fréquemment par la rupture des ouvrages. Èn,1602,
la charge de fur-intendant des mines fut créée en faveur
de Roger de Bellegarde, & Beringhen en eut
le. contrôle général. Le meilleur moyen qui fut emp
lo y é , fut de rétablir l’ufage du fer douxf fe de ne
permettre celui du fer. aigre qu’aux ouyrages.dont la
rujpturq pouvpit caufer aucun accident £, il fut
jcree à^cette occafîon de nouveaux offiçiers,, pour
connoitre, marquer, & diftinguer îefefdoux d’avec
Xe fer aigre ; il fut attribué à tous ces. officiers divers
droits. .En .1628^^ de/cr mis en oeuyrp,,& apporté
des/pays. étrangers * fut déclaré fujet, . ainfu que ,cé-
Iui,des forces du royaume ,, & affujettis â,être conduits
& .décharges aux. bureaux pofir y"pâY,ér les
droits. ( rVi*T f.
| ; L a q u in c a i lle r ie ,é ta n t u q .c om p o fé d e ^ r jSc*d’a c
i e r , fu t d é c la r é e , 1 6 3 6 . . ,t >
La. mine,de.fi/: eft fûjétte àuxdits droits , faû fl’évaluation
que l’on a fixée au quart; fe s’il, eft réduit
en quintal de gueufes , il paye comme fer parfait, j parce que les fontes ne font plus fujettes à aucun
déchet. Ces droits font fixés par l’ordonnance de
1680, fur le fait des aides 8c entrées, à raifon de 13
fous 6 den. par quintal de fer, 18 fous par quintal de
quincaillerie erofle & menue, 20 fous par quintal
d’acier, & 3 lous 4 den. par quintal de mine de fer,
fur le pié de 100 1. poids de marc par quintal, pour
diftinguer le poids de forges qui eft beaucoup plus
, fort.
Il n’y a nulle exemption de ces droits, ni aucun
privilège; les fermiers du domaine, les propriétaires
des forges de quelque qualité qu’ils foient, même
les eccléfiaftiques pour celles qui font du temporel
de leurs bénéfices , encore qu’ils les faffent valoir
par les mains de leurs domeftiques, tous indiftin&e-
ment y font afîujettis. Les boulets de canon, bombes
, fe grenades, quoique pour le fervice de S. M.
y ont été déclarés fujets.
Ces droits font partie de la ferme générale , 8c
font foûfermés pour tout le royaume à une feule
compagnie. Les baux font de fix ans, comme ceux
des autres droits d’aides. La régie eft la même. Cet
article ejl de M. DuFOVR.
* Fer- b l a n c . M. Colbert appella en France les
premiers manufacturiers en fer-blanc qu’oa y ait vus.
Les uns s’établirent à Chenefey en Franche-Comté,
les autres à Beaumont-la-Ferriere en Nivernois ;
mais ces ouvriers précieux ne trouvant pour les fou-
tenir ni une intelligence ni une proteâion telles que
celles qui les avoient attirés, n’eurent aucun fuccès ,
& fe retirèrent. Il s’en éleva une manufacture à
Strasbourg fur la fin de la régence. Il y a actuellement
quatre manufactures de fer-blanc en France:
i ° celle de Manfvaux en Alface , établie il y a quarante
deux ans : 20 celle de Bain en Lorraine, établie
en 1733, fur des lettres-patentes du duc François
I II. confirmées en 1745 parle roi Staniflas dé
Pologne : 30 celle de Moramber en Franche-Comté,
établie depuis cinq années : 40 une établie depuis
trois ans à une lieue de Nevers. On y porte le fer en
petits barreaux : le meilleur eft celui qui s’étend facilement
, qui eft duCtile & doux, & qui fe forge bien
à-froid ; mais il nefaut pas qu’il ait ces qualités avec
excès.On le chauffe en^; on i’applatit d’abord un peu-
en B , & dès le premier voyage fous le gros marteau
C » on le coupe en petits morceaux qu’on appelle fe melles.
La femelle peut fournir deux feuilles de fer-
blanc , ddd. On chauffe ces morceaux jufqu’à étinceler
violemment, dans l’efpece de forge A ; on les
applatit groflierement. On rechauffe une troifieme
fois ; & on les étend fous le. même gros marteau C,
jufqu’à dpubler à-peu-près leurs dimenfions; puis on
les pÛe en deux, luivant la longueur. On les trempe
dans une eau trçuble qui contient une terre fabuleu-
f e . à.laquelle il feroit peut-être très-à-propos d’ajouter
du charbpn en poudre, les femelles en feroient
mornshmlées.-L’effet de.cette immerfion eft d’empêcher
les plis de fouder. Quand on a une grande quan?
tjté de ces feuilles pliées en deux, on les tranfporte
à la forge S ; on les y .range à côté les unes des autres,
verticalement,. fur deux barres de fer qui les
tiennent élevées, & l ’on en forme une file plus ou
moins grande, félon leur épaiffeur : on appelle cette
fille.,.«/:« troujfe. Un levier de fer qu’on leve ou qu’on
àbaiffe quand il en eft tems , fert à tenir la trouflç
ferrée : on met enfuite deffous 8c deffus du plus gros"
charbon, 8c l ’on,chauffe. Quand on s’apperçoit quer
la file eft bien rpuge j un ouvrier prend un paquet ou
linefrouffe de quarante de ces feuilles doubles, 8c
le porte fous ,1e marteau. Ce fécond marteau eft plus
gros que, le, précédent ; il pefe 700 , & n’eft point
açér,ë. Là ce.paquet eft battu jufqu’à ce que les feuil-
l^f ayent à-pçu,-près Jeur^jinenfion ; mais il
faut obferver que les feuilles extérieures, celles qui
couchent immédiatement à 1 enclume 8c au marteau,
ne s’étendent pas autant que celles qui font renfermées
entr’elles, celles-ci confervant la chaleur plus
long-tems, & cedant par conféquent aux coups plu- '
tôt 8c plus long-tems.
Après cette première façon, parmi ces feuilles on
en entre-larde quelques-unes qui dans le travail précédent
n’avoient pas été affez étendues ; puis on fait
la même opération fur tous les paquets ou trouffes.
On remet au feu chaque paquet entre •?lardé , on
chauffe. Quand le tout eft affez chaud, on retire Iei
feuilles du feu par paquets d’environ cent feuilles
chacun. On divife un paquet en deux parties égales,
& l’on applique ces deux parties de maniéré que ce
qui étoit en-dédans fe trouve en-dehors. On les porte
en cet état fous le gros marteau, on b a t , on éjrtiifè
la trouffe : on entre-larde encore des feuilles de rebut
, on remet au feu, on retire du feu : on divife encore
en deux parties chaque paquet, remettant le
dedans en - dehors , & l’on bat pour la troifieme
fois fous le marteau. Il faut obferver que dans les
deux dernieres opérations on ne remet plus en trouffe
, on fe contente feulement de rechauffer par paquet.
Dans la fucceflion de ce travail, chaque feuille
a eu un côté tourné vers le dedans de la trouffe ou
du paquet, 8c un côté tourné vers le marteau, 8c ex-
pofé à l’aâion immédiate du feu. Ce dernier côté a
néceffairement été mieux plané que l’autre, plus net,
moins chargé de craffe ; ce qui produit auffi quelque
inégalité dans le fuccès de l’étamage.
Tandis qu’on forme une nouvelle trouffe dans là
forge A , 8c que des feuilles s’y préparent à être mi-
fes dans l’état où nous avons conduit celles - c i , les
mêmes ouvriers rognent ; ils fe fervent pour cet
effet d’une cifaille, & d’un çhaflis qui détermine l’étendue
de la feuille. Chaque feuille eft rognée fépa-
rément. Quand les feuilles font rognées 8c équar-
ries, opération dans laquelle chaque feuille pliée fe
trouve coupée en deux, la cifaille emportant le pli,
on prend toutes ces feuilles, on en forme des piles
fur deux groffes barres de fer rouge qu’on met à terre;
on contient ces piles par une ou deux autre# groffes
barres de fer rouges qu’on pofe deffus.
Cependant les feuilles de la trouffe en travail, du
paquet qui fuit, s’avancent jufqu’à l’état d’être équarries
; mais dans la chaude qui précédé immédiatement
leur équarriffage, on divife chaque paquet en
deux, 8c l’on met entre ces deux portions égales de
feuilles non-équarries, une certaine quantité de feuilles
équarries : on porte le tout fous le gros marteau ;
on bat, 8c les feuilles équarries reçoivent ainfi leur
dernier poli. Après cette opération, les feuilles équarries
des paquets iront à la cave, & les non-équarries,
à la cifaille.
De ces feuilles prêtes à aller à la cave , les unes
font gardées en tô le , ce font les moins parfaites ; les
.autres font deftinées à être mifes enfer-blanc. Avant
que de les y porter, on les décape groflierement au
grès, puis elles defeendent à la cave ou étuv.e', où
«lies font mifes dans des tonneaux pleins d’eaux fuie
s , c’.eft-à-dire dans un mélange d’eau & de farine
de feigle, à laquelle on a excité une fermentation
^céteufe, par l’a&ion d’une grande chaleur répandue
& entretenue par des fourneaux F dans ces caves,
où il put fo r t , & où il fait très-chaud. C ’eft-là qu’elles
achèvent de fe décaper, c’eft-à-dire que la craffe
de forge qui les couvre encore, en eft tout - à - fait
,enlevee. Peut-être feroit-on bien d’enlever en partie
cette craffe des feuilles a^ant que de les mettre dans
l ’eau fûre ; cette eau en agiroit (virement d’autant
mieux. Les feuilles paffent trois fois vingt - quatre
heures dans ces eaux, où on les tourne 8c retourne
de tems en tems, pour les çxpofer à l’attiondu fluide
en tout fens ; puis on les retire , & on les donne à
des femmes G, qui fe fervent pour cet effet de fable,
d’eau, de liège, 8c d’un chiffon : cela s’appelle blanchir,
& les ouvriers 8c ouvrières occupés à ce travail
, blanchiffeurs. Après l’écurage ou blanchiment
des feuilles, on les jette à l’eau pour les préferver de
la groffe rouille ; la rouille fine qui s’y forme, tombe
d’eUe-même : c’eft de-là qu’elles paffent à l’étamage»
L’attelier d’étamage E confifte en une chaudière
de fer fondu, E , placée dans le milieu d’une efpece
de table de plaques de fer inclinées legerement vers
la chaudière qu’elles continuent proprement. Cette
chaudière a beaucoup plus de profondeur que n’a de
hauteur la feuille qui s’y plonge toujours verticalement,&
jamais à plat ; elle contient 1500 à 2000 d’étain.
Dans le maflif qui foûtient ceci, eft pratiqué un
four, comme de boulanger, dont la cheminée eft fur
la gueule, 8c qui n’a d’autre ouverture que cette
gueule , qui eft oppofée au côté de l’étameur. Ce
four fe chauffe avec du bpis.
L’étamage doit commencer à fix heures du matin.
La veille de ce jour, l’étameur met fon étain à fondre
en F à dix heures du foir ; il fait feu , fon étain
eft bientôt fondu : il.le laiffe fix heures en fufion ,
puis il y introduit l’arçane, qu’on ignore ; il eft à
préfumer que c’eft du cuivre, 8c ce foupçon eft fondé
fur ce que la chofe qu’on ajoute doit fervir à la foudu-
re : or le cuivre peut avoir cette qualité, çuifqu’il eft
d’une fufibilité moyenne entre 1 e fer 8c l’étain. Peut-
être faudroit-il employer celui qui a été enlevé des
vaiffeaux de cuivre étamés , & qui a déjà avec lui
une partie d’étain. Il ne faut ni trop ni trop peu d’ar-
cane. L’arcane eft en fi petite quantité dans l’étain,
qu’en enlevant l’étamage d’un grand nombre de plaques
de fer étamées, & faifant l’effai de cet etain,
on ne peut rendre l’addition fenfible : il faut donc
très-peu d’addition. Nous pouvons affûrer que c’eft
un alliage ; mais s’il en faut peu, il ne faut non plus
ni trop ni trop peu de feu. Mais ces chofes ne fe décrivent
point, 8c font l’ouvrier ; elles confident dans
un degré qui ne s’apprécie que par l ’ufage.
On fait fondre l’étain fous un eeclum de fuif de quatre
à cinq pouces d’épaiffeur, parce que l’étain fondu
fe calcine facilement quand il eft en fufion, 8c qu’il
a communication avec l’air. Cette précaution empêche
la communication, 8c peut même réduire quelque
petite portion d’étain qui pourroit fe calciner ;
fecret que n’ignorent point les fondeurs de cuillères
d’étain. Ils favent bien que la prétendue craffe qui fe
forme à la furface de l’étain qu’ils fondent, eft une
véritable chaux.d’étain qu’ ils pourront réduire en la
fondant avec du fuif ou autre matière grade. Ce tectum
de fuif eft de fuif brûlé, & c ’eft-là ce qui lui
donne fa couleur noire.
Dès les fix heures du matin, lorfque l’étain a le
degré de chaleur convenable (car s’il n’eft pas affez
chaud, il ne s’ attache point au feri trop chaud, l’étamage
eft trop mince 8c inégal), on commence à
travailler. On trempe dans l’étain, en F , les feuilles
retirées de l’eau ; l’ouvrier les jette enfuite à côté ,
fanss’embarraffer de les féparer les unes des autres,
8c en effet elles font prefque toutes prifes enfemble.
Ce premier travail fait fur toutes les feuilles, .l’ouvrier
en reprend une partie qu’il trempe toutes enfemble.
dans fon étain fondu : il les y tourne , retourne
en tout fens, divifant, foûdiyifant fon paquet
fans le fortir de la chaudière ; puis il les prend
une à une, & les trempe féparément dans un efpace
féparé par une plaque de fer qui forme dans la chaudière
même un retranchement. Il les tire donc de la
grande partie de la chaudière, pour les plonger une
à une dans ce retranchement. Cela fa it , il les met
à égoutter fur deux petites barres de fer affemblées
parallèlement, fe hériffées d’autres petites barres de