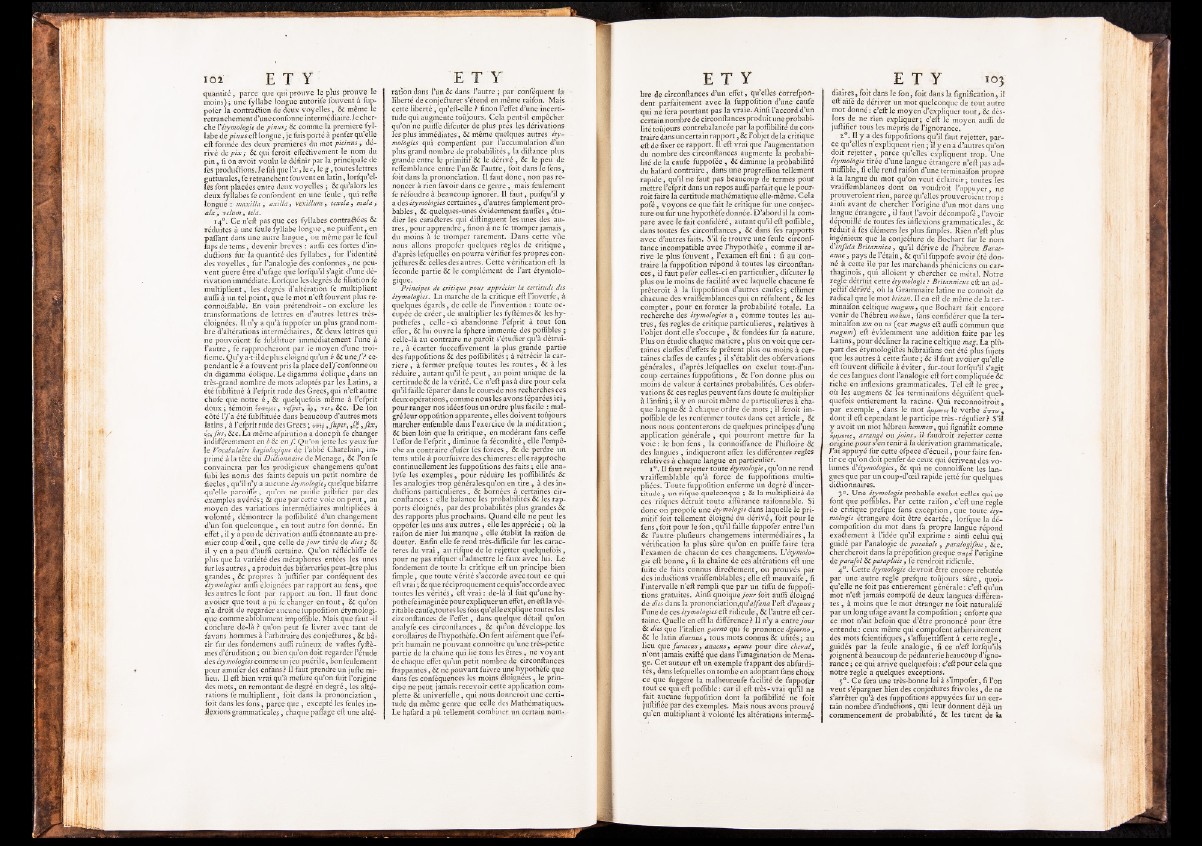
quantité, parce que qui prouve le plus prouve le
moins) ; une fyllabe longue autorife fouvent à fuppofer
la contraction de deux voyelles, & même le
retranchement d’une confonne intermédiaire Je cherche
l'étymologie de pinus; & comme la première fyllabe
de pinus eft longue, je fuis porté à penfer qii’elle
eft formée des deux premières du mot picinus, dérivé
de p ix ; & qui feroit effectivement le nom du
pin, fi on avoit voulu le définir par la principale de
les productions. Je fai que l*x , le c , 1e g , toutes lettres
gutturales, fe retranchent fouvent en latin, lorfqu’el-
les font placées entre deux voyelles ; & qu’alors les
deux fyllabes fe confondent en une feule , qui refte
longue : maxilla , axilla, vexillum , texela , mata ,
ata , vélum, tela.
140. Ge n’eft pas que ces fyllabes contractées &
réduites à une feule lyllabe longue, ne puiffent, en
pàffant dans une autre langue, ou même par le feul
laps de tems, devenir brèves : aufll ces fortes d’in-
duétions fur la quantité des fyllabes, fur l’identité
des voyelles, fur l’analogie des confonnes, ne peuvent
guere être d’ufage que lorfqu’il s’agit d’une dérivation
immédiate. Lorlque les degrés de filiation fe
multiplient, les degrés d’altération fe multiplient
aufli à un tel point, que le mot n’eft fouvent plus re-
connoiffable. En vain prétendroit - on exclure les
transformations de lettres en d’autres lettres très-
éloignées. Il n’y a qu’à fuppofer un plus grand nombre
d’altérations intermédiaires, & deux lettres qui
ne pouvoient fe fubftituer immédiatement l’une à
l’autre, fe rapprocheront par le moyen d’une troi-
fieme. Qu’y a-t-il déplus éloigné qu’un b & une f ? cependant
le b a fouvent pris la place de Vf confonne ou
du digamma éolique. Le digamma éolique, dans un
très-grand nombre de mots adoptés par les Latins, a
été fubftitué à l’efprit rude des Grecs, qui n’eft autre
chofe que notre h , & quelquefois même à l’efprit
doux; témoin «Wêpoç, vefper, «p, ver, &c. De fon
côté Vf a été fubftituée dans beaucoup d’autres mots
latins, à l’efprit rude des Grecs ; wnp ,fuper, 9î% ,fe x ,
vç9fiisy &c. La même afpiration a donc pu fe changer
indifféremment en b 6c e n f Qu’on jette les yeux fur
Je Vocabulaire hagiologique de l’abbé Châtelain, imprimé
à la tête du Dictionnaire de Ménagé, & l’on fe
convaincra par les prodigieux changemens qu’ont
fubi les noms des faints depuis un petit nombre de
fiecles, qu’il n’y a aucune étymologie, quelque bifarre
qu’elle paroiffe, qu’on ne puifle juftifier par des
exemples avérés ; & que par cette voie on peut, au
moyen des variations intermédiaires multipliées à
volonté, démontrer la poflibilité d’un changement
d’un fon quelconque, en tout autre fon donné. En
effet, il y a peu de dérivation aufli étonnante au premier
coup d’oe il, que celle de jour tirée de dits; &&
il y en a peu d’aufli certaine. Qu’on réfléchiffe de
plus que la variété des métaphores entées les unes
fur les autres, a produit des bifarreries peut-être plus
grandes, & propres à juftifier par conféquent des
étymologies aufli éloignées par rapport au lens, que
les autres le font par rapport au fon. Il faut donc
avoiier que tout a pû fe changer en tou t, & qu’on
n’a droit de regarder aucune iuppofition étymologique
comme abfolument impofîibie. Mais que faut -il
conclure de-là ? qu’on peut fe livrer avec tant de
favans hommes à l’arbitraire des conjectures, & bâtir
fur des fondemens aufli ruineux de vaftesfyftè-
mes d’érudition ; ou bien qu’on doit regarder l’etude
des étymologies comme un jeu puérile, bon feulement
pour amufer des enfans ? Il faut prendre un jufte milieu.
Il eft bien vrai qu’à mefure qu’on fuit l’origine
des mots, en remontant de degré, en degré, les altérations
fe multiplient, foit dans la prononciation ,
foit dans les fons, parce que , excepté les feules inflexions
grammaticales, chaque pafl’age eft une altération
dans l’un & dans l’autre; par confequent la
liberté de conjeCturer s’étend en même raifon. Mais
cette liberté, qu’eft-elle ? linon l’effet d’une incertitude
qui augmente toujours. Cela peut-il empêcher
qu’on ne puifle difcuter de plus près les dérivations
les plus immédiates, & même quelques autres étymologies
qui compenfent par l’accumulation d’un
plus grand nombre de probabilités, la diftance plus
grande entre le primitif & le dérivé , & le peu de
reflemblance entre l’u n& l’autre, foit dans le fens,
foit dans la prononciation. Il faut donc, non pas renoncer
à rien favoir dans ce genre, mais feulement
fe réfoudre à beaucoup ignorer. Il faut, puifqu’il y
a des étymologies certaines, d’autres Amplement probables
, & quelques-unes évidemment faillies, étudier
les caraCteres qui diftinguent les unes des autres
, pour apprendre, flnon à ne fe tromper jamais ,
du moins à le tromper rarement. Dans cette vue
nous allons propofer quelques réglés de critique,
d’après lefquelles on pourra vérifier fes propres conjectures
& celles des autres. Cette vérification eft la
fécondé partie & le complément de l’art étymologique.
Principes de critique pour apprécier la certitude des
étymologies. La marche de la critique eft l’inverfe, à
quelques égards, de celle de l’invention : toute occupée
de créer, de multiplier les fyftèmes & les hy-
pothefes , ce lle-ci abandonne l’efprit à tout fon
efior, & lui ouvre la fphere immenfè des poflibles ;
celle-là au contraire ne paroît s’étudier qu’à détruire
, à écarter fucceflivement la plus grande partie
des fuppofitions & des poflibilités ; à rétrécir la carrière
, à fermer prefque toutes les routes, & à les
réduire, autant qu’il le peut, au point unique de la
certitude & de la vérité. C e n’eft pas à dire pour cela
qu’il faille féparer dans le cours de nos recherches ces
deux opérations, comme nous les avons féparées ic i,
pour ranger nos idées fous un ordre plus facile : malgré
leur oppofition apparente, elles doivent toujours
marcher enfemble dans l’exercice de la méditation ;
& bien loin que la critique, en modérant fans celle
l ’eflor de l’efprit, diminue fa fécondité, elle l’empêche
au contraire d’ufer fes forces , &c de perdre un
tems utile à pourfuivre des chimères : elle rapproche
continuellement les fuppofitions des faits ; elle ana-
lyfe les exemples, pour réduire les poflibilités &
les analogies trop générales qu’on en tire , à des in-
duCtions particulières , & bornées à certaines circonftances
: elle balance les probabilités &c les rapports
éloignés, par des probabilités plus grandes &
des rapports plus prochains. Quand elle ne peut les
oppofer les uns aux autres, elle les apprécie ; oii la
raifon de nier lui manque , elle établit la raifon de
douter. Enfin elle fe rend très-difficile fur les caractères
du v r a i, au rifque de le rejetter quelquefois,
pour ne pas rifquer d’admettre le faux avec lui. Le
fondement de toute la critique eft un principe bien
fimple, que toute vérité s’accorde avec tout ce qui
eft vrai ; & que réciproquement ce quis’accorde avec
toutes les vérités, eft vrai : de-là il fuit qu’une hy-
pothefe imaginée pour expliquer un effet, en eft la v é ritable
caufe,toutes les fois qu’elle explique toutes les
circonftances de l’effet, dans quelque détail qu’on
analyfe ces circonftances, & qu'on développe .les
corollaires de l’hypothèfe. On fent aifément que l’efprit
humain ne pouvant connoître qu’une très-petite
partie de la chaîne qui lie tous les êtres , ne voyant
de chaque effet qu’un petit nombre de circonftances
frappantes, & ne pouvant fuivre une hypothèfe que
dans fes conféquences les moins éloignées, le principe
ne peut jamais recevoir cette application com-
plette & univerfelle, qui nous donneroit une certitude
du même genre que celle des Mathématiques.
Le hafard a pu tellement combiner, un certain nonu.
bre de circonftances d’un effet, qu’elles eôfrefport-
dent parfaitement avec la fuppofition d’une caufe
qui ne fera pourtant pas la vraie. Ainfi l’accord d’un
certain nombre de circonftances produit une probabilité
toûjours contrebalancée par la poflibilité du contraire
dans un certain rapport, & l’objet de la critique
eft de fixer ce rapport. Il eft vrai que l’augmentation
du nombre des circonftances augmente la probabilité
de la caufe fuppofée, & diminue la probabilité
du hafard contraire, dans une progreflion tellement
rapide, qu’il ne faut pas beaucoup de termes pouf
mettre l’efprit dans un repos aufli parfait que le pour-
roit faire la certitude mathématique elle-même. Cela
pofé, voyons ce que fait le critique fur une conjecture
ou fur une hypothèfe donnée. D ’abord il la compare
avec le fait confidéré, autant qu’il eft poflible,
dans toutes fes circonftances, & dans fes rapports
avec d’autres faits. S’il fe trouve une feule circonf-
tance incompatible avec l’hypothèfe, comme il arrive
le plus fouvent, l’examen eft fini : fi au contraire
la fuppofition répond à toutes les circonftances
, il faut pefer celles-ci en particulier, difcuter le
plus ou le moins de facilité avec laquelle chacune fe
prêteroit à la fuppofition d’autres caufes ; eftimer
chacune des vraifl'emblances qui en réfultent, & les
compter, pour en former la probabilité totale. La
recherche des étymologies a , comme toutes les autres
, fes regles de critique particulières, relatives à
l’objet dont elle s’occupe, & fondées fur fa nature.
Plus on étudie chaque matière, plus on voit que certaines
claffes d’effets fe prêtent plus ou moins à certaines
clafles de caufes ; il s’établit des obfervations
générales, d’après .lefquelles on exclut tout-d’un-
coup certaines fuppofitions, & l’on donne plus ou
moins de valeur à certaines probabilités. Ces obfervations
& ces réglés peuvent fans doute fe multiplier
à l’infini ; il y en auroit même de particulières à chaque
langue & à chaque ordre de mots ; il feroit im-
poflible de les renfermer toutes dans cet article, &
nous nous contenterons de quelques principes d’une
application générale, qui pourront mettre fur la
voie : le bon fens , la connoiflance de l’hiftoire &
des langues , indiqueront allez les différentes réglés
relatives à chaque langue en particulier.
i ° . Il faut rejetter toute étymologie, en?on ne rend
vraiffemblable qu’à force de fuppofitions multipliées.
Toute fuppofition enferme un degré d’incertitude
, un rifque quelconque ; & la multiplicité de
ces rifques détruit toute aflïirance raifonnable. Si
donc on propofe une étymologie dans laquelle le primitif
foit tellement éloigné du dérivé, foit pour le
fens, foit pour le fon, qu’il faille fuppofer entre l’un
& l’autre plufieurs changemens intermédiaires, la
vérification la plus sûre qu’on en puifle faire fera
l’examen de chacun de ces changemens. L'étymologie
eft bonne, fi la chaîne de ces altérations eft une
liiite de faits connus directement, ou prouvés par
des induftions vraiflemblables ; elle eft mauvaife, fi
l’intervalle n’eft rempli que par un tiflii de fuppofitions
gratuites. Ainfi quoique jour foit aufli éloigné
de dies dans la prononciation,eptalfana l’eft â’equus;
l ’une de ces étymologies eft ridicule, & l’autre eft certaine.
Quelle en eft la différence? Il n’y a entre jour
& dies que l’italien giorno qui fe prononce dgiorno ,
& le latin diurnus , tous mots connus & ufités ; au
lieu que fanacus , anacus, aquus pour dire cheval,
n’ont jamais exifté que dans l’imagination de Ménagé.
Cet auteur eft un exemple frappant des abfiirdi-
tés, dans lefquelles on tombe en adoptant fans choix
ce que fuggere la malheureufe facilité de fuppofer
tout ce qui eft poflible : car il eft très-vrai qu’il ne
fait aucune fuppofition dont la poflibilité ne foit
juftifiée par des exemples. Mais nous avons prouvé
qu’en multipliant à volonté les altérations intermédiaïres,
fbït dans le fon, foit dans la lignification* il
eft aifé de dériver un mot quelconque de tout autre
mot donné : c’eft le m oyen d’expliquer tout, & dès-
lors de ne rien expliquer; c’en: le moyen aufli de
juftifier tous les mépris de l’ignOrànce.
i ° . II y a des fuppofitions qu’il faut rejetter, parce
qu’elles n expliquent rien ; il y en â d’autres qu’on
doit rejetter, parce qu’elles expliquent trop. Une
étymologie tirée d’une langue étrangère n’eft pas ad-
miflible, fi elle rend raifon d’une terminaifon propre
à la langue du mot qu’on veut éclaircir ; toutes les
vraifl'emblances dont on voudrait l’appuyer, ne
prouveroient rien, parce qu’elles prouveroient trop :
ainfi avant de chercher l’Origine d’un mot dans une
langue étrangère, il faut l’avoir décompofé, l’avoir
dépouillé de toutes fes inflexions grammaticales, &c
réduit à fes élémens les plus Amples. Rien n’eft plus
ingénieux que la conjecture de Bochart fur le nom
d’infula Britannica , qu’il dérive de l’hébreu Barat-
anae , pays de l’étain, & qu’il fuppofe avoir été donné
à cette île par les marchands phéniciens ou carthaginois,
qui alloient y chercher ce métal. Notre
réglé détrüit cette étymologie : Britannicus eft un ad-
jeCtif dérivé, oii la Grammaire latine ne connoît de
radical que le mot britan. Il en eft de même de la terminaifon
celtique magum, que Bochart fait encore
venir de l’hébreu mohun, fans confidérer que la terminaifon
um ou us (car magus eft aufli commun que
magum) eft évidemment une addition faite par les
Latins, pour décliner la racine celtique mag. La plupart
des étymologiftës hébraïfans ont été plus fujets
que les autres à cette faute ; & il faut avoiier qu’elle
eft fouvent difficile à éviter, fur-tout lorfqu’il s’agit
de ces langues dont l’analogie eft fort compliquée &
riche en inflexions grammaticales. Tel eft le grec ,
oii les augmens & les terminaifons déguifent quelquefois
entièrement la racine. Qui reconnoîtroit,
par exemple , dans le mot npqMvoç le verbe «Vra ,
dont il eft cependant le participe très-régulier? S’il
y avoit un mot hébreu hemmen, qui figninât comme
n/A/xtvcc, arrangé ou joint, il faudroit rejetter cette
origine pour s’en tenir à la dérivation grammaticale.
J’ai appuyé fur cette efpece d’écueil, pour faire fen-
tir ce qu’on doit penfer de ceux qui écrivent des volumes
6!étymologies, & qui ne connoiflent les langues
que par un coup-d’oeil rapide jetté fur quelques
di&ionnaires.
30. Une étymologie probable exclut celles qui ne
font que poflibles. Par cette raifon, c’eft une réglé
de critique prefque fans exception, que toute étymologie
étrangère doit être écartée, lorfque la dé-
compofition du mot dans fa propre langue répond
exactement à l’idée qu’il exprime : ainfi celui qui
guidé par l’analogie de parabole , paralogjfme, &c.
chercherait dans la prépofitiongreque Trapà l’origine
de parafai & parapluie, fe rendrait ridicule.
40. Cette étymologie devrait être encore rebutée
par une autre réglé prefque toûjours sûre, quoiqu’elle
ne foit pas entièrement générale : c’eft qu’un
mot n’eft jamais compofé de deux langues*differentes
, à moins que le mot étranger ne foit naturalifé
par un long ufage avant la compofition ; enforte que
ce mot n’ait befoin que d’être prononcé pour être
entendu : ceux même qui compofent arbitrairement
des mots feientifiques, s’afliijettiflent à cette réglé,
guidés par la feule analogie, fi ce n’eft lorfqu’ils
joignent à beaucoup de pédanterie beaucoup d’ignorance
; ce qui arrive quelquefois: c’eft pour cela que
notre réglé a quelques exceptions.
50. C e fera une très-bonne loi à s’impofer, fi l’on
veut s’épargner bien des conjectures frivoles, de ne
s’arrêter qu’à des fuppofitions appuyées fur un certain
nombre d’induétions, qui leur donnent déjà un
commencement de probabilité, & les tirent de &