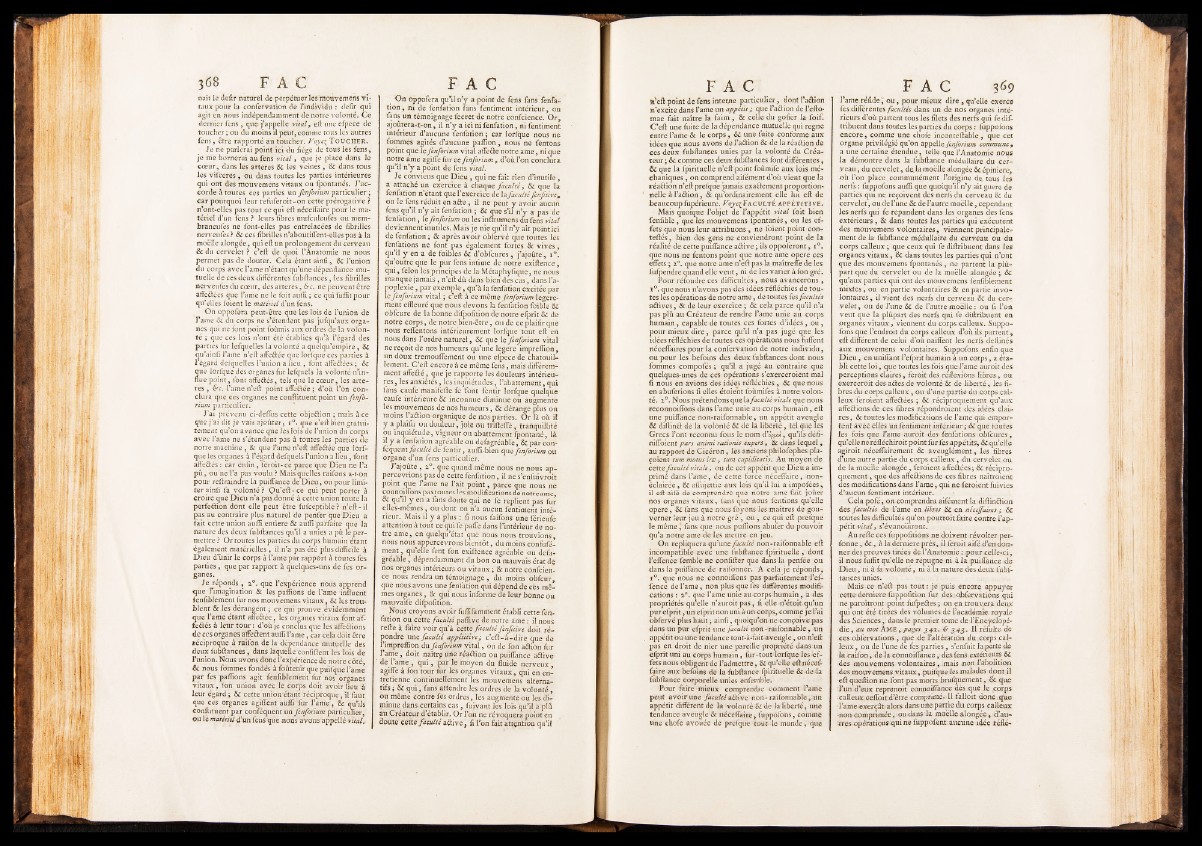
naît le defir naturel de perpétuer les‘moiivèmens v i taux
pour la confervation de l’individu : defir qui
agit en nous indépendamment de notre’volonté. Ce
dernier fens, que j’appelle vital, eft une efpeee dé
toucher ; ou du moins il peut, comme tous les autres
fens, être rapporté au toucher. F oy e^ T o u ch er .
Je ne parlerai point ici du liège de tous les fens,
je me bornerai au fens 'vital, que je place dans le
coeur, dans les arteres & les veines, &c dans tous
les vifceres, ou dans toutes les parties intérieures
qui ont des mouvemens vitaux ou fpontanés. J’accorde
à toutes ces parties un fenforium particulier ;
car pourquoi leur refuferoit-on cette prérogative ?
n’ont-elles pas tout ce qui eft néceffaire pour le matériel
d’un fens ? leurs fibres mufculeufes ou mem-
braneufes ne font-elles pas entrelacées de fibrilles
nerveufes ? & ces fibrilles n’aboutiffent-elles pas à la
moelle alongée, qui eft un prolongement du cerveau
& du cervelet ? c’eft de quoi l’Anatomie ne nous
permet pas de douter. Cela étant ainfi, & l’union
du corps avec l’ame n’étant qu’une dépendance mutuelle
de ces deux différentes fubftances, les fibrilles
nerveufes du coeur, des arteres, &c. ne peuvent être
affeûées que l’ame ne le foit aufli ; ce qui fuffit pour
qu’ elles foient le matériel d’un fens.
On oppofera peut-être que les lois de Punion de
l ’ame & du corps ne s’ étendent pas jufqu’aux organes
qui ne font point fournis aux ordres de la volonté
; que ces lois n’ont été établies qu’à l’égard des
parties fur lefquelles la volonté a quelqu’empire , &
qu’ainfi l’ame n’eft affeélée que lorfque ces parties à
l ’égard defquelles l’union a lieu , font affeétées ; &
que lorfque des organes fur lefquels la volonté n’influe
point, font affe&és, tels que le coeur, les arteres
, &c. l’ame n’ eft point affeftée ; d’où l’on conclura
que ces organes ne conftituent point un fenfo-
fium particulier.
J’ai prévenu ci-deffus cette objection ; mais à ce
que j ’ai dit je vais ajouter, i° . que c’eft bien gratuitement
qu’on avance que les lois de l’union du corps
avec l’ame ne s’étendent pas à toutes les parties de
notre machine , & que l’ame n’eft affeftée que lorfque
les organes à l’égard defquels Punion a lieu, font
afteâés : car enfin, feroit- ce parce que Dieu ne l’a
p u , ou ne l’ a pas voulu ? Mais quelles raifons a-t-on
pour reftraindre la puiffance de D ieu, ou pour limiter
ainfi fa volonté? Qu’eft-ce qui peut porter à
croire que Dieu n’a pas donné à cette union toute la
perfeûion dont elle peut être fufceptible? n’eft-il
pas au contraire plus naturel de penfer que Dieu a
fait cette union aufli entière & aufli parfaite que la
nature des deux fubftances qu’il a unies a pû le permettre
? Or toutes les parties du corps humain étant
également matérielles , il n’a pas été plus difficile à
Dieu d’iinir le corps à l’ame par rapport à toutes fes
parties, que par rapport à quelques-uns de fes organes.
Je réponds , i ° . que l’expérience nous apprend
que l’imagination & les pallions de l’ame influent
fenfiblement fur nos mouvemens vitaux, & les troublent
& les dérangent ; ce qui prouve évidemment
que l’ame étant affeftée, les organes vitaux font affrétés
à leur tour : d’où je conclus que les affeétions
de ces organes affectent aufli l’ame, car cela doit être
réciproque à raifon de la dépendance mutuelle des
deux fubftances, dans laquelle confiftent les lois de
l’union. Nous avons donc l’expérience de notre Coté,
& nous fommes fondés à foûtenir que puifque l’ame
par fes pallions agit fenfiblement fur nos Organes
vitaux, Ion union avec le corps doit avoir lieu à
leur égard ; & cette union'étant réciproque, il faut
que ces organes agiffent aiifîi fur rame , & qu’ils
conftituent par conféquent un fenforium particulier,
ou le matériel d’un fens que noos avons appelle vital,
On oppofera qu’ il n’y a point de fens fansfenfa-
tion, ni de fenfation fans fentiment intérieur, ou
fans un témoignage fecret de notre confcience. O r ,
ajoûtera-t-on, il n’y a ici ni fenfation, ni fentiment
intérieur d’aucune fenfation ; car lorfque nous ne
fommes agités d’aucune paflîon, nous ne fentons
point que le fenforium vital affeéle notre ame, ni que
notre ame agiffe fur ce fenforium , d’où l’on conclura
qu’il n’y a point de fens vital.
Je conviens que Dieu , qui ne fait rien d’inutile,
a attaché un exercice à chaque faculté, & que la
fenfation n’étant que l’exercice de la facultéfenfitive„
ou le fens réduit en afte , il ne peut y avoir aucun
fens qu’il n’y ait fenfation ; & que s’il n’y a pas de
fenfation, le fenforium ou les inftrumens du fens vital
deviennent inutiles. Mais je nie qu’il n’y ait point ici
de fenfation ; & après avoir obfervé que toutes les
fenfations ne font pas également fortes & v iv e s ,
qu’il y en a de foibles & d’obfcures, j’ajoute, i° .
qu’outre que le pur fens intime de notre exiftence ,
qui, félon les principes de la Métaphyfique, ne nous
manque jamais , n’eft dû dans bien des cas, dans l’apoplexie
, par exemple, qu’à la fenfation excitée par
le fenforium vital ; c’eft à ce même fenforium legere-
ment effleuré que nous devons la fenfation foible &:
obfcure de la bonne difpofition de notre efprit & de
notre corps, de notre bien-être, ou de ce plaifir que
nous reffentons intérieurement lorfque tout eft en
nous dans l’ordre naturel, & que le fenforium vital
ne reçoit de nos humeurs qu’une legere impreflion,
un doux tremouffement ou une efpeee de chatouillement.
C ’eft encore à ce même fens, mais différem-
[ ment affeâe, que je rapporte les douleurs intérieures
, les anxiétés, les inquiétudes, l’abattement, qui
fans caufe manifefte fe font fentir lorfque quelque
caufe intérieure & inconnue diminue ou augmente
les mouvemens de nos humeurs, & dérange plus ou
moins l’aâion organique de nos parties. Or là où il
y a plaifir ou douleur, joie ou trifteffe, tranquillité
ou inquiétude, vigueur Ou abattement fpontané, là
il y a fenfation agréable ou defagréable, & par con-
fequent faculté de fentir, aufli-bien que fenforium ou
organe d’un fens particulier.
J’ajoute , i ° . que quand même nous ne nous ap-
percevrions pas de cette fenfation, il ne s’enfuivroit
point que l’ame ne l’ait point, parce que nous ne
connoiflons pastouteslès modifications de notreame,
& qu il y en a fans doute qui ne fe replient pas fur
elles-mêmes, où dont on n’a aucun fentiment intérieur.
Mais il y a plus : fi nous faifons une férieufe
attention à tout ce qui fe paffe dans l’intérieur de notre
ame, en quelqu’état que nous nous trouvions,
nous nous appercevrons bientôt, dumoins confufé-
ment, qu’elle fent fon exiftence agréable ou defa-
greable, dependamment du bon ou mauvais état de
nos organes intérieurs ou vitaux ; & notre confcience
nous rendra un témoignage , du moins obfcur,
qüe nous avons une fenfation qui dépend de cbs mêmes
organes, & qui nous informe dë leur bonne ou
mauvaife difpofition.
Nous croyons avoir fuffifamment établi cette fenfation
ou cette facilité paflivë de notre ame : il nous
refte à faire voir qu’à cette faculté fenftive doit répondre
line faculté appétitive; c’eft-à-dirè que de
l’impreflïon du fenforium v ita l, ou de fon aûion fur
l’ame, doit naître une réadion ou puiffance àftive
de l’ame , q u i, par le moyen du fluide nerveux ,
agiffe à fon tour fiir les organes vitaux, qui en entretienne
continuellement les mouvemens alternatifs
; & q ui, fans attendre les ordres de la volonté,
ou même contre fes ordres, les augmente ou les diminue
daps certains cas , fuivant les lois qu’il à plu
au Créateur d’établir. Or l’on ne révoquera point en
doute cette faculté active, fi l’on fait attention qu’il
W*eft. point de fens interne particulier, dont Paéfion
ïi’excite dans l’ame un appétit ; que l’aâion de l’efto-
mac fait naître la faim , & celle du gofier la foif.
C ’eft une fuite de la dépendance mutuelle qui régné
entre l’ame & le corps, èt une fuite conforme aux
idées que nous avons de l’aftion & de la réa&ion de
ces deux fubftances unies par la volonté du Créateur;
& comme ces deux fubftances font différentes,
& que la fpirituelle n’eft point foûmife aux lois mé-
chaniques, on comprend aifément d’où vient que la
réaftion n’eft prefque jamais exactement proportionnelle
à l’aftion, & qu’ordinairement elle lui eft de
beaucoupfupérieure. Foye{F a c u l t é a p p é t i t i v e .
Mais quoique l’objet de l’appétit vital foit bien
fenfible, que les mouvemens fpontanés, ou les effets
que nous leur attribuons , ne foient point conr
teftés, bien des gens ne conviendront point de la
réalité de cette puiffance aétive ; ils oppoferont, i°:.
que nous ne fentons point que notre ame opéré ces
effets ; 2°. que notre ame n’eft pas la maîtreffe de les
fufpendre quand elle v eu t, ni de les varier à fon gré.
Pour réfoudre ces difficultés, nous avancerons ,
ï° . que nous n’avons pas des idées réfléchies de toutes
les opérations de notre ame, de toutes fes facultés
a&ives, & de leur exercice ; & cela parce qu’il n’a
pas plû au Créateur de rendre l’ame unie au corps
humain, capable de toutes ces fortes d’idées, o u ,
pour mieux dire, parce qu’il n’a pas jugé que les
idées réfléchies de toutes ces opérations nous fuffent
néceffaires pour la confervation de notre individu,
ou pour les befoins des deux fubftances dont nous
fommes compofés ; qu’il a jugé au contraire que
quelques-unes de ces opérations s’exerceroient mal
fi nous en avions des idées réfléchies , & que nous
en abuferions fi elles étoient foûmifes à notre volonté.
2°. Nous prétendons que la faculté vitale que nous
reconnoiffons dans l’ame unie au corps humain, eft
une puiffance non-raifonnable, un appétit aveugle
& diftinft de la volonté & de la liberté, tel que les
Grecs l’ont reconnu fous le nom d’oeil», qu’ils défi-
niffoient pars animi rationis expers, & dans lequel,
au rapport de Cicéron, les anciens philofophes pla-
çoient tum motus ira, tum cupiditatis. Au moyen de
cette faculté vitale, ou de cet appétit que D ieu a imprimé
dans l’ame, de cette force néceffaire, non-
éclairée , & affujettie aux lois qu’il lui a impofées,
il eft aifé de comprendre que notre ame fait jouer
nos organes vitaux, fans que nous fentions qu’elle
opéré, & fans que nous foyons les maîtres de gouverner
leur jeu à notre gré , o u , ce qui eft prefque
le mêm efan s que nous puflions abuler du pouvoir
qu’a notre ame de les mettre en jeu.
On répliquera qu’une faculté non-raifonnable eft
incompatible avec une fubftance fpirituelle, dont
l’effence femble ne confifter que dans'la penfée ou
dans la puiffance de raifonner. A cela je réponds;;
i ° . que nous ne connoiflons pas parfaitementl’ef-
fence de l’ame, non plus que les différentes modifications
: 2°. que l’ame unie au corps;humain, a dess
propriétés qu’elle n’auroit pas, fi élle n’étoit. qu’un
pur efprit, Un efprit non uni à un corps, comme je'l’ai
Obfervé plus haut ; ainfi, quoiqu-on>ne conçoive.pas
dans un pur efprit une faculté non-raifonnable, -un
appétit ou une tendance tout-à-fait-aveugle, on n’eft
pas en droit de nier une pareille propriété dans un
efprit uni au corps humain, fur -tout lorfque les e f fets
nous obligent-de ^admettre, & qu’elle eftnécef-
faire aux befoins de la fubftance\fpirituelle & • de la
fubftance corporelle unies erifenlhle.
Pour faire mieux comprendre ‘comment Famé
p e u t avoir une faculté aéfive non - raifonnable, un
appétit différent de la volonté & de la;liberté, une
ten d a n c e a v e u g le & riéeeffaire; fuppofons, Gomme
une chofe avoiiée de prefque tout le m o n d e , que
Pâme rende o u , pour mieux d ire , qu’elle exerce
fes différentes facullés dans un de nos organes intérieurs
d’où partent tous les filets des nerfs qui fe distribuent
dans toutes les parties du corps : fuppofons
encore, comme une chofe inconteftable , que cet
organe privilégié qu’on appelle fenforium commune ,
a une certaine étendue, telle que l’Anatomie nous
la démontre dans la fubftance médullaire du cerveau
, du cervelet, dé jà moelle alongée êc épiniere,
où l’on place communément llorigine de. tous les
nerfs ; fuppofons aufli que quoiqu’il n’y ait guere de
parties qui ne reçoivent des nerfs du cerveau & du
cervelet, ou de l’une & de l’autre moelle, cependant
les nerfs qui fe répandent dans les organes des fens
extérieurs , & dans toutes les parties qui exécutent
des mouvemens volontaires, viennent principale^
ment de la fubftance médullaire du cerveau ou du
corps calleux ; que ceux qui fe diftribuent dans les
organes vitaux, & dans toutes les parties qui n’ont
que des mouvemens fpontanés, ne partent la plû-
part que du cervelet ou de la moelle alongée ; &
qu’aux parties qui ont des mouvemens fenfiblement
mixtes, ou en partie volontaires & en partie involontaires
, il vient des nerfs du cerveau & du cervelet
, ou de l’une & de l’autre moelle : ou fi l’on
veut que la plupart des nerfs qui fe diftribuent en
organes v itaux, viennent du corps calleux. Suppo-
fons que l’endroit du corps calleux d’où ils partent ;
eft différent de celui d’où naiffent les nerfs deftinés
aux mouvemens volontaires. Suppofons enfin que
D ie u , en uniflant l’efprit humain à un corps, a établi
cette lo i, que toutes les fois que l’ame auroit des
perceptions claires, feroit des reflexions fibres, ou
exerceroit des aftes de volonté & de liberté, les f i bres
du corps calleux, ou d’une partie du corps caL-
léux feroient affeftées ; & réciproquement qu’aux
affeâions de ces fibres répondroient des idées clair
res, & toutes les modifications de l’ame qui emportent
avec elles un fentiment intérieur ; & que toutes
les fois que l’ame auroit des fenfations obfcures ,
qu’elle neréfléchiroit point fur fes appétits, & qu’elle
agiroit néceffairement & aveuglément, les fibres
d’une autre partie du corps calLeux, du cervelet ou
de la moelle alongée, feroient affe&ées ; & réciproquement
, que des affe&ions de ces fibres naîtroient
des modifications dans l’ame, qui ne feroient fui vies
d’aucun fentiment intérieur.
Cela pofé, on comprendra aifément la diftinftion
des facultés de l’ame en libres Sc en néceffaires ; &
toutes les difficultés qu’on pourroit faire contre l’appétit
vital, s’évanoiiiront.
Au.refte.ces ffuppolxtions ne doivent révolter per-
-fonne, & y .à ia derniereprès , il lèroit aifé. d’en don-
ner-des preuves tirées de l’Anatomie : ,pour celle-ci,
il nous fuffit qu’elle ne répugne ni à la puiffance de
Dieu,;ni.àffa volonté, ni àda nature des deux.fubf-
tances unies.
Mais.ce nleft pas tout : je ip.ùis .encore appuyer
cette dernierefuppofition fur des ;obfervalions qui
ne paraîtront.point fufpe&es ; on en trouvera deux
•qui ont été tirées des vôlumes dè l’académie royale
des Sciences, da ns le premier tome de l’Encÿclopé-
-die, au mot ÂME, pages 342. & 3 4 3 . Il rélulte de
ces obfervations , que de l ’altération du.corps calleux
, ou de l’une de fes parties, s’enfuit la^perte de
-la .raifon ,-delà eonnoiffance,:dèsffens extérieurs &
-des mouvemens volontaires , mais nonyl’âbolition
.des mouvemens .vitaux, puifque les.malades dpnt il
eft queftion-ne-font pas morts bmftjuement, & qup
l’un d’eux reprenoit eonnoiffance dès que Je .corps
calleux,ceflbitd?être comprimé.. Il falloit doncique
-rame-exerçât-alorsidans une partie du.corps calleux
-non-comprimée, ou dans'la moelle alongée, d’au-
-tres opérations -qui ne fuppofent aucune idée réflé