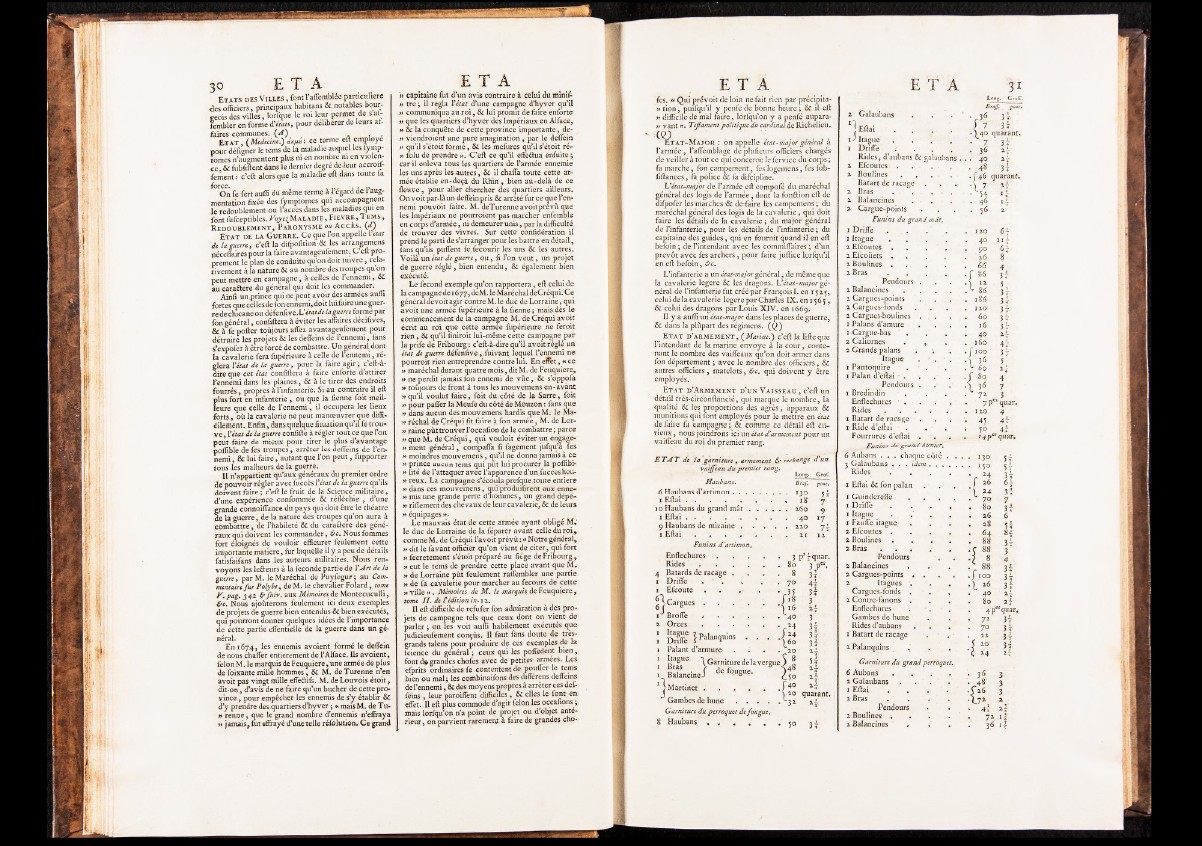
Etats des Villes , font l’aflemblée particulière
des officiers, principaux habitans & notables bourgeois
des villes, torique lembler en forme d le roi leur permet de saf- * états, pour dehberer de leurs affaires
communes. (A ) , Eta t, (Médecine.) î|g g ce terme eft employé
ptoomuer sd néf’aigungemr elen tteeinnts . pdleu sl an im eanl andoime abureq unei le lnes v iiyomlepn-
ce, & fubfiltent dans le dernier degre de-leur accroii-
fementc c’eft alors que la maladie eft dans toute la
force. 9 ü | . , _
On fe fert auffi du meme terme-àl egard de 1 augmentation
fixée des fymptomes qui accompagnent
le redoublement ou l’accès dans les maladies qui en
font fufceptibles. Voye^ Maladie , Fie v r e , T ems ,
Red o ub lement, Pa rox ysm e ou A c c è s , (d)
Et a t de l a G uerre. Ce que l’on appelle Y état
de U guerre, c’eft la difpofitionfc les arrangemens
jiécefl'aires pour la faire avantageufement. C ’eft proprement
le plan de conduite qu’on doit iuivre, relativement
à la nature & au nombre des troupes qu on
peut mettre-en campagne, à celles de l’ennemi, oC
au caraftere du général qui doit les commander.
Ainli un prince qui ne .peut avoir désarmées auffi
fortes que celles de Ion ennemi,-doit lui faire une guerre
de chicane ou défenfive.LVWe la guerre formé par
fon général, confiftera à éviter les affaires décifives,
& à fe pofter toujours affez avantageufement pour
détruire les projets & les defleins de l’ennemi, ians
s’expofer à être forcé de combattre. Un général dont
la cavalerie fera fupérieure à celle de l’enrtemi, réglera
Y état de la guerre, pour la faire agir ; c’eft-à-
dire que cet état confiftera à faire enforte d’attirer
l’ennemi dans les plaines, & à le tirer des endroits
fourrés, propres à l’infanterie. Si au contraire il eft
plus fort en infanterie, ou que la fienne foit meilleure
que celle de l’ennemi, il occupera les lieux
forts, où la cavalerie ne peut manoeuvrer que difficilement.
Enfin, dans quelque fituation qu’il fe trouv
e , Y état de la guerre confifte à régler tout ce que l’on
peut faire de mieux pour tirer le plus d’avantage
poffible de fes troupes, arrêter les defleins de l’ennemi
, & lui faire, autant que l’on peut, fupporter
tous les malheurs de la guerre.
11 n’appartient qu’aux généraux du premier ordre
de pouvoir régler avec fuccès Y état de la guerre qu’ils
doivent faire ; c’eft le fruit de la Science militaire,
d’une expérience confbmmée & réfléchie , d’une
grande connoiflance du pays qui doit être le théâtre
de la guerre, de la nature des troupes qu’on aura à
combattre, de l’habileté & du cara&ere des généraux
qui doivent les commander, &c. Nousfommes
fort éloignés de vouloir effleurer feulement cette
importante matière, fur laquelle il y a peu de détails
fatisfaifans dans les auteurs militaires. Nous renvoyons
les le&eurs à la fécondé partie de Y Art de la
guerre, parM. le Maréchal de Puyfegur; au Commentaire
fur Polybe, deM. le chevalier Folard, tome
y. pag. 3 42 &fuiv. aux Mémoires de Montecuculli,
&c. Nous ajoûterons feulement ici deux exemples
de projets de guerre bien entendus & bien exécutés,
qui pourront donner quelques idées de l’importance
de cette partie eflentielle de la guerre dans u a général.
En 1674, les ennemis avoient formé le deflein
de nous chafler entièrement de l’Alface. Ils avoient,
félon M. le marquis de Feuquiere, une armée de plus
defoixantemille hommes, & M. deTurenne n’en
avoit pas vingt mille effedtifs. M. de Louvois étoit,
dit-on, d’avis de ne faire qu’un bûcher de cette province
, pour empêcher les ennemis de s’y établir &
d’y prendre des quartiers d’hyver ; « mais M. de Tu-
» renne, que le grand nombre d’ennemis n’effraya
» jamais, fut effrayé d’une telle réfolution, Ce grand
» capitaine fut d’un avis contraire à celui du mini£
» tre ; il régla Yétat d’une campagne d’hyver qu’il
» communiqua au ro i, & lui promit de faire enforte
» que les quartiers d’hyver des Impériaux en Alface,
» éc la conquête de cette province importante, de-
» viendroient une pure imagination, par le deflein
» qu’il s’étoit formé, & les mefures qu’il s’étoit ré-
» folu de prendre ». C ’eft ce qu’il efleâua enfuite ;
car il enleva tous les quartiers de l’armée ennemie
les uns après les autres, & il chafla toute cette armée
établie en-deçà du Rhin , bien au-delà de ce
fleuve, pour aller chercher des quartiers ailleurs.
On voit par-là un deflein pris & arrêté fur ce que l’ennemi
pouvoit faire. M. deTurenne avoit prevu que
les Impériaux ne pourroient pas marcher enfemble
en corps d’armée, ni demeurer unis, par la difficulté
de trouver des vivres. Sur cette confédération il
prend le parti de s’arranger pour les battre en détail,
fans qu’ils puflent fe fecourir les uns & les autres.
Voilà un état de guerre, o u , fi l’on v eu t , un projet
de guerre réglé, bien entendu, &c également bien
exécuté.
Le fécond exemple qu’on rapportera, eft celui de
la campagne de 1677, deM. le Maréchal deCréqui. Ce
généraldevoitagir contre M. le duc de Lorraine, qui
avoit une armée fupérieure à la fienne ; mais dès le
commencement de la campagne M. de Créqui avoit
écrit au roi que cette armee fupérieure ne feroit
rien, & qu’il tiniroit lui-même cette campagne par
la prife de Fribourg : c’eft-à-dire qu’il avoit réglé un
état de guerre défenfive „ fuivant lequel l’ennemi ne
pourvoit rien entreprendre contre lui. En effet, « ce
» maréchal durant quatre mois, dit M. de Feuquiere,
» ne perdit jamais fon ennemi de v u e , & s’oppofa
» toûjours de front à tous les mouvemens en-avant
» qu’il voulut faire, fqit du côté de la Sarre, foit
» pour pafler la Meufe du côté de Mouzon : fans que
» dans aucun des mouvemens hardis que M. le Ma-
» réchal de Créqui fit faire à fon armée, M. de Lor-
» raine pût trouver l’occafion de le combattre ; parce
» que M. de Créqui, qui vouloit éviter un engages
» ment général, compafla fi fagement jufqu’à fes
1 » moindres mouvemens, qu’il ne donna jamais à ce
» prince aucun tems qui pût lui procurer la poffibi-
» lité de l’attaquer avec l’apparence d’un fuccès heu-
» reux. La campagne s’écoula prefque toute entière
» dans ces mouvemens, qui produifirent aux enne-
» mis une grande perte d’hommes, un grand dépé-
» riffement des chevaux de leur cavalerie, & de leurs
» équipages ».
Le mauvais état de cette armée ayant obligé M.’
le duc de Lorraine de la féparer avant celle du ro i,
comme M. de Créqui l’avoit prévû : « Notre général,
» dit le favant officier qu’on vient de citer, qui fort
» fecretement s’étoit préparé au fiége de Fribourg ,
» eut le tems de prendre cette place avant que M-
» de Lorraine pût feulement raffembler une partie
» de fa cavalerie pour marcher au fecours de cette
» v ille » . Mémoires de M. le marquis de Feuquiere,
tome I I . de tédition in-12.
Il eft difficile de refufer fon admiration à des projets
de campagne tels que ceux dont on vient de
parler ; on les voit auffi habilement exécutés que
judicieufement conçûs. Il faut , fans doute de très-
grands talens pour produire de ces exemples de la
lcience du général ; ceux qui les pofîedent bien ,
font de grandes chofes avec de-petites armees. Les
efprits ordinaires fe contentent de pouffer le tems
bien ou mal; les combinaifons des differens defleins
de l’ennemi, & des moyens propres à arrêter ces deffeins
, leur paroiflent difficiles , & elles le font- en
effet. U eft plus commode d’agir félon les occafions^;
mais lorfqu’on n’a point de projet ou d’objet antérieur
, on parvient rarement à faire de grandes chofes.
« Qui prévoit de loin ne fait rien par précipita-
» tion, puifqu’il y penfe de bonne heure ; & il eft
» difficile de mal faire, lorfqu’on y a penfé aupara-
» vant ». Tefament "politique du cardinal de Richelieu.
« 2E)t at-M, aj.o r : o, n appelle état-major geMneral à
l’armée, l’aflemblage de plufieurs officiers chargés
de veiller à tout ce qui concerné le fervice du corps ;
lfiaf tmanacrecsh,e f, af opno lcicaem &pe fma edniftc, ipfelisn leo.gemerts, fes fub-
\Yétat-major de l’armée eft compofé du maréchal
général des logis de l’armee, dont la rondtion eft de
difpofer les marches •& de-faire -les campemens ; du
maréchal général des logis de la- cavalerie., qui doit
faire les détails de la cavalerie-; du major général
de l’infanterie •, pour les détails- de l’infanterie ; du
capitaine-des guides , qui-en fournit quand il en eft
befoin ; de l’intendant avec les commiflaires ; d’un
prévôt avec fes archers ,-pour faire juftice lorfqu’il
en eft befoin, &c.
L ’infanterie a un état-major général, de même que
la cavalerie legere & les dragons. L’état-major général
de l’infanterie fut créé par François I. en 1525,
celui de la cavalerie legere par Charles IX. en 15 6 ç ,
& celui des dragons par Louis XIV. en 1669.
Il y a auffi un état-major dans les placés de guerre,
& dans la plûpart des régimens. (Q )
Etat d’armement, (Marine.) c’eft la lifte que
l’intendant de la marine envoyé à la cour, contenant
le nombre des vaiffeaux qu’on doit armer dans
fon département ; avec le nombre des officiers, &
autres officiers, matelots, &c. qui doivent y être
employés.
Etat d’Armement d’ün Vaisseau , c’eft un
détail très-circonftàncié, qui marque le nombre, la
qualité & les proportions des agrès, apparaux &
munitions qui font employés pour le mettre en état
de faire fa campagne ; & comme ce détail eft curieux
, nous joindrons ici un état d'armement pour un
vailfeau du roi du premier rang.
E T A T de la garniture, armement & rechange d'un
vaiffeau du premier rang.
Long. Grof.
Haubans. Braf.
6 Haubans d’artimon..........................
i Eftai ............................................... 7
io Haubans du grand m â t .................
i E f ta i ..............................................
9 Haubans de mizaine . . . . . 220
i Eftai . . . 12
3 p 7 quar.
80 3 pes.
I
FiCnins d?artimon,
Enflechures
Rides . . . .
4 Bâtards de racage .
1 Drifle * * . ^
1 Efcoute
g jc a r g u e s . . . .
1 Brofle « . . .
2 Orces . . . .
î Briffe ! Palanquins .
i Palant d’armure
î Bras1* \Gatniture de Iavergue 5 |
BalancineJ de ) f o
37
4f 3? 32~
3m3
i
37
57
Martinet . . . .
S zo quarant.
Gambes de h u n e ........................*-32 2~
Garniture du perroquet de fougue.
8 Haubans • . , 5° 3i
E T A
2 Galaubans . ,■
3 1
Long. Grofl".
Braff. . Epuc.
m 37
’ 1 Eftai ) 7 y 37
i ' Itague . ,
^40 quarant,
7 H
i Drifle- .- 2-
Rides, d’aubans & galaubans 40 2-r
2 Efcoutes . . . . . .2s
2 Boulines . , . f 46 quarant.
Batart de racage • . -. ..
2 Bras . . . . , . a
2 Balancines . • 46
2 Cargue-points . , 5« 2
Funins du grandjndr.
î Drifle 120 67
i Itague . . 40 11 7 2 Efcoutes H
26
6~
2 Efcoiiets 8
2 Boulines . . . . ë s 4
2 Bras
86 37 Pendours . 12
I
; l
2 Balancines 86 37
2 Cargues-points 186 37
2 Cargues-tonds 120 37
2 Cargues-boulines . . . 60 37
i Palans d’amure 16
î Cargue-bas . 40 2-J
2 Caliornes . , 160
2 Grànds palans ■ i
1
100 ' 3t
Itague . • . • . 36 5 î Pantoquire . . 60 27 î Palan d’eftai • . . f -8o 4
Pendours -. A I 7 î Bredindin . . '72 3
Enflechures - . - ■ . ; . • ' 7 Pe quar.
Rides . . . . 120 4 î Batart de racage 45 47 î Ride d’eftai . . . 5°
Fourrures d’eftai . 14 p65quar.
Funi/Z* grand hunier.
6 Aubans . . . chaque côté . . 130
3 Galaubans . . . idem............... 150
Rides . . . . 37
î Eftai & fon palan . . .
rf 76
î Guinderefle . . . . l 7204 3ï
7
î Drifle . . . . 80 3i
î Itague . . . . 26 6
î Faufle itague 28 5*
2 Efcoutes . . . . H
2 Boulines . . . . 88
2 Bras . . . r 88 3 Pendours - 8
2 Balancines '• 88 37
2 Cargues-points .- . , . j 100 37
2 Itagues '. . . • l i
. 40 3 r
Cargues-fonds . ■ . , 22
2 Contre-fanons . . . 2y
Enflechures- : • . - . 4 P■* quar»
Gambes de hune l i
Rides d’aubans . . . 70 i l
î -Batart de racage •. * . - 22 37
2 Palanquins t ^ . . 20
24 37 2 v
Garniture du grand perroquet.
6 Aubans . . 36 3
2 Galaubans . . . . 48 3 î Eftai . . . . -j 26 3
2 Bras . . -1I72 2
Pendours 4 ï 27 2 Boulines . . . . 72
2 Balancines . . . 36 Jf.