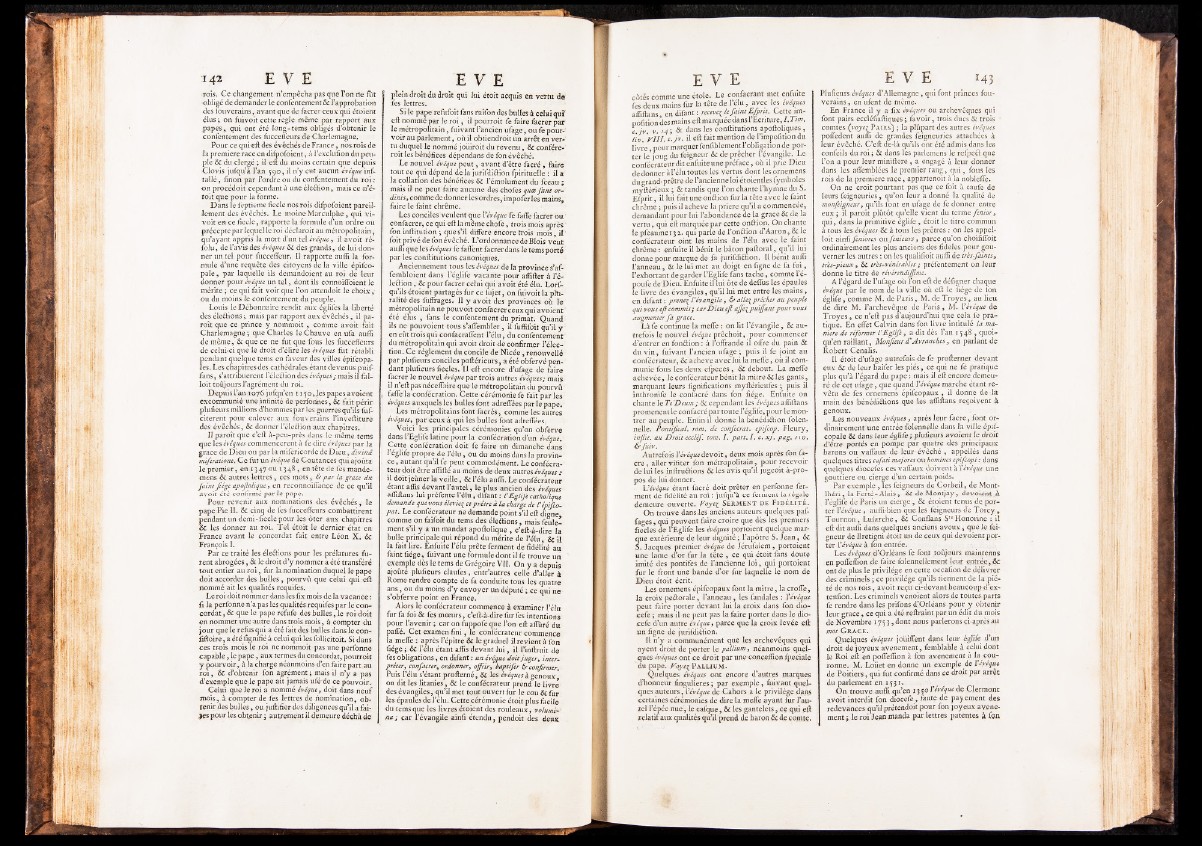
rois. Ce changement n’empêcha pasque Ton rte fût
•obligé dé demander le confentement & l’approbation
des fouverains, avant que de facrer ceux qui étoient
élus ; on fuivoit cette réglé même .par rapport aux
.papes , qui ont été long-tems obligés d’obtenir le
confentement des fucceiiéirçs de Charlemagne.
Pour ce quieft des évêchés de France, nos rois de
Ja première raceendiipofoient, à l’exclufion du peuple
& du clergé ; il eft du moins certain que depuis
•Clovis jufqu’à l’an <90, il n’y eut aucun évêque installé,
linon par l’ordre ou du confentement du roi-:
on.procédoit cependant à une éle&ion, mais ce n’é-
toit que pour la forme.
Dans le feptieme liecle nos rois difpofoient pareillement
des évêchés. Le moine Marculphe, qui vi-
voit en ce .fieple, rapporte la formule d’un ordre ou
précepte par lequel le roi déclaroit au métropolitain,
qu’ayant appris la mort d’un tel évêque, il avoit ré-
folu, de l’avis des évêques 6c des grands, de lui donner
un tel pour fucceffeur. Il rapporte aulîi la formule
d’une requête des citoyens de la ville épifco-
pale, par laquelle ils demandoient au roi de leur
donner pour evêque un t e l, dont ils connoiffoient le
mérite ; ce qui fait voir que l’on attendoit le choix ,■
ou du moins le confentement du peuple.
Louis le Débonnaire rendit aux églifes la liberté
des élevions ; mais par rapport aux évêchés, il pa-
roît que ce prince y nommoit , comme avoit fait
Charlemagne ; que Charles le Chauve en ufa aulîi
de même, & que ce ne fut que fous les fucceffeurs
de celui-ci que le droit d’élire les évêques fut rétabli
pendant quelque tems en faveur des villes épifcopa-
îes. Les chapitres des cathédrales étant devenus puif-
fans, s’attribuèrent l ’éle&ion des évêques ; mais il fal-
loit toujours l’agrément du roi.
Depuis l’an É076 jufqu’en 1150, Jes papes avoient
excommunié une.infinité de perforines, 6c fait périr
plulieurs millions d’hommes par les guerres qu’ilsfufichèrent
pour enlever aux fouverains l’inveftiture
des évêchés, & donner l’éle&ion aux chapitres.
Il paroîtque c’eft à-peu-près dans le même tems
que les évêques commencèrent à fe dire évêques par la
grâce de Dieu ou par la milericorde de Dieu, divinâ
miferatione. C e fut un évêque de Coutances qui ajouta
le premier, en 1347 ott 1348, en tête dé fes mande-
mcns ■ & autres lettres, ces mots, & par La grâce dit
faim fiége apojiolique, en reconnoiffance de ce qu’il
avoit été confirmé par le pape.
Pour revenir aux nominations des évêchés, le
pape Pie II. 6c cinq de fes fuccefl’eurs combattirent
pendant un demi-fiecle pour les ôter aux chapitres
& les donner au roi. T el étoit le dernier état en
France avant le concordat fait entre Léon X . 6c
François I.
Par ce traité les élevions pour les prélatures furent
abrogées, & le droit d’y nommer a été transféré
tout entier au ro i, fur la nomination duquel le pape ]
doit accorder des bulles, pourvu que celui qui eft
nommé ait les qualités requifes.
Le roi doit nommer dans les fix mois de la vacance :
fi la perfonne n’a pas les qualités requifes par le concordat
, & que le pape refufe des bulles, le roi doit
on nommer une autre dans trois mois, à compter du
jour que le refus qui a été fait des bulles dans le con-
fiftoire, a été fignifié à celui qui les follicitoit. Si dans
ces tr-ois mois le roi ne nommoit pas une perfonne
capable, le pape, aux termes du concordat, pourroit
y pourvoir, à la charge néanmoins d’en faire part au
r o i , & d’obtenir fon agrément ; mais il n’y a pas
d’exemple que le pape ait jamais ufé de ce pouvoir.
Celui que le roi a nommé évêque, doit dans neuf
mois, à compter de fes lettres de nomination, obtenir
des bulles, ou juftifier des diligences qu’il a faites
pour les obtenir 3 autrement il demeure déchu de j
plein droit du droit qui lui étoit acquis en vertu de
les lettres.
Si le pape refufoit fans raifon des bulles à celui qu?
eft nommé par le r o i , il pourroit fe faire facrer par
le métropolitain, fuivant l’ancien ufage, ou fe pourvoir
au parlement, où il obtiendrait un arrêt en vertu
duquel le nommé jouirait du revenu, & conférerait
les bénéfices dépendans de fon évêché.
Le nouvel évêque peut, avant d’être facré , faire
tout ce qui dépend de la jurifdiftion fpirituelle : il a
la collation des bénéfices & l’émolument du fceau ;
mais il ne peut faire aucune des chofes quce /une or-
dinisy comme de donner les ordres, impofer les mains,
faire le faint chrême.
Les conciles veulent que 1-'evêque fe fafle facrer ou '
confacrer, ce qui eft la même chofe, trois mois après '
fon inftitution ; que s’il différé encore trais mois, il
foit privé de fon évêché. L’ordonnance de Blois veut
aufîi que les évêques fe faffent facrer dans le tems porté
par les conftitutions canoniques.
Anciennement tous les évêques de la province s’af-
fembloient dans l’églife vacante pour aflifter à |Éjf
le â io n , & pour facrer celui qui avoit été élu. Lorsqu'ils
étoient partagés fur ce lu je t, on fuivoit la phi-
! ralité des fuffrâges. Il y avoit des provinces oii le
métropolitain ne pouvoit confacrer ceux qui avoient
été élus , fans le confentement du primat. Quand
ils ne pouvoient tous s’àffembler, il fuffifoit qu’il y
en eût trois qui confacraffent l’élu, du confentement
du métropolitain qui avoit droit de confirmer l’élection.
C e réglement du concile de Nicée, renouvellé
par plulieurs conciles poftérieurs, a été obfervé pendant
plulieurs fiecles. Il eft encore d’ufage de faire
facrer le nouvel évêque par trois autres évêques; mais,
il n’eftpasnéceffaire que le métropolitain du pourvû
, fafféla confécration. Cette cérémonie fe fait par les
. évêques auxquels les bulles font adreffces par le pape.
Les métropolitains font facrés, comme les autres
évêques, par ceux à qui les bulles font adreffées.
Voici les principales cérémonies qu’on obferve
dans l’Eglife latine pour la confécration d’un évêque,
Cette confécration doit fe faire un dimanche dans
1 eglife propre de l’élu, où du moins dans la pravin-
. c e , autant qu’il fe peut commodément. Le confécrateur
doit être aflifté au moins de deux autres évêques :
il doit jeûner la veille, & l’élu aufli. L e confécrateur
étant aflis devant l’autel, le plus ancien des évêques
afliftans lui préfente l’élu , difant : l'Eglife catholique
demande que vous élevie{ ce prêtre à la charge de l'épifco-
pat. Le confécrateur ne demande point s’il eft digne
comme on faifoit du tems des élevions, mais feulement
s’il y a lin mandat apoftolique , c’eft-à-dire la
bulle principale qui répond du mérite de l’élu, & U
la fait lire. Enfuite l’élu prête ferment de fidélité au
faint fiége, fuivant une formule dont il fe trouve uii
exemple dès le tems de Grégoire VII. On y a depuis
ajoûté plufieurs claufes, entr’autres celle d’aller à
Rome rendre compte de fa conduite tous les quatre
ans, ou du moins d’y envoyer un député ; ce qui ne
s’obferve point en France.
Alors le confécrateur commence à examiner l’élu
fur fa foi & fes moeurs, c’eft-à-dire fur fes intentions
pour l’avenir ; car on fuppofe que l’on eft affûré du
paffé. Cet examen fin i, le confécrateur commence
la meffe : après l’épître & le graduel il revient à fon
fiége ; & l’elu étant aflis devant lu i , il l’inftruit de
fes obligations, en difant : un évêque doit juger, interpréter,
confacrer, ordonner, offrir, baptifer & confirmer.
Puis l’élu s’étant profterné, 6c les évêques à genoux
on dit les litanies, & le confécrateur prend le livre
des évangiles, qu’il met tout ouvert fur le cou & fur
les épaules de l’élu. Cette cérémonie étoit plus facile
du tems que les livres étoient des rôuleaux, volumW
na. ; car l’évangile ainfi étendu, pendoit des deux
E V E
cdtës comme une êtole. Le çonfaerant met enfuite
fes deux mains fur l a t t e de l’élu , A J « les
afliftans, en difant: r m v t i U f m t E f p r u . Cette, jm-
pofition des mains eft marquée dans l'Ecriture, I.Tim.
c . j v . V . 14’, & dans les conftitutions apoftoliques ,
l i v . VIII- c . j v , il eft fait mention de l’impofition du
liv re , pour marquer fenfiblement l’obligation de porter
te joug du feigneur 6c de prêcher ré vangile. Le
confécrateur dit enfuite une préface, oii il prie Dieu
de donner à l’élu toutes tes vertus dont les ornemens
du grand- prêtre de l’ancienne loi étoientles Symboles
myftérieux ; & tandis que l’on chante l’hymne du S.
Elprit, il lui fait une onftion fur la tête avec 1e faint
chrême ; puis il achevé la priera qu’il a commencée,
demandant pour lui l’abondance de la grâce 6c de la
vertu, qui eft marquée par cette onélion. On chante 1e pfeaume 132. qui parte de l’onélion d’Aaron, & 1e
confécrateur oint tes mains de l’élu avec le feint
chrême : enfuite il bénit 1e bâton paftoral, qu’ il lui
donne pour marque de fa jurifdiâion. Il bénit aufli
l’anneau, & le lui met au doigt en figne de fe f o i ,
l’exhortant de garder l’Eglife fans tache, comme l’e-
poufe dé Dieu. Enfuite il lui ôte de deffus les épaules
le livre des évangiles, qu’il lui met entre les mains,
en difant : prene[ l'évangile, & alle^ prêcher au peuple
qui vous eji commis; car Dieu eft affe^puiffant pour vous
augmenter fa grâce.
Là fe continue la meffe : on lit l’évangile, 6c autrefois
1e nouvel évêque prêchoit, pour commencer
d’entrer en fonction : à l’offrande il offre du pain &
du v in , fuivant l’ancien ufege ; puis il fe joint au
confécrateur, & achevé avec lui la meffe, où il communie
fous tes deux efpeces, 6c debout. La meffe
achevée, 1e confécrateur bénit la mitre & les gants,
marquant leurs fignifications myftérieufes ; puis il
inthronife 1e confacré dans fon fiége. Enfuite on
chante 1e Te’Deum ; 6c cependant tes évêques afliftans
promènent le confacré par toute l’églife, pour 1e montrer
au peuple. Enfin il donne la hénédi&ion folen-
nelle. Pontifical, rom. de confecrat. epifcop. Fleury,
inflit. au Droit eccléf. tom. I. part. 1. c. x j . pag. n o .
& fuiv.
Autrefois Y évêque devoit, deux mois après fon fa-
c r e , aller vifiter fon métropolitain, pour recevoir
de lui les inftru&ions & les avis qu’il jugeoit à-propos
de lui donner. L'évêque étant facré doit prêter en perfonne ferment
de fidélité demeure ouvertaeu. roi : jufqu’à ce ferment la régale Voyeç Serment de Fidélisé.
On trouve dansles anciens auteurs quelques pafi-
fages, qui peuvent faire croire que dès tes premiers
fiecles de FEglife tes évêques portoient quelque marque
extérieure de leur dignité ; l’apôtre S. Jean, 6c
S. Jacques premier évêque de Jérufalem, portoient
une lame d’or fer la tête , ce qui étoit fans doute
imité des pontifes de. l’ancienne lo i, qui portoient
fur 1e front une bande d’or fur laquelle 1e nom de
Dieu étoit écrit.
Les ornemens épifeopaux font la mitre, la crofte,
la croix p.eâ:orale, l’anneau, les fandales : Yévêque
peut faire porter devant foi la croix dans fon dio-
cefe ; mais il ne peut pas la faire porter dans te dio-
cefe d’un autre évêque, parce que la croix levée eft lin figne de jurifdiâion.
Il n’y a communément que les archevêques qui
ayent droit de porter le pallium, néanmoins quelques
évêques ont ce droit par une' concelfion fpejçiale
du pape. Voyei Pallüüm.
Quelques évêques ont encore d’autres marques
d’honneur fingulier.es ; par exempte, fejvant quelques
auteurs, Yévêque de Cahors a 1e privilège dans
certaines cérémonies de dire la meffe ayant fer l’au-
tel l’épée nu e, 1e cafque, & les gantelets, ce qui eft
relatif aux qualités qu’il prend de baron 6i de comte.
E V E 143
Plufieurs évêques d’Allemagne, qui font princes fouverains
, en ufent de même»
En France il y a fix évêques ou archevêques qui
font pairs eccléfiaftiques ; favoir, trois ducs & trois
comtes (voye^ Pairs) ; la plupart des autres évêques
poffedent aufli de grandes feigneuries attachées à
leur évêché. C ’eft de-là qu’ils ont été admis dans les
confeils du roi ; & dans les parlemens le refpeâ que
l’on a pour leur miniftere , a engagé à leur donner
dans tes affemblées 1e premier rang, q ui, fous les
rois de la p r e m i è r e race, a p p a r t e n o i t à la nobleffe.
On ne croit pourtant pas que ce foit à caufe de
leurs feigneuries, qu’on leur a donné la qualité de
monfeigneur, qu’ils font en ufage de fe donner entre
eux ; il paraît plûtôt qu’elle vient du terme fenior,
qui, dans la primitive égiife , étoit 1e titre commun
à tous les évêques & à tous tes prêtres : on les appel-
loit ainfi feniores ou fenieurs, parce qu’on choififfoit
ordinairement tes plus anciens des fideles pour gouverner
tes autres : on tes qualifîoit aufli de trhs-faints,
tris-pieux, 6c trls-vènérables ; préfentement on leur
donne 1e titre de révérendifftme.
A l’égard de l’ufage où l’on eft de défigner chaque
évêque par le nom de la ville où eft 1e fiége de ion
égiife, comme M. de Paris, M. de T ro y es, au lieu
de dire M. l’archevêque de Paris, M. Yévêque de
T ro y e s , ce n’eft pas d’aujourd’hui que cela fe pratique.
En effet Calvin dans fon livre intitulé la maniéré
de réformer VEgiife, a dit dès l’an 1548, quoi-
qu’en raillant, Monfieurd'Avranchcs, en parlant de
Robert Cenalis.
II étoit d’ufage autrefois de fe profterner devant
eux & de leur baifer tes p ies, ce qui ne fe pratique
plus qu’à l ’égard du pape : mais il eft encore demeuré
de cet ufage, que quand Y évêque marche étant revêtu
de fes ornemens épifeopaux , il donne de la
main des bénédi&ions que les afliftans reçoivent à
genoux.
Les nouveaux évêques, après leur facre, font ordinairement
une entrée folennelle dans la ville épil-
copale & dans leur égiife ; plufieurs .avoient le droit
d'être portés en pompe par quatre des principaux
barons ou vaffaux de Ieurravêché , appelles dans
quelques titres cafati majores ou homines epifeopi : dans
quelques diocefes ces vaffaux doivent à Y évêque une
gouttière ou cierge d’un certain poids.
Par exempte ,le s feigneurs de Corbeil, de Mont-
lhéri, la Ferté- Alais, 6c de M o n t j a y , d é v o i e n t >à
l’églife de Paris un cierge, & étoient tenus de porter
l'évêque, aufli-bien que tes feigneurs de Torey ,
Tournon, Lufarche, 6c Conflans Ste Honorine :.il
eft dit aufli dans quelques anciens aveux, que 1e feigneur
de Bretigni étoit un de ceux qui dévoient por-,
ter Yévêque à fon entrée.
Les évêques d’Orléans fe font toujours maintenus
en poffeflion de faire folennellement leur entrée, &
ont de plus 1e privilège en cette occafion de délivrer
des criminels ; ce privilège qu’ils tiennent de la pîé-
té de nos rois, avoit reçu ciTclevant beaucoup d’ex-
| tenfion. Les criminels ven.oi.ent alors de toutes: parts
fe rendre dans les prifons d’Orléans pour y obtenir
leur grâce, ce qui a été reftraint par un édit du mois
de Novembre 1753, dont nous parlerons çi-après au
mot Grâce.
Quelques évêques joiiiffent dans leur égiife d’un
droit de joyeux avenement, femblable à celui dont
le Roi eft en p.offeflion à fon avenement à la couronne.
M. Loiiet en donne un exemple de Vevêque
de Poitiers, qui fut confirmé dans .ce droit par arrêt
du parlement en 1 $.31, .
On trouve aufli qu’en 13 qo l'eveque de Clermont
avoit interdit fon diocefe, faute de pay ement des
redevances qu’il prétendoit pour fon joyeux avenement
3 1e roi Jean manda par lettres patentes à fon