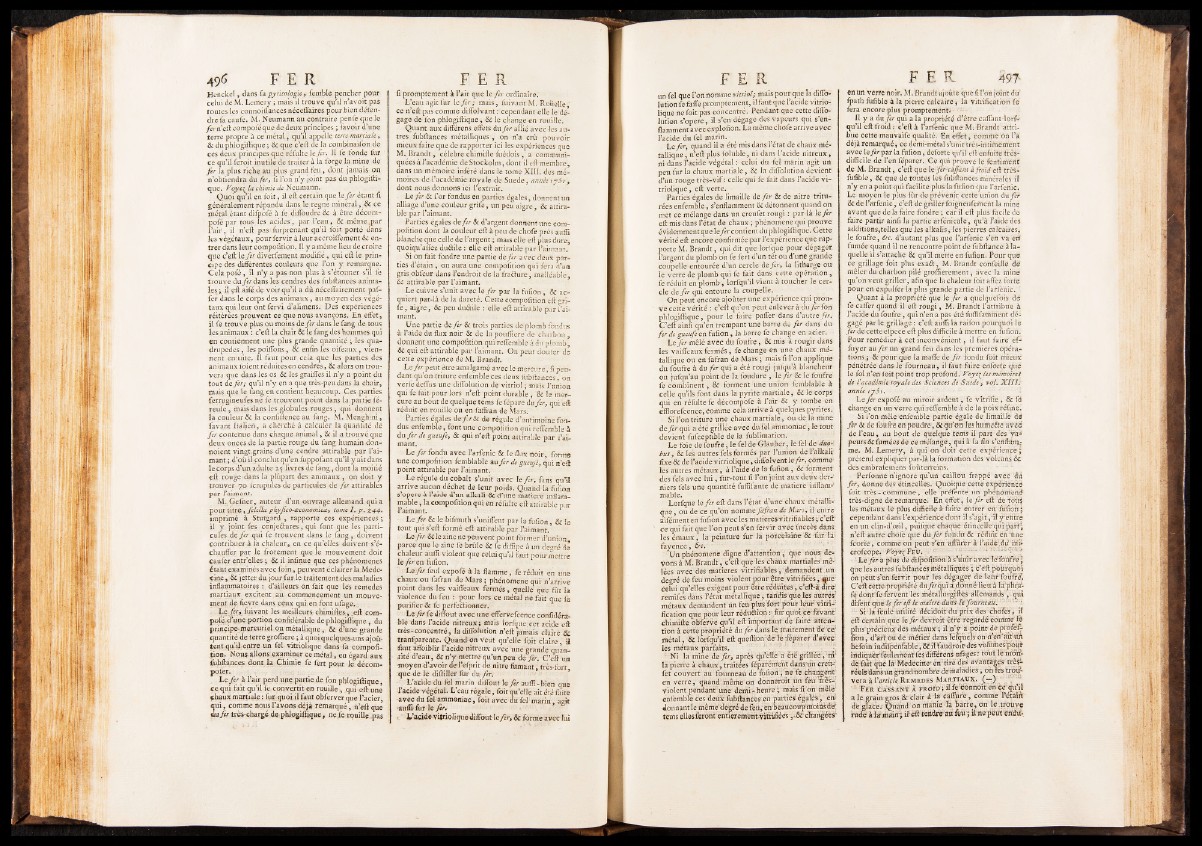
Henckel, dans fa pyritologie, femble pencher pour
celui de M. Lemery ; mais il trouve qu’il n’avoit pas
toutes les connoillances néceflair,es pour bien défendre
fa caufe. M. Neumann au contraire penfe que le
ferré eft compoféque de deux principes ; favoir d’une
terre propre à ce métal, qu’il appelle terre martiale,
& du phlogiftique ; 6c que c’eft de la combinaifon de
ces deux principes que réfulte h fit. Il fe fonde fur
ce qu’il feroit inutile de traiter à la forge l«i mine de
fer la plus riche au plus grand feu, dont jamais on
n’obtiendra du fer, li l’on n’y joint pas du phlogifti-
que. Voye^ la chimie de Neumann.
Quoi qu’il en foit, il eft certain que 1 efer étant fi
généralement répandu dans le régné minéral, & ce
métal étant difpofé à fe, diffoudre & à être décomposé
par tous les acides, par l’eau, 6c même^ar
l’air, il n’eft pas'furprenant qu’il l'oit porté dans
les végétaux, pour fervir à leur accroiflèment 6c entrer
dans leur compofition, Il y a même lieu de croire
que c’eft le fer diverfement modifié, qui eft le principe
des differentes couleurs que l’on y remarque.
Cela p ofé, il n’y a pas non plus à s’étonner s’il fe
trouve duÿèr dans les cendres des fubftances animales
il eft aifé de voir qu’il a dû néceffairement paf-
fer dans le corps des animaux, au moyen des végétaux
qui leur ont fervi d’alimens. Des expériences
réitérées prouvent ce que nous avançons. En effet,
il fe trouve plus ou moins de fer dans le fang de, tous
les animaux : c’eft la chair 6c le fang des hommes qui
en contiennent une plus grande quantité ; les quadrupèdes
, les poiflbns., & enfin les oifeaux, viennent
eniuite. Il faut pour cela que les, parties des
animaux foient réduites en cendres, 6c alors on trouvera
que dans les os & les grailles il n’y a point du
tout de fer; qu’il n’y en a que très-peu dans la chair,
mais que le fang en contient beaucoup. Ces parties
ferrugineufes ne fe trouvent point dans la partie fé-
reul'e, mais dans les globules-rouges, qui donnent
la couleur & la confidence au fang. M. Menghini,
favant Italien, a cherché à calculer la quantité de
fer contenue dans chaque,animal, &.il a trouvé que
deux onces de la partie rouge du fang humain don-
noient vingt,grains d’une cendre attirable par l’aimant
; d’où il-£onclut qu’en fuppofant qu’il y ait dans
le Corps d’un adulte livres de fang, dont la moitié
eft rouge dans la plupart des animaux , on doit y
trouver 79 fcrupules de particules de fer attirables
par l’aimant.
M._Gefner, auteur d’un ouvrage allemand quia
pour titre, felccla phyjicortecpnomica, tome I. p. 244.
imprimé à Stutgard , rapporte ces expériences ;
il y joint fes conjectures, qui font que les particules
de fer qui fe trouvent dans le.fang, doivent
contribuer à la chaleur, en ce qu’elles doivent's’échauffer
par le frotement que le mouvement doit
caufer entr’elles ; 6c il infinue que ces phénomènes
étant examinés avec foin, peuvent éclairer la Médecin
e, 6c jefter du jour fur le traitement des maladies
inflammatoires : d’ailleurs on fait que les remedes
martiaux excitent au commencement un mouvement
de; fievre dans ;ceux qui en font ufage^
Lefer, fuivant les meilleurs chimiftes:, ..eft com-
pofé, d Vî1e portion confidérable de phlogiftique, du
principe:mercuriel ou métallique, & d’une grande
quantité de terre grofliere ; à quoiquelques-unsajoutent
qu’il.entre un fel vitriolique dans fa compofi-
tion. Nous allons examiner ce métal, eu égard aux
fubftances dont la Chimie fe fert pour le décom-
poier, ,
Le fer à l’air perd une partie de fon phlogiftique,
ce qui fait qu’il fe convertit en ro.uiüe| qui eft une
chaux martiale : fur quoi il faut obferver que l’acier,
qui, comme nous l’avons déjà remarqué, n’eft que
ou fer très-chargé de phlogiftique , nç.lè rouiUe .pas
fi promptement à l’air que le fer ordinaire.'
L’eau agit fur. le fer; mais, fuivant M. Rotielîe '
ce n’eft pas comme diffolvant : cependant elle le dégage
de fon phlogiftique, & le change en rouille.
Quant, aux differens effets du fer allié avec les autres
fubftances métalliques ,- on n’a crû pouvoir
mieux faire que de rapporter ici les expériences que
M. Brandt, célébré chimifte fuédois , a communiquées
à l’académie deStockolm, dont il e f t m e m b r e ,
dans un mémoire inféré dans le tome XIII. des mé^-
moires de l’académie royale de Suede, année iy S t,
dont nous donnons ici l’extrait.
- Le fer & l’or fondus en parties égales, donnent un
alliage d’une couleur grife, un peu aigre, 6c attirable
par l’aimant.
Parties égales de fer 6l d’argent donnent une compofition
dont la couleur eft à peu de chofe près aufli
blanche que celle de l’argent ; mais elle eft plus dure,
quoiqu’aflèz duétile : elle eft attirable par l’aimam.
Si on fait fondre une partie de fer avec deux parties
d’étain , on aura une compofition qui fera d’un
gris obfcur dans l’endroit de la frafture, malléable,
6c attirable par l’aimant.
Le cuivre s’unit avec le fer par la fufion, & acquiert
par-là de la dureté. Cette compofition eft gri-
l e , aigre, 6c peu duâile : elle eft attirable par l’aimant.
Une partie de fer & trois parties de plomb fondus
à l’aide du flux noir & de la poufliere de charbon ,
donnent une compofition qui reflemble à du plomb,
6c qui eft attirable par l’aimant. On peut douter de
cette expérience de M. Brandt.
.Le fer peut être amalgamé avec le m e r c u r e , fi pendant
qu’on triture enfemble ces deux fubftances, on
verfe defïùs une diflolution de vitriol ; mais l’union
qui fe fait pour lors n’eft point durable, 6c lé mercure
au bout de quelque tems fe fépare du fer, qui eft
réduit en rouille ou en faffran de M a r s . ‘
Parties égal es d e 'fr 8c de régule d’antimoine fondus
enfemble, font une compofition qui reffembie à
du fer de gueufe, & qui n’eft point attirable par i’ai-
mant.
Le fer fondu avec l-’arfenic &.le flux noir , forme
une compofition femblable au fer de gueufe, qui n’eft
point attirable par l’aimant.
Le régule du cobalt s’unit avec le fer, fans qu’il
arrive aucun déchet de leur poids. Quand la fufion
s’opère à l’ aide d’un alkali & d’une matière inflammable
, la compofition qui en réfulte eft attirable par
-l’aimant. ••■■■■■
Le fer & le bifinuth s’uniffent par la fufion, 6c le
tout qui s’eft formé eft attirable par Paimant.
Le fer 6c le zinc ne peuvent point former d’union,
parce que le zinc fe brûle & fe diffipe à un de*ré de
chaleur aufli violent que celui qu’il faut pour mettre
le fer en fufion.
Lefer.feul expofé à-la flamme, fe réduit en une
chaux ou fafran de Mars ; phénomène qui n’arrive
point dans les vaiffeaux fermés, quelle que fût la
violence dù feu : pour lors ce métal ne fait que fe
purifier & fe perfectionner.
Leferfe diffout avec une effervefcence confidérable
dans l’acide nitreux ; mais lorfque cet acide eft
-très-concentré, la diflolution n’eft jamais claire 6c
trarrfparente. Quand On v'éut qu’elle foit claire il
faut affbiblir l’acide nitreux avec line grande quantité
d’eau, & n’y mettre qu’un peu dé fer. C ’eft un
moyen d’avoir de l’éfprit de nitre fumanttrès-fort,
que de le diftillër fur du fer.
- L’acide du fol marin diffout le fer aufli-bien que
l ’acide végétal. L’eau régale, foit qu’elle ait été faite
•avec du fêi ammoniac, l'oit avec-du fel marin, agit
-aufli fur le f e r .
< L’acid© vitriolique diffout- le fer; 6c forme avec lui
un fel que l’on nomme vitriol; mais pour que la di Ablution
fe faffe promptement, il faut que l’aciclé; vitriol
lique ne foit pas concentré. Pendant que cette diflo-
lution s’opère, il s'en dégage des vapeurs qui s’enflamment
avec explofion. La même chofe arrive avec
l’acide du fel marin.
Le fer, quand il a été mis darisl’état de chaux métallique
, n’eft plus fbluble, ni dans l ’acide nitreux,
ni dans l’acide végétal : celui du fel marin agit un
peu fur la chaux martiale, & la diflolution devient
d’un rouge très-vif : celle qui fe fait dans l’acide vitriolique,
eft verte.
Parties égales de limaille de fer & de nitre triturées
enfemble, s’enflamment 6c détonnent quand on
met ce mélange dans un creufet rougi : par-là 1 efer
eft mis dans l’état de chaux ; phénomène qui prouve
évidemment que le fer contient du phlogiftique. Cette
vérité eft encore confirmée par l’expérience que rapporte
M. Brandt, qui dit que lorfque pour dégager
l’argent du plomb on fe fert d’un têt ou d’une graride
coupelle entourée d’un cercle de fer, la litharge otr
le verre de plomb qui fe fait dans cette operation,
fe réduit en plomb-, lorfqu’il vient à toucher le cercle
de fer qui entoure la coupelle.
On peut encore ajoûter une expérience qui prouv
e cette vérité : c’eft qu’on peut enlever à du fer fon
phlogiftique, pour le faire paffer dans d’autre fer.
C ’eft ainfi qu’en trempant une barre de fer dan* du-
fer de gueufe en fufion, la barre fe change en acier.
Le fer mêlé avec du foufre, & mis à rougir dans
les vaiffeaux fermés, fe change en une chaux métallique
ou en fafran de Mars ; mais li l’on applique
du foufre à du fer qui a été rougi jufqu’à blancheur
ou jufqu’au point de la foudure , 1e fer 6c le foufre
fe combinent, & forment une union femblable à
celle qu’ils font dans la pyrite martiale, 6c le'corps
qui en réfulte fe décompofe à l’air 6c y tombe en
efflorefcence, comme cela arrive à quelques pyrites.
Si l’on triture une chaux martiale, ou de.la mine
de fer qui a été grillée avec du lel ammoniac, le tout
devient fufceptible de la fublimation.
Le foie de loufre, le fel de Glauber, le fel de duo--
bus, 6c les autres felsformés par l’union d e l’alkali
fixe 6c de l’acide vitriolique, diffolvent 1 efer, comme-
lès autres métaux, à l’aide de la fufion, & forment
des fels avec lu i, fur-tout fi l’on jbint aux deftx derniers
fels une quantité fuffifante de matière ïrfflâm-
mable. ; -
Lorfque le fer eft dans l’état d’une-chaux méràHi-
que, ou de ce qu’on nomme fafran de Mars; il entre
àifément en fufion avec les matières vîtrifiables ; c’eft1
ce qui fait que l ’on peut s’en fervir avec fuccès dans,
les émaux, la peinture fur la poÈcëtaihe 6c fiir/lài
fayence ,& c . ■
Un phénomène digne d'àttehtîoiï^.' que' • ndïits; 3c-
Vbns à M. Brandt, c’eft que les chàùx niartialés mêlées
avec .des matières vitrifiables ; .demandent .uii
degré de Feu moihs violent pour être vitrifiées, ^ue
celui qu’elles exigent pouf être réduites, c’eft-à dirè^
remifes dans l’ état métallique, tàridis qiie les afitrés'
métaux demandent Un feri plusTbrt pour leur vitri--
fication que pbùr leur rédtîûicfl r .fttr quoi cè-fëvant'
chimifte. obferve qu’il eft impe^tàr^ de faire uftën^
tion à cette propriété du fer dails le traitement fféce'
métal, 6c iarfqu’il eft queftibn^ê* lè -fé^aref d’avec1
lès métaux parfaits. , “ f j - f
' Ni la mine de fer, après cju’ ëfîè1 !a‘ été grïlfeë:,itil*
là pierre à chaux1, traitées fépatéhreht dans,mil creù-'
fét couvert au fourneaû de fofiori j rne fe cnàngë'rrt‘
en verre, quand mêihe on donnerdit Un féit
violent pendant une demi-heurè1;, mais l^'orr mêle
enfemble ces deux fubftancesen parties égalés
donnant le même' degré de fbti,' èh 'beàüédup'mbiûS dh'
tems elles feront entierement-vitrifiées ,-àc changées
en lin verre noir. M. Brandt ajoute que fil’ott jbint du
fpath fufible à la pierre calcaire -, là vitrification fe
fera encore plus promptement/- •;
Il y a du fer qui a la propriété d’être caffant lorf--
qu’il eft froid : c’eft à l’arfenic que M; Brandt attribue
cette mauvaife qualité. En effet, cbmrtië'ôn l’à
déjà remarqué, ce clertfométal s’unittrès-intimement
avec le fer par la fufibn, deforte qu’il eft enfnrte tfès-
difficile de l’en féparer. Ge qui prouvé le fentimëtit
de M. Brandt ; c’eft que le 'fer^càjfam à froid eft très-
fufible, 6c que de toutés les fubftàncés minéràlès il
n’y en a point qui Facilite plus la ftilion que l’arfeilic.
Le moyen le plus fûr de prévenir cette union du fei
6c de l’arfenic, c’eft de griller fbignèufement la miné
avant que de la faire fondre ; car il eft plus facile de
faire partir ainfi la partie ârfénicâle, qu’à l’aide des
additions,telles qüè les alkàlis, lés pierres calcaires,
le foufre, &c. d’autant plus que l’arfenic s’eh va eri
fumée quand il ne rencontre point de fubftance à fa-
quelle il S’attache 6c qu’il mette èn fufion. Pour que
ce grillagé foit plus exaft, M. Brandt confèille d e
meier du charbon pilé groflierement, avec la mine
qu’on veut griller, afin que la chaleur foit àffez forte
pour en expulfer la plus graiïde partie de l’arfénic.
Quant à la propriété que le fer a quelquefois de
fe caffer quand il eft rougi, M. Brandt l'attribue à
l’acide du foufre, qui n’en à pas été fuffifamrnent dégagé
par le grillage : c’eft aufli la raifort pourqubi le
fer de cêt-te elpeee eft plus difficile à mettre en rufion.
Pour remédier à cet inconvénient, il faut faire' efi*
fuyer au fer un grand feu dans les premières Opérations.
j & -pour que la maffe de fer fondu foit mieux
pénétrée dans lé fourneau j il faut-faire enforte que
le fol ii’en foit point trop profond. Voyellesmérhoirei_
de l'académie royale des Sciences dé Suide, vól. X I I I ;
année r jé i . ' •
Le fer expofé-au miroir ardent1, fê vitrifie, & fé
change en lin verre qui reffemble à de la poix réfine.
Si l’on mêle enfemble. partie égale de limaille dé
fer & de foufre èn poudre, & qu’on les hunleéte avec
de l’eau, au bout de quelque tems il part;dés vapeurs
& fumées de ce mélangé, qui à la fin s’ëhffâm;
me. M. Lemefy, à qui ori doit cette expërten'çë \
prétend expliquer par-là la formation des volcans 6c
des embralemens foûterreins., !
P e r f o n r t è n ’ i g n o r é q u ’ u n c a i l l o u f r a p p é a v e c 'd i t
fer, d o n n e d e s é t i n c e l l e s . Q u o i q u e c e t t e e x p é r i e n c e
f o i t t r è s - c o m m u n e , e l l e p r é f e n t é u n p h é f ib m 'e n t f
t r è s - d i g n e d e r em a r q u e ^ E n e f f e t , le '^ S r e f t d e
l e s m é t a u x l e p l u s d i f f i c i l e à f am é e h f r é r e q ' 'f t r f i o i r |
c é p e n d a n t d a n s l ’ e X p é f i e i f e é < îo h t ü s-’ a g i f , - r l ÿ ' ë f ï t r è
e n u n c l i n - d ’ o e i l , p u i fq ù é - '^ r a c p i e • é tr r ic ê li fe ' dtti;
n ’ e f t a u t r e c h o f e q u e d ü fér ïdiï<dix 6c f ê f lù ^ t ë h 'f i n e
f e o r i e , c o m m e o n p e u t s ’ e n a f f û f o r à l ’ a id é ' .d i f m i t
c r o f c o p e . 'V6ye\ F e ü . : ‘ c f :
1 L e^Kà plus dedifpbi^iôh .à'is’tnnr'àvw lëfôûiffé;''
que les autres' fiibftàhcésmëtalliqttës ; t ’èft, jfoifrqùbi
on petit s’en .fetvîr pour lés dégagef dé le û f fotlFtd.
C’eft cette:j)ropfiété du j^rqifr a dcmné lietï t l^JjHrà1-
fë dofiélefer ventlés m étàllnr^ë^lleihattdé-^'mîi
difent qne lê fctrtjlle rHdittè d^aii^ ïé'foùThidu; j -1 ? S
- S i l l â f e t i i ë 'u f r l i f é d é c i d ô i t 'd u p r ï x d e s c,è h ö fe ?S y H
e f t c e i't â lh .q t i .è ' 1efir d ë v i f o i t ê t F é ' f é ^ d é c ô 'm h T e l è
p h iS 'j i i - ë d iè t i^ 'd ë s m é t a u x -, i l n V à m ô i r i t d e p f o f é f f
f t b n , d ’ a r i o û d e h t é t i ë f d a n s
b e f o i n i n d i f p ë i î l a b l é y S é i l f a ù d r o i t 'd e s v b f i im e s q ib i j f
i r td iq i ,i è r f ê û l e îh e h t f e $ d r f f é f e n i é u l a g e v : tc r iit l è 'n f o f f -
d è ^ fè it q ù ë l à ' M e d é c m e ' é n ‘ t i r é dçs^ a V à n fâ g é s ' tre ÿ î -
r é e lV d a r i s u n g f à h d h b m b V e d é i f i^ l à d i e s ; b h l é s t r o u v
e r a à Yartiflç R e m e d e s Ma r j ia u x . ( - r ) ' . _
F e r t A - s s A N T Â fr o id ; ' i l f e b o n n b ï t e n ç e 'q iL ’ i l
a l e . g r a i n g r o s ,&■ c l a i r à l a c à f f u r e , c o r tm f e P e t â i fiT
d é g l a c e . - Q i t â h d o n m a flie .- l'à b à r i e , o n l e . t r o u v e
ttide à l a i h a i i f ; f t e f t t e n d r e a u fe irj |