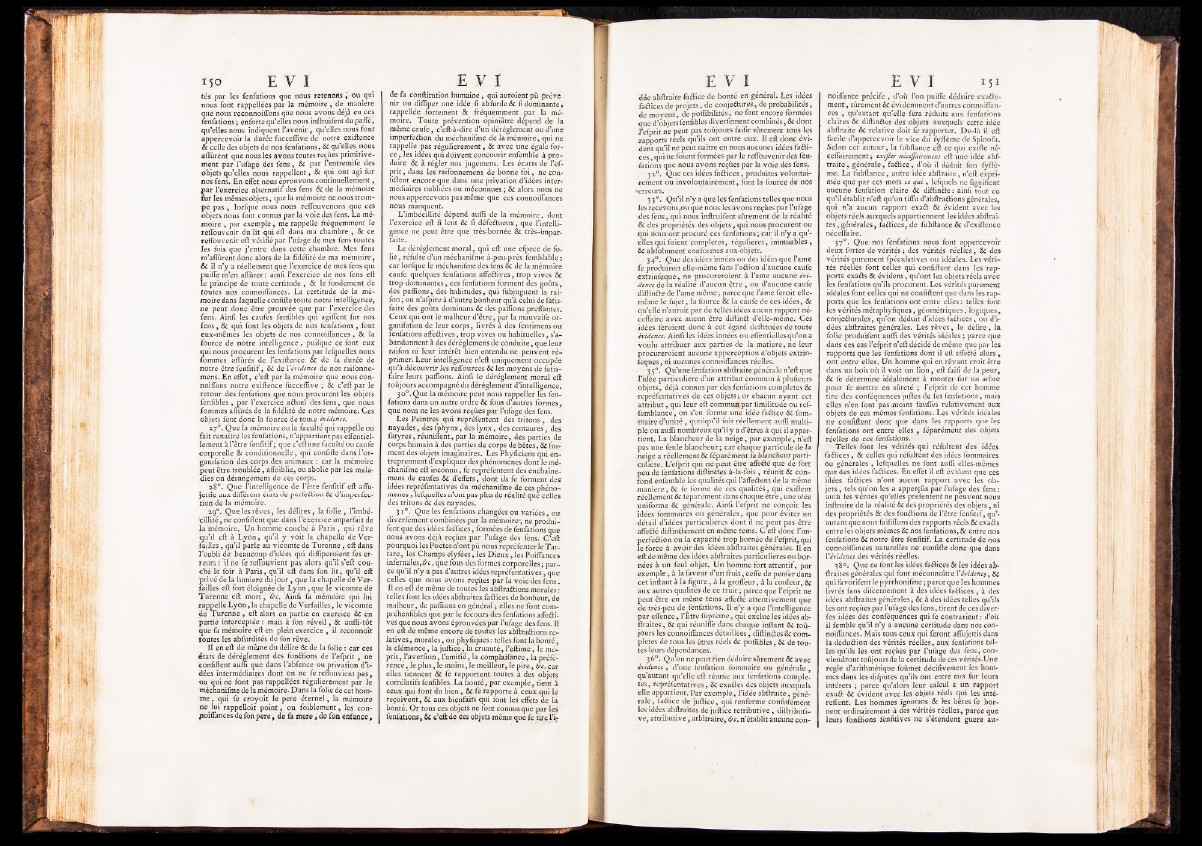
tés par les fenfations que nous retenons \ ou qui
nous font rappellées par la mémoire , de maniéré
que nous reconnoiflbns que nous avons déjà eu ces
fenfations ; enforte qu’elles nous inftruifent du palfé,
qu’elles nous indiquent l’avenir, qu’elles nous font
appercevoir la durée fiicceflive de notre exiftence
& celle des objets de nos fenfations, 8c qu’elles nous
a (Turent que nous les avons toutes reçûes primitivement
par l’ufage des fens, 8c par l’entremife des
objets qu’elles nous rappellent, & qui ont agi fur
nos fens. En effet nous éprouvons continuellement,
par l’exercice alternatif des fens 8c de la mémoire
lur les mêmes objets, que la mémoire ne nous trompe
pas , lorfque nous nous reffouvenons que ces
objets nous font connus par la voie des fens. La mémoire
, par exemple, me rappelle fréquemment le
reffouvenir du lit qui eft dans ma chambre , & ce
reffouvenir eft vérifié par l’ufage de mes fens toutes
les fois que j’entre dans cette chambre. Mes fens
m’aflurent donc alors de la fidélité de ma mémoire,
& il n’y a réellement que l’exercice de mes fens qui
puifle m’en, aflïirer : ainfi l’exercice de nos fens eft
le principe de toute certitude , & le fondement de
toutes nos connoiflances. La certitude de la mémoire
dans laquelle confifte toute notre intelligence,
ne peut donc être prouvée que par l’exercice des
fens. Ainfi les caufes fenfibles qui agiffent fur nos
fens, 8c qui font les objets de nos fenfations , font
eux-mêmes les objets de nos connoiflances, & la
iource de notre intelligence, puifque ce font eux
qui nous procurent les fenfations par lefquelles nous
tommes affûrés de l’exiftence 8c de la durée de
notre êtrefenfitif, & de l’évidence de nos raifonne-
mens. En effet, c’eft par la mémoire que nous con-
noiffons notre exiftence fuecefîive ; 8c c’eft par le
retour des fenfations que nous procurent les objets
fenfibles , par l’exercice aduel des fens, que nous
tommes aflurés de la fidélité de notre mémoire. Ces
objets font donc la fource de toute évidence.
17°. Que la mémoire on la faculté qui rappelle ou
fait renaître les fenfations, n’appartient pas eflëntiel-
lement à l’être fenfitif ; que c’eft une faculté ou caufe
corporelle & conditionnelle, qui confifte dans l’or-
ganifation des corps des. animaux : car la mémoire
peut être troublée, affoiblie, ou abolie par les maladies
ou dérangemens de ces corps.
z8°. Que l’intelligence de l’être fenfitif eft aflii-
jettie aux différens états de perfedion 8c d’imperfection
de la mémoire.
29°. Que les rêves, les délires, la folie , l’imbécillité
, rie confident que dans l’exercice imparfait de
la mémoire. Un homme couché à Paris , qui rêve
qu’il eft à L y on , qu’il y voit la chapelle dé Ver-
failles , qu?il parle au vicomte de Turenne, eft dans
l ’oubli de beaucoup d’idées qui difliperoiént fes erreurs;
il ne fe reffoiiÿièht pas alors qu’il s’eft couché
le foir à Paris, qu’il eft dans fon lit , qu’il éft
privé de la lumière dit jour, que la chapelle de Ver-
failles eft fort éloignée de L y on , que le vicomte de
Türenne eft mort, &c. Ainfi fa mémoire qui lui
rappelle L yon, la chapelle de Verfailles, le vicomte
de Turenné , eft alors en partie en exercice 8c en
partie interceptée : mais à fon réveil, & aufli-tôt
que fa mémoire eft en plein exercice , il reconnoît
toutes les abfurdités de fon rêve.
Il en eft de même du délire 8c de la folie : car ces
états de déréglement des fondions de l’efprit , ne
confident aufli que dans l’abfence ou privation d’idées
intermédiaires dont on ne fe reffouvient pas,
ou qui ne font pas rappellées régulièrement par le
méchanifme de la mémoire. Dans la folie de cet homme
, qui fe croyoit le pere éternel, la mémoire
ne lui rappelloit point, ou foiblement, les con-
poiffances de fon pere, de fa mere > de fon enfance,
de fa conftitution humaine, qui auroient pû préve
nir ou difliper une idée fi abfurde 8c fi dominante,
rappellée. fortement & fréquemment par la mémoire.
Toute prévention opiniâtre dépend de la
même caufe, c’eft-à-dire d’un déréglement ou d’une
imperfedion du méchanifme de la mémoire, qui ne
rappelle pas régulièrement, & avec une égale force
, les idées qui doivent concourir enfemble à produire
8c à régler nos jugemens. Les écarts de l’ef-
prit, dans les raifonnemens de bonne fo i, ne confident
encore que dans une privation d’idées intermédiaires
oubliées ou méconnues ; & alors nous ne
nous appercevons pas même que ces connoiflances
nous manquent.
L’imbécillité dépend aufli de la mémoire, dont
l’exercice eft fi lent 8c fi défedueux, que l’intelligence
ne peut être que très-bornée 8c très-imparfaite.
Le déréglement moral, qui eft une efpece de folie
, réfulte d’un méchanifme à-peu-près femblable :
car lorfque le méchanifme des fens 8c de la mémoire
caufe quelques fenfations affedives, trop vives 8c
trop dominantes, ces fenfations forment des goûts,
des pallions, des habitudes, qui fubjuguent la rai-
fon ; on n’afpire à d’autre bonheur qu’à celui de fatis-
faire des goûts dominans 8c des paflîons preffantes.
Ceux qui ont le malheur d’être, par la mauvaife or-
ganifation de leur corps, livrés à des fentimens ou
fenfations affedives, trop v ives ou habituelles, s’abandonnent
à des déréglemens de conduite, que leur
raifon ni leur intérêt bien entendu ne peuvent réprimer.
Leur intelligence n’eft uniquement occupée
qu’à découvrir les reflources 8c les moyens de fatis-
faire leurs pallions. Ainfi le déréglement moral eft
toujours accompagné du déréglement d’intelligence.
30°. Que la mémoire peut nous rappeller les fenfations
dans un autre ordre 8c fous d’autres formes,
que nous ne les avons reçûes par l’ufage des fens.
Les Peintres qui repréfentent des tritons , des
nayades, des fphynx, des lyn x, des centaures, des
fatyres, réunifient, par la mémoire, des parties de
corps humain à des parties de corps de bêtes, 8c forment
des objets imaginaires. Les Phyficiens qui entreprennent
d’expliquer des phénomènes dont le méchanifme
eft inconnu, fe repréfentent des enchaîne-
mens de caufes 8c d’effets, dont ils fe forment des
idées repréfentatives du méchanifme de ces phénomènes
, lefquelles n’ont pas plus de réalité que celles
des tritons 8c des. nayades.
31°. Que les fenfations changées ou variées, ou
diverfement combinées par la mémoire*, ne produi-
fent que des idées fadices, formées de fenfations que
nous avons déjà reçûes par l’ufage des fens. C ’eft
pourquoi les Poètes n’ont pû nous repréfenter le Tar-
tare, les Champs elyfées, les D ieux, les Puiffances
infernal es, de . que fous des formes corporelles; parce
qu’il n’y a pas d’autres idées repréfentatives, que
celfes que nous avons reçûes par la voie des fens.
Il en eft de même de toutes les abftradions morales:
telles font les idées abftraites fadices de bonheur, de
malheur, de paflîons en général ; elles ne font com-
préhenfibles que par le fecours des fenfations affectives
que nous avons éprouvées par l’ufage des fens. II
en eft de même encore de toutes les abftradions relatives
, morales, ou phyfiques : telles font la bonté,
la clémence, la juftice, la cruauté, l’eftime, le mépris,
l’averfion, l’amitié, la complaifance, la préférence
, le plus, le moins, le meilleur, le pire, &c. car
elles tiennent 8c fe rapportent toutes à des objets
corrélatifs fenfibles. La bonté, par exemple, tient à
ceux qui font du bien, 8c fe rapporte à ceux qui le
reçoivent, 8c aux bienfaits qui font les effets de la
bonté. Or tous ces objets ne font connus que par les
fenfations, 8c c’eft de ces objets même que fe tire l’idóe
abftràite fadiee de bonté en général. Les idées
fadices de projets, de conjedures, de probabilités,
de moyens, de poflibilités, ne font encore formées
que d’objeîsfenfibles diverfement combinés ; 8c dont
l’efprit ne peut pas toûjours faifir sûrement tous les
■ rapports reels qu’ils ont entre eux. Il eft donc évident
qu’il ne peut naître en nous aucunes idées factices
, qui rre foient formées par le reffouvenir des fen-
-fations qüe nous avons reçûes par la voie des fens.
•; 3 Z0.. Que ces idées factices, produites volontairement
ou involontairement, font la fource de nos
•erreurs.
330. Qu’il n’y a que les fenfations telles que nous
-les recevons,ou que nous les avons reçûes par l’ufage
des fens , qui nous inftruifent sûrement de la réalité
8c des propriétés des objets, qui nous procurent ou
qui nous ont procuré ces fenfations ; car il n’y a qu’elles
qui foient complétés, régulières, immuables,
8e ablolument conformes aux objets;
34°. Que dés idées innées ou des idées que l’ame
fe produiroit elle-même fans l’adion d’aucune caufe
extrinfeque j ne procureroient à 1’aiöe aucune évidence
de la réalité d’aucun être , ou d’aucune caufe
diftinde de l’ame même; parce que l’ame feroit elle-
même le fujet, la fource 8c la caufe de ces idées, 8c
q u ’elle n’auroit par de telles idées aucun rapport né-
ceffaire avec aucun être diftind d’eile-meme. Ces
-idées feroient donc à cet égard deftituées dé toute
évidence. Ainfi les idées innées ou eflëntielles qu’on a
voulu attribuer aux parties de la matière, ne leur
procureroient aucune apperceptioli d’objets extrin-
ieques, ni aucunes connoiflances réelles.
3 50. Qu’une fenfation abftraite générale n’eft que
l ’idée particuliere d’un attribut commun à plufieurs
objets, déjà connus par des fenfations complétés 8c
-repréfentatives' de ces objets; or chacun ayant cet
attribut, qui leur eft communpar fimilitude ou ref-
■ femblanee, on s’en forme une idée fadiee 8C fom-
maire d’unité, quoiqu’il foit réellement aufli multiple
ou aufli nombreux qu’il y a d’êtres à qui il appartient.
La blancheur de la neige, par exemple, n’eft
•pas une feule blancheur; car chaque particule de la
.neige a réellement 8c féparément la blancheur particuliere.
L’efprit qui ne peut être affedé que de-fort
peu de fenfations diftindes à-la-fois , réunit 8c confond
enfemble les qualités qui l’àffedent de la même
-maniéré, 8c fe forme de ces qualités, qui exiftent
réellement 8c féparément dans chaque être, une idée
uniforme 8c générale. Ainfi l’efprit rie conçoit les
idées fpriîmaires ou générales $ que pour éviter un
-détail d’idées particulières dont il ne peut pas être
affedé diftindement en même teins. C ’eft donc l’im-
perfedion ou la capacité trop bornée de l’efprit, qui
le force à avoir des idées abftraites générales. Il en
eft de même des idées abftraites particulières ou bornées
à un feul objet. Un homme fort attentif, par
exemple, à la faveur d’un fruit, celfe de penfer dans
cet inftant à la figure, à la groffeur, à la couleur, 8c
aux autres qualités de ce fruit ; parce que l’efprit ne
peut être en même tems affedé attentivement que
de très-peu de fenfations. Il n’y a que l’intelligence
par effence, l’Être fuprème, qui exclue les idées abftraites
, 8c qui réunifie dans chaque inftant 8c toûjours
les connoiflances détaillées, diftindes 8c complétés
de tous les êtres réels 8c poflibles, 8c de toutes
leurs dépendances. 3&°* Qu’on ne peut#ien déduire sûrement 8c avec
évidence, d’une lénfation fommaire ou générale
qu’autant qu’elle eft réunie aux fenfations complétés,
repréfentatives , 8c exades des objets auxquels
elle appartient. Par exemple, l ’idée abftraite, générale
, fadiee de juftice, qui renferme eonfufément
les idées abftraites de juftice rétributive, diftributi-
ve, attributive, arbitraire, &c. n’établit aucune connoilfancé
précife , d’où l’on puifle déduite exade-
ment, sûrement 8c évidemment d’autres connoiflances
, qu’autant qu’elle fera réduite aux fenfations
claires 8c diftindes des objets auxquels cette idée
abftraite 8c relative doit fe rapporter. De-là il eft
facile d’appercevoir le vice du fyftème de Spinofa.
Selon cet auteur, la fubftance eft ce qui exifte né-*
ceflairement ; exijler nécejfairement eft une idée abftraite
, générale, fadiee, d’Où il déduit fon fyftè-
me. La fubftance, autre idée abftraite, n’eft exprimée
que par ces mots ce qui , lefquels ne lignifient
aucune fenfation claire 8c diftihde : âinfi tout eé
qu’il établit n’eft qu’un tiflii d’abftradions générales,
qui n’a aucun rapport exad 8c évident avec les
Objets réels auxquels appartiennent les idées abftraites
, générales, fadices, de fubftance 8c d’éxiftence
néeelfaire.
370. Que nos fenfations nous font appercevoir
deux fortes de vérités ; des vérités réelles, 8c des
vérités purement fpéculatives ou idéales. Les vérités
réellès font celles qui confident dans les rapports
exads & évidens, qu’ont les objets réels avec
les fenfations qu’ils procurent. Les vérités purement
idéales font celles qui ne confident que dans les rapports
que les fenfatioris ont entre elles : telles font
les vérités métaphyliques, géométriques, logiques,
conjeduralès, qu’on déduit d’idées fadices, ou d’idées
abftraites générales. Les rêves, le délire, la
folie produifent aufli des vérités idéales ; parce que
dans ces cas l’efprit n’eft décidé de même que par les
rapports que les fenfations dont il eft affedé alors ,
ont entre elles. Un homme qui en rêvant croit être
dans un bois où il voit un lion, eft faili de la peur,
8c fe détermine idéalement à monter fur un arbre
pour fe mettre en sûreté ; l’efprit de cet homme
tire des coriféquenees juftes de fes fenfations, mais
elles n’en font pas moins faulfes relativement aux
objets de ces mêmes fenfations^ Les vérités idéales
ne confiftent donc que dans les rapports que les
fenfations ont entre elles , féparément des objets
réelles de ces fenfations.
Telles font les vérités qui réfulterit des idées
fadices, & celles qui réfultent des idées fommaires
ou générales , lefquelles ne, font aufli elles-mêmes
que des idées fadices. En effet il eft évident que ces
idées fadices n’ont aucun rapport avec les objets
, tels qu’on les a apperçûs par l’ufage des fens ;
ainfi les vérités qu’elles préfentent ne peuvent nous
inftruire de la réalité éc des propriétés des objets, ni
des propriétés 8c des fondions de l’être fenfitif, qu’-
autant que nous faififfons des rapports réels 8c exads
entre les objets mêmes 8c nos fenfations, 8c entre nos
fenfations 8c notre être fenfitif La certitude de nos
connoiflances naturelles, ne confifte donc que dans
l'évidence des vérités réelles;
38°. Que ce font les idées fadices 8c les idées abftraites
générales qiii font méconnoître Vévidence, 8c
qui favorifent le pyrrhonifriie ; parce que les hommes
livrés fans difeernement à des idées fadices , à des
idées abftraites générales j 8c à des idées telles qu’ils
lés ont reçûes par l’ufage des fens, tirent de ces diver-
fes idées des conféquences qui fe contrarient : d’où
il femble qu’ il n’y a aucune certitude dans nos con-
•noiflances. Mais tous ceux qui feront alfujettis dans
la dédudion des vérités réelles, aux fenfations telles
qu’ils les ont reçûes par l’ufage des fens, conviendront
toûjours de la certitude de ces vérités.Une
réglé d’arithmétique foûrriet décifivement les hommes
dans les difputes qu’ils ont entre eux fur leurs
intérêts ; parce qu’alors leur calcul a un rapport
exad 8c évident avec les objets réels qui les itité-
reflent. Les hommes ignorans 8c les bêtes fe bornent
ordinairement à des vérités réelles, parce que
leurs fondions fenfitives ne s’étendent guere au*