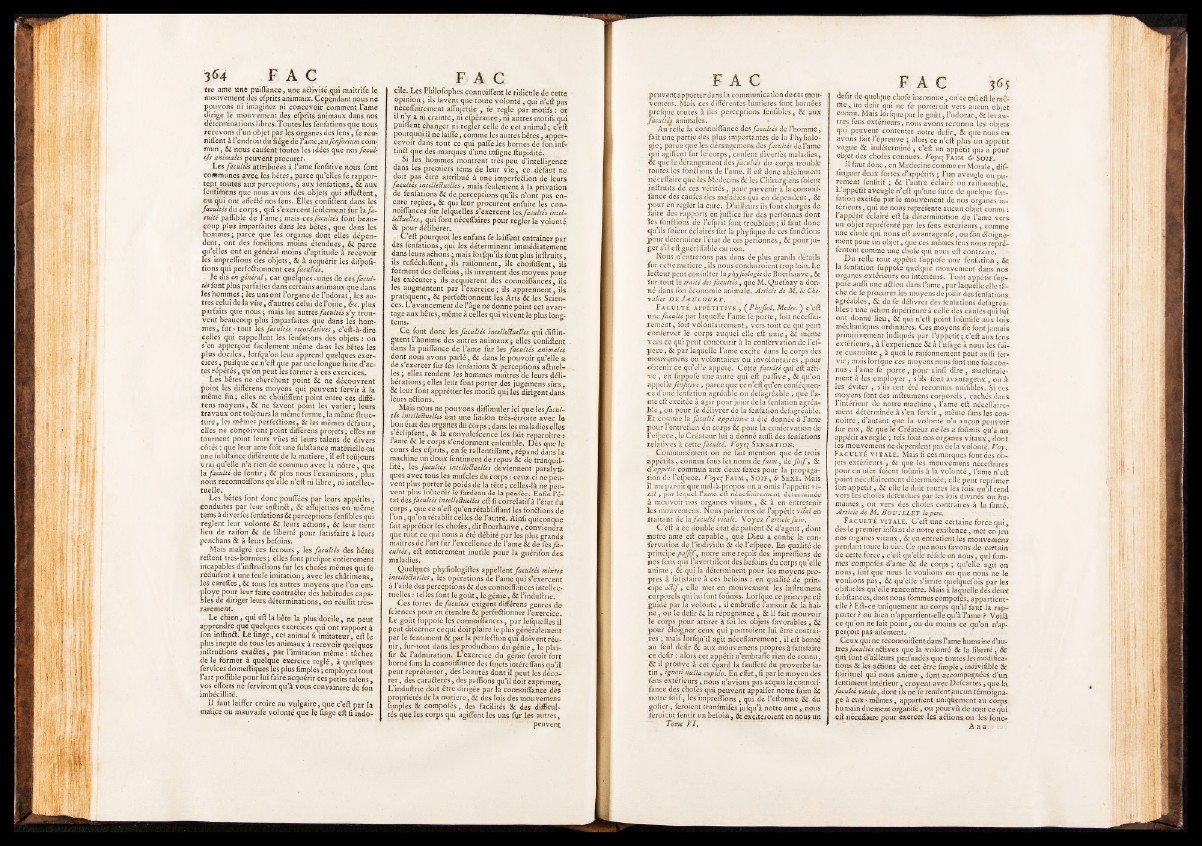
tre ame une puiflànce,une activité .qui maîtrife le.
mouvement des efprits animaux. Cependant nous ne
pouvons ni imaginer ni concevoir .comment, l’ame
dirige le mouvement,.d;es efprits animaux daqs nos
déterminations libres.Toutes les fenfations que nous
recevons d’un objet par les organes des fens, fe réunifient
à l’endroit du liège de l’ame,aufenforium commun
, & nous caufent toutes les idées que nos facultés
animales peuvent procurer.
Les facultés attribuées à l’ame fenfitive nous l’ont
communes avec les bêtes, parce qu’elles fe rapportent
toutes aux perceptions, aux ienfations,. & aux
fentimens que nous avons des, objets qui affqâent,
ou qui ont affeâé nos fpns. ÉJIes„confinent dans les
facultés du corps, qui s’exercent feulement fur la faculté
paflïble de l’ame; mais ces facultés font beaucoup
plus imparfaites dans les bêtes, que dans les
hommes; parce que les organes donç elles dépendent,
ont des fondions moins étendues, parce
qu’elles ont en général moins d’aptitude à recevoir
les impreflîons des objets, & à acquérir les difpoll-
tions qui perfectionnent ces facultés.
Je dis en général, car quelques-unes de ces facultés
font plus parfaites dans certains animaux que dans
les hommes ; les uns ont l’organe de l’odorat, lés autres
celui de la vû e , d’autres celui de l’oiiie , &c. plus
parfaits que nous ; mais les autres facultés s’y trouvent
beaucoup plus imparfaites que dans les hommes
, für - tout les facultés recordatives , c’eft-à-dire
celles qui rappellent les fenfations des objets : on
s’en apperçoit facilement même dans les bêtes les
plus dociles, lorfqu’on leur apprend quelques exercices
, puifque ce n’eft que par une longue fuite d’actes
répétés, qu’on peut les former à ces exercices.
Les bêtes ne cherchent point & ne décQuvrent
point les différens moyens qui peuvent fervir à la
même fin ; elles ne choififfent point entre ces différens
moyens, & ne favent point les varier ; leurs
travaux ont toûjours la même forme, la même ftruc-
iure, les mêmes perfections, & les mêmes défauts ;
elles ne conçoivent point différens projets ; elles ne
tournent point leurs vûes ni leurs talens de divers
côtés : que leur ame foit une fubftance matérielle-ou
une fubftance différente de la matière, il eft toûjours
vrai qu’elle n’ a rien de commun avec la nôtre, que
la faculté de fentir ; & plus nous l’examinons, plus
nous reconnoiffons qu’elle n’eft ni libre, ni intellec- ;
tuelle.
Les bêtes font donc pouffées par leurs appétits,
conduites par leur inftinft, & affujetties en même j
tems à diverfes fenfations & perceptions fenfibles qui
règlent leur volonté & leurs aCtions, & leur tient j
lieu de raifon & de liberté pour fatisfaire à leurs j
penchans & à leurs befoins.
Mais malgré ces fecours ,. les facultés des bêtes
reftent très-bornées ; elles font prefque entièrement
incapables d’inftruCtions fur les chofes mêmes qui fe
réduifent à une feule imitation ; avec les châtimens,
les careffes, & tous les autres moyens que l’on employé
pour leur faire contracter des habitudes capables
de diriger leurs déterminations, on réuflit très-
rarement.
Le chien, qui eft la bête la plus docile, ne peut
apprendre que quelques exercices qui ont rapport à
fon inftinCt. Le linge, cet animal fi imitateur, eft le
plus inepte de tous les animaux à recevoir quelques
inftruûions exaûes, par l’imitation même : tâchez
de le former à quelque exercice réglé, à quelques
fervices domeftiques les plus fimples ; employez tout
l’art poflible pour lui faire acquérir ces petits talens,
yos efforts ne ferviront qu’à vous convaincre de fon
imbécillité.
Il faut laiffer croire au vulgaire, que c’eft par la
malice ou mauyaife volonté que le finge eft fi indoçile.
Les Philofophesj çonqoiffent le ridicule de cette
opinion » Us favent que toute volonté, qui n’çft pas
néceffairpment affiqettié , J e .réglé par motifs : or
y.a qi crainte, ni efpërance, ni autres motifs qui
puiflent changer ni regler celle de çet animal ; c’eft
pQurquoul ne laiffe, comme les autres bêtes, apper-
cevoir dans tout ce qui paffe les bornes de fon inf-
tmCl que des marques d’une infigne ftupidité.
Si les hommes montrent très-peu d’intelligence
i fj.aq?, les premiers tems de leur vie;, ce défaut ne
doit pas etrp. attribué à une imperfection de leurs
facultés intellectuelles , mais feulement à la privation
de fenfations &'de perceptions qu’ils n’ont pas encore
reçues, & qui leur procurent enfuite les connoiffances
fur lesquelles s’exercent les facultés intellectuelles,
qui font néçeflaires pour regler la volonté
& pour délibérer.
C ’eft pourquoi les enfan$ fe laiffent entraîner par
des fenfations, qui les déterminent immédiatement
dans leurs a étions ; mais lorsqu’ils font plus inftruits ,
ils refléchiffent, ils raisonnent, ils choififfent, ils
forment des deffeins, ils inventent des moyens pour
les exécuter; ils acquièrent des connoiffances, ils
les augmentent par l’exercice ; ils apprennent, ils
pratiquent, & perfectionnent les Arts & les Sciences.
L’avancement de l’âge ne donne point cet avantage
aux bêtes, même à celles qui vivent le plus long-
tems.
Ce font donc les facultés intellectuelles qui diftiri-
guent l’homme des autres animaux ; elles confiftent -
dans la puiffance de l’ame fur les facultés animales
dont nous avons parlé, & dans le pouvoir qu’elle a
de s’exercer fur fes fenfations & perceptions aéhiel- -
les ; elles rendent les hommes maîtres de leurs délibérations
; elles leur font porter ,des jugemens sûrs ,
& leur font apprétier les motifs qui les dirigent dans
leurs aftions.
I n0us pouvons diflîmuler ici que les facultés
intellectuelles ont une liaifôn très-étroite avec le
bon état des organes du corps ; dans les maladies elles
seclipfent;, & la convalefcence les fait reparoître:
Famé & le corps s’endorment enfemble. Dès que le
cours des efprits, en'fe rallentiffant, répand dans la
machine un doux fentiment de repos & de tranquil-
lite, les facultés intellectuelles deviennent paralytiques
avec tous les mufcles du corps : ceux-ci ne peuvent
plus porter le poids de la tête ; celles-là ne peuvent
plus foûtenir le fardeau de la pënfée. Enfin l’état
des facultés intellectuelles eft fi corrélatif à l’état du
corps, que cè n’eft qu’en rétàbliffant les fonctions de
l’un, qu’on rétablit celles de l’autre. Ainfi quiconque
fait apprétier les chofes, ditBoerhaave, conviendra
que.tout ce qui nous a été débité par les plus grands
maîtres de l’art fur l’excellence de l’ame & de fe s facultés
, eft entièrement inutile pour là guérifon des
maladies.
Quelques phyfiologiftes appellent facultés mixtes
intellectuelles, les opérations de l’ame qui s’exercent
à l’aide des perceptions & des connoiffances intellectuelles
: telles font le goût, le génie, & l’induftrie.
Ces fortes dc facultés exigent différens genres de
fciences pour en étendre & perfectionner l’exercice.
Le goût fuppofe les connoiffances, par lefquelles il
peut difeerner ce qui doit plaire le plus généralement
par le fentiment & par la perfection qui doivent réunir
, fur-tout dans les productions du génie, le plai-
fir & l’admiration. L’exercice du genie feroit fort
borné fans la connoiffance des fujets intéreffans qu’il
peut repréfenter, des beautés dont il peut les décorer
, des carafteres, des pallions qu’il doit exprimer,
L’induftrie doit être dirigée par la connoiffance des
propriétés de la matière, & des lois des mouvemens
fimples & compofés, des facilités & des difficultés
que les corps qui agiffent les uns fur les autres,
peuvent
peuvent apporter dans la communication de ces mou-
vemens. Mais ces différentes lumières font bornées
prefque toutes à des perceptions fenfibles, & aux
facultés animales.
Au refte la connoiffance des facultés de l’homme,
fait une partie des plus importantes de la Phyfiolo-
gie; parce que les dérangemens des facultés de l’ame
qui agiffent fur le corps, caufent diverfes maladies,
& que le dérangement des facultés du corps trouble
toutes les fonctions de l’ame. Il eft donc abfolument
néceffaire que les Médecins & les Chirurgiens foient
inftruits de ces vérités, pour parvenir à la connoiffance
des caufes des maladies qui en dépendent, &
pour en regler la cure. D ’ailleurs iis font chargés de
faire des rapports en juftice fur des perfonnes dont
les fondions de l’efprit font troublées ; il faut donc
qu’ils foient éclairés fur la phyfique de ces fondions
pour déterminer l’état de ces perfonnes, & pour juger
s’ il eft guériffable ou non.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails
fur cette matière, ils nous conduiroient trop loin. Le
ledeur peut confulter laphyjiologie de Boerhaave, &
fur-tout le traité des facultés, que M. Quefnay a donné
dans fon économie animale. Article de M. le Chevalier
DE J A U COU RT.
F a c u l t é a p p é t i t iv e , ( Phyjîol. Medec. ) c ’eft
une faculté par laquelle l’ame fe porte, foit néceffai-
rement, foit volontairement, vers tout ce qui peut
conferver le corps auquel elle eft unie, & même
vers ce qui peut concourir à la confervation de l’ef-
p ec e, & par laquelle l’ame excite dans le corps des
mouvemens ou volontaires ou involontaires , pour
obtenir ce qu’elle appete. Cette faculté qui eft adi-
v e , en fuppofe une autre qui eft paffive, & qu’on
appelle fenfitive, parce que ce n’eft qu’en conféquen-
ce d’uné fenfation agréable ou defagréable , que l’ame
eft excitée à agir pour jouir de la fenfation agréable
, ou pour fe délivrer de la fenfation defagréable.
Et comme la faculté appétitive a été donnée à l’ame
pour l’entretien du corps & pour la confervation de
l ’efpece, le Créateur lui a donné auffi des fenfations
relatives à cette faculté. Voye{ S e n s a t io n .
Communément on ne fait mention que de trois
appétits , connus fous les noms de faim, de fo if , &
'd’appétit commun aux deux fexes pour la propagation
dé l’efpece. V o y e^ Fa im , S o i f , & S e x e . Mais
Il me paroît que mal-à-propos on a omis l’appétit visai
, par lequel l’ame eft néceffairement déterminée
à mouvoir nos organes vitaux , & à en entretenir
les mouvemens. Nous parlerons de l’appétit vital en
traitant de la faculté vitale. Voyez l ’article fuiv.
C ’eft à ce double état de patient & d’agent, dont
notre ame eft capable, que Dieu a confié la con-
fervation de l’individu & de l’efpece. En qualité de
principe pajjif, notre ame reçoit des imprelfions de
nos fens qui l’avertiffent des befoins du corps qu’elle
anime , & qui la déterminent pour les moyens propres
à fatisfaire à ces béfoins : en qualité de principe
actif t elle met en. mouvement les inftrumens
corporels qui lui font foûmis. Lorfque ce principe eft
guidé par la volonté, il embraffe l’amour & la haine
, ou le defir.& la répugnance , & il fait mouvoir
le corps pour attirer à foi les objets favorables, ôç
pour eloigner ceux qui pourroient lui être contraires
; mais Iorfqu’il agit néceffairement, il eft borné
au feul defir & aux mouvemens propres à fatisfaire
ce defir ; alors cet appétit n’embraffe rien de connu,
& il prouve à cet égard là.fauffeté du proverbe latin
, ignoti nulla cupido. En effet, fi par le moyen des
fens extérieurs,, nous n’avions pas acquis 1^ connoiffance
des chofes qui peuvent appaifer notre faim &
notre fo lf, les imprelfions , qui de l’eftomac & ,du
gofier, feroient tranfmifes jufqu’à notre ame , nous
ieroient fentir un befoin, & exciteroient en nous un
Tome VI,
defir de quelque chofe inconnue, ou ce qui eft le même
, un defir qui ne fe porteroit vers aucun objet
connu. Mais lorfque par le goût, l’odorat, & les autres
fens exterieurs, nous avons reconnu les objets
qui peuvent contenter notre defir, & que nous en
avons fait 1 epreuve ; alors ce n’eft plus un appétit
vague & indéterminé , c’eft un appétit qui a pour
objet des chofes connues. fîy'c^FAiM & S o i f .
Il faut donc, en Medecine comme en Morale dif*
tinguer deux fortés d’appétits ; l’un aveugle ou purement
fenfitif ; & l’autre éclairé ou raifonnable.
L’appétit aveugle n’eft qu’une fuite de quelque fenfation
excitée par le mouvement de nos organes interieurs
, qui ne nous repréfente aucun objet connu :
l’appétit éclairé eft la détermination de i’ame vers
un objet repréfenté par les fens extérieurs , comme
une chofe qui nous eft avantageufe, ou fon éloignement
pour un objet, que ces mêmes fens nous repré-
fentent comme une chofe qui nous eft contraire.
Du refte tout appétit fuppofe une fenfation, &
la fenfation fuppofe quelque mouvement dans nos
organes extérieurs ou intérieurs. Tout appétit fuppofe
alifli une aétion dans Famé, par laquelle elle tâche
de fe procurer les moyens de joiiir des fenfations
agréables, &.de fe délivrer des fenfations defagréa-
bles : une.aétion fupérieure à celle des caufes qui lui
ont donné lieu, & qui n’eft point foûmife aux lois
méchaniques ordinaires. Ces moyens rfe font jamais
primitivement indiqués par l’appetit ; c’eft aux fens
extérieurs, à l’expérience & à Fufage à nous les faire
connoître , à quoi le.raifonnement peut aufli fervir
; mais lorfque c es moyens nous font une foiscon-
nus , Famé fe porte , pour ainfi dire , machinalement
à les employer , s ’ils font avantageux , pu à
les éviter , s’ils ont été rebonnus nuifibles. Si ces
moyens font des inftrumens corporels, cachés dans
l’intérieur de notre machine , l’ame eft néceffaire-
ment déterminée à s’en fervir , même fans les connoître
, d’autant que la volonté n’a aucun pouvoir
fur eux, & que le Créateur ne les a foûmis qu’à un
appétit aveugle ; tels font nos organes vitaux, dont
les mouvemens ne dépendent pas delà volonté. Voy.
Fa c u l t é v i t a l e . Mais fi ces marques font des objets
extérieurs , & que les-mouvemens néceffaires
pour en ufer foient fournis à la volonté, l’ame n’eft
point néceffairement déterminée; elle peut reprimer
fon appétit, & elle le doit toutes les fois . qu’il tend
vers les chofes défendues par les lois divines ou humaines
, ou vers des chofes contraires à la fanté.
A r t i c l e d e M . B o u i L L E T le p e r e .
Fa c u l t é v i t a l e . C ’eft une certaine force qui,
dès le premier inftant de notre exiftence, met en jeu
nos organes vitaux , & en entretient les mouvemens
pendant toute la vie. Ce que nous favoris de certain
de cette force, c’eft qu’elle réfide en nous, qui fom-
mes compofés d’ame & de corps ; qu’elle agit en
nous, foit que nous le voulions ou que nous ne le
voulions pas, & qu’elle s’irrite quelquefois par les
obftacles qu’elle rencontre. Mais à laquelle des deux
fubftances, dont nous fommes compofés, appartient-
elle ? Eft-ce uniquement au corps qu’il'faut la rapporter?
ou bien n’appartientr-ellequfà l’ame ? Voilà
ce qu’on ne fait point, ou du moins ce qu’on n’ap-
perçoit pas aîfément.
Ceux qui ne reconnoiffent dans l’ame humaine d’au-
tres facultés actives que la volonté & la liberté, &
qui font d’ailleurs persuadés que toutes les modifications
& les aétions de cet être fimple, indivifible &
fpirituel qui nous anime, j font accompagnées d’un
fentiment intérieur, croyant.avec Defcartes-, que la
faculté vitale, dont ils ne fe rendenf^ucun témoigna-
ge à eux - mêmes, appartient uniquement au corps
humain duement orgànifé, ou pourvu de tout ce qui
eft néceffaire pour exercer les actions.ou les fonç-
Aa a : . as