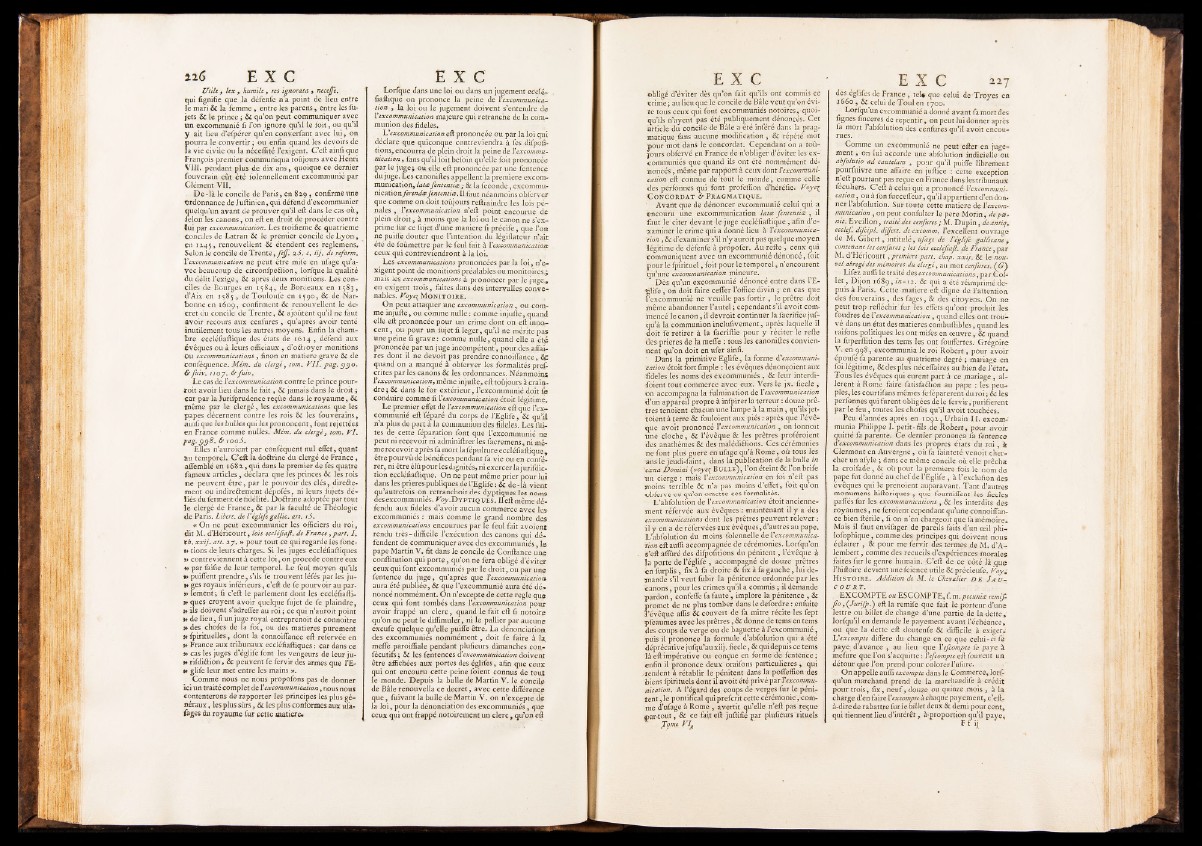
*26 E X C Utile f lex , humile, res ignorata , nccejje.
qui lignifie que la défenfe n’a point de lieu entre
le mari & la femme, entre les parens, entre les fu-
jets & le prince ; & qu’on peut communiquer avec
un excommunié fi l’on ignore qu’il le lo it, ou qu’il
y ait lieu d’efpérer qu’en converfant avec lui, on
Îiourra le convertir ; ou enfin quand les devoirs de
a v ie civile ou la néceffité l’exigent. C’elt ainfi que
François premier communiqua toujours avec Henri
VIII. pendant plus de dix ans, quoique ce dernier
fouverain eût été folennellement excommunié par
Clément VII.
D e - là le concile de Paris, en 8 19 , confirme une
ordonnance de Juftinien, qui défend d’excommunier
quelqu’un avant de prouver qu’il ell dans le cas où,
félon les canons, on eft en droit de procéder contre
lui par excommunication. Les troifieme & quatrième
Conciles de Latran & le premier concile de L y on ,
en 1245, renouvellent & étendent ces reglemens.
Selon le concile de Trente, fejf. a i . c. iij. de reform,
Yexcommunication ne peut être mile en ufage qu’avec
beaucoup de circonfpeûion, lorfque la qualité
du délit l’exige, & après deux monitions. Les conciles
de Bourges en 1584, de Bordeaux en 1583 ,
d’Aix en 1585 , deTouloufe en 1590, & de Narbonne
en 1609, confirment & renouvellent le decret
du concile de Trente, & ajoutent qu’il ne faut
avoir recours aux cenfures , qu’après avoir tenté
inutilement tous les autres moyens. Enfin la chambre
ecciéfiaftique des états de 1614 , défend aux
évêques ou à leurs officiaux , d’oéhoyer monitions
ou excommunications, finon en matière grave & de
Conféquence. Mém. du clergé, tom. VII. pag. g g o.
& fuiv. 11 oy. & fuiv.
Le cas de ¥ excommunication contre le prince pourvoit
avoir lieu dans le fa it , êf jamais dans le droit ;
car par la Jurifprudence reçûe dans le royaume, &
même par le clergé, les excommunications que les
papes décernent contre les rois & les fouverains,
ainfi que les bulles qui les prononcent, font rejettées
en France comme nulles. Mém. du clergé 3 tom. VI.
pag. ÿ<)8. & 1006.
Elles n’auroient par conféquent nul effet, quant
au temporel. C ’eft la do&rine du clergé de France,
affemblé en 1681, qui dans le premier de fes quatre
fameux articles, déclara que les princes & les rois
ne peuvent être, par le pouvoir des clés, directement
ou indirectement dépofés, ni leurs fujets déliés
du ferment de fidélité. DoCtrine adoptée par tout
le clergé de France, & par la faculté de Théologie
de Paris. Libert. de l ’églife gallic. art. iS.
« On ne peut excommunier les officiers du ro i,
dit M. d’Héricourt, lois ecclèjiafl. de France, part. I.
th. xxij. art. zy. » pour tout ce qui regarde les fonc-
» tions de leurs charges. Si les juges eccléfiaftiques
» contreviennent à cette lo i, on procédé contre eux
w par faifie de leur temporel. Le feul moyen qu’ils
*» puiffent prendre, s’ils fe trouvent léfés par les ju-
» ges royaux inférieurs, c’eft de fe pourvoir au par-
» lement ; fi c’eft le parlement dont les eccléfiafti-
9* ques croyent avoir quelque fujet de fe plaindre,
» ils doivent s’adreffer au roi ; ce qui n’auroit point
» de lieu, fi un juge royal entreprenoit de connoitre
» des chofes de la foi, ou des matières purement
» fpirituelles, dont la connoiffance eft relèrvée en
» France aux tribunaux eccléfiaftiques : car dans ce
» cas les juges d’églife font les vengeurs de leur ju-
» rifdiûion, & peuvent fe fervir des armes que l’E-
* glife leur met entre les mains ».
Comme nous ne nous propofons pas de donner
ici un traité complet de l'excommunication, nous nous
contenterons de rapporter les principes les plus généraux
, les plus sûrs, &. les plus conformes aux iua-
fages du royaume fur cette matière«
E X C Lorfque dans une loi ou dans un jugement eccté-
fiaûique on prononce la peine de Y excommunication
y la loi ou le jugement doivent s’entendre de
l’excommunication majeure qui retranche de la communion
des fideles.
L excommunication eft prononcée ou par la loi qui
déclaré que quiconque contreviendra à fes difpofi-
tions, encourra de plein droit la peine de Yexcommunication
, fans qu’il foit befoin qu’elle foit prononcée
par le juge ; ou elle eft prononcée par une fentençe
du juge. Les canoniftes appellent la première excommunication,
latte Jententite ; & la fécondé, excommu-
nication ferendtefententite. Il faut néanmoins obferver
que comme on doit toujours reftraindre les lois pénales
, Yexcommunication n’eft point encourue de
plein droit, à moins que la loi ou le canon ne s’exprime
fur ce fujet d’une maniéré fi précife, que l’on
ne puiffe douter que l’intention du légiflateur n’ait
été de foûmettre par le feul fait à Y excommunication
ceux qui contreviendront à la loi.
Les excommunications prononcées par la lo i, n’ exigent
point de monitions préalables ou monitoiresô
mais les excommunications à prononcer par le juge,,
en exigent trois , faites dans des intervalles conve-,
nables. Voye{ M o n i t o ir e .
On peut attaquer une excommunication, ou comme
injufte, ou comme nulle : comme injufte, quand
elle eft prononcée pour un crime dont on eft innocent
, ou pour un fujet fi leger, qu’il ne mérite pas
une peine fi grave : comme nulle, quand elle a é té
prononcée par un juge incompétent, pour des affaires
dont il ne devoit pas prendre connoiffance, &
quand on a manqué à obferver les formalités prêt
crites parles canons & les ordonnances. Néanmoins
Y excommunication y même injufte, eft toûjours à craindre
; & dans le for extérieur, l’excommunié doit fe
conduire comme fi Y excommunication étoit légitime.
Le premier effet de Y excommunication eft que l’excommunié
eft féparé du corps de l’Eglife, & qu’i l
n’a plus de part à la communion des fideles. Les fuites
de cette féparation font que l’excommunié ne
peut ni recevoir ni adminiftrer les facremens, ni même
recevoir après fa mort la fépulture ecciéfiaftique ,
être pourvu de bénéfices pendant fa vie ou en conférer,
ni être élûpour les dignités, ni exercer la jurifdic-
tion ecciéfiaftique. On ne peut même prier pour lui
dans les prières publiques de l’Eglife : & de-là vient
qu’autrefois on retranchoit des dyptiques les noms
des excommuniés. f'by.DYPTiQUES. Il eft même défendu
aux fideles d’avoir aucun commerce avec les
excommuniés : mais comme le grand nombre des
excommunications encourues par le feul fait avoient
rendu très-difficile l’exécution des canons qui défendent
de communiquer avec des excommuniés, fe
pape Martin V. fit dans le concile de Confiance une
conftitution qui porte, qu’on ne fera obligé d’éviter
ceux qui font excommuniés par le droit, ou par une
fentençe du juge, qu’après que Xexcommunication
aura été publiée, & que l’excommunié aura été dé*
noncé nommément. On n’excepte de cette réglé que
ceux qui font tombés dans Y excommunication pour
avoir frappé un clerc, quand le fait eft fi notoire
qu’on ne peut le diffimuler, ni le pallier par aucune
excufe quelque qu’elle puiffe être. La dénonciation,
des excommunies nommément, doit fe faire à la,
meffe paroiffiale pendant plufieurs dimanches con-
fécutifs ; & les fentences dfexcommunication doivent
être affichées aux portes des églifes, afin que ceux
qui ont encouru cette peine foient connus de tout
le monde. Depuis la bulle de Martin V . le concile
de Bâle renouvella ce decret, avec cette différence
que, fuivant la bulle de Martin V. on n’excepte dé
la loi, pour la dénonciation des excommuniés, que
ceux qui Qnt frappé notoirement un c lerc, qu’on eft
E X C
obligé d’éviter dès qu’on fait qu’ils ont commis ce
crime; au lieu que le concile de Bâle veut qu’on évite
tous ceux qui font excçmmuniés notoires,-quoiqu’ils
n’ayent pas été publiquement dénoncés. Cet
article du concile de Bâle a été inféré dans la prag-
matique.fans aucune modification, & répété mot
pour mot dans le concordat. Cependant on a toujours
obfervé en France de n’obliger d’éviter les excommuniés
que quand ils ont été nommément dénoncés
, même par rapport à c e uxdont Y excommunication
eft connue d‘e :toût le mondé, comme celle
dés perfonnes qui font profeffion d’héréfie; Voye{
C o n c o r d a t & P r a g m a t iq u e , j:;-
Avant que de dénoncer excommunié celui qui a
encouru une excommunication latte fententice , il
faut le citer devant le'juge ecciéfiaftique ; afin d'examiner
le crime qui a donné lieu à l’excommunication
3 8c d’examiner s’il n’y auroit pas quelque moyen
légitime de défenfe à propofer. Au refte , ceux qui
communiquent avec un excommunié dénoncé, foit
pour le fpirituel ,- foit pour le temporel, n’encourent
qu’une ex communication mineure.
Dès qu’un excommunié dénoncé entre dans l’E-
V life, on doit faire ceffer l’office divin ; en cas que
l ’excommunié ne veuille pas fortir , le prêtre doit
même abandonner l’autel ; cependant s’il avoit commencé
le canon, il devroit continuer la facrifice juf-
qu’à la communion inclufivement, après laquelle il
doit fe retirer à la facriftie pour y réciter le refte
des'prieres de la meffe : tous les canoniftes conviennent
qu’on doit en ufer ainfi.
' Dans la primitive Eglife, la forme à’excommunication
étoit fort fimple : les évêques dénonçoient aux
fideles les noms des excommuniés , & leur interdi-
foient tout commerce avec eux. Vers le jx. fiecle ,
on accompagna la fulmination de Y excommunication
d’un appareil propre à infpirer la terreur : douze prêtres
tenoient chacun une lampe à la main, qu’ils jet-
toient à terre & fouloient aux piés : après que l’évêque
avoit prononcé Y excommunication , on fonnoit
une cloche, & l’évêque & les prêtres proféraient
des anathèmes & des malédifrions. Ges cérémonies
ne font plus guere en ufage qu’à Rome, où tous les
ans le jeudi-faint, dans la publication de la bulle fe
■ ccena Domini (yoye{ Bu l l e ) , l’on éteint & l’on brife
un cierge : mais Y excommunication en foi n’eft pas
moins terrible & n’ a pas moins d’effet, foit qu’on
obferve ou qu’on omette ces formalités.
L ’abfolution de Y excommunication étoit anciennement
réfervée aux évêques : maintenant il y a des
excommunications dont les prêtres peuvent relever :
i l y en a de réfervées aux évêques, d’autres au pape.
L ’abfolution du moins folennelle de Y excommunication
eft auffi accompagnée de cérémonies. Lorfqu’on
s’eft affûré des difpofitions du pénitent, l’évêque à
la porte de l’églife , accompagné de douze prêtres
en furplis, fix à fa droite & fix à fa gauche, lui demande
s’il veut fubir la pénitence ordonnée par les
•canons, pour les crimes qu’il a commis ; il demande
pardon, confeffe fa faute, implore la pénitence , &
promet de ne plus tomber dans le defordre : enfuite
l ’évêque affis & couvert de fa mitre récite les fept
pfeaumes avec les prêtres, & donne de tems en tems
des coups de verge ou de baguette à l’excommunié,
puis il prononce la formule d’abfolution qui-a.été
déprécative jufqu’au xiij. fiecle, & qui depuis ce tems
là eft impérative ou conçue en forme ;de: fentençe;
enfin il prononce deux oraifons particulières , qui
/tendent a rétablir le pénitent dans la poffeffion des
biens fpirituels dont il avoit été pr i vépar Y excommunication.
A l’égard des coups de verges fur le pénitent
, le pontifical qui preferit cette cérémonie, comme
d’ufage à Rome , avertit qu’elle n’eft pas reçue
par-tout, & ce fait eft juftifie par plufieurs rituels
J orne
E X C *27 des eglifçs de France , tel# que celui de Troyes en
^660, & celui de Toul en 1700.
- Lorfqu’un excommunié a donné avant fa mort des
lignes finceres de repentir, on peut lui donner après
fa mort l’abfolution des cenfures qu’il avoit encourues.
Comme un excommunié ne peut efter en juge-
ment, on lui accorde une abfolution indicielle ou
abfolutio ad cautelam , pour qu’il puiffe librement
pourfuivre une affaire en juftice : cette exception
n’eft pourtant pas reçue en France dans les tribunaux
féculiers. C ’eft à celui qui a prononcé Vexcommuni-
. cation, ou à fon fucceffeur, qu’il appartient d’en donner
l’abfolution. Sur toute cette matière de Yexcom-
munication, on peut confulter le pere Morin, de poe-
nit. E veillon, traite des cenfures ; M. Dupin, de antiq.
ecclef. difcipl. dijjert. de excomm. l’excellent ouvrage
de M. Gibert , intitulé, ufage de l'églife gallicane ,
contenant les cenfures ; les lois ecclèjiafl. de France, par
M. d’Héricoqrt 3 première part. chap. xxij. & le nouvel
abregédes mémoires du clergé, au mot cenfures. (G )
Lifez auffi le traité des excommunications, par Col-»
le t , Dijon 1689, f e - 12. & qui a été réimprimé .depuis
à Paris. Cette matière eft digne de l’attention
des fouverains , des fages, & des citoyens* On ne
peut trop réfléchir fur les. effets qu’ont produit les
foudres de l ’excommunication, quand elles ont trôu^
vé dans un état des matières combuftibles, quand les
raifons politiques les ont mifes en oeuvre , & quand
la fuperftition des tems les ont fouffertes. Grégoire
V. en 998, excommunia le roi Robert, pour avoir
époufé fa parente au quatrième degré ; mariage en
foi légitime, & des plus néceffaires au bien de l’état.
Tous les évêques qui eurent part à ce mariage., allèrent
à Rome faire fatisfaâion au pape : les; peuples,
les courtifans mêmes fe féparerent du roi ; & les
perfonnes qui furent obligées de le fervir, purifièrent
par le feu , toutes les chofes qu’il avoit touchées.
Peu d’années après en 109 2 ,Urbain II. excommunia
Philippe I. petit-fils.de Robert , pour avoir
quitté fa parente. Ce dernier prononça fa fentençe
(Eexcommunication dans les propres états du r o i , à
Clermont en Auvergne, où fa fainteté venoit chercher
un afyle ; dans ce même concile où elle prêcha
la croifade, & où pour la première fois le nom de
pape fut donné au.chef dé l’Eglife , à l’exclufion des
évêques qui le prenoient auparavant. Tant d’autres
monumens hiftoriques , que fourriiffent les fiéeles
paffés fur les excommunications , & les interdits des
royaumes, ne feraient cependant qu’une connoiffance
bien ftérile, fi on n’en chargeoit que fa mémoire.
Mais il faut envifager de pareils faits d’un oeil phi-
lofophique, comme des principes qui doivent nous
éclairer , & pour me fervir des termes de M. d’A -
lembert, comme des recueils d’expériences morales
faites fur ie genre humain.--jC’eft de ce côté là que
l’hiftoire devient une fçience utile & précieûfe, Voyi
Hi s t o ir e . Addition de M ,. le Chevalier d e J a u -
c O U R T .
EXCOMPTE ou ESCOMPTE, f. m.pecunice remif-
foyÇJurifp.') eft la remife que fait le porteur d’une
lettre cou billet de change d’une partie.de la dette,
lorfqu’il en demandé le payement avant l’échéance,
ou que la dette eft douteufe & difficile à exigera
L ’excompte différé du change en. ce que celui-ci fe
paye, d’avance , au lieu que Yefcompte fe paye à
mefure que l’on s’acquitte : Yefcompte eft fou vent un
détour que l’on prends pour colorer l’ùfure.
On appelle auffi excompte dans le Commerce, Iorf-
qu’un marchand prend de la marchandife à crédit
pour trois, fix, neuf, douze ou quinze mois , à la
charge d’en faire Yexcompte h chaque payement, c’eft-
à-dire de rabattre fur le billet deux & demi pour cent,
qui tiennent lieu d’intérêt, à-proportion qu’il paye^