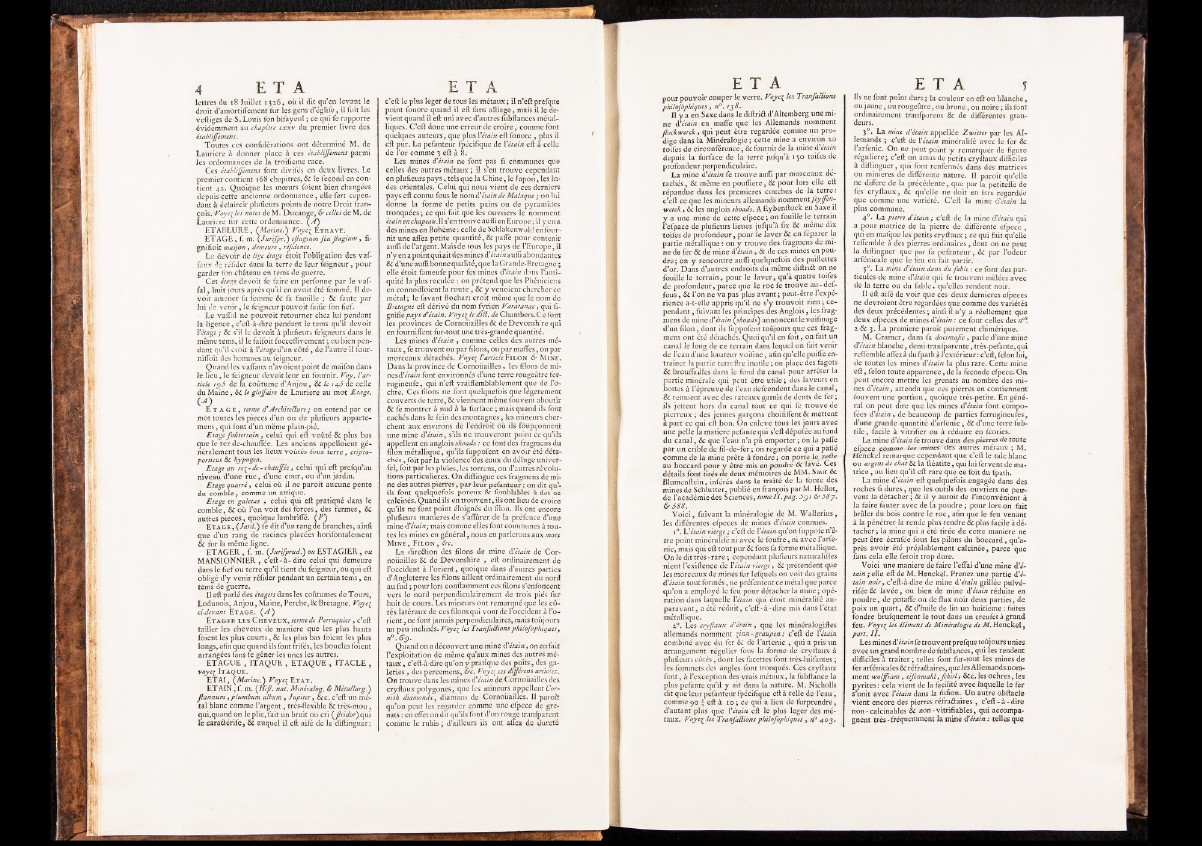
jm m m m
4 E T A
lettres du 18 Juillet 13 26, où il dit qu’en levant le
droit d’amortiffement fur les gens d’églife, il fuit les
vertiges de S. Louis fon bifayeul ; ce qui fe rapporte
évidemment au chapitre exxv du premier livre des
établijfemens.
Toutes ces confidérations ont déterminé M. de
Lauriere à donner place à ces ètabliffemens parmi
les ordonnances de la troifieme race.
Ces établi(ferriens font divifés en deux livres. Le
premier contient 168 chapitres, 6c le fécond en contient
42. Quoique les moeurs foient bien changées
depuis cette ancienne ordonnance, elle fert cependant
à éclaircir plufieurs points de notre Droit fran-
çois. ‘Voyelles notes de M. Ducange, & celles de M. de
Lauriere fur cette ordonnance. (A )
ETABLURE, (Marine.) Voyeç Etrave.
E T A G E , f. m. (Jurifpr.) ejlagium feu Jlagium , fi-
gnifioit maifon, demeure, réhdence.
Le devoir de lige étage étoit l’obligation des vaf-
faux de rélider dans la terre de leur leigneur, pour
garder fon château en tems de guerre.
Cet étage devoit fe faire en perfonne par le vaf-
fa l, huit jours après qu’il en avoit été fommé. Il devoit
amener fa femme 6c fa famille ; 6c faute par
lui de venir, le feigneur pouvoit faifir fon fief.
Le vaflal ne pouvoit retourner chez lui pendant
la ligence, c’eft-à-dire pendant le tems qu’il devoit
1 * étage ; 6c s’il le devoit à plufieurs feigneurs dans le
même tems, il le faifoit fuccelîivement ; ou bien pendant
qu’il étoit à Vétage d’un cô té, de l’autre il four-
nilfoit des hommes au feigneur.
Quand les valfaux n’avoient point de maifon dans
le lieu, le feigneur devoit leur en fournir. Voy. Varticle
ic)5 de la coutume d’Anjou, 6c le 14S de celle
du Maine, & le glojfaire de Lauriere au mot Etage.
o o „ . I
E t a g e , terme déArchitecture ; on entend par ce
mot toutes les pièces d’un ou de plufieurs apparte-
mens, qui font d’un même plain-pié.
Etage foûterrain, celui qui eft voûté & plus bas
que le rezde-chauflee. Les anciens appelloient généralement
tous les lieux voûtés fous terre, cripto-
p or tic us 6c hypogea.
Etage au re^-de-chauffée, celui qui eft prefqu’au
niveau d’une rue , d’une cour, ou d’un jardin.
Etage quarré , celui où il ne paroît aucune pente
du comble, comme un attique.
Etage en galetas , celui qui eft pratiqué dans le
comble, & où l’on voit des forces, des fermes, 6c
autres pièces, quoique lambriffé. ( P ) Etage, (Jardé) fe dit d’un rang de branches, ainfi
que d’un rang de racines placées horifontalement
6c fur la même ligne.
E T AG ER , f. m. (Jurifprud.) ou ESTAGIER, ou
MANSIONNIER , c’eft-à-dire celui qui demeure
dans le fief ou terre qu’il tient du feigneur, ou qui eft
obligé d’y venir réfider pendant un certain tems, en
tems de guerre.
Il eft parlé des étagers dans les coutumes de Tours,
Lodunois, Anjou, Maine, Perche, & Bretagne. Voye{
ci-devant Etage. (A ) Etager les C k e v e v x , terme de Perruquier, c’eft
tailler les cheveux de maniéré que les plus hauts
foient les plus courts, 6c les plus bas foient les plus
longs, afin que quand ils font frifés, les boucles foient
arrangées fans fe gêner les unes les autres.
ETAGUE , ITAQUE , ETAQUE , ITACLE ,
voyeç I t a QUE.
ETAT, (Marine.) Voye^Etay.
ETAIN, f. m. (Hïfi. nat. Minéralog. & Métallurg.)
Jlannum, plumbum album, Jupiter, &e. c’eft un métal
blanc comme l’argent, très-flexible 6c très-mou,
qui,quand on le plie, fait un bruit ou cri (Jlridor) qui
le caraôérife, 6c auquel il eft aifé de le diftinguer;
c’eft le plus Ieger de tous les métaux; il n’eft prefque
point fonore quand il eft fans alliage, mais il le devient
quand il eft uni avec d’autres fubftances métalliques.
C’eft donc une erreur de croire, comme font
quelques auteurs, que plus Vétain eft fonore , plus il
eft pur. La pefanteur fpécifique de l’étain eft à celle
de l’or comme 3 eft à 8.
Les mines d’étain ne font pas fi communes que
celles des autres métaux ; il s’en trouve cependant
en plufieurs pa ys, tels que la Chine, le Japon, les Indes
orientales. Celui qui nous vient de ces derniers
pays eft connu fous le nom à*étain de Malaque ; on lui
donne la forme de petits pains ou de pyramides
tronquées ; ce qui fait que les ouvriers le nomment
étain en chapeau. Il s’en trouve aufli en Europe ; il y en a
des mines en Bohème : celle de Schlakenwald en fournit
une aflez petite quantité, 6c parte pour contenir
aufli de l’argent. Mais de tous les pays de l’Europe, il
n’y en a point qui ait des mines d'étain aufli abondantes
6c d’une aufli bonne qualité, que la Grande-Bretagne ;
elle étoit fameufe pour fes mines d'étain dans l’antiquité
la plus reculee : on prétend que les Phéniciens
en connoifloient la route, & y venoient chercher ce
métal ; le favant Bochart croit même que le nom de
Bretagne eft dérivé du nom fyrien Varatanac, qui lignifie
pays d’étain. Voyeç le dict. de Chambers.Ce font
les provinces de Cornouailles 6c de Devonshire qui
en fourniffent fur-tout une très-grande quantité.
Les mines d'étain, comme celles des autres métaux
, fe trouvent ou par filons, ou par malles, ou par
morceaux détachés. Voye[ Varticle Filon & Mine.
Dans la province de Cornouailles, les filons de mines
à?étain font environnés d’une terre rougeâtre fer-
rugineufe, qui n’eft vraiflemblablement que de l’o-
chre. Ces filons ne font quelquefois que légèrement
couverts de terre, 6c viennent même fouvent aboutir
6c fe montrer à nud à la furface ; mais quand ils font
cachés dans le fein des montagnes, les mineurs cherchent
aux environs de l’endroit oîi ils foupçonnent
une mine d'étain, s’ils ne trouveront point ce qu’ils
appellent en anglois shoads : ce font des fragmens du
mon métallique, qu’ils fuppofent en avoir été détachés
, foit par la violence aes eaux du déluge univer-
fel, foit par les pluies, les torrens, ou d’autres révolutions
particulières. On diftingue ces fragmens de mine
des autres pierres, par leur pefanteur : on dit qu’ils
font quelquefois poreux 6c femblables à des os
calcinés. Quand ils en trouvent, ils ont lieu de croire
qu’ils ne font point éloignés du filon. Ils ont encore
plufieurs maniérés de s’aflïirer de la préfence d’une
mine d’étain; mais comme elles font communes à toutes
les mines en général, nous en parlerons aux mots Mine, Filon, &c.
La direûion des filons de mine d'étain de Cor-
noüailles 6c de Devonshire , eft ordinairement de
l’occident à l’orient, quoique dans d’autres parties
d’Angleterre les filons aillent ordinairement du nord
au fud ; pour lors conftamment ces filons s’enfoncent
vers le nord perpendiculairement de trois piés fur
huit de cours. Les mineurs ont remarqué que les côtés
latéraux de ces filons qui vont de l’occident à l’orient
, ne font jamais perpendiculaires, mais toujours
un peu inclines. Voye[ les Tranfaclionsphilofophiques,
B B H .
Quand on a découvert une mine Ol etain, on enfait
l’exploitation dë même qu’aux mines des autres métaux
, c’eft-à-dire qu’on y pratique des puits, des galeries
, des percemens, &c. Voye[ ces eüfférens articles.
O ïi trouve dans les mines d!étain de Cornouailles des
cryftaux polygones , que les mineurs appellent Cor-
nish diamonds, diamans de Cornoiiailles. Il paroît
qu’on peut les regarder comme une efpece de grenats
: en effet on dit qu’ils font d’un rouge tranfparent
comme le rubis ; d’ailleurs ils ont allez de dureté
pour pouvoir couper le verre. V?ye{ les Tranfaclions
philofophiques , n°. 13 8.
Il y a en Saxe dans le diftrift d’Altemberg une mine
dé étain en marte que les Allemands nomment
Jlockwerck, qui peut être regardée comme un prodige
dans la Minéralogie ; cette mine a environ ao
toifes de circonférence, 6c fournit de la mine d’étain
depuis la furface de la terre jufqu’à 150 toifes de
profondeur perpendiculaire.
La mine dé étain fe trouve aufli par morceaux détachés
, 6c même en poufliere, 6c pour lors elle eft
répandue dans les premières couches de la terre:
c’eft ce que les mineurs allemands nomment feyffen-
werck, 6c les anglois shoads. A Eybenftock en Saxe il
y a une mine de cette efpece; on fouille le^ terrain
l’efpace de plufieurs lieues jufqu’à fix 6c meme dix
toifes de profondeur, pour le laver 6c en féparer la
partie métallique : on y trouve des fragmens de mine
de fer 6c de mine dé étain , & de ces mines en poudre
; on y rencontre aufli quelquefois des paillettes
d’or. Dans d’autres endroits du même diftriû on ne
fouille le terrain, pour le laver, qu’à quatre toifes
de profondeur, parce que le roc fe trouve au-def-
fous, 6c l’on ne va pas plus avant; peut-être l’expérience
a-t-elle appris qu’il ne s’y trouvoit rien ; cependant
, fuivant les principes des Anglois, les fragmens
de mine d'étain (shoads) annoncent le voifinage
d’un filon, dont ils fuppofent toujours que ces fragmens
ont été détachés. Quoi qu’il en foit, on fait un
canal le long de ce terrain dans lequel on fait venir
de l’eau d’une hauteur voifine, afin qu’elle puiffe entraîner
la partie terreftre inutile ; on place des fagots
& brouffailles dans le fond du canal pour arrêter la
partie minérale qui peut être utile ; des laveurs en
bottes à l’épreuve de l’eau defeendent dans le canal,
& remuent avec des rateaux garnis de dents de fer ;
ils jettent hors du canal tout ce qui fe trouve de
pierreux ; des jeunes garçons choififfent & mettent
à part ce qui eft bon. On enleve tous les jours avec
une pelle la matière pefantequi s’eftdépofée au fond
du canal, 6c que l’eau n’a pû emporter ; on la parte
par un crible de fil-de-fer ; on regarde ce qui a pafl'é
comme de la mine prête à fondre ; on porte le reûe
au boccard pour y être mis en poudre Sc lave. Ces
détails font tirés de deux mémoires de MM. Saur 6c
Blumenftein, inférés dans le traité de la fonte des
mines de Schlutter, publié en françois par M. Hellot,
de l’académie des Sciences, tome ll.pag. 5$ 1 & 58y.
& 588.
V o ic i, fuivant la minéralogie de M. Wallerius,
les différentes efpeces de mines détain connues.
i°. L'étain vierge ; c’eft de Pétain qu’on fuppofe n’ê-
tre point minéralifé ni avec le foufre, ni avec l ’arfe-
nic, mais qui eft tout pur 6c fous fa forme métallique.
On le dit très - rare ; cependant plufieurs naturaliftes
nient l’exiftence de l'étain vierge, 6c prétendent que
les morceaux de mines fur lefquels on voit des grains
détain tout formés, ne préfentent ce métal que parce
qu’on a employé le feu pour détacher la mine ; opération
dans laquelle l'étain qui étoit minéralifé auparavant
, a été réduit, c ’eft - à - dire mis dans l’état
métallique.
20. Les cryfiaux d'étain, que les minéralogiftes
allemands nomment rjnn - graupen : c’eft de l'étain
combiné avec du fer 6c de l ’arfenic , qui a pris un
arrangement régulier fous la forme de cryftaux à
plufieurs côtés, dont les facettes font très-luifantes ;
les fommets des angles font tronqués. Ces cryftaux
font, à l’exception des vrais métaux, la fubftance la
plus pefante qu’il y ait dans la nature. M. Nicholls
dit que leur pefanteur fpécifique eft à celle de 'l’eau ,
comme 90£ eft à 10 ; ce qui a lieu dé furprendre,
d’autant plus que l'étain eft le plus leger des métaux.
Voye^ les Tranfaclions philofophiques , n° 403.
Ils ne font point durs,; la couleur en eft ou blanche,
ou jaune, ou rougeâtre, ou brune, ou noire ; ils font
ordinairement tranfparens 6c de différentes grandeurs.
3 . La mine dé étain appellée Zwitter par les Allemands
; c’eft de l’étain minéralifé avec le fer 6c
l’arfenic. On ne peut point y remarquer de figure
reguliere ; c’eft un amas de petits cryftaux difficiles
à diftinguer, qui font renfermés dans des matrices
ou minières de différente nature. II paroît qu’elle
ne diffère de la précédente, que par la petiteflè de
fes cryftaux, & qu’elle ne doit en être regardée
que comme une variété. C ’eft la mine détain la
plus commune.
40. La pierre d'étain; c’eft de la mine détain qui
a pour matrice de la pierre de différente efpece ,
qui en mafque les petits cryftaux ; ce qui fait qu’elle
reflemble à des pierres ordinaires, dont on ne peut
la diftinguer que par fa pefanteur, 6c par l’odeur
arfénicale que le feu en fait partir.
5 . La mine dé étain dans du fable : ce font des particules
de mine détain qui fe trouvent mêlées avec
de la terre ou du fable, qu’elles rendent noir.
Il eft aifé de voir que ces deux dernieres efpeces
ne devroient être regardées que comme des variétés
des deux précédentes ; ainfi il n’y a réellement que
deux efpeces de mines détain : ce font celles des n°l
z 6c 3. La première paroît purement chimérique.
M. Cramer, dans fa docimajie, parle d’une mine
détain blanche, demi-tranfparente, très-pefante,qui
reflemble aflez à du fpath à l’extérieur : c’eft, félon lui,
de toutes les mines détain la plus rare. Cette mine
eft, félon toute apparence, de la fécondé efpece. On
peut encore mettre les grenats au nombre des mines
détain, attendu que ces pierres en contiennent
fouvent une portion, quoique très-petite. En général
on peut dire que les mines d étain font compo-
fées détain, de beaucoup de parties ferrugineufes,
d’une grande quantité d’arfenic, 6c d’une terre fub-
t ile , facile à vitrifier ou à réduire en feories.
La mine détain fe trouve dans des pierres de toute
efpece comme les mines des autres métaux ; M.
ffenckel remarque cependant que c’eft le talc blanc
ou argent de chat 6c la ftéatite, qui lui fervent de matrice
, au lieu qu’il eft rare que ce foit du fpath.
La mine détain eft quelquefois engagée dans des
roches fi dures, que les outils des ouvriers ne peir-
vent la détacher ; & il y auroit de l’ inconvénient à
la faire fauter avec de la poudre ; pour lors on fait
brûler du bois contre le roc, afin que le feu venant
à la pénétrer la rende plus tendre 6c plus facile à détacher;
la .mine qui a été tirée de cette maniéré ne
peut être écrafée fous les pilons du boccard, qu’a-
près avoir été préalablement calcinée, parce que
fans cela elle feroit trop dure.
Voici une maniéré de faire l’eflai d’une mine d é tain
; elle eft de M. Henckel. Prenez une partie dV-
tain noir, c’eft-à-dire de mine détain grillée pulvé-
rifée 6c lavée, ou bien de mine d'étain réduite en
poudre, de potafle ou de flux noir deux parties, de
poix un.quart, 6c d’huile de lin un huitième : faites
fondre brufquement le tout dans un creufet à grand
feu. Voye% les élémens de Minéralogie de M. Henckel,
part. I I .
Les mines détainfe trouvent prefque toûjours unies
avec un grand nombre de fubftances, qui les rendent
difficiles à traiter ; telles font fur-tout les mines de
fer arfénicales& réff aftaires, que les Allemands nomment
wolfram , eifenmahl, fchirl, & c . les ochres, lés
pyrites : cela vient de la facilité avec laquelle le fer
s’unit avec éétain dans la fiifion. Un autre obftacle
vient encore des pierres réfraftaires , c’eft-à -dire
non-calcinables & non-vitrifiables, qui accompagnent
très - fréquemment la mine détain ; telles que