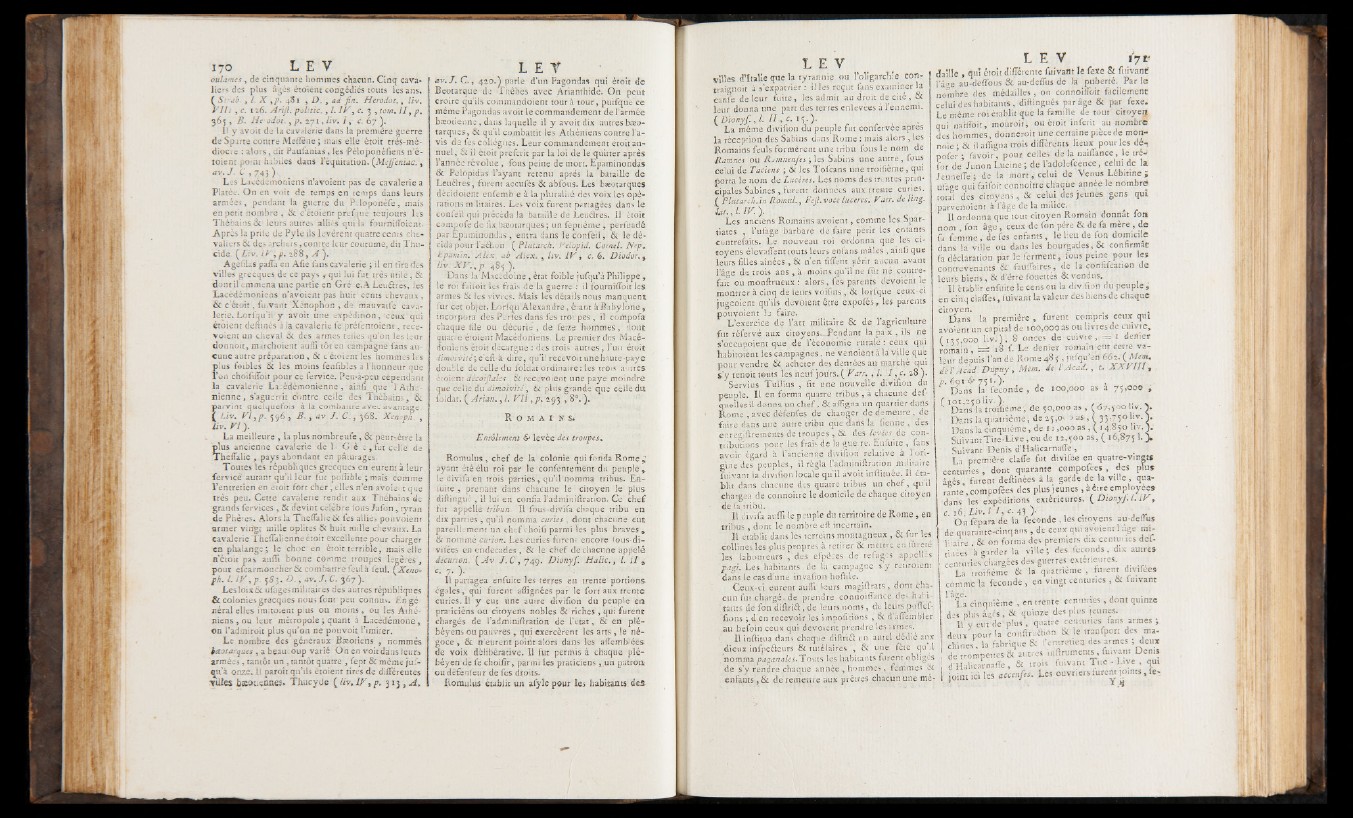
oulames , de cinquante hommes chacun. Cinq cavaliers
des plus âgés étoient congédiés touts les ans.
( Stvab. , l. X ,p. 481 , D. , ad fin. Herodot. , liv.
V il; , c. 126. Arïfi. politic., L IV , c. 3 ,tom. I I f p.
365 , B. He’ odot. , p. 2.JI, liv. I , c. 67 ).
Il y avoit de la cavalerie dans la première guerre
de Sparte contre Méfie ne ; mais elle étoit très-médiocre
: alors, dit Paufanias, les Péloponéfiens n’é-
toient point habiles dans l'équitation. {Mejfeniac.,
av.J. C ,743 )..
Les Lacédémoniens n’avoient pas de cavalerie a
Platée. On en voit de temps en temps dans leurs
armées, pendant la guerre du Ptloponèfe, mais
en petit nombre , & c étoient prefque toujours les
Thébains& leurs autres alliés qui la fourniffoiént.
Après la prile de Pyle ils levèrent quatre cents chevaliers
& des archers, contre leur coutume, dit Thu-
cide. ( Liv. IV\ p. 288, A ).
Agefilas paffa en Alie fans cavalerie ; il en tira des
villes grecques de ce pays qui lui fut très utile, &
dont il emmena une partie en Grè e.A L'euélres, les
Lacédémoniens n’avoienc pas huit cents chevaux ,
& c'étoit, fu.vant 'Xénophon , de mauvail'e cavalerie.
Lorfqu’ii y avoir une expédition, -ceux qui
étoient deftinés à la cavalerie fe préfentoient, rece-
voient un ciieyal & des armes telles qu’on les leur
donnoit, marenoient aufiï tôt en campagne fans au- j
cune autre préparation, & c étoient les hommes les
plus feibles & les moins fenfibies à l’honneur que
l ’on choififfoit pour ce fervice. Peu-à-peu cependant
la cavalerie La~édémonienne, ainfi que 1 Athénienne,
s’aguerrit contre ceile des Tnébains, ' &
parvint quelquefois à la combattre avec avantage.
( Liv. V I ,p . 596 j B. , av J. C 368. Xenaph. ,
liv. v i y
La meilleure , la plus nombreufe, & peur-.être la
plus ancienne cavalerie de 1 Giè e , fut celle de
Theffalie , pays abondant en pâturages.
Toutes les républiques grecques en eurent à leur,
fervice autant qu’il leur fut poflïble ; mais comme
l ’entretien en étoit fort cher , elles n’en avoiéi.t que
très peu. Cette cavalerie rendit aux Tbébains de
grands fervices , & devint célèbre lous Jafon, tyran
de Phères. Alors la Theffalie & fes alliés pou voient
armer virigt mille oplites & huit mille chevaux. La
cavalerie Theffalienne étoit excellente pour charger
en pliai ange ; le choc en étoit terrible, mais elle
n’étoit pas aufli bonne comme troupes légères ,
pour efcarmoucher & combattre feula feui. ( Xeno-
ph. I. lV ,p . 5#3. D. , av. J. C. 367).
Lesloixôc ufagesmilitaires des autres républiques
& colonies grecques nous font peu connus. Erigé
lierai elles irmtoient pius ou moins , ou les Athéniens
, ou leur métropole; quant à Lacédémone,
on l’admiroit plus qu’on ne pouvoir l’imirer.
Le nombre des généraux Bæotiens , nommés
lototarqu.es , a beaucoup varié On en voit dans leurs
armées, tantôt un , tantôt quatre , fept & même juf-
ou’à onze. Il paroît qu’ils étoient tirés de différentes
■ filles bs-OL-çnnesv Thucyde ( liv. IV , p. 313 ,
L E V
a v .J .C ., 420.) parle d’un Pagondas qui étoit de
Beotarque do Tiièbes avec Arianthide. On peut
croire qu’ils commandoient tour à tour, puifque ce
meme Pagondas avoit le commandement de l’armée
bæotienne, dans laquelle il y avoit dix autres bæo-
tarques, & qu’il combattit les Athéniens contre l'avis
de fes collègues. Leur commandement étoit annuel,
8c il étoit preferit par la loi de le quitter après
l’année révolue, fous peine de mort. Epaminondas
8c Pelopidas l’ayant retenu après la bataille de
Leuélres, furent accufés & abfous. Les bæotarques
décidoient enfemb e à la pluralité des voix les opérations
militaires. Les voix furent partagées dans le
conîeil qui précéda la bataille de Leuélres. Il étoit
compofê de fix bæotarques ; un feptième , perfuadé
par Epaminondas , entra dans le confeil, & le décida
pour l aélion (Plutarck. Veîopid. Cornel. Nep.
Lpdmin. Alex, ab Alex. , Liv. IV , c. 6. Diodor.,
liv. X V ., p. 485: ).
Dans la Macédoine, état foible jufqu’à Philippe,
le roi fai (oit les frais de la guerre : il fourniffoit les
armes & les vivres. Mais les détails nous manquent
<ur cet objet. Lorfqu Alexandre, étant à Babylone,
incorpora des Perles dans fes troupes , il compofa
chaque file ou décurie , de feize hommes , dont
quatre étoient Macédoniens. Le premier des Macédoniens
étoit décargue : des trois autres, l’un étoit
dïmoivïtè j c’efi-à dire, qu’il recevoit une haute-paye
double de celle du foidar ordinaire : les trois autres
étoient décoifiales. 8c recevoient une paye moindre
que celle du dimoivitè, & plus grande que celle du
foldat. ( Arian. , /. VII ,p . 293 , 8°. ).
R O M A I N ■ Si
Enrôlement 6» levée des troupes»
Romulus, chef de la colonie qui fonda Rome >
ayant été élu roi par le confentement du peuple*
le divifa en trois parties, qu’il nom ma tribus. En-
(uite , prenant dans chacune le citoyen le plus
diftinguô , il lui en confia l’adminiffration. Ce chef
fut appelle tribun. Il fous-divifa chaque tribu en
dix parties -, qu’il nomma curies , dont chacune dut
pareillement un chef choifi parmi les plus braves *
& nommé curion. Les curies furent encore (ous-di-
vifées en endecades , & le chef de chacune appelé
décurien. {A v J .C , 749. Dionyf. Halic. , l. i l %
c. 7. ). . .
Il partagea en fuite tes terres en trente portions
égales, qui furent aflignèes par le fort aux trente
curies. Il y eut une autre divifion du peuple en
praticiens ou citoyens nobles & riches , qui furent
chargés de radminiflration de l’état, & en plé-
béyens ou pauvres , qui exercèrent les arts , le négoce
, & n eurent point alors dans les affemb/ées.
de voix délibérative. Il fut permis à chaque plé—
béyen de fe choifir, parmi les praticiens, un patron
oudéfeofeur de fes droits. Romulus établit un afyle pour les habitants des-,
villes d’Italie que la tyrannie ou l’oligarchie COU-
traignoit à s’expatrier : il les reçut fans examiner la
canfe de leur fuite, les admit au droit de cité , &
leur donna une part des terres enlevées à l’ennemi.
£ Dionyf. , 1. II.., c. 15. ). , ,
La même divifion du peuple fut confervée apres
la réception des Sabins dans Rome : mais alors , les
Romains feuls formèrent une tribu, fous le nom de
■ Ravines ou Rumnenfcs les Sabins une autre, fous
celui de Taciens ; & les Tofcans une trothème, qui
porta le nom de Lucères. Les noms des trentes principales
Sabines , furent données aux trente curies.
( Plutarch. in Romul. , Fuji, voce luceres. Varr. de Ung.
mmLesÈ aÈncMien s R~ omai. ns avo.i ent, comme ,l es cSpartiates
, l’ufage barbare de faire, périr les enfants
Contrefaits. Le nouveau roi ordonna que les citoyens
élevaffent touts leurs enfans mâles , ainfi que
leurs filles aînées , Ôt n’en fiffent périr aucun avant
l’âge de.trois ans , à moins qu’il ne fut né contrefait
ou monffrueux : alors, fes* parents dévoient le
montrer.à cinq de leurs voifins , 8c lorfque ceux-ci
jugeoient qu’ils dévoient être expofés, les parents
pouvoieni l i faire.
L’exercice de l’art militaire 8c de l’agriculture
fut réfervé aux citoyens.. Pendant la paix , ils ne
s’occupoient que de l’économie rurale : ceux qui
habicoiènt les campagnes, ne venoient alâ ville que
pour vendre 8c acheter des denrées au marché qui .
s’y tenoit touts les neuf jours. ( Varr. , l. '/ , c. 28 ).
Servius Tullius , fit une nouvelle divifion du
peuple. Il en forma quatre tribus , à chacune def-
quelles il donna un chef, & aflïgna un quartier dans
Rome , avec défenfes dé changer de demeure, de
faire dans une autre tribu que dans la fienrie , des
enregiftrements de troupes , & des levées de con-
tributipns pour les frais de la gueire. Ènïuite , fans
avoir-égard à l’âncienne divifion' relative à 1 origine
des peuples, il régla l’adminiffration .militaire
fuivant la divifion locale qu’il avoit inffituée. Il établit
dans chacune des quatre tribus un chef, qu’il
chargea de connoître le domicile de chaque citoyen
de fa tribu.
Il divifa auflî le .peu pie du territoire de Rome , en
tribus , dont le nombre efi incertain.
Il établie dans les terreins montagneux , & fur les
collines Les plus propres à retirer & mettre en fureté
les laboureurs des e.fpêces de refuses appelles
pagi. Les habitants de la campagne s y retiroient
dans le cas d’une invafion hoftiie.
Ceux-ci eurent auflî leurs magiftrats , dont chacun
fut.chargé, de prendre connoiflancé des habitants
de fon diflriél, de leurs noms, de leurs poflef-
fions ; d en recevoir les impofitions , 8c d’affembler
au befoin ceux qui dévoient prendre les armes.
<3a!IIe , qu* étoit différente fuivant le fexé & fuivant
la»e au-deffons & au-deffus de là puberté. Par le
nombre des médailles, on connoilfoit facilement
celui des habitants , diflingués par âge & par (exe.
Le même roi établit que la famille de tout citoyen
qui nahfoit, mouroir; ou étoit inferit au nombre
des hommes, donneroit une certaine pièce de mon-
noie ; & il afftgna trois différents lieux pour les dé,
pofer ; favoir, pour celles de la naiffance, le tré-
for de JunonLucine; de l'adolefcence, celui de la
Jeuneffe; de la mort, celui de Venus Lébitine ;
ufage qui faifoit connoître chaque année le nombre
total des citoyens, Si celui des jeunes gens qui
parvenoient à l’âge de la milice. ^ .
Il ordonna que tout citoyen Romain donnât fon
nom , fon âge , ceux de fon père & de fa mère, de
fa femme , de fes enfants, le lieu de fon domicile
dans la ville ou dans les bourgades, & confirmât
fa déclaration par le ferment, fous peine pour les
contrevenants 8c fauffaires, de la confiscation de
leurs biens, & d’être fouettés 8c vendus.
Il inftitua dans chaque diftriét un autel dédié aux
dieux infpeéleurs & tutélaires , & une fête qu’il
nomma paganales. Tours les habitants furent obligés
de s’y rendre chaque année , hommes, femmes &
enfants, & de remettre aux prêtres chacun une mé-
Il établit enfuite le cens ou la divifion du peuple ,
en cinq claffes, fuivant la valeur des biens de chaque
citoyen. ' . .
Dans la première , furent compris ceux qui
avoient un capital de 100,000as oulivresde cuivre,
( 133,000 liv .), 8 onces de cuivre, .= 1 denier
omain, h= 18 f. Le denier romain eut cette va-
Slir depuis l’an de Rome 485 ; jufqu'en 661. ( Mem.
le T A c a d . Düpuy , Mém. de l'A c a d ., £. X X V I I I ,
6 9 1 7 5 ït)* , « Dans la fécondé , de 100,000 as a 75,00® 9
101,250 liv.). .
‘ Dans la troifième , de 50,000 as , f 67,5°°i,v-
Dans la quatrième, de 25,0V :> as , ( 33,750 liv.
Dans la cinquième, de 11,000 as, ( 14 -° 5° “ v* s
SuivantTite-Live , ou de 12,500 as, ( 16,875 '•.
Suivant Denis d’Halicarnaffe ,
La première claffe fut divifèe en quatre-vingts
centuries, dont quarante compofées , des plus
âgés, furent deftinées à la garde de la ville, quarante’
,compofées des plus jeunes, à être employées
dans les expéditions extérieures. ( D10nyjA.LV,
c. 16, L i v . L J , c. 43 )• , „
On fépara de la fécondé , les citoyens au-deffus
de quarante-cinq ans , de ceux qui avoient 1 âge mt-
'litaire , 8c on forma des premiers dix centimes def-
tiitées à garder la ville ; des féconds, dix autres
centuries chargées des guerres extérieures.
La troifième 8c la quatrième , furent diyifees
comme la fécondé , en vingt centuries , 8c luivant
l‘âgè. *' j
La cinquième , en trente centuries , dont quinze
des plus âgés , 8c quinze des plus jeunes.
Il y eut de'plus , quatre centuries (ans armes;
deux pour la confiruaion 8c le tranfport des machines,
la fabrique 8c l'entretien des armes ; deux
de trompettes 8c autres iuftruments , fuivant Denis
d'Halicarnafle , 8c trots fuivant Tue - Levé , qui