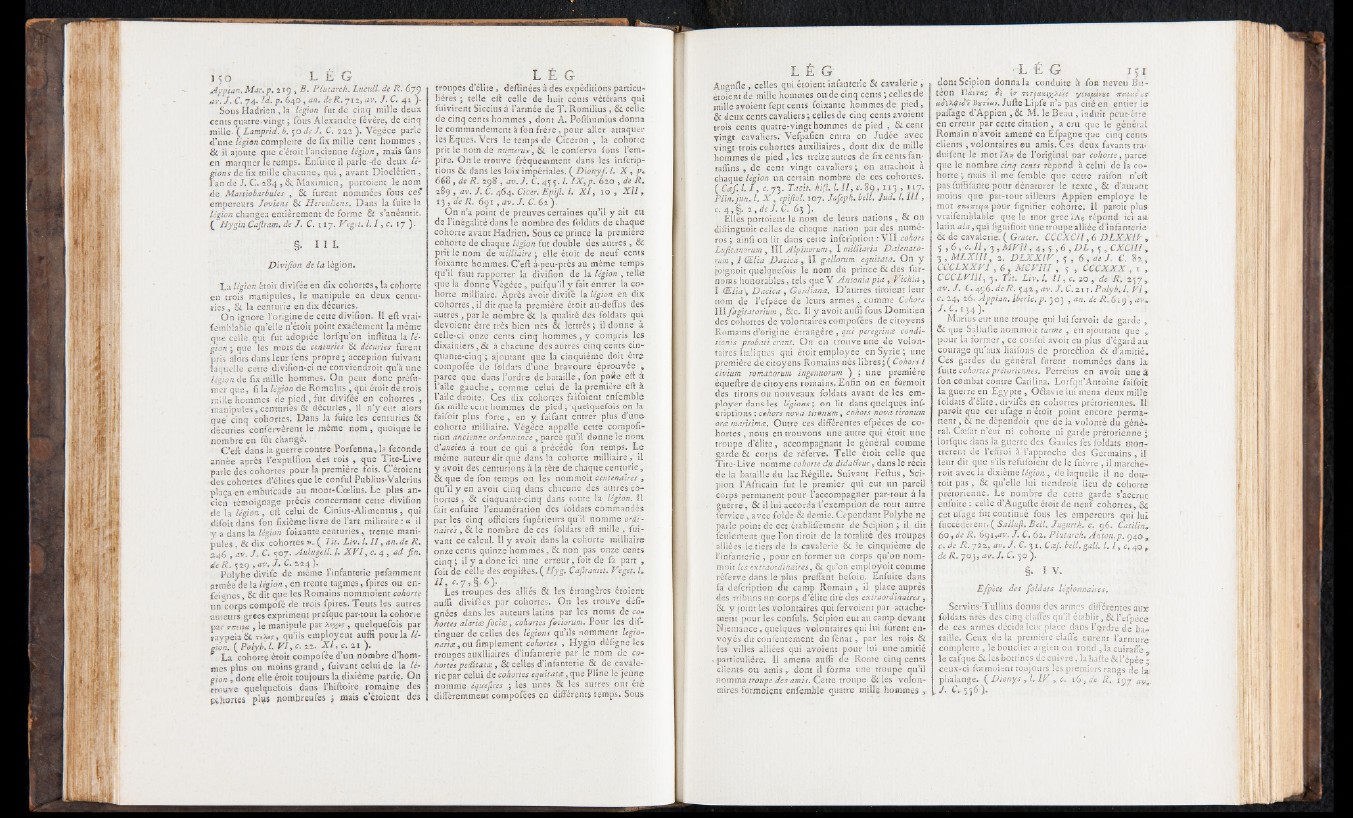
150 L £ G
Appian. Mar. p. 219 } B. Plutarch. Lucull. de /?. 679
/. C. 74. /d. p. 640, an, de R, 712, <îv . /. C, 41 )•
Sous Hadrien, la légion fut de cinq raille deux
cents quatre-vingt ; fous Alexandre révère, de cinq
mille- ( Lamprid. b. 50 de J, C. 222 ). Végèce parle
d’une légion completre de fix mille cent hommes,
& il ajoute que c’étoit l’ancienne légion, mais fans
en marquer le temps. Enfuite il parle -de deux légions
de fix mille chacune, q u i, avant Dioclétien ,
Fan de J. C. 284 & Maximien, portoient le nom
.de Martiobarbules , &. furent nommées fous ces*
empereurs deviens & Herculiens. Dans la fuite la
légion changea entièrement de forme & s’anéantit.
C Hygin Cafirarn. de J. C. 117. Vega. l, I , c, 17 ).
§. I I I .
Divifion de la légion.
La légion étoit divifée en dix cohortes, la cohorte
en trois manipules, le manipule en deux centuries
., & la centurie en dix décuries.
On ignore l’origine de cette divifion. Il eft vrai-
femblable qu’elle n’étoit point exactement la même
que celle qui fut adoptée lorfqu’on inftitua la légion
; que les mots de centuries 8c décuries furent
'pris alors dans leur fens propre ; acception fuivant
laquelle cette divifion-ci ne convrendroit qu’à une
légion de fix mille hommes. On peut donc préfu-
mer que, fi la légion de Romnlus , qui étoit de trois
mille hommes de pied, fut divifée en cohortes ,
manipules, centuries & décuries , il n’y eut alors
que’ cinq cohortes. Dans la fuite les centuries &
décuries confervèrent le même nom , quoique le
nombre en fût changé.
C ’eft dans la guerre contre Porfenna, la fécondé
année après l’expulfion des rois , que Tite-Live
parie des cohortes pour la première fois. C ’étoient
des cohortes d’élites que le conful Publius-Valerius
plaça en embufcade au mont-Coelius. Le plus ancien
témoignage précis concernant cette divifion
de la légion , eft celui de Cinius-Alimentus, qui
difoit dans fon fixième livre de l’art militaire : « il
y a dans la légion foixante centuries , trente manipules
, & dix cohortes ». ( Tit. Liv. /. I I , an.de R,
3.46 , av. J. C. 507. Aulugell. I. X V I , c. 4 , ad fin.
de R. 529 ,a v .J , C. 224). .
Polybe divife de même l’infanterie pefamment
armée de la légion, en trente tagmes, fpires ou en-
fei^nes, & dit que les Romains nommoient cohorte
un^corps compofé de trois fpires. Touts les autres
auteurs grecs expriment prefque par-tout la cohorte
par TTreipa , le manipule par , quelquefois par
j-aypeia & rtto?, qu’ils employeur auffi pour la légion.
( Polyi. l . y l . c . v i . X l , c , z 1 ).
6 La cohorte étoit compofée d’un nombre d’hommes
plus ou moins grand , fuivant celui de la légion
, dont elle étoit toujours la dixième partie, On
trouve quelquefois dans l’hiftoire romaine des
pcportes plus qombreufes ; mais c’étoient des
L É G
troupes d’élite, deftinées à des expéditions particulières
; telle eft celle de huit cents vétérans qui
fuivirent Siccius à l’armée de T . Romilius , & celle
de cinq cents hommes , dont A. Pofthumîus donna
le commandement à fon frère, pour aller attaquer
les Equ.es'. Vers le temps de Cicéron , la cohorte
prit le nom de numerus, 8c le conferva fous l’empire.
On le trouve fréquemment dans les infcrip-
tions 8c dans les loix impériales. ( Dionyf. I. X , p.
668, de R. 298 , av. J. C. 45 ç. I. IX, p. 620 , de R.
289 , av. J. C. 464. Cicer. Epifl. L X I , 10 , X I I ,
13 ,~de R. 6 9 1 , av. J. C. 62).
On n’a point de preuves certaines qu’il y ait eu
de l’inégalité dans le nombre des foldats de chaque
cohorte avant Hadrien. Sous ce prince la première
cohorte de chaque légion fut double des autres , &
prit le nom de milliaire ; elle étoit de neuf cents
foixante hommes. C ’eft à-peu-près au même temps
qu’il faut rapporter la divifion de la légion , telle
que la donne Végèce, puifqu’il y fait entrer la cohorte
milliaire. Après avoir divife la légion en dix
cohortes, il dit que la première étoit au-deffus des
autres , par le nombre & la qualité des foldats qui
dévoient être très bien nés & lettrés ; il donne à
celle-ci onze cents cinq hommes, y compris les
dixainiers,& à chacune des autres cinq cents cinquante
cinq ; ajoutant que la cinquième doit être
compofée de foldats d’une bravoure éprouvée ,
parce que dans l’ordre de bataille , fon pofte eft à
l’aile gauche, comme celui de la première eft à
l’aile droite. Ces dix cohortes faifoient enfemble
fix mille cent hommes de pied ; quelquefois on la
faifoit plus forte, en y faifant entrer plus d’une
cohorte milliaire. Végèce appelle cette compofi-
tion ancienne ordonnance , parce qu’il donne le nom
d'ancien à tout ce qui a précédé fon temps. Le
même auteur dit que dans la cohorte milliaire / il
y avoit des centurions à la tête de chaque centurie,
& que de fon temps on les nomnioit centenaires ,
qu’il y en avoit cinq dans chacune des autres cohortes,
& cinquante-cinq dans toute la légion. Il
fait enfuite l’énumération des foldats commandés
parles cinq officiers fupérieurs qu’il nomme ordinaires
, & le nombre de ces foldats eft mille , fuivant
ce calcul. Il y avoit dans la cohorte milliaire
onze cents quinze hommes, 8c non pas onze cents
cinq; il y a donc ici une erreur, foit de fa part ,
foit de celle des eopiftes. (immm Hyg. Caflramet. Vsget. L Les troupes des alliés & les étrangères etoient
auffi divifées par cohortes. On les trouve défi-
gnées dans les auteurs latins par les noms de cohortes
alarioe focict, cohortes fociorum. Pour les dif-
tinguer de celles des légions qu’ils nomment legio-
nariot, ou fimplement cohortes , Hygin défigne les
troupes auxiliaires d’infanterie par le nom de cohortes
pedîtatee, & celles d’infanterie & de cavalerie
par celui de cohortes equitat<z, que Pline le jeune
nomme équeftres ; les unes & les autres ont été
différemment compofées en différents temps, Sous
L É G
Augufle, celles qui étoient infanterie 8c cavalerie
étoient de mille hommes ou de cinq cents ; celles de
milleavoientfeptcents foixante hommes,de pied,
& deux cents cavaliers; celles de cinq cents avoient
trois cents quatre-vingt hommes de pied , & cent
vingt cavaliers.- Vefpafien entra en Judée avec
vingt-trois cohortes auxiliaires , dont dix de mille
hommes de pied , les treize autres de fix cents fan-
taffins , de cent vingt cavaliers ; on attaclioit a
chaque légion un certain nombre de ces cohortes.
( Ccef. 1. 1 , c. 73. Tacit. hiß. I. I I , c. 89, 1 1 3 ,1 1 7 *
Plin.jun. L X , epißol. 107. Jofeph. bell. lud. I. I I I ,
c. 4 , §. 2 ,de J. C. 63 ).
Elles portoient le nom de leurs nations, & on
diftinguoit celles de chaque nation par des numéros
; ainfi on lit dans cette infeription : V I I cohors
Lufitanorum , III Alpinorum , I milliaria Dalenato-
rurn, I (Elia Dacica, II gallorum equitata. On y
jioignoit quelquefois le nom du prince & des fur-
nonas honorables, tels que V Antoniapia , Vichia ,
I (Elia\ Dacica , Gordiana. D ’autres tiroient leur
nom de l’efpèce de leurs armes, comme Cohors
III fagitatorium , &c. Il y avoit aufii fous Domirien
des cohortes de volontaires compofées de citoyens
Romains cf’ôrigine étrangère , qui peregrince condi-
tionis 'probati erant. On en trouve une de volontaires
Italiques qui étoit employée en Syrie ; une
première de citoyens Romains nés libres ; ( Cohors 1
civiurru romanorum ingenuorum ) ; une première
équeftre de citoyens romains. Enfin on en formoit
des tirons ou nouveaux foldats avant de les employer
dans les légions ;. on lit dans quelques inf-
eriptions : cohors nova tirenum, cohors nova tironum
om rnaritimee. Outre ces différentes efpèees de cohortes
, nous en trouvons une autre qui étoit une
troupe d’élite , accompagnant le général comme
garde & corps de réferve. Telle étoit celle que
Tite-Live nomme cohorte du didaéleur, dans le récit
de la bataille du lac Régille. Suivant Feftus, Sci-
pion l’Africain fut le premier qui eut un pareil
corps permanent pour l’accompagner par-tout à la
guerre, & il lui accorda Texemption de tout autre
fervice, avec folde & demie..Cependant Polybe ne
parle point de cet établiffement de Scipion ; il dit
feulement que l’on tiroit de la totalité des troupes
alliées le.tiers de la cavalerie & le cinquième de
Finfanrerie ,-pour en former un corps qu’on nom-
moit les extraordinaires, & qu’on employoit comme
réferve dans le plus preffant befoin. Enfuite dans
fa defeription du camp Romain , il place auprès
des tribuns un corps d’élite tiré des extraordinaires
& y joint les volontaires qui fervoient par attachement
pour les confuls. Scipion eut au camp devant
Niemance, quelques volontaires qui lui furent envoyés
du confentement du fénat, par les rois &
les villes alliées qui avoient pour lui une amitié
. particulière. Il amena auffi de Rome cinq cents
clients' ou amis r dont il forma une troupe qu’il
nomma troupe des amis.. Cette troupe & les volontaires.
formoient enfemble quatre mille hommes
LÉ G 151
dont Scipion donna la conduite à fon neveu B11-
teon Uuvreiç éï ir .riTfeiKi^Xiùs yivoutyas irtipadisç
uihxfyici'E Jufte Lipfe n’a pas cité en entier le
paffage d’Appien , & M. le Beau , induit peut-être
en erreur par cette citation , a cru que le général
Romain n’avoit amené en Efpagne que cinq cents
clients , volontaires ©u amis. Ces deux favants tra-
duifent le mot tÂtj de l’original par cohorte, parce
que le nombre cinq cents répond à celui de la cohorte
; mais il me femble que cette raifon n’eft
pas fuffifante pour dénaturer le texte, & d’autant
moins que par-tout ailleurs Appien employé le
mot <7tt«7rupa. pour fignifier cohorte. Il paroît plus
vraifemblable que le mot grec ÏAq répond ici au
latin ala, qui fignifioit une troupe alliée d’infanterie
& de cavalerie^ ( Gruter. CCCXCII, 6 D L X X IP v
5 , 6 , c. I I , 3 J M V I I , 4 ,5 ., 6 , D L , 5, CXCIII,
3 , M L X I I l, 2. D L X X IV , 5 , 6 , de J. C. 82,
CCCLXXV1 , 6 . MCVIII | 5 C CCXXX , 1 ,
CCCLVIll, 3. lit. H t I I , c. zo , de R. 257,
av. J. C. 496. de R. 542, av. J. C. n i .Polyb. I. V I ,
c. 24, 26. Appian. Iberic. p. 303 , an. de R. 61ÿ , av*
ƒ. C. 134).
Marius eut une troupe qui lui fervoit de garde ,
& que Sallufte nommoit turme , en ajoutant que
pour la former , ce conful avoit eu plus d’égard au
courage qu’aux liaifons de proteélion 8c d’amitié.
Ces gardes du général furent nommées dans m
fuite cohortes prétoriennes. Petreius en avoit une à:
fon combat contre Catilina. Lorfqu’Antoine faifoit
la guerre en Egypte , Oélavie lui mena deux mille
foldats d’élite, divifés en cohortes prétoriennes* Il
paroît que cet ufage n’étoit point encore perma~
nent, 8c ne dépendoit que de la volonté du général.
Cæfar n’eut ni cohorte ni garde prétorienne S
lorfque dans la guerre des Gaules fes foldats montrèrent
de l’effroi à l’approche des Germains il
leur dit que s’ils refufoient de le fuivre ,.il marche-
roit avec la dixième légion , de laquelle il ne dou-
toit pas, & qu’elle lui tiendrait lieu de cohorte
prétorienne. Le nombre de cette garde s’accrut
enfuite : celle d’Augufte étoit de neuf cohortes, 8c
cet ufage fut continué fous les empereurs qui lui:
fuccédèrenr. ( Salluft. Bell. Jugurth. c. 96. Catïlïn,
60 ,de R. 691,av. J. C. 62. Plutarch. Anton.p. 940 ,
c. de R. 722, av. J. C. 31, Ccef.-bell, gall. 1. 1 , c, 4.0 r
de R, 703, av. J. C, 50 ).
§•■ I V.
Efp'ece des foldats légionnaires.
Servius-Tullius donna des armes différentes aur
foldats tirés des cinq claffes qu’il établit, & l ’èfpèce
de ces armes décida leur place dans l’ordre de bataille
» Ceux de la première claffe eurent l’armure
complette , le bouclier argiên ou rond , la cuirafte
le cafque & les bottines de cuivre, la hafte & l ’épée *
ceux-ci formoient toujours les premiers rangs de la:
phalange. {Dionys , L IV c. 16 , de R, igy av