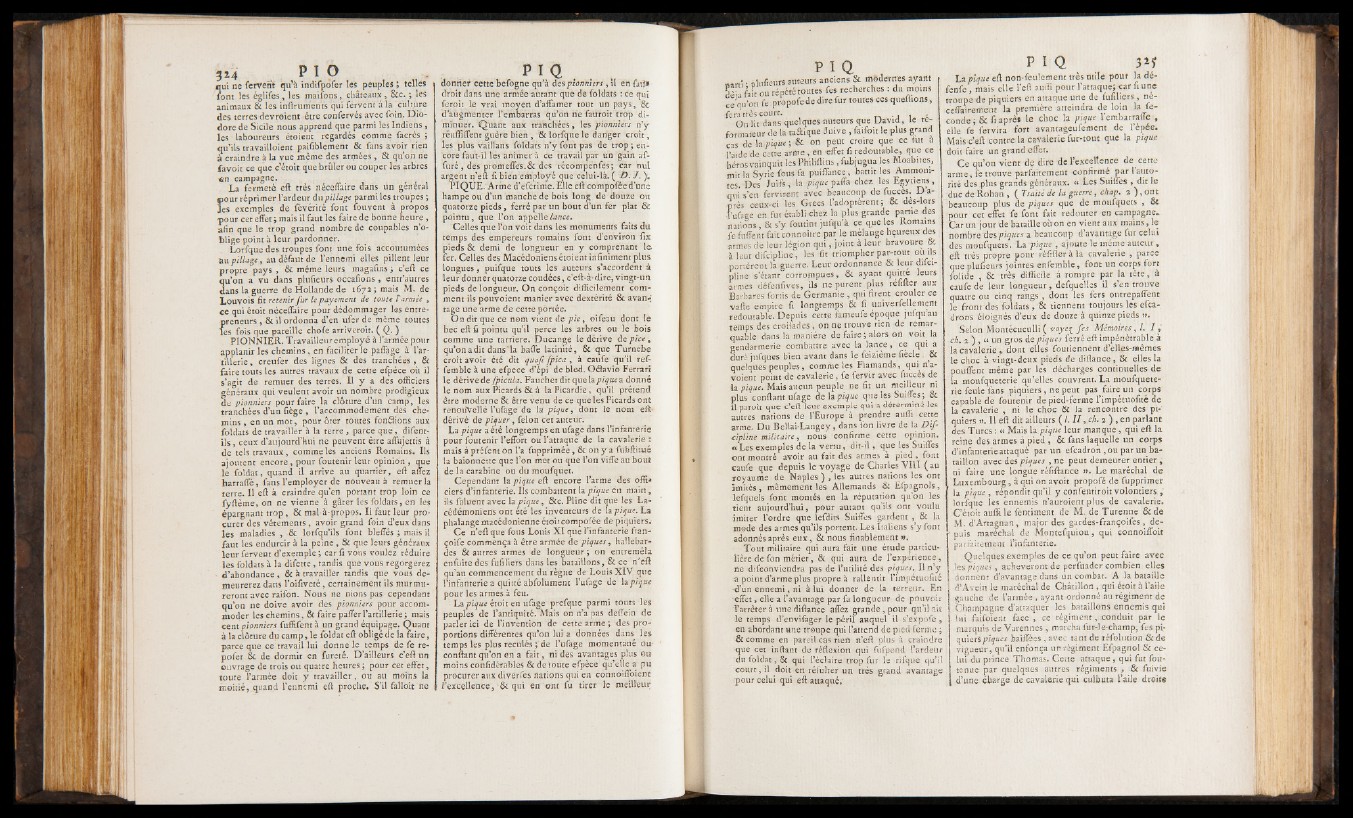
3 1 4 P I O
cui ne fervent qu’à indifpofer les peuples ; telles
font les églifes, les maifons , châteaux, 8ic. ; les
animaux & les instruments qui fervent à la culture
des terres devraient êtfe confervés avec foin. Dio-
dore de Sicile nous apprend que parmi les Indiens ,
les laboureurs étoient regardés comme facres ;
qu’ils travailloient paifiblement & fans avoir rien à craindre à la vue même des aripées , & qu’on rie
favoit ce que c’étoit que brûler ou couper les arbres
campagne. • , , . ,
La fermeté eft très néccffaire dans ün general
pour réprimer l’ardeur du pillage parmi les troupes ;
Jes exemples de févéritè font fouvent à propos
pour cet effet ; mais il faut les faire de bonne heure ,
afin que le trop grand nombre de coupables n’oblige
point à leur pardonner.
Lorfque des troupes font une fois accoutumées
au pillage, au défaut de l’ennemi elles pillent leur
propre pays , & même leurs magafins ; c’eft cé
qu’on a vu dans plufieurs occafions , entr’aiitres
dans la guerre de Hollande de 1672 ; mais M. de
Louvois fit retenir fur le payement de toute l'armée ,
ce qui étoit nèceffaire pour dédommager les entrepreneurs
, & il ordonna d’en ufer de même toutes
les fois que pareille ehofe arriverait. ( Q. )
PIONNIER. Travailleur employé à l’armée pour
applanir les chemins, en faciliter le paffage à l’artillerie
, creufer des lignes & des tranchées , &
faire touts les autres travaux de cette efpèce où il
s’agit de remuer des terres. Il y a des officiers
généraux qui veulent avoir un nombre prodigieux
de pionniers pour faire la clôture d’un camp, les
tranchées d’un fiège , l’accommodement des chemins
, en un mot, pour ôter toutes fondions aux
foldats de travailler à la terre, parce que, difent-
ils , ceux d’aujourd’hui ne peuvent être affujettis à
de tels travaux, comme les anciens Romains. Ils
ajoutent encore, pour foutenir leur opinion , que
le foldat, quand il arrive au quartier, eft affez
harraffé, fans l’employer de nouveau à remuer la
terre. Il eft à craindre qu’en portant trop loin ce
fyftème, on ne vienne à.gâter les foldats, en les
épargnant trop, & mal à-propos. Il faut leur procurer
des vêtements , avoir grand foin d’eux dans
les maladies , & lorfqu’ils font bleffés ; mais il
faut les endurcir à la peine , & que leurs généraux
leur fervent d’exemple ; car fi vous voulez réduire
les foldats à la difette, tandis que vous regorgerez
d’abondance, 8c à travailler tandis que vous demeurerez
dans l’oifiveté, certaineriient ils murmureront
avec raifon. Nous ne nions pas cependant
qu’on ne doive avoir des pionniers pour accommoder
les chemins, & faire pafferl’artillerie; mais
cent pionniers fuffifent à un grand équipage. Quant
à la clôture du camp, le foldat eft obligé de la faire,
parce que ce travail lui donne le temps de fe re-
pofer & de dormir en fureté. D’ailleurs c’eft un
ouvrage de trois ou quatre heures ; pour cet effet,
toute l’armée doit y travailler, ou au moins la
moitié, quand l’enricmi êft proche. S’il fallait rie
Pi Q .
donrief cette befogne qu’àdes pionniers , il en faii*
droit dans une armée autant que de foldats : ce qui
ferait le vrai moyen d’affamer tout un pays, &
d’àugrrienter rembarras qu’on rie faüfoit trop diminuer.
Quant aux tranchées, les pionniers n’y
réuffiffent guère bien, & lorfque le danger croît,
les plus Vaillans foldats n’y fônt pas de trop ; encore
faut-il les animer à ce travail par un gain affûté,
des promeffes.& des récompénfes; car nul
argent n’eft fi bien eriiployé que celui-là. ( D. J. ).
PIQÜE. Arme d’efcrime. Elle eft comppféed’une
hampe ou d’un manche de bois long de douze ou
quatorze pieds, ferré par un bout d’un fer plat &
pointu, que l’ on appelle lance.
Celles que l’on voit dans les monuments faits du
temps des empereurs romains font d’environ fix
pieds & demi de longueur en y comprenant le.
fer. Celles des Macédoniens étoient infiniment plus
longues, puifque touts les auteurs s’accordent à
leur donner quatorze coudées, c’eft-à-dire, vingt-un
pieds de longueur. On conçoit difficilement comment
ils pouvoient manier avec dextérité & avan«*
tage une arme de cette portée.
On dit que ce nom vient de pie, oifeau dont le
bec eft fi pointu qu’il perce les arbres ou le bois
comme une tarriere. Ducange le dérive de pïce,
qu’onadit dans la baffe latinité, & que Turnebe
croît avoir été dit quofi fpïca , à caufe qu’il ref-
femble à une efpece d’épi de bled. Oélavio Ferrari
le dérive de fpicula. Faucher dit que l a a donné
le nom aux Picards & à la Picardie, qu’il prétend
être moderne & être venu de ce que les Picards ont
renouVellé l’ufage de la pique, dont le nom eft-
dérivé de piquer, félon cet auteur.
La pique a été longtemps en ufage dans l’infanterie
pour foutenir l’effort ou l’attaque de la cavalerie :
mais à préfent on l ’a fupprimée, & on y a fubftitué
la baïonnette que l’on met ou que l’on viffe au bout
de la carabine ou du moufquet.
Cependant la pique eft encore l’arme des offi*
ciers d’infanterie. Ils combattent la pique en main ,
ils faluent avec la pique, &c. Pline dit que les Lacédémoniens
ont été les inventeurs de la pique. La
phalange macédonienne étoit compofée de piquiers.
Ce n’eft que fous Louis XI que l’infanterie fran-
çoife commença à être armée de piques, hallebardes
& autres armes de longueur ; on entremêla
enfnite des fufiliers dans les bataillons, & ce n’eft
qu’au commencement du règne de Louis X IV que
l’infanterie a quitté abfolument l’ufage de la pique
pour les armes à feu.
La pique étoit en ufage prefque parmi touts les
peuples de l’antiquité. Mais on n’a pas deffein de
parler ici de l’invention de cette arme; des proportions
différentes qu’on lui a données dans les
temps les plus reculés ; de l’ufage momentané ou
confiant qu’on en a fait, ni des avantages plus ou
moins confidérables & de toute efpèce qu’elle a pu
procurer aux diverfes nations qui en connoiffoient
l ’excellence, & qui en ont fu tirer le meilleur
p 1 Q
»art! • plufieurs auteurs anciens & mSdertres ayant
rièia fait ou répété toutes fes recherches : du moins
ce qu’on fe .propofede dire fur toutes ces quefttons ,
fera très court. , ,
Gn lit dans quelques auteurs que David, le reformateur
de la taftique Juive , faifoit le plus grand
cas delà .pique y 8c on peut croire que ce fut a
l’aide de cette arme, en -effet fi redoutable, que ce
héros vainquit les Philiftins ,fubjugua les Moabnes,
mit la Syrie fous fa puiffance, battit les Ammonites.
Des Juifs, la .pique paffa chez les E^y tiens ,
oui s’en fervirent avec beaucoup de fucces. D a-
près ceux-ci les Grecs l’adoptèrent; & des-lors
•Vufage en fut établi chez la plus grande partie des
nations, & s’y foutint jufqu’à ce que les Romains
fe fuffenr fait connoître par le mélange heureux des
armes de leur légion qui, joint à leur bravoure &
à leur difcipline, les fit triompher par-tout ou ils
portèrent la guerre. Leur ordonnance & leur difcipline
s’étant corrompues, & ayant quitté leurs
armes défènfives, ils ne purent plus refifter aux
Barbares fortis de Germanie , qui firent crouler ce
vafte empire fi longtemps & fi univerfellement
redoutable. Depuis cette fameufe époque jufqu’au
temps des croifades , on ne trouve rien de remarquable
dans la manière de faire; alors ori voit la
gendarmerie combattre avec la lance, ce qui a
duré jufques bien avant dans le feizième fiècle 8c
quelques peuples, comtrie les Flamands, qui n’a-
voient point de cavalerie, fe fervir avec füccès de
la pique. Mais aucun peuple ne fit un meilleur ni
plus confiant ufage de \z pique que les.Suiffes; &
il paroît que c’eft leur exemple qui a déterminé les
autres nations de l’Europe à prendre aulfi cette
arme. Du Bellai-Langey, dans fon livre de la Difcipline
militaire, nous confirme cette opinion.
« Les exemples de la vertu, dit-il, que les Suiffes
ont montré avoir au fait des armes à pied , font
caufe que depuis le voyage de Charles VIII ( au
royaume de Naples ) , les autres nations les ont
imités, mêmement les Allemands & Efpagnols,
lefquels font montés en la réputation qu’on les
tient aujourd’hui, pour autant qu’ils ont voulu
imiter l’ordre que lefdits Suiffes gardent , & la
mode des armes qu’ils portent. Les Italiens s’y font
adonnés après eux, &nous finablement »,
Tout militaire qui aura fait une étude particulière
de fon métier, & qui aura de l’expérience,
ne difconviendra pas de l'utilité des piques, Il n’y
a point d’arme plus propre à rallentir l’impétuofité
d’un ennemi, ni à lui donner de la terreur. En
effet, elle a l’avantage par fa longueur de pouvoir
l’arrêter à une diftance affez grande, pour qu’il ait
le temps d’envifager le péril auquel il s’expofe ,
en abordant une troupe qui l’attend de pied ferme ;
& comme en pareil cas rien n’eft plus à craindre
que cet inftant de réflexion qui fufpend l’ardeur
du foldat, & qui l’éclaire trop fur le rifque qu’il
court, il doit en réfultef un très grand avantage
pour celui qui eft attaqué.
P I Q
La pique eft non-feulement très utile pour la dé-
fenfe, mais elle i’eft aufti pour l’attaque; car fi une
troupe de piquiers en attaque une de fufiliers , né-
ceffairement la première atteindra de loin la fécondé;
& fi après le choc la pique l’embarraffe ,
elle fe fervira fort avantageufement de l’épée.
Mais c’eft contre la cavalerie fur-tout que la pique
doit faire un grand effet.
Ce qu’on vient dç dire de l’excellence de^ cette
arme, fe trouve parfaitement confirmé par l autorité
des .plus grands généraux. « Les Suiffes , dit le
duc de Rohan , ( Traité de la guerre, chap. 2 ) , ont
beaucoup plus de piques que de mouiquets , &
'pour cet effet fe font fait redouter en campagne.
Car un jour de bataille où on en vient aux mains, le
nombre des piques a beaucoup d’avantage fur celui
des moufquets. La pique , ajoute le meme auteur ,
eft très propre pour réfifter à la cavalerie , parce
que plufieurs jointes enfemble, font un corps fort
folide , & très difficile à rompre par la tête, à
caufe de leur longueur, defquelles il s’en trouve
quatre ou cinq rangs , dont les fers outrepaffenc
le front des foldats, & tiennent toujours les efea-
drons éloignés d’eux de douze à quinze pieds ».
Selon Montécuculli ( voye{ fes Mémoires, /. /
Ich. 2 ) , « un gros de piques ferré eft impénétrable à
la cavalerie dont elles foutiennent d’elles-raêmes
le choc à vingt-deux pieds de diftance, & elles la
pouffent même par les décharges continuelles de
la moufqueterie qu’elles couvrent. La nioufquete-
rie feule fans piquiers, ne peut pas faire un corps
capable de foutenir de pied-ferme l’impétuofité de
la cavalerie , ni le choc & la rencontre des piquiers
». Il eft dit ailleurs ( l. II ,ch. 2 ) , en parlant
des Turcs : « Mais la .pique leur manque, qui eft la
reine des armes à pied , & fans laquelle un corps
d’infanterie attaqué par un efeadron, ou par un bataillon
avec des piques , ne peut demeurer entier ,
ni faire une longue réfiftance ». Le maréchal de
Luxembourg, à qui on avoit propofé de fupprimer
la pique, répondit qu’il y confentiroit volontiers.
lorfque les ennemis n’auroient plus de cavalerie.
C’étoit auffi le fentiment de M. deTurenne & d e
M. d’Artagnan, major des gardes-françoifes , de-
’ puis maréchal de Montefquiou, qui connoiffoit
parfaitement l’infanterie.
Quelques exemples de ce qu’on peut faire avec
les piques., achèveront de perfuader combien elles
| donnent d’avantage dans un combat. A la bataille
d’Avein le maréchal de Châtillon , qui étoit à l’aile
gauche de l’armée, ayant ordonné au régiment de
Champagne d’attaquer les bataillons ennemis qui
lai faifoient face , ce régiment, conduit par le
marquis de Varennes , marcha fur-le-champ, fes piquiers
piques baiffées , avec tant de réfolution & de
vigueur, qu’il enfonça un régiment Efpagnol & celui
du prince Thomas. Cette attaque , qui fut fou-
tenue par quelques autres régiments , 8c fuivie
d’une charge de cavalerie qui culbuta l’aile droite