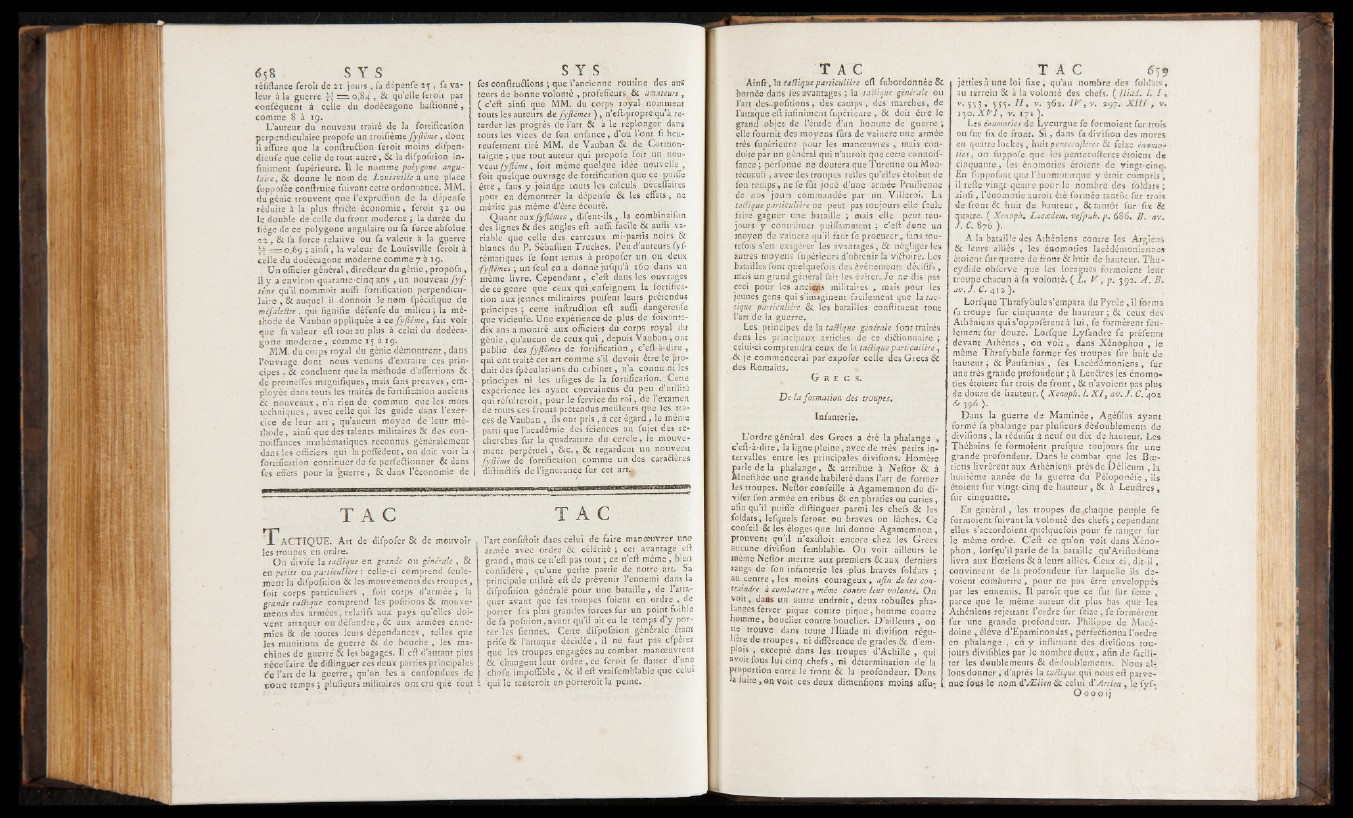
<S58 S Y S
lèliflance feroit de 21 jours , fa dépenfe 15 , fa valeur
à la guerre -f-j = : 0,84', & qu’elle feroit par
conféquent à celle du dodécagone baftionné,
comme 8 à 19.
L’auteur du nouveau traité de la fortificatibn
perpendiculaire propofe un troifième fyficme , dont
il allure que la conftru&ion feroit moins difpen-
dieufe que celle de tout autre, & la difpofition infiniment
fupérieure. Il le nomme polygone angulaire,
8c donne le nom de Louisville à une place
fuppofée confiante fuivant cette ordonnance. MM.
du génie trouvent que l’expreflion de la dépenfe
réduite à la plus ftriéle économie, feroit 32 ou
le double de celle du front moderne ; la durée du
fiège de ce polygone angulaire ou fa force abfolue
a a , & fa force relative ou fa valeur à la guerre
= 0,69 ; ainfi , la valeur de Louisville feroit à
celle du dodécagone moderne comme 7 à 19.
Un officier général, direéleur du génie, propofa,
il y a environ quarante-cinq ans , un nouveau fyf-
ûme qu’il nommoit aufli fortification perpendiculaire
, & auquel il donnoit le nom fpécifique de
méfalefére, qui fignifie défenfe du milieu ; la méthode
de Vauban appliquée à ce fyjlême, fait voir
que fa valeur eft tout au plus à celui du dodécagone
moderne , comme 15 à 19: g
MM. du corps royal du génie démontrent, dans
l’ouvrage dont nous venons d’extraire ces principes
concluent que la méthode d’afferrions &
de proraeffes magnifiques, mais fans preuves, employée
dans touts les traité? de fortification anciens
8c nouveaux , n’a rien de commun que les mots
techniques, avec celle qui les guide dans l'exercice
de leur art ; qu’aucun moyen de leur méthode,
ainfi que des talents militaires & des con-
noiflances mathématiques reconnus généralement
dans les officiers qui la poffèderit, on doit voir la
fortification continuer de fe perfectionner & dans
fes effets pour la guerre, & dans l’économie de
S Y S
fes conftru&ions ; que l’ancienne routine des auï!
teurs de bonne volonté , profeffeurs & amateurs ,
( e’eft ainfi que MM. du corps royal nomment
touts les auteurs de fyflêmes ) , n’efLproprequ’à retarder
les progrès de l’art & à le rèplonger dans
touts les vices de fon enfance, d’où l’ont fi heu-
reufement tiré MM. de Vauban St de Cormon-
taigne ; que tout auteur qui propofe foit un nouveau
Jyfleme, foit même quelque idée nouvelle ,
foit quelque ouvrage de fortification que ce puiffe
être, fans y joindre touts les calculs necefïaires
pour en démontrer la dépenfe & les effets, ne
mérite pas même d’être écouté.
Quant aux fyflêmes , difent-il^, la combinaifon
des lignes & des angles eft aufli facile 8c aufli variable
que celle des carreaux mi-partis, noirs &
blancs du P. Sébaftien Truches. Peu d’auteurs fyf*
tématiques fe font tenus à propofer un ou deux
•fyflêmes ; un feul en a donné jufqu’à 160 dans un
même livre. Cependant, c’ eft dans les ouvrages
de ce genre que ceux qui „enfeignent la fortification
aux jeunes militaires puifent leurs prétendus
principes ; cette inftru&ion eft aufli dangereufe
que vicieufe. Une expérience de plus de foixante-
dix ans a montré aux officiers du corps royal du
génie, qu’aucun de ceux qui , depuis Vauban ., ont
publié des fyflêmes de fortification , c’eft-à-dire ,
qui ont traité cet art comme s’il devoir être le produit
des fpéculations du cabinet, n’a connu ni les
principes ni les ufages de la fortification. Cette
expérience les ayant convaincus du peu d’utilité
qui réfulteroit, pour le fervice du roi * dé l’examen
de touts ces Fronts prétendus meilleurs que les traces
de Vauban , ils ont pris , à cet égard, le même
parti que l’académie des fciences au fujet des recherches
fur la quadrature du cercle, le mouvement
perpétuel, & c ., 8c regardent un nouveeu
fyflême de fortification comme un des caractères
di'ftinâifs de l’ignorance fur cet art.*
T A C
’1 ACTIQUE. Art de difpofer 8c de mouvoir
les troupes en ordre.
On divife la taâique en grande ou générale , 8c
en petite ou particulière : celle-ci comprend feulement
la difpofition & les.mouvements des troupes,
foit .corps particuliers , foit corps d’armée; la
grande tactique comprend les pofirions & mouvements
des armées, relatifs aux pays qu’elles doivent
attaquer ou défendre, & aux armées ennemies
& de toutes leurs dépendances, telles que
les munitions de guerre & de bouche , les machines
de guerre' & les bagages. Il eft d’autant plus
néceffaire de diftinguer ces deux parties principales
de l’art de la guerre, qu’on les a confondues de
rou e temps; plufieurs militaires ont cru que tout
T A C
l’art confiftoit dans celui de faire manoeuvrer Une
armée avec ordre 8c célérité ; cet avantage eft
grand, mais ce n’eft pas tout ; ce n’eft même, bien
confidéré, qu’une petite partie de notre art. Sa
principale utilité eft de prévenir l’ennemi dans la
difpofition générale pour une bataille, de l’attaquer
avant que fes .troupes foient en ordre , de
porter fes plus grandes forces fur un point foible
de fa pofition,avant qu’il ait eu le temps d’y porter
les Tiennes. Cette difpofition générale étant
prife & l’attaque décidée., il ne faut pas efpérer
que les troupes engagées au.combat manoeuvrent
& changent leur ordre, ce feroit fe flatter d’une
chofe; impoflible , 8c il eft vraifemblable que celui
qui le tenteroit en porteront la peine.
TAC
Ainfi, lâ laâtque particulière eft fubordonnée &
bornée dans fes avantages ; la taâique générale ou
l’art des-.pofitions, des camps , des marches, de
l’attaque eft infiniment fupérieure , & doit être le
grand objet- de l’étude d’un homme de guerre ;
elle fournit des moyens fûrs de vaincre une armée
très fupérieure pour les manoeuvres , mais conduite
par un général qui n’auroit que cette connoif-
fance; perfonne ne doutera que Turenne ou Mon-
técuculi, avec*des troupes telles qu’elles étoient de
fon temps, ne.fe-fût joué d’une armée Pruffienne
de nos jours commandée par lia Villeroi. La
taélique particulière ne peut pas toujours elle feule
faite gagner une bataille ; mais elle peut toujours
y contribuer puiflamment ; c’eft donc un
moyen de vaincre qu’il faut fe procurer*, fans toutefois
s’en • exagérer les avantages, & négliger les
autres moyens fûpérieurs d’obtenir la victoire. Les
batailles font quelquefois des événements décififs ,
mais un grand général fait les éviter.: Je ne dis pas
ceci pour les anciens militaires , mais pour les
jeunes gens qui s’imaginent facilement que \a. tactique
particulière 8c les batailles conftituent tout
l’art de la guerre.
Les principes de la taâique générale font traités
dans les principaux articles de ce dictionnaire ;
çelui-ci comprendra ceux de la taâique particulière ,
8c je commencerai par expofer celle des Grecs 8c
.des Romains.
G r e c s. - ;
De la formation des troupes♦
Infanterie.
L’ordre général des Grecs a été la phalange ,
c’eft-à-dire, la ligne pleine, avec de très petits intervalles
entre les principales divifions.' Homère
arle de la phalange, & attribue à Neftor & à
Inefthée une grande habileté dans l’art de former
les troupes. Neftor confeille à Agamemnon de di-
vifer fon armée en tribus & en phraties ou curies ,
afin qu’il puifle diftinguer parmi les chefs & les
foldats, lefquels feront ©u braves ou lâches. Ce
confeil & les éloges que lui donne Agamemnon ,
prouvent qu’il n’exiftoit encore chez les Grecs
aucune divifion femblable. On voit ailleurs le
même Neftor mettre aux premiers 8c aux derniers
rangs de fon infanterie les plus braves foldats ;
au centre , les moins courageux, afin de les contraindre
à combattre , même contre leur volonté. On
voit, dans un autre endroit, deux robuftes phalanges
ferrer pique contre pique, homme contre
homme, bouclier contre bouclier. D ’ailleurs, on
ne trouve dans toute l’Iliade ni divifion régulière
de troupes , ni différence de grades & d'em-
plois , excepté dans les troupes d’Achille , qui
avoit fous lui cinq ,chefs , ni détermination de la
proportion entre le front & la profondeur. Dans
la fuite, on voit ces deux dimenfions moins affu;
T A C 6 5 9
jettiesà une loi fixe ; qu’au nombre des foldats,
au terrein & à la volonté des chefs. ( lliad. I. I „
v. 553 ; I l , v. 362. IV , v. 297. X I I I t y.
130. X V I , v. 171 ).
Lés énomoties de Lycurgue fe formoient fur trois
ou fur fix de front. S i , dans fa divifion des mores
en quatre lockes , huit pentecofieres 8c feize énomo-*
ties, on fuppofe que les pentecofteres étoient de
cinquante, les énomoties étoient de vingt-cinq.
En fuppofant que l’énomotarqne y étoit compris ,
il refte vingt-quatre pour le nombre des foldats ;
ainfi , Pénomotie auroit été formée tantôt fur trois
de front 8c huit de hauteur, 8c tantôt fur fix &
quatre. ( Xenoph. Lactzdem. vefpub. p. 686. B. av.
J. C. 876 ).
A la bataille des Athéniens contre les Argîens
8c leurs alliés , les énomoties lacédémonien nes’
étoient fur quatre de front & huit de hauteur. Thucydide
obferve que les locagues formoient leur
troupe chacun à fa volonté. {JL. V , p. 392. A . B.
av. J. C. 412 ).
Lorfque Thrafybule s’empara du Pyrée, il forma
fa troupe fur cinquante de hauteur; & ceux des
Athéniens quis’oppofèrent à lui, fe formèrent feulement
fur douze. Lorfque Lyfandre fe préfenta
devant Athènes , on v o it , dans Xénophon , le
même Thrafybule former fes troupes fur huit de
hauteur; 8c Paufanias , fes Lacédémoniens, fur
une très grande profondeur ; à LeuCtres les énomoties
étoient fur trois de front, & n’avoient pas plus
de douze de hauteur. ( Xenoph. I. X I , av. J. C. 402
& 356 ).
Dans la guerre de Mantinée, Agéfilas ayant
formé fa phalange par plufieurs dédoublements de
divifions , la réduifit à neuf ou dix de hauteur. Les
Thébains fe formoient prefque toujours fur une
grande profondeur. Dans le combat que les B ce- _
tiens livrèrent aux Athéniens près de Délicum , la
huitième année de la guerre du Péîoponèfe, ils
étoient fur vingt-cinq de hauteur, & à Leudres ,
fur cinquante.
En général, les troupes de ..chaque peuple fe
formoient fuivant la volonté des chefs ; cependant
elles s’accordoient quelquefois pour fe ranger fur
le même ordre. C ’eft ce qu’on voit dans Xénophon
, lorfqu’i! parle de la bataille qu’Ariftodème
livra aux Bcetiens & à leurs alliés. Ceux ci, dit-il,
convinrent de la profondeur fur laquelle ils dévoient
combattre, pour ne pas être enveloppés
par les ennemis. Il paroît que ce fut fur feize ,
parce que le même auteur dit plus bas que les
Athéniens rejettant l’ordre fur feize , fe formèrent
fur une grande profondeur. Philippe de Macédoine
, élève d’Epaminondas, perfectionnaTordre,
en phalange , eh y inftituant des divifions toujours
divifibles par le nombre deux , afin de faciliter
fes doublements & dédoublements. Nous al-:
Ions donner , d’après la taâique qui nous eft parvenue
fous le nom d'Ælicn 8c celui d'Arricn, le fyf