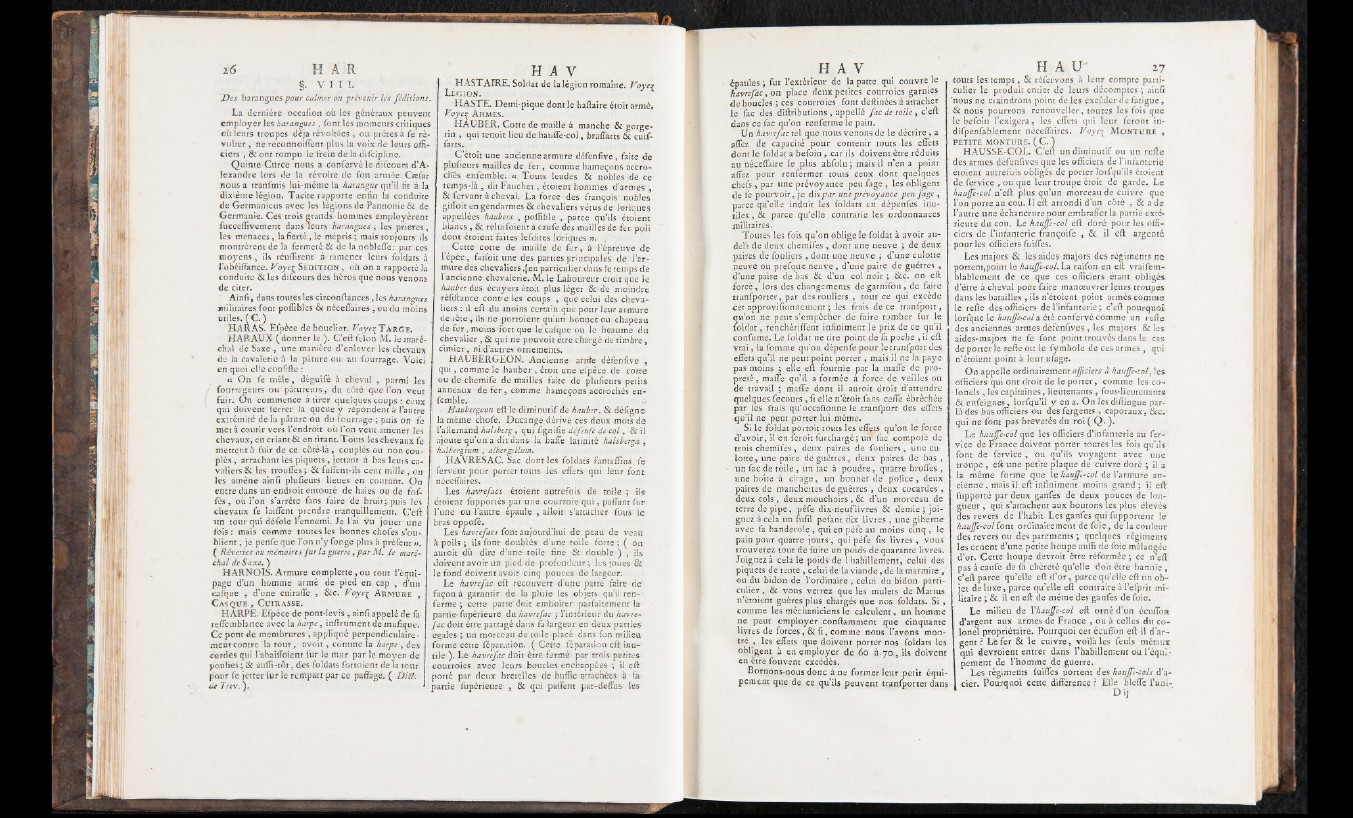
§. v u i.
Des harangues pour calmer ou prévenir les féditions.
La dernière occafion où les généraux peuvent
employer les harangues , font les moments critiques
où leurs troupes déjà révoltées , ou prêtes à fe révolter
, ne reconnoiffent plus la voix de leurs officiers
, & ont rompu le frein de la difcipline.
Quinte-Curce nous a confervé le difeours d’A lexandre
lors de la révolte de fon armée. Cæfar
nous a tranfmis lui-même la harangue qu’ il fit à la
dixième légion. Tacite rapporte enfin la conduite
de Germanicus avec les légions de Pannonie & de
Germanie. Ces trois grands hommes employèrent
fucceffivement dans leurs harangues , les prières,
les menaces, la fierté, le mépris ;, mais toujours ils
montrèrent de la fermeté & de la nobleffe: par ces
moyens, ils réuffirent à- ramener leurs foldats à
i’obéiffance. Voye\ SÉDITION , où on a rapporté la
conduite & les difeours des héros que nous venons
de. citer.
. Ainfi, dans toutes les circonffances, les harangues
militaires font poffibies & néceffaires , ©u du moins
utiles. ( C. )
HARAS. Efpèce de bouclier. Foy^TARGE.
HARAUX (donner le ). C ’eft félon M. le maréchal
de Saxe , une manière d’enlever les chevaux
de la cavalerie à la pâture ou. au fourrage. Voici
en quoi elle confifte :
« On fe mêle, ' déguifé à cheval , parmi les
fourrageurs ou pâtureurs, du côté que l’on veut
fuir. On commence à tirer quelques coups : ceux
qui doivent ferrer la queue y répondent à l’autre
extrémité delà pâture ou du fourrage ; puis on fe
met à courir vers l’endroit où l’on veut amener les
chevaux, en criant & en tirant. Tours les chevaux fe
mettent à fuir de ce côté-là , couplés ou non couplés
, arrachant les piquets , jettant à bas leurs cavaliers
& les trouffes; & fuffent-ils cent mille, on
les amène ainfi plufieurs lieues en courant. On
entre dans un endroit entouré de haies ou de fof-
fé s , où l’on s’arrête fans faire de bruit; puis les
chevaux fe laiffent prendre tranquillement. C ’eft
un tour qui défiole l’ennemi. Je l’ai VU jouer une
fois : mais comme toutes les bonnes chofes s’oublient
, je penfe que l’on n’y fonge plus à préfent ».
( Rêveries ou mémoires fur la guerre, par M. le maréchal
de Saxe. Y
HARNOIS. Armure complette, ou tout l ’équipage
d’un homme armé de pied en cap , d’un
cafque , d’une cuiraffe , &c. Voyeç A rmure ,
C asque , C uirasse.
HARPE. Efpèce de pont-levis , ainfi appelé de fa
re.ffemblance avec la harpe, inftrument de mufique.
Ce pont de membrures , appliqué perpendiculairement
contre la tour, avoir , comme la harpe , des
cordes qui l’abaifloient fur le mur par le moyen de
poulies ; & auffi-tôt, des foldats fortoient de la tour
pour fe jetter furie rempart par ce paffage. ( Ditf, J
de Trev. ), *
HASTAIRE. Soldat de la légion romaine. Voyez
. Légion. 1
HASTE. Demi-pique dont le haftaire étoit armé.
Voye^ Armes.
HAUBER. Cotte de maille à manche & gorge-
rin , qui tenoit lieu de hauffe-col, braffarts & cuif-
farts. ,
C ’étoit une ancienne armure défenfive, faite de
plufieurs mailles de fer , comme hameçons accroches
enfemble. « Touts leudès & nobles de ce
temps-là , dit Faucher, étoient hommes d’armes ,
& fervant à cheval. La force des françois nobles
gifloit en gendarmes & chevaliers vêtus de loriques
appellées haubers , poflïble , parce qu’ils étoient
blancs , & reluifoient à caufe des mailles de fer poli
dont étoient faites lefdites loriques ».
Cette cotte de maille de fe r , à l’épreuve de
l’épée , faifoit une des parties principales de l’armure
des chevaliers ,Jen particulier dans le temps de
l’ancienne chevalerie. M. le Laboureur croit que le
hauber des écuyers étoit plus léger & de moindre
réfiftance contre les coups , que celui des Chevaliers
: il eft du moins certain que pour leur armure
de tête , ils ne portoient qu'un bonnet ou chapeau
de fer, moins fort que lé cafque ou le heaume du
chevalier , & qui ne pouvoit être chargé de timbre,
cimier, ni d’autres ornements.
HAUBERGEON. Ancienne arrive défenfive ,
qui, comme le hauber , étoit une efpèce de cotte
ou de chemife de mailles faite de plufieurs petits
anneaux de fe r , comme hameçons accrochés enfemble.
Haubergeon efi le diminutif de hauber, & défigne
_ la même chofe. Ducange,dérive ces deux mots de
l'allemand halsberg, qui fignifie défenfe de col, & il
ajoute qu’on a dit dans la baffe latinité halsberga ,
: hàlbergium , albergelluin.
HAVRESAC. Sac dont les foldats fantaffins fe
fervent pour porter tours les effets qui leur font
néceffaires.
Les havrefacs étoient autrefois de toile ; ils
étoient fupportés par une côii-rrore qui, paffant fur
l’une ou l’autre épaule , alloit s’attacher fous le
bras oppofé.
Les havrefacs font aujourd’hui de peau de veau
à poils ; ils font doublés d’une toile forte ; ( on
auroit dû dire d’une: toile .fine & double ) , ils
doivent avoir un pied de profondeur; lés joues &
le fond doivent avoir cinq pouces de largeur.
Le havrefac eft recouvert d’une patte faite de”
façon à garantir de la pluie les objets qu’il renferme
; cette patte'doit emboîter parfaitement la
partie’ fupérieure du.havrefac ; l’intérieur du havrefac
doit être partagé dans fa largeur en deux parties
égales ; un morceau de toile placé dans fon milieu
forme cette réparation. ( Cette féparation eft inutile
). Le kavrefac doit être fermé par trois petites
courroies avec leurs boucles enchappées ; il eft
porté par deux bretelles de buffle attachées à fa
partie fupérieure , & qui paffent par-deffus les
épaules ; fur l’extérieur de la patte qui couvre le
havrefac, on place deux petites courroies garnies
de boucles ; ces courroies font deftinées à attacher
le fac des diftributions , appelle fac de toile, c’eft
dans ce fac qu’on renferme le pain.
Un havrefac tel que nous venons de le décrire , a
affez de capacité pour contenir touts les effets
dont le foldat a befoin, car ils doivent être réduits
au néceffaire le plus abfolu ; mais il n’en a point
affez pour renfermer touts ceux dont quelques
chefs , par une prévoyance peu fage , les obligent
de fe pourvoir, je dis par une prévoyance peu fage ,
parce qu’elle induit les foldats en dépenfes inutiles
, & parce qu’elle contrarie les ordonnances
militaires.
Toutes les fois qu’on oblige le foldat à avoir au-
delà de deux chemifes , dont une neuve ; de deux
paires de fouliers , dont une neuve ; d’une culotte
neuve ou prefque neuve , d’une paire de guêtres ,
d’une paire de bas & d’un co,l noir ; &c. on eft
forcé, lors des changements de garnifon , de faire
tranfporter, par desrouliers , tout ce qui excède
cet approvifionnement ; les frais de ce tranfport,
qu’on ne peut s’empêcher de faire tomber fur le
foldat, renchériffent infiniment le prix de ce qu’il
confume. Le foldat ne tire point de fa poche , il eft
vrai, la font me qu’on dépenfe pour le tranfport des
effets qu’il ne peut point porter , mais il ne la paye
pas moins ; elle eft fournie par la maffé de propreté,
mâffe qu’il a formée à force de veilles ou
de travail ; maffe dont il auroit droit d’attendre
quelques fecours , fi elle n’étoit fans ceffe ébréchée
par les frais qu’occafionne le tranfport des effets
qu’il ne peut porter lui même.
Si le foldat portoit touts les effets qu’on le force
d’avoir j il en feroit furchargé; uiî lac compofé de
trois chemifes, deux paires de fouliers, une eu
lotte, une paire de guêtres, deux paires de bas ,
un fac de toile', un lac à poudre, quatre broffes ,
une boîte à cirage, un bonnet de police , deux
paires de manchettes de guêtres , deux cocardes ,
deux cols , deux mouchoirs, & d’un morceau de
terre de pipe-, pèfe dix-neuf livres & demie ; joignez
à cela un! fufil pefant dix livres , une giberne
avec 1a banderole , qui en pèfe au moins cinq , le
pain pour quatre jours , qui pèfe fix livres , vous
trouverez tout de fuite un poids de quarante livres. !
Joignez à cela le poids de rhabilleraient, celui des
piquets de tinte , celui de la viande, de la marmite ,
©u du bidon de l’ordinaire, celui du bidon particulier
, & vous verrez que les mulets de Marins
n’étoiem guères'plus chargés que nos foldats. S i ,
comme les méchaniciensle calculent, un homme
ne peut employer conftamment .que cinquante
livres de forces, & fi, comme nous l’avons montré
, les effets que doivent porter nos foldats les
obligent à en employer de 60 à -7 a , ils doivent
en être fouvent excédés.
Bornons-nous donc.à ne formerleur petit équipement
que de ce qu’ils peuvent tranfporter dans
touts les temps, & réfervons à leur compte particulier
le produit entier de leurs décomptes ; ainfi
'nous ne craindrons point de les excéder de fatigue,
& nous pourrons renouveller, toutes les fois que
le befoin l’exigera, les effets qui leur feront in-
difpenfablement néceffaires. Voye^ Monture ,
PETITE MONTURE. ( C. )
HAUSSE-COL. C ’eft un diminutif ou un refte
des armes défenfives que les officiers de l’infanterie
étoient autrefois obligés de porter lorfqu’ils étoient
de fervice , ou que leur troupe étoit de garde. Le
hauffe-col r i plus qu’un morceau de cuivre que
l’on porte au cou. Il eft arrondi d’un côté , & a de
l’autre une échancrure pour embraffer la partie extérieure
du cou. Le hauffe-col eft doré pour les officiers
de l’infanterie françoife , & il eft argenté
pour les officiers fuiffes.
Les majors & les aides-majors des régiments ne
portenqpoint le hauffe-col. La raifon en eft vraifem-
blablement de ce que ces officiers étant obligés
d’être à cheval pour faire manoeuvrer leurs troupes
dans les batailles , ils n’étoient point armés comme
le refte des officiers de l’infanterie ; c’eft pourquoi
lorfque le hauffe-col a été confervé comme un refte
des anciennes armes défenfives , les majors1 8c les
aides-majors ne fe font point trouvés dans le cas
de porter le refte ou le fymbole de ces armes , qui
n’étoient point à leur ufage.
On appelle ordinairement officiers à haujfe-cof les
officiers qui ont droit de le porter, comme les co«=
- lonels , les capitaines, lieutenants , fous-lieutenants
& enfeignes, lorfqu’il y en a. On les diftingue par-
là des bas officiers ou desfergents , caporaux, & c .
qui ne font pas brevetés du roi ( Q . ).
Le haujfe-col que les officiers d’infanterie au fer-
vice de France doivent porter toutes les fois qu’ils
font de fervice , ou qu’ils voyagent avec mie
troupe, eft une petite plaque de 'cuivre doré ; il a
la même forme que le haujft-col de l’armure ancienne
, mais il eft infiniment moins grand ; il eft
fupporté par deux ganfés de deux pouces de lon-
! gueur , qui s’attachent aux boutons les plus élevés
dés revers de l’habit. Les garafes qui fupportent le
haujfe-col font ordinairement de foie, de la couleur
des revers ou des parements ; quelques régiments
les ornent d’une petite houpe auffi de foie mélangée
d’or. Cette houpe devroit être réformée ; ce n’eft
pas à caufe de fa chèreté qu’elle doit être bannie ,
c’eft parce qu’elle eft d’q r , parce qu’elle eft un objet
de luxe, parce qu’elle eft contraire à l’efprit militaire
; & il en eft de même des ganfes de foie.
Le milieu de l'hauffe-col eft orné d’un écuffoa
d’argent aux armes de France , ou à celles du colonel
propriétaire. Pourquoi cet écuffon eft-il d’argent
? Lë fer & le cuivre, voilà les feuls métaux
qui devroient entrer dans l’habillement ou l’équl •
pement de l’homme de guerre.
Les régiments fuiffes portent des hauffe-cols d’acier.
Pourquoi cette différence ? Elle bleffe l’uni-
D ij