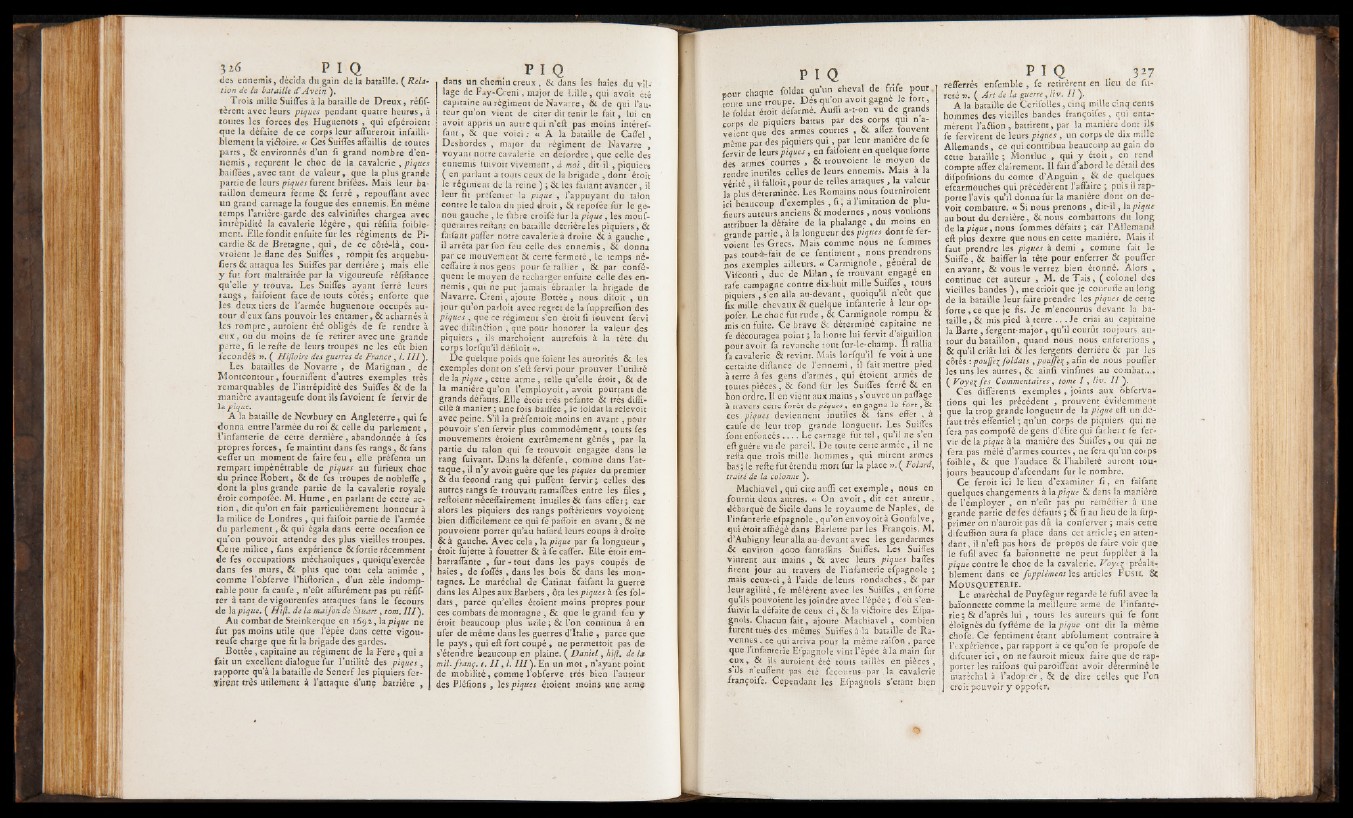
3*6 P I Q
des ennemis, décida du gain de la bataille. ( Rela^
tion de lu bataille tf Avein ).
Trois mille Suifles à la bataille de Dreux, réfif-
terent avec leurs piques pendant quatre heures, à
toutes les forces des Huguenots , qui efpéroient ! j
que la défaite de ce corps leur affureroit infailliblement
la viéloire. « Ces Suifles aflaillis de toutes
parts, & environnés d’un fi grand nombre d’ennemis
, reçurent le choc de la cavalerie , piques
baiflees, avec tant de valeur, que la plus grande
partie de leurs piques furent brifées. Mais leur bataillon
demeura ferme & ferré , repouflant avec
un grand carnage la fougue des ennemis. En même
temps l’arrière-garde des calvinifles chargea avec
intrépidité la cavalerie légère, qui réfifta faiblement.
Elle fondit enfuite fur les régiments de Picardie
& de Bretagne, qui, de ce côté-là, cou-
vroient le flanc des Suifles , rompit fes arquebu-
fiers & attaqua les Suifles par derrière ; mais elle'
y fut fort maltraitée par la vigoureufe réfiftance
qu’elle y trouva. Les Suifles ayant ferré leurs
rangs, faifoient face de touts côtés ; enforte que
les deux tiers de l’armée huguenote occupés autour
d’eux fans pouvoir les entamer, & acharnés à
les rompre, auroient été obligés de fe rendre à
e u x , ou du moins de fe retirer avec une grande
perte, fi lerefle de leurs troupes ne les eût bien
fécondés ». ( Hijloire des guerres de France, l. ///).
Les batailles de Novarre , de Marignan, de
Montcontour, fournifl'ent d’autres exemples très
remarquables de l’intrépidité des Suifles & de la
manière avantageufe dont ils favoient fe fervir de
la pique.
A la bataille de Newbury en Angleterre, qui fe
donna entre l’armée du roi & celle du parlement,
l ’infanterie de cette dernière, abandonnée à fes
propres forces, fe maintint dans fes rangs, & fans
cefler un moment de faire feu , elle préfenta un
rempart impénétrable de piques au fiirieux choc
du prince Robert, & de fes troupès de noblefle ,
dont la plus grande partie de la cavalerie royale
étoit compofée. M. Hume, en parlant de cette action
, dit qu’on en fait particulièrement honneur à
la milice de Londres , qui faifoit partie de l’armée
du parlement, & qui égala dans cette occafton çe
qu’on pouvoit attendre des plus vieilles troupes.
Cette milice , fans expérience 6c fortie récemment
de fes occupations méchaniques , quoiqu’exercée
dans fes murs, & plus que tout cela animée ,
comme l’obferve l’hiflorien 9 d’un zèle indomptable
pour fa caufe, n’eût aflurément pas pu réfif-
ter à tant de vigoureufes attaques fans le fecours
de la pique. ( Hifl. de la maifoti de Stuart, tom. ///).
Au combat de Steinkerque en 1692, la pique ne
fut pas moins utile que l ’épée dans cette vigoureufe
charge que fit la brigade des gardes.
Bottée , capitaine au régiment de la Fere , qui a
fait un excellent dialogue fur l’utilité des piques ,
rapporte qu?à la bataille de Senerf les piquiers fer-
yirent très utilement à l’attaque d’une barrière ,
P I Q
. dans un chemin creux, & dans les haies du village
de Fay-Creni, major de Lille , qui avoit été
capitaine au régiment de Navarre, 6c de qui l’au-
i teur qu’on vient de citer dit tenir le fait, lui en
: avoit appris un autre qui n’eft pas moins intéref-
fant, 6c que voici ; « A la bataille de Caflel ,
Desbordes , major du régiment de Navarre ,
voyanr notre cavalerie en defordre ; que celle des
ennemis lui voit vivemenr, à moi , dit-il , piquiers
( en parlant à tours ceux de la brigade , dont étoit
le régiment de la reine ) ; & les fanant avancer , il
leur fit préfenter la pique , l’appuyant du talon
contre le talon du pied droit, Sc repofée fur le genou
gauche , le fttbre croifé f ur la pique , les mouf-
quetaires reflanc en bataille derrière les piquiers, &
faifant pafîer notre cavalerie à droite & à gauche ,
il arrêta parfon feu celle des ennemis , & donna
par ce mouvement &c cette fermeté, le temps né-
ceflaire à nos gens pour fe rallier , & par confé-
quent le moyen de recharger enfuite celle des ennemis
, qui ne put jamais ébranler la brigade de
Navarre. Creni, ajoute Bottée , nous difoit , un
jour qu’on parloit avec regret de la fupprefiion des
piques , que ce régiment s’en étoit fi fouvent fervi
avec diftin&ion , que pour honorer la valeur des
piquiers , ils marchoient autrefois à la tête, du
corps lorfqu’il défiloit ».
De quelque poids que foient les autorités & les
exemples dont on s’eû fervi pour prouver l’utilité
de la pique, cette arme, telle qu’elle étoit, & de
la manière qu’on l’employoit, avoit pourtant dé
grands défauts. Elle étoit très pefante & très diffi-
cilè à manier ; une fois baiflee , le foldat la relevoit
avec peine. S’il la préfentoit moins en avant, pour
pouvoir s’en fervir plus commodément, touts fes
mouvements étoient extrêmement gênés, par la
partie du talon qui fe trouvoit engagée dans le
rang fuivant. Dans la défenfe, comme dans l’attaque,'
il n’y avoit guère que les piques du premier
6c du fécond rang qui puffent lervir ; celles des
autres rangs fe trouvant ramaffées entre les files ,
refioient néceflairement inutiles 6c fans effet ; car
alors les piquiers des rangs poflérieurs voyoient
bien difficilement ce qui fe paffoit en avant, 6c ne
pouvoient porter qu’au hafard leurs coups à droite
6c à gauche. Avec cela , la pique par fa longueur ,
étoit fujette à fouetter & à fe caffer. Elle étoit em-
barraflante , fur - tout dans les pays coupés de
haies, de folles , dans les bois oç dans les montagnes.
Le maréchal de Catinat faifant la guerre
dans les Alpes aux Barbets, ôta les piques à fes fol-
dats, parce qu’elles étoient moins propres pour
ces combats de montagne , & que le grand feu y
étoit beaucoup plus utile » & l’on continua à en
ufer de même dans les guerres d’Italie , parce que
le pays, qui efi fort coupé , ne permettoit pas de
s’étendre beaucoup en plaine. ( Daniel, hijl. de la
mil. franç. t. I I , l. ///). En un mot, n’ayant point
de mobilité, comme L’obferve très bien l’auteur
des Pléfjons , les piques étoient moins une arme
P I Q
pour chaque foldat qu’un cheval de frïfe pour,’
foute une troupe. Des qu on avo.t gagné le fort,
le foldat étoit défarmé. Aufli a-t-on vu de grands
corps de piquiers battus par des corps qui n’a-
veient què des armes courtes , & affez fouvent
même par des piquiers q u i, par leur manière de fe
fervir de leurs piques , en faifoient en quelque forte
des armes" courtes , & trouvoient le moyen de
rendre inutiles celles de leurs ennemis. Mais à la
vérité , il falloir, pour de telles attaques , la valeur
la plus’ déterminée. Les Romains nous fourniroient
ici beaucoup d’exemples , fi; à l’imitation de plu-
fieurs auteurs anciens & modernes , nous voulions
attribuer la défaite de la phalange , du moins en
grande partie, à la longueur des piques dont fe fer-
voient les Grecs. Mais comme nous ne femmes
pas tout-à-fait de ce fentiment, nous prendrons
nos exemples ailleurs. « Carmignole , général de
Wconti , duc de Milan, fe trouvant engagé en
rafe campagne contre dix-huit mille Suifles , touts
piquiers , s’en alla au-devant, quoiqu’il n’eût que
fix mille chevaux 6c quelque infanterie à leur op-
pofer. Le choc fut rude , 8t Carmignole rompu &
mis en fuite. Ce brave & déterminé capitaine ne
fe découragea point la honte lui fervit d’aiguillon
pour avoir fa revanche tout fur-le-champ. Il rallia
fa cavalerie & revint. Mais lorfqu’il fe voit à une
certaine diftance de l’ennemi, il fait mettre pied
à terre à fes gens d’armes, qui étoient armés de
toutes pièces, & fond fur les Suifles ferré & en
bon ordre. Il en vient aux mains , s’ouvre un paffage
à travers cette forêt de piques, en gagne le fort, &
ces piques deviennent inutiles & fans effet , à
caufe de .leur trop grande longueur. Les Suifles
font enfoncés . . . . Le carnage fut te l, qu’il ne s’en
eft guère vu de pareil. De toute cette armée, il ne
reflaque trois mille hommes, qui mirent armes
bas ; le refte fut étendu mort fur la place ». ( Folardy
traité de la colonne ).
Machiavel, qui cite aufli cet exemple , nous en
fournit deux autres. « On. avoit, dit cet auteur,
débarqué de Sicile dans le royaume de Naples , de
l’infanterie efpagnole , qu’on envoyoità Gonfalve,
qui étoit afîiégé dans Barlette par les François. M.
d’Aubigny leur alla au-devant avec les gendarmes
& environ 4000 fantalfins -Suifles. Les Suifles
vinrent aux mains , 6c avec leurs piques baffes
firent jour au travers de l’infanterie efpagnole ;
mais ceux-ci, à l’aide de leurs rondaches, 6c par
leur agilité, fe mêlèrent avec les Suifles , en forte
qu’ils pouvoient les joindre avec l’épée ; d’où s’en-
fuivit la défaite de ceux c i , & la vi&oire des Efpa-
gnols. Chacun fait, ajoute Machiavel , combien
furent tués des mêmes Suifles à la bataille de Ra-
vennes , ce qui arriva pour la même raifon , parce
que l’infanterie Espagnole vint l’épée à la main fur
eux, & ils auroient été touts taillés en pièces ,
s’ils n’euffem pas été fe cou rus par la cavalerie
françoife. Cependant les Espagnols s’etant bien
P I Q 327
reflerrés enfemble , fe retirèrent en lieu de fureté
». ( Art de la guerre, liv. I l ).
A la bataille de Cerifoiles, cinq mille cinq cents
hommes des vieilles bandes françoifes, qui entamèrent
l’aâion , battirent, par la manière dont ils
fe fervirent de leurs piques , un corps de dix mille
Allemands, ce qui contribua beaucoup au gain de
cette bataille ; Montluc , qui y étoit, en rend
compte affez clairement. Il fait d’abord le détail des
difpofitions du comte d’Anguin , & de quelques
efcarmouches qui précédèrent l’affaire ; puis il rapporte
l’avis qu’il donna fur la manière dont on de-
voit combattre. « Si nous prenons , dit-il, la pique
au bout du derrière, 6c nous combattons du long
de la pique, nous fommes défaits car l’Allemand
eft plus dextre que nous en cette manière. Mais il
faut prendre les piques à demi , comme fait le
Suiffe , & baiffer la tête pour enferrer 6c pouffer
en avant, & vous le verrez bien étonné. Alors ,
continue cet auteur , M. de Tais, (colonel des
vieilles bandes ) , me crioit que je couruffe au long
de la bataille leur faire prendre les piques de cetre
forte, ce que je fis. Je m’encourus devant la bataille
, & mis pied à terre . . . Je criai au capitaine
la Barte , fergent-major, qu’il courût toujours autour
du bataillon, quand nous nous enfererions ,
& qu’il criât lui 6c les fergents derrière & par les
côtés : pouffe^ foldats , pouffe^y afin de nous pouffer
les uns les autres, & ainfi vinfmes au combat.,..|
( Voye^fes Commentaires, tome I , liv. I l ).
Ces différents exemples , joints aux ôbferva-
tions qui les précèdent , prouvent évidemment
que la trop grande longueur de la pique eff un défaut
très effentiel ; qu’un corps de piquiers qui ne
fera pas compofé de gens d’élite qui facher.t fe fervir
de la pique à la manière des Suifles, ou qui ne
i fera pas mêlé d’armes courtes, ne fera qu’un corps
foible, & que l’audace & l’habileté auront toujours
beaucoup d’afeendant fur le nombre.
Ce feroit ici le lieu d’examiner f i , en faifant
quelques changements à la pique 6c dans la manière
de 1’employer , on n’eût pas pu remédier à une
grande partie de fes défauts ; & fi au lieu de la fup-
primer on n’auroit pas dû la conferver ; mais cette
difeuflion aura fa place dans cet article ; en attendant
, il n’eft pas hors de propos de faire voir que
le fufil avec fa baïonnette ne peut fuppléer à la
pique contre le choc de la cavalerie. Voycç préalablement
dans ce fupplément les articles F u s il 8ç
M o ù sq u e t e r ie .
Le maréchal de Puyfégur regarde le fufil avec la
baïonnette comme la meilleure arme de l’infanterie
; & d’après lui , touts les auteurs qui fe font
éloignés du fyftème dé la pique ont dit la même
choie. Ce fentiment étant abfolument contraire à
l’expérience, par rapport à cè qu’on fe propofe de
difeuter ic i, on ne fauroit mieux faire que de rapporter
les ràifons qui paroiflent avoir déterminé le
maréchal à l’adoprer, & de dire celles que l’on
croit pouvoir y oppofer.