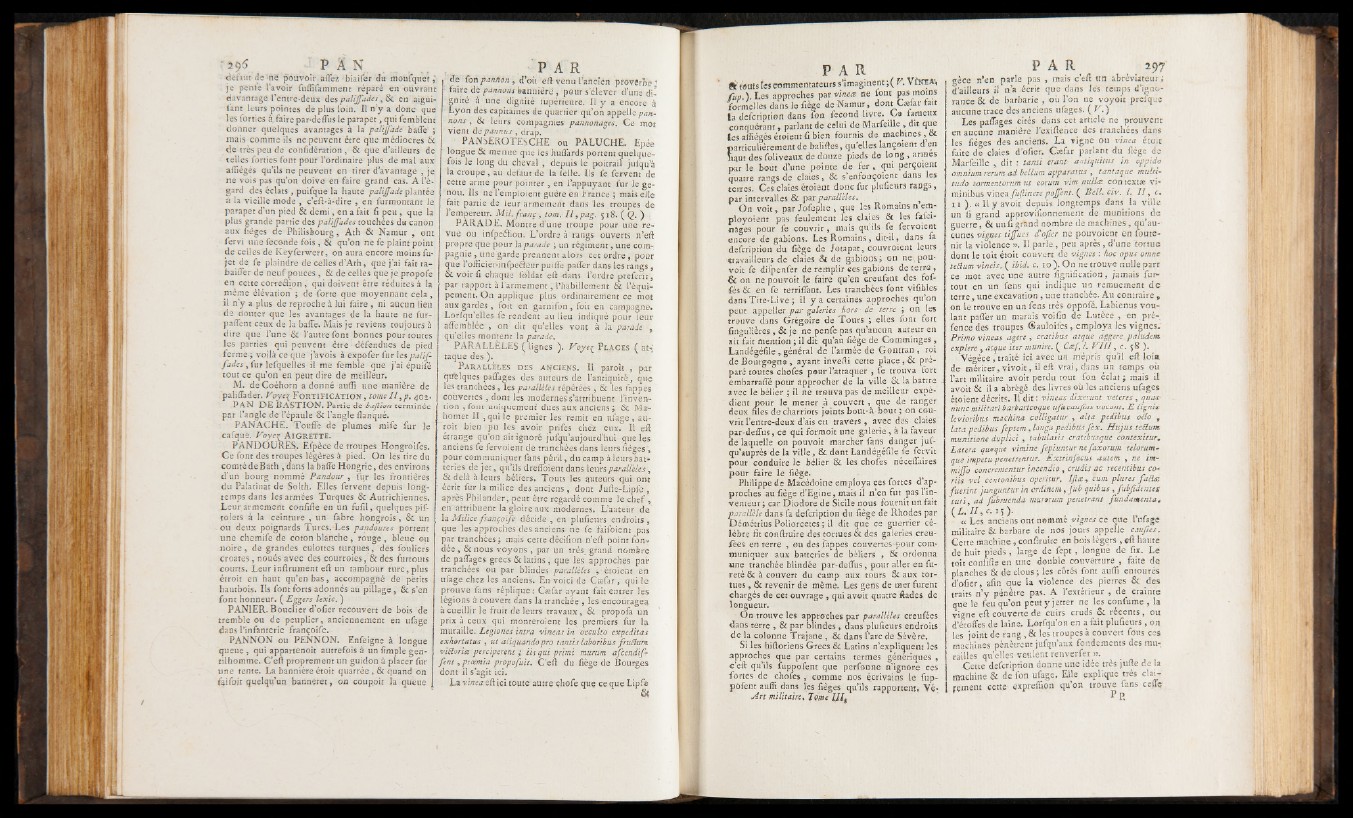
defaut d e ‘né pouvoir, affez biaifer du monfquet y
je pente l’avoir fufRfamment réparé en ouvrant
davantage l’entre-deux des palïjfades, & en .aigùi-
l'ant leurs pointes de plus loin. Il n’y a donc que
les (orties à, faire par-deffus le parapet, qui femblent
donner quelques avantages à la palijfadë baffe' ;
mais comme ils ne peuvent être que médiocres 6c
de très peu de confédération, 8c que d’ailleurs de
telles forties font pour l’ordinaire plus de mal aux
afiiégés qu’ils ne peuvent en tirer d’avantage , je
ne vois pas qu’on doive en faire grand cas. A l’égard
» de fonpahfion, d’où èfl venu l’ancien proverbe1
t ' faire dé pannons bannière , pour s’élever d’une di-
- gniré à une dignité lupérieure. Il y a encore à
5 - Lyon des capitaines de quartier qu’on appelle pan-
t nons, & leurs compagnies pannonages. C e mot
j vient depannus , drap.
: PANbEROTESCHE ou PALUCHË. Epée
; longue & menue que les huffards portent quelque-
■ fois le long du cheval , depuis le poitrail jufqua
î, la croupe, au défaut de la Celle. Us fe fervent de
des éclats , puifque la haute palijjade plantée
à la vieille mode , c’eft-à-dire , en furmonrant le
parapet d’un pied & demi, en a fait fi peu , que la
plus grande partie des palijfades touchées du canon
aux fièges de Philisbourg, Ath & Namur , ont
fervi une fécondé fois , & qu’on ne fe plaint point
de celles de Keyferwert, on aura encore moins fa-
jet de fe plaindre de celles d’Ath, que j’ai fait ra-
baiffer de neuf pouces , & de celles que je propofe
en cette correélion, qui doivent être réduites à la
même élévation ; de -forte que moyennant cela,
il n’y a plus de reproche à lui faire , ni aucun lieu
de douter que les avantages de la haute ne fur-
paffent ceux de la baffe. Mais je reviens toujours à
dire que l’une 8c l’autre font bonnes pour toutes
les parties qui peuvent être défendues de pied
ferme-; voilà ce que j’avois à expofer fur les pal if-
fades , fur lefquelles il me femble que j’ai épuifé
tout ce qu’on en peut dire de meilleur.
M. deCoéhorn adonné aufli une manière de
paliffader. Voyeç F o r t if ic a t io n , tome I I , p. 402.
PAN DE BASTION. Partie àe-bafiion terminée
par l’angle de l’épaule & l’angle flanqué.
PANACHE. Touffe de plumes mife fur le
cafque. Voyeç AIGRETTE.
PANDOURES. Efpèce de troupes Hongroifes.
Ce font des troupes légères à pied. On lés tire du
comté de Bath , dans la baffe Hongrie, des environs
d’un bourg nommé Pandour , fur les frontières
du Palatinat de Solth. Elles fervent depuis long- '
temps dans les armées Turques & Autrichiennes.
Leur armement confifie en un fufil, quelques pif-
tolets à la ceinture , un fabre hongrois , & un
ou deux poignards Turcs. Les pandoures portent
une chemife de coton blanche , rouge , bleué ou
noire, de grandes culottes turques, dés fouliers
croates, noués avec des courroies, & des furtouts
courts. Leur infiniment eft un tambour turc, plus
étroit en haut qu’en bas, accompagné de petits
hautbois. Ils font forts adonnés au pillage, & p’en
font honneur. ( Eggers lexic. )
PANIER. Bouclier d’ofier recouvert de bois de
tremble ou de peuplier, anciennement en ufage
dans l’infanterie françoife.
PANNON ou PENNON. Enfeigne à longue
queue , qui appartenoit autrefois à un fîmple gentilhomme.
C’efi proprement un guidon à placer fur
une tente. La bannière étoit quarrée , & quand on
&ifojt quelqu’un banneret, on coup.oit la queue ,
cette arme pour pointer , en l’appuyant fur le ge-
: nou. Ils ne l’emploient guère en France ; mais elle
: fait partie de leur armement dans les troupes de
l’empereur. Mil. franc.,, _tom. I I ,pag. 518. ( Q. )
PARADE. Montre.d’une troupe pour une revue
ou infpeétion. L’ordre à rangs ouverts n’eft
propre que pour la parade ; un régiment, une compagnie
, une garde prennent alors cet ordre , pour
que l’officier-infpeéieur puiffe paffer dans les rangs ,
& voir fi chaque foldat eft dans l’ordre prêtent,
par rapport à l’armement, l’habillement & l’équipement.
On applique plus ordinaireftient ce mot
aux gardes , foit en garnifon, foit en campagne.
Lqrfqu’elles fe rendent au lieu indiqué pour leur
affemblée , on dit qu’elles vont à la parade 5
qu’elles montent la parade.
PARALLÈLES ( lignes ). Voye^ Places ( attaque
des ).
Parallèles des anciens. Il paroît., par
quelques paffages des auteurs de l’antiquité, que
les tranchées, les parallèles répétées , & les fappes
couvertes , dont les modernes s’attribuent l’invention
, font ,uniquement dues aux anciens ; & Mahomet
II , qui le premier les remit en nlage , aurait
bien pu les avoir prifes chez eux. Il eft
étrange qu’on ait ignoré jufqu’aujourd’hui que les
anciens fe fervoient de tranchées dans leurs lièges',
pour communiquer fans péril, du camp à leurs batteries
de jet, qti’ils dreffoient dans leurs parallèles,
& delà à leurs béliers. Touts les quteurs qui ont
'écrit fur la milice des anciens , dont JuflerLipfe ,
après Philander, peut être regardé comme le chef ,
en attribuent la gloire aux modernes, L’auteür de
la Milice françoife décide , en plufieurs endroits ,
que les approches des anciens ne fe faifoient pas
par tranchées ; mais cette dêcifion n’eft point fon?
dee, & nous voyons , par un très grand nombre
de paffages grecs & latins , que les approches par
tranchées ou par blindes parallèles , • étoient en
ufage chez les anciens. En voici de Cæfar, qui le
prouve fans réplique: Cæfar ayant fait entrer les
légions à couvert dans la tranchée , les encouragea
à cueillir le fruit de leurs travaux, & propofa un
prix à ceux qui monteroient les premiers fur la
muraille. Legiones intra vineas in occulto expéditas
exhùrtatus , ut aliquando pro tantis laboribus fruElum
viEloruz perciperent $ iis qui primi murum afcendif-
fent, prcemïa propofuit. C ’eft du fiège de Bourges
dont il s’agit ici.
La vinea ici toute autre çhofe que ce que Lipfe
PAR
f t fouts tes commentateurs s’imaginent ;( V. VfNEA^
fup.). Les approches p a rv in s ne font pas moins
formelles dans le fiège de-Namur, dont Cæfar fait
la defcription dans fon fécond livre. Ce fameux
conquérant, parlant de celui de Marfeille , dit que
les afiiégés étoient fi bien fournis de machines, &
particulièrement de baliftes, qu’elles lançoient d en
liaut des foliveaux de douze pieds de lo n g , armes
par le bout d’une pointe de fe r , qui perçoient
quatre rangs de claies, Sc s’enfonçoient dans les
terres. Ces claies étoient donc fur plufieurs rangs,
par intervalles & par parallèles. ^
On vo it, par Jofephe-, que les Romains n em-
pioyoient pas feulement les claies 6c les fafci-
nâges pour fe couvrir, mais qu’ils fe fervoient
encore de gabions. Les Romains, dit-il, dans fa
defcription du fiège de Jotapat, couvraient leurs
travailleurs de claies 6c de gabions j on ne\ pou-
voit fe difpenfer de remplir «es gabions de terre ,
6c on ne pouvoit le faire qu’en creufant des fof-
fés 8c en fe terrifiant. Les tranchées font vifibles
dans Tite-Live ; il y a certaines approches qu’on
peut appeller par galeries hors- de terre ; on les
trouve dans Grégoire de Tours ; elles font fort
fingtilières , & je ne penfe pas qu’aucun auteur en
ait fait mention ; il dit qu’au fiège de Comminges,
Landégéfile, général de l’armée de Gontran , roi
de Bourgogne , ayant invefti cette place , 6c préparé
toutes chofes pour l’attaquer , fe trouva fort
embarraffé pour approcher de la ville ôl la battre -
avec le bélier ; il ne trouva pas de meilleur expédient
pour le mener à couvert, que de ranger
deux files de charriots joints boui-â bout ; on cou- :
vrit l’entre-deux dais en travers, avec dés claies ,
par-deffus, ce qui formoit une galerie, à la faveur i
de laquelle on pouvoit marcher fans danger juf-
qu’auprès de la ville, & dont Landégéfile fe fervit
pour conduire le bélier & les chofes néceffaires
pour faire le fiège.
Philippe de Macédoine employa ces fortes d’approches
au fiège d’Egine, mais il n’en fut pas l’inventeur
; car Diodore de Sicile nous fournit un fart
parallèle dans fa defcription du fiège de Rhodes par
Démétrius Poliorcetes ; il dit que ce guerrier célèbre
fit conftruire des tortues o1 des galeries creu-
iees en terre , ou des jappes couvertes-pour communiquer
aux batteries de béliers , & ordonna
une tranchée blindée par-deffus, pour aller en fureté
6c à couvert du camp aux tours & aux tortues
, 8c revenir de même. Les gens de mer furent
chargés de cet ouvrage , qui avoit quatre ftades de
longueur.
On trouve les approches par parallèles creufées
dans terre , 8c par blindes , dans plufieurs endroits
de la colonne Trajane , 8c dans l’arc de Sévère.
Si les hiftoriens Grecs 8c Latins n’expliquent les
approches que par certains termes génériques ,
c’eft qu’ils fuppofe.nt que perfonne n’ignore ces
fortes de chofes , comme nos écrivains le fup-
pôfent aufli dans les fièges qu’ils rapportent? Vé-
Art militaire % Tome JJIt
P A R 1 9 7
gèce n’en parle pas , mais c’eft un abréviateur;
d’ailleurs il n’a -écrit que dans les temps d’ignorance
8c de barbarie , où l’on ne voyoit prefquc
aucune trace des anciens ufages. ( V.)
Les paffages cités dans cet article ne prouvent
en aucune manière l’exiftence des tranchées dans
les fièges des anciens. La vigne ou vinea étoit
faite de claies d’ofier. Cæfar parlant du fiège de
Marfeille , dit : tatiti erant- antiquitus in oppido
omnium rerum ad bellutn apparatus , tantaque multi-
tudo tormentorumut eorum vim nullrz contextæ vi~
minibus vinea fujlinere pojfent. ( Bell.civ. I. I I , c,
11 ). «IL y avoit depuis longtemps dans la ville
un fi grand approvifionnement de munitions de
guerre, 8c un fi grand nombre de machines, qu’aucunes
vignes tijfues d'ofier ne pouvoient en Soutenir
la violence ». II. parle, peu après, d’une tortue
dont le toit étoit couvert de vignes : hoc opus omne
teElum vineis. ( ibid. c. 10). On ne trouve nulle part
ce mot avec une autre lignification, jamais fur-
tout en un Sens qui indique un remuement d e
terre, une excavation , une tranchée. Au contraire „
on le trouve en un fens très oppofé. Labienus vou-
lant paffer un marais voifin de Lutèce , en pré-
fencédes troupes Gauloifes, employa les vignes:
Primo vineas agere , craùbus atque aggsre paludem
explere , atque iter munire. ( Coef l. V IH , c. 58 ).
Végèce, traité ici avec un mépris qu’il eft loitt
de mériter, vivoit, il eft vrai, dans un temps où
l’art militaire avoit perdu tout fou éclat ; mais il
avoit & il a abrégé des livres où les anciens ufages
étoient décrits. Il dit : vineas dixerunt veteres , qua&
mine militari barbaricoque ufn caufias vocant. E lignis
levioribus machina collïgatur , ait a pedibus 0U0 ,
lata pedibus feptem, longu pedibus fex. Hujus teElum
munitione duplici , tàbulatis craiibusque contexitur„
Latera que que vimine fepiuntur ne faxorujn telorum-
que impetu penetrentur. Extrïnfecus autem , ne im-
mijfo concrementur incendio , crudis ac recentibus co*
riis vel centonibus operitur, IJloe-, cum plures faidée
fuerint junguntur in ordinem, Jub quibus , fubjîdentes
tuti, ad fibruenda muromni pénétrant fundamenta,
( L ; I I , c. i 5 ).
« Les anciens ont nommé vignes ce que Fufage
militaire & barbare de nos jours appelle caufies.
Cette machine, conftruice en bois légers , eft haute
de huit pieds, large de fep t, longue de fix. Le
toit confifie en une double couverture , faite de
planches 8c de clous ; les côtés font aufli entourés
d’ofier , afin que la violence des pierres & des
traits n’y pénètre pas. A l’extérieur , de crainte
que le feu qu’on peut y jetter ne les confume , la
vigne eft couverte de cuirs cruds 8c. recents, ou
d’étoffes de laine. Lorfqu’on en a fait plufieurs , on
les joint de rang, 8c les troupes à couvert feus ces
machines pénètrent jufqu’aux fondements dès mu?
railles quelles veulent renverfer ».
Cette defcription donne une idée très jufte de la
machine 8c. de fon ufage. Elle explique très clairement
cette expreffi.on qu’on trouve fans ceftç'
P P.