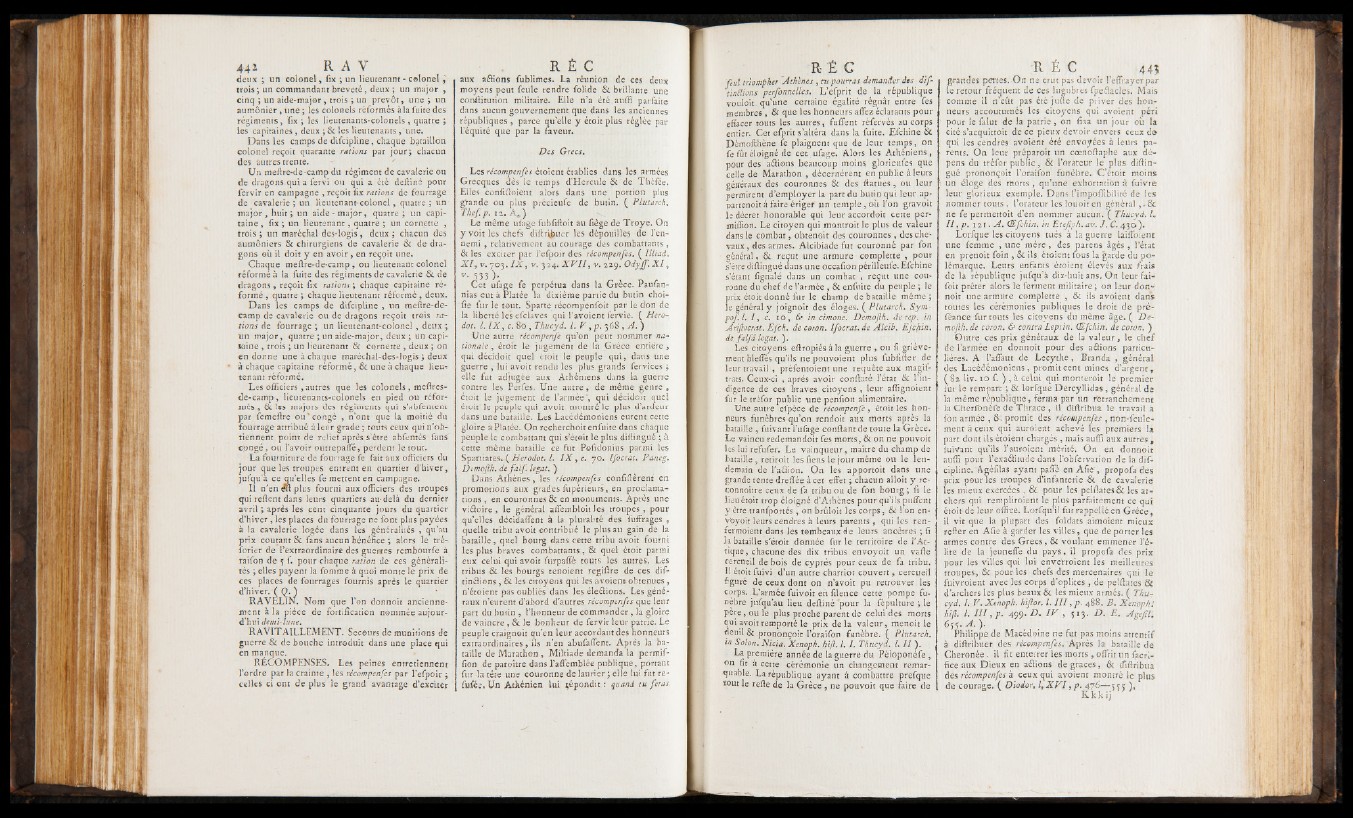
44ï R A V
d e u x ; u n c o l o n e l , fix ; un lieu ten an t - c o l o n e l ,
t r o i s ; un com m an d an t b r e v e t é , d e u x ; un m a jo r ,
c in q ; un a id e -m a jo r , trois ; un p r é v ô t , une ; un
aum ô n ie r , u n e ; les c o lo n e ls ré fo rm é s à la fu ite des
r é g im e n t s , fix ; les lieu ten an ts -co lo n e ls , q u a tre ;
le s cap itaines , d eu x ; & les lieuten an ts , u n e .
D a n s le s camps de d if c ip lin e , ch a qu e b a taillon
c o lo n e l re ç o it quarante rations pa r jo u r ; cha cun
d e s autres trente.
U n m e ft r e -d e c am p du ré g im en t d e c a v a le r ie ou
d e d ra g on s q u i a fe r v i o u q u i a été d eftin é pour
fe r v i r en cam p a gn e , r e ç o it fix rations de fo u rra ge
d e c a v a le rie ; un lie u te n a n t - c o lo n e l, qu atre ; un
m a jo r , huit ; un a id e - m a jo r , quatre ; un cap ita
in e , fix ; un l ie u t e n a n t , q u a tre ; un c o rn e tte ,
tro is ; un ma récha l d e s -lo g is , d eu x ; cha cun des
aum ô n ie r s St ch iru rg ien s d e c a v a le r ie St d e drag
o n s o ù il d o it y en a v o i r , en r e ç o it un e.
C h a q u e me ftre-d e-cam p , o u lieuten an t c o lo n e l
r é fo rm é à la fu ite d es ré g im en ts d e c a v a le rie & de
d ra g o n s , r e ç o it f ix rations ; ch a qu e cap itaine r é fo
rm é , quatre ; ch a qu e lieuten an t r é fo rm é , d eu x .
D a n s le s camp s d e d ifc ip lin e , un me ftre-d e-
cam p de c a v a le r ie o u de d ra g on s r e ç o it trois rations
de fo u rra g e ; un lie u t e n a n t - c o lo n e l, d eu x ;
u n m a jo r , qu atre ; un a id e -m a jo r , d eu x ; un capita
in e , trois ; un lieuten an t St c o rn e t te , d eu x ; on
e n d on n e un e à chaqu e m a ré ch a l-d e s -lo g is ; d eu x
à chaqu e cap itain e r é fo rm é , & u n e à ch aqu e lie u ten
an t r é fo rm é .
L e s o f f ic ie r s , au tre s q u e les c o lo n e l s , me ftres -
d e - c am p , lieu ten an ts -co lo n e ls en pied o u r é fo r m
é s ., & les ma jors d es r ég im en ts qu i s’ab fen ten t
pa r fem e ftre o u “ c o n g é , n ’o n t qu e la m o itié du
fo u r r a g e attribu é à le u r grad e ; touts c eu x qui n’ o b t
ie n n e n t p o in t de r e l ie f après s’ê tre ab fentés fa n s '
c o n g é , o u l ’a v o ir o u t r e p a f le , p e rdent le tout.
L a fo u rn itu re d e fo u r ra g e fe fait aux officiers du
jo u r q u e les trou p e s en tren t en qu artier d ’h i v e r ,
ju fq u ’à c e qu ’e lle s fe m e tten t en camp agne .
I l n’ en e ft plus fo u rn i au x officiers d es troupes
q u i reftent d ans leurs quartiers au-delà du dernier
a v r il ; après le s c en t c in q u an te jo u rs d u qu artier
d ’h iv e r , le s pla ce s du fo u r ra g e n e fo n t plus p a y é e s
à la c a v a le r ie lo g é e dans le s g én éralité s , qu ’au
p r ix coû tan t & fans aucun b éné fice ; alo rs le tré-.
îb r ie r d e l ’ e x trao rd in a ire d es g u er res r em b o u r fe à
ra ifon d e 5 f. p o u r chaqu e ration de c e s g é n é r a lité
s ; e lle s p a y e n t la font me à qu o i mo n te le p r ix de
c e s pla ce s d e fo u rra g e s fo u rn is ap rès le quartier
d’h iv e r . ( Q . )
R A V E L IN . N om q u e l ’on d on n o it an c ien n e m
e n t à la p iè c e d e fo r tifica tio n n ommé e au jo u r d
’hui demi-lune.
R A V I T A I L L E M E N T . Se cou r s de m unitions de
g u e r r e & de b o u ch e in tro d u it d ans u n e p la ce qui
en man qu e.
R É C O M P E N S E S . L e s p e in e s e n tr e tien n e n t
l’o rd r e par la c rain te , les rêcompenfes par l ’e fp o ir ;
c e lle s c i o n t d e plu s le g ran d a v an ta g e d ’e x c ite r
R É C
aux aâions fublimes. La réunion de ces deux
moyens peut feule rendre folide & brillante une
constitution militaire. Elle n’a été aufff parfaite
dans aucun gouvernement que dans les anciennes
républiques , parce qu’elle y étoit plus réglée par
l’équité que par la faveur.
Des Grecs.
Les rêcompenfes étoient établies dans les années
Grecques dès le temps d’Hercule & de Théfée.
Elles confiftoient alors dans une portion plus
grande ou plus précieufe de butin. ( Plutarch.
Thef. p. 12. A# )
Le même ufage fubfiftoit au fiège de Troye. On
y voit les chefs difiri^uer lès dépouilles de l’ennemi
, relativement au courage des combattants ,
& les exciter par l’efpoir des rêcompenfes. ( Ill'iad.
X I , v. 703. I X , v. 324. X V I I , v. 229. Odyjf. X I ,
v- 5 3 3 )*
Cet ufage fe perpétua dans la Grèce. Paufan-
nias eut à Platée la dixième partie du butin choi-
fie fur le tout. Sparte récompenfoit par le don de
la liberté les efclaves qui l’avoient fervie. ( Hero-
dot. I. IX , c. 8 0 :, Thucyd. I. V , p. 368, A. )
Une autre récompenfe qu’on peut nommer nationale
, étoit le jugement de la Grèce entière »
qui décidoit quel étoit le peuple qui, dans Une
guerre , lui avoit rendu les plus grands fervices ;
elle fut adjugée aux Athéniens dans la guerre
contre les Perfes. Une autre, de même genre,
étoit le jugement de l’armée', qui décidoit quel
étoit le peuple qui avoit montré le plus d’ardeur
dans une bataille. Les Lacédémoniens eurent cette
gloire à Platée. On recherchoitenfuite dans chaque
peuple le combattant qui sJét©it le plus diftingué ; à
cette même bataille ce fut Pofidonius parmi les
Spartiates-.fHerodot. I. I X , c. 70. Ifocrat. Pane g.
Dtmofih. de fa l f légat. )
Dans Athènes, les rêcompenfes confilièrent en
promotions aux grades fupérieurs, en proclamations
, en couronnes & en monuments. Après une
v iâo ire , le général alfembloit Jes troupes , pour
qu’elles décidaient à la pluralité des fuffrages ,
quelle tribu avoit contribué le plus au gain de la
bataille, quel bourg dans cette tribu avoit fourni
les plus braves combattants, & quel étoit parmi
eux celui qui avoit furpaffé touts les autres. Les
tribus & les bourgs tenoient regiftre de ces dif-
tinâions , & les citoyens qui les avoient obtenues,
n’étoient pas oubliés dans les élections. Les généraux
n’eurent d’abord d’autres rêcompenfes que leur
part du butin , l’honneur de commander, la gloire
de vaincre, & le bonheur dé fervir leur patrie. Le
peuple craignoit qu’en leur accordant des honneurs
extraordinaires, ils n’en abufa fient. Après la bataille
de Marathon , Miltiade demanda la permif-
fion de paroitre dansPaffenablée publique, portant
fur -la tête une couronne de laurier ; elle lui fut re-
fufée. Un Athénien lui Répondit : quand tu feras.
RÉC
feul triompher Athènes , tu pourras demander des dif-
tïnElions perfonnelles. L’efprit de la république
vouloit. qu’une certaine égalité régnât entre fes
membres, St que les honneurs affez éclatants pour
effacer touts les autres, fuffent réfervés au corps
entier. Cet efprit s’altéra dans la fuite. Efchine St
Démofthène fe plaignent que de leur temps, on
fe fût éloigné de cet ufage. Alors les Athéniens ,
pour des aâions beaucoup moins glorieufes que
celle de Marathon , décernèrent en public à leurs
généraux des couronnes & des. ftatues, ou leur
permirent d’employer la part du butin qui leur ap-
partenoit à faire ériger un temple, où l’on gravoit
le décret honorable qui leur aecordoit cette per-
miffion. Le citoyen qui montroit le plus de valeur
dans le combat, obtenoit des couronnes , des chevaux,
des armes. Alcibiade fut couronné par fon
général, St reçut une armure complette , pour
s’être diftingué dans une occafion périlleufe. Efchine
s’étant fignaîé dans un combat , reçut une couronne
du chef de l’armée , & enfuite du peuple ; le
prix étoit donné fur le champ de bataille même ;
le général y joignoit des éloges. ( Plutarch. Sym-
pof. I. I , c. 10, & in cimone. Demojlh. derep. in
Ariflocrat. Efch. dé coron. Ifocrat. de Alcib. Efcfiin.
de. falfâ légat. ).
Les citoyens eftropiés à la guerre , ou fi grièvement
bleffés qu’ils ne pouvoient plus fubfifter de
leur travail , préfentoient une requête aux magif-
trats. Ceux-ci , après avoir conftaté l’état & L’indigence
de ces braves citoyens , leur affignoienr
fur le tréfor public une penfion alimentaire.
Une autre efpèce de récompenfe, étoit les honneurs
funèbres qu’on rendoit aux morts après la
bataille , fuivant l’ufage confiant de toute la Grèce.
Le vaincu redemandoit fes morts, & on ne pouvoit
les lui réfufer. Le vainqueur, maître du champ de
bataille, retiroit les fiens le jour même ou le lendemain
de l’aâion. On les apportoit dans une
grande tente drefiée à cet effet ; chacun alloit y re-
connoître ceux de fa tribu ou de fon bourg ; fi le
lieu étoit trop éloigné d’Athènes pour qu’ils puffern
y être tranfportés , on bruloit les corps, & l’on en-
Vbyoit leurs cendres à leurs parents , qui les ren-
fermoient dans lés tombeaux de leurs ancêtres ; fi
la bataille s’étoit donnée fur le territoire de l’At- ;
tique, chacune des dix tribus envoyoit un vafle 1
cercueil de bois de cyprès pour ceux de fa tribu.
Il étoit fuivi d’un autre charriot couvert, cercueil
figuré de ceux dont on n’avoit pu retrouver les
corps. L’armée fuivoit eh filence cette pompe funèbre
jufqu’au lieu deftiné *pour la fépulture ; le
pere, ou le plus proche parent de celui des morts
qui avoit remporté le prix delà valeur, menoit le
deuil & prononçoit l’oraifon funèbre. ( Plutarch.
in Solon. ISicia. Xenoph. friß. /. I. Thucyd. I. I l ).
La première année de la guerre du Péloponèfe ,
on fit à cette cérémonie un changement remarquable.
La république ayant à combattre prefque
tout le refte de la Grèce, ne pouvoit que faire de
RÉC 4 4 5
grandes peïtes. On ne crut pas devoir l’effrayer parle
retour fréquent de ces lugubres fpe&acies. Mais
comme il n’eût pas été jufte de priver des honneurs
accoutumés les citoyens qui avoient péri
pour le falut de la patrie, on fixa un jour où la
cité s’acquittoit de ce pieux devoir envers ceux do
qui les cendres avoient été envoyées à leurs parents.
On leur préparoit un coenofiaphe aux dépens
du tréfor public, St l’orateur le plus diftingué
prononçoit l’oraifon funèbre. C ’étoit moins
un éloge des morts, qu’une exhortation à fuivre
leur glorieux exemple. Dans l’impoflibilité de les
nommer touts , l’orateur les louoiten général
ne fe permettoit d’en nommer aucun. ( Thucyd. L
I l , p. 12! • A . OEfchin. in Etejîpk. av. J. C. 430).
Lorfque les citoyens tués à la guerre laifibient
une femme , une mère, des parens âgés , l’état
en prenoit foin , St ils étoient fous la garde du po-
lémarque. Leurs enfants étoient élevés aux frais
de la république jufqu’à dix-huit ans. On leurfai-
foit prêter alors le ferment militaire; on leur don-;
noit une armure complette , & ils avoient dans
toutes les cérémonies publiques le droit de pré-
féance fur touts les citoyens du même âge. ( Demojlh.
de coron. & contra Lepùn. GZfchin. de coron. )
Outre ces prix généraux de la valeur, le chef
de l’armée en donnoit pour des a fiions particulières.
A l’aflàut de Lecythe, Branda , générai
des Lacédémoniens, promit cent mines d’argent,
( 82 liv. 10 f. ) , à celui qui monteroit le premier
fur le rempart ; & lorfque Dercyllidas, général de
la même république, ferma par un retranchement
la Cherfonèfe de Thrace , il diftribua le travail à
fon armée , S", promit des rêcompenfes , non-feulement
à ceux qui auroient achevé les premiers la
part dont ils étoient chargés , mais auffi aux autres #
fuivant qu’ils Pauroïent mérité. On en donnoit
auffi pour l’exaâitude dans Tobfervatïon de la discipline.
Agéfilas ayant paffé en Afie', propofa des
prix pour les troupes d’infanterie St de cavalerie
les mieux exercées , & pour les pelfiates St les archers
qui rempliroient le plus parfaitement ce qui
étoit de leur office. Lorfqu’il futrappelléen Grèce,
il vit que la plupart des foldats aimoient mieux
refler en Afie à garder les villes, que de porter les
armes contre des Grecs, & voulant emmener l’élite
de la jeuneffe du pays, il propofa des prix
pour les villes qui lui envetroient les meilleures
troupes, & pour les chefs des mercenaires qui le
fuivroient avec les corps d’oplites , de pelfiates &
d’archers les plus beaux St les mieux armés. ( Thucyd.
l.V . Xenoph. hijlor. I. I I I , p. 488. B. Xenophi
hijl. I. I I I , p. 499. D . IV , 513. D . E . AgefîT.
é t f .A . ) .
Philippe de Macédoine ne fut pas moins attentif
à diftribuer des rêcompenfes. Après la bataille de
Cheronée . il fit enterrer les morts , offrit un facrl-
fice aux Dieux en aélions de grâces, & diftribua
des rêcompenfes à ceux qui avoient montré le plus
de courage. ( Diodor, lt X V I , p. 476'— 5 55 ),
K k k i j