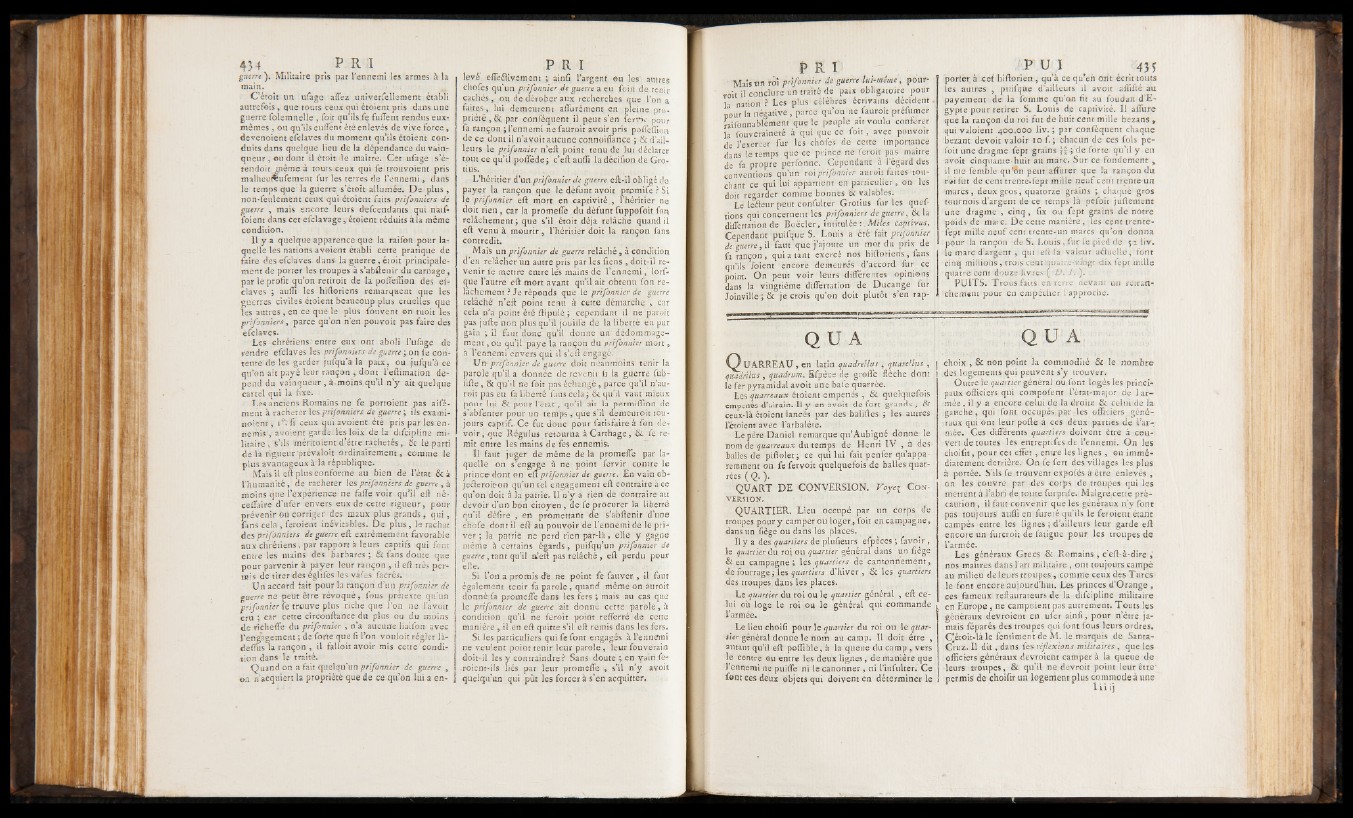
434 P R I
guerre ). Militaire pris par l’ennemi les armes à la
main.
C ’étoit un ufage aflez universellement établi
autrefois, que touts ceux qui étoient pris dans une
guerre folemnelle , foit qu'ils le fuiTent rendus eux-
mêmes , ou qu’ils euffent été enlevés de vive force,
devenoient efclaves du moment qu’ils étoient conduits
dans quelque lieu de la dépendance du vainqueur
, ou dont il étoit le maître. Cet ufage s’ér
tendoit tneme à touts.ceux qui fe.trouvoient pris
malheureufement fur les terres de l’ennemi y dans
le temps que la giierre s’étoît allumée. De plus,
non-feulement ceux qui étoient faits prifonniers de
guerre , mais encore leurs d-efeendants qui naif-
foient dans cet efclavage, étoient réduits à la même
condition.
Il y a quelque apparence que la raifon pour laquelle
les nations avoient établi cette pratique de
faire des efclaves dans la guerre, étoit principale-^
ment de porter les troupes à s’abflenir du carnage,
par le profit qu’on retiroit de la poffeffion des efclaves
; aufli les hiftoriens remarquent que les
guerres civiles étoient beaucoup plus cruelles que
les autres , en ce que le plus fouvent on tuoit les
prifonniers, parce qu’on n’en pouvoit pas faire des
efclaves.
Les chrétiens’ entre eux. ont aboli l’ufage de
rendre efclaves les prifonniers de guerre ; on fe contente
de les garder jufqu’à la paix, ou jufqu’à ce
qu’on ait payé leur rançon , dont l’eftimation dépend
du vainqueur, à-moins qu’il n’y ait quelque
cartel qui la fixe.
Les anciens Romains ne fe. portoient pas aifé-
nient à racheter les prifonniers de guerre ; ils exami-
noient -, ceux qui avoient été pris parles en-
nemis , avoient gardé lès loix de la difeipline militaire^
s’ils méritoient d’être rachetés,. & le parti
de la rigueur prévaloit ordinairement, comme le
plus avantageux à la république.
Mais il eft plus conforme au bien de l’état & à
l’humanité, de racheter les prifonniers de guerre, à
moins que l’expérience ne faffe voir qu’il eft né-
caffaire d’ufer envers eux de cette rigueur, pour
prévenir ou corriger des maux plus grands, qui ,
fans cela , feraient inévitables. De plus , le rachat
des prifonniers de guerre eft extrêmement favorable
aux chrétiens, par rapport à leurs captifs qui font
entre les mains des barbares; & fans doute que
pour parvenir à payer leur rançon , il eft très permis
de tirer des églifes les vâfes facrés.
Un accord fait pour la rançon d’un prifonnier de
guerre ne peut être révoqué, fous prétexte qu?un
prifonnier fe trouve plus riche que l’on ne L’avoit
cru ; car cette circonftance du plus ou du moins
de richeffe du prifonnier , n’a aucune liaifon avec
l’engagement ; de forte que fi l’on vouloit régler là-
deffus la rançon , il falloit avoir mis cette condition
dans le traité.
Quand on a fait quelqu’un prifonnier de guerre ,
on n’acquiert la propriété que de ce qu’on lui a en-
P R I
levé effeélivement ; ainfi l’argent ou les autres
chofes qu’un prifonnier de guerre a eu foin de tenir
cachés, ou de dérober aux recherches que l’on a
faites, lui demeurent affurément en pleine propriété
, 8c par conféquent il peut s’en fervk pour
fa rançon ; l’ennemi nefauroit avoir pris poffëflioii
de ce dont il n’avoit aucune connoiffance ; & d’ailleurs
le prifonnier n’eft point tenu de lui déclarer
tput ce qu’il poffède; c’eft aufli la décifion de Grotius.
L’héritier d’un prifonnier de guerre eft-il obligé de
payer la rançon que le défunt avoir prpmife ? Si
le prifonnier eft: mort en captivité , l’héritier ne
doit rien , car la promeffe du défunt fuppofoit fon
relâchement; que s’il étoit déjà relâché quand il
eft venu à mourir, l’héritier doit la rançon fans
contredit.
Mais un prifonnier de guerre relâché, à condition
d’en relâcher un autre pris par lés fiens , doit-il revenir
fe mettre entre lés mains dé l’ennemi, lorf-
que l’autre eft mort avant qu’il ait obtenu fon relâchement
? Je réponds que le prifonnier de guerre
relâché n’eft point tenu à cette démarche , car
cela n’a point été ftipulé ; cependant il ne paroît
pas jlifté non plus qu’il jouifle de la liberté en pur
gain ; il faut donc qu’il donne un dédommagement
, Ou qu’il paye la rançon du prifonnier mort,
à Pennemi envers qui il s’eft engagé.
Un- prifonnier de guerre doit néanmoins tenir la
parole qu’il a donnée de revenir fi la guerre fub-
îifte, & qu’il ne foit pas échangé, parce qu’il n’au-
roir pas eu fa liberté fans cela ; 8c qu’il vaut mieux
pour lui 8c pour Pétât, qu’il ait la permiffiori de
s’abfenter pour un temps ,■ que s’il demeurôit toujours
captif.-Ce fut donc pour fatisfaire à fon devoir,
que Régulus retourna à Carthage, 8c fe remît
entre les mains de fes ennemis;
Il faut juger de même de la promeffe par laquelle
on s’engage à ne point fervir contre le
prince- dont on eu prifonnier de guerre. En vain ob-
jeéieroiton qu’un tel engagement eft contraire à ce
qu’on doit à la patrie. 11 n’y a rien de contraire au
devoir d’un bon citoyen , de fe procurer la liberté
qu’il défire , en promettant de s’abftenir d’une
chofe dont il eft au pouvoir de l’ennemi de le priver
; la patrie ne perd rien par-là, elle y gagne
même à certains égards , puifqu’un prifonnier de
guerre, tant qu’il a’eft pas relâché, eft perdu pour
elle.
Si Ton a promis d'e ne point fe fauver , il faut
également tenir fa parole, quand même on àuroit
donné fa promeffe dans les fers ; mais au cas que
le prifonnier de guerre ait donné cette parole, à
condition qu’il ne feroit point refferré de cette
manière , il en eft quitte .s’il eft remis dans les fers.
Si les particuliers qui fe font engagés à l’ennemi
ne veulent point tenir leur parole, leur fouverain
doit-il les y contraindre? Sans doute ; en yain.fe-
^oient-iis liés par leur promeffe , s’il n’y avoit
quelqu’un qui pût les forcera s’en acquitter.
r
P R I
Mais un roi prifonnier de guerre lui-même, pour-
roit il conclure un traité de paire obligatoire pour
la nation ? Les plus célèbres écrivains décident
pour la négative, parce qu’on ne fauroit préfunrer
raifonnablement que le peuple ait voulu conférer
la fouveraineté à qui que ce foit, avec pouvoir
de l’exercer fur les chofes de cette importance
dans le temps que-ce prince ne feroit pas maître
de fa propre perfonne. Cependant à l’égard des
conventions qu’un roi prifonnier aurait faites touchant
ce qui lui appartient en particulier, On les
doit regarder comme bonnes & valables.
Le 1 Sieur peut confulter Grotius fur les quef-
fions qui concernent les prifonniers de guerre, & la
differtation de Boeder, intitulée -.Miles cnptivus.
Cependant puifquè S. Louis a ’été fait prifonnier
de guerre, il faut que j’ajoute un mot du prix de
fa rançon ,. qui a tant exercé nos liidoriens , fans
qu’ils foient encore demeurés d’aecord fur ce
point. On peut voir leurs différentes opinions
dans la vingtième differtation de Ducange lur
Joinville; & je crois qu’on doit plutôt s’en rapp
V I 43*
porter à cet hiftorien , qu’à ce qu’en ont écrit touts
les autres , puifqtte d’ailleurs il avoit aflifté au
payement de la fomine qu’on fit au foudan d’Egypte
pour retirer S. Louis cfe captivité. Il affure
que la rançon du roi fut de huit cent mille bezans »
qui valoient 400,000 liv. ; par conféquent chaque
bezant devoit valoir 10 f. ; chacun de ces fols pe-
foit une dragme fept grains f | ; de forte qu’il y en
avoit cinquante-huit au marc. Sur ce fondement %
il me femble qu’on peut .aflurer que la rançon du
roi fut de cent trente-fept mille neuf cen t trente-un
marcs, deux gros, quatorze grains ; chaque gros
tournois d’argent de ce temps-là pefoit juftement
une dragme , cinq, fix ou fept grains de notre
poids de marc. De cette manière, les cent trente-
fept mille neuf cent trenre-uii marcs qu’on donna
pour la rançon de S. Louis ,:fur le pied de. 52 liv.
le marc dlargent , qui . eft la valeur aâueiie, font
cinq millions, trois centrquatre-vibgt dix fept mille
quatre cent douze livrés :( £). J. ).
PUITS. Trous faits en terre devant un retranchement
pour en empêcher 1 approche.
QU A
UARREAU , en latin quadrellus4 quarellus , ;j
quadrilus , quadrum. Rfpèce de grofle flèche dont :
le fer pyramidal avoit une bafe quarrée.
Les quarreaux étoient empenés , 8c quelquefois
empenés d’airain. Il y en avoit de fort grands ,« &
ceux-là étoient lancés par des baliftes ; les autres
lîétoient avec l’arbalète.
Le père Daniel remarque qu’Aubigné donne le
nom de quarreaux du temps de Henri IV , à des-
bailes de piftolet; ce qui lui fait penfer qu’appa-
remment on fe fervoit quelquefois de balles quar-
rées ( Q. ).
QUART DE CONVERSION. Voye^ C o n v
e r s io n .
QUARTIER. Lieu occupé par un corps cîe
troupes pour y camper ou loger., foit en campagne,
dans un fiège ou dans lés places.
Il y a des quartiers de plufieurs efpèces ; favbir >
le quartier du roi ou quartier général dans un fiège
& en campagne ; les quartiers de cantonnement,
de fourrage ; les quartiers d’hiver , & les quartiers
des troupes dans les, places.
Le quartier du roi ou 1«? quartier général , eft celui
où loge le roi ou le général qui commande 1
l’armée.
Le lieu choifi pour le quartier du roi ou le quartier
général donne le nom au camp. Il doit être ,
autant qu’il eft poffible, à la queue du camp , vers
le centre ©u entre les deux lignes, de manière que
l'ennemi ne puiffe ni le canonner , ni l’infulter. Ce
font ces deux objets qui doivent en déterminer le
Q U A
choix , & non point la commodité & le nombre
.des logements qui peuvent s’y trouver.-
Outre le quartier général où font logés les principaux
officiers qui compofent l’état-major de 1 armée,
i) y a encore celui de la droite & celui de la
;gauche, qui font occupés par les officiers .généraux
qui ont leur pofte à ces deux parties de l’armée.
Ces différents quartiers doivent être à couvert
de toutes les entreprifes .de l’ennemi. On les
choifit, pour cet effet, entre les lignes , ou immédiatement
derrière. On fe fert des villages les plus
à portée. S’ils fe trouvent expofés à être enlevés,
on les couvre, par des corps de troupes qui les
mettent àTabri de toute furprife. Malgré.cëtte précaution
, il faut convenir que les généraux n’y font
pas toujours aufli en fureté qu’ils le feroient étant
campés entre les lignes ; d’ailleurs leur garde eft
encore un furcroît de fatigue pour les troupes de
l’armée.
Les généraux Grecs & Romains , c’eft-à-dire
nos maîtres dans l’art militaire , ont toujours campé
au milieu de leurs troupes, comme ceux des Turcs
le font encore aujourd’hui. Les princes d’Orange ,
ces fameux reftaurateurs de la difeipline militaire
en Europe , ne campoient pas autrement. Touts les
généraux devroient en ufer ainfi, pour n’être jamais
féparés des troupes qui font fous leurs ordres.
Cétoit-là le fentitnent de M. le marquis de Santâ-
Cruz. Il d it, dans fes réflexions militaires , que les
officiers généraux devroient camper à la queue de
leurs troupes, & qu’il ne devroit point leur être;
permis de choifir un logement plus commode à une