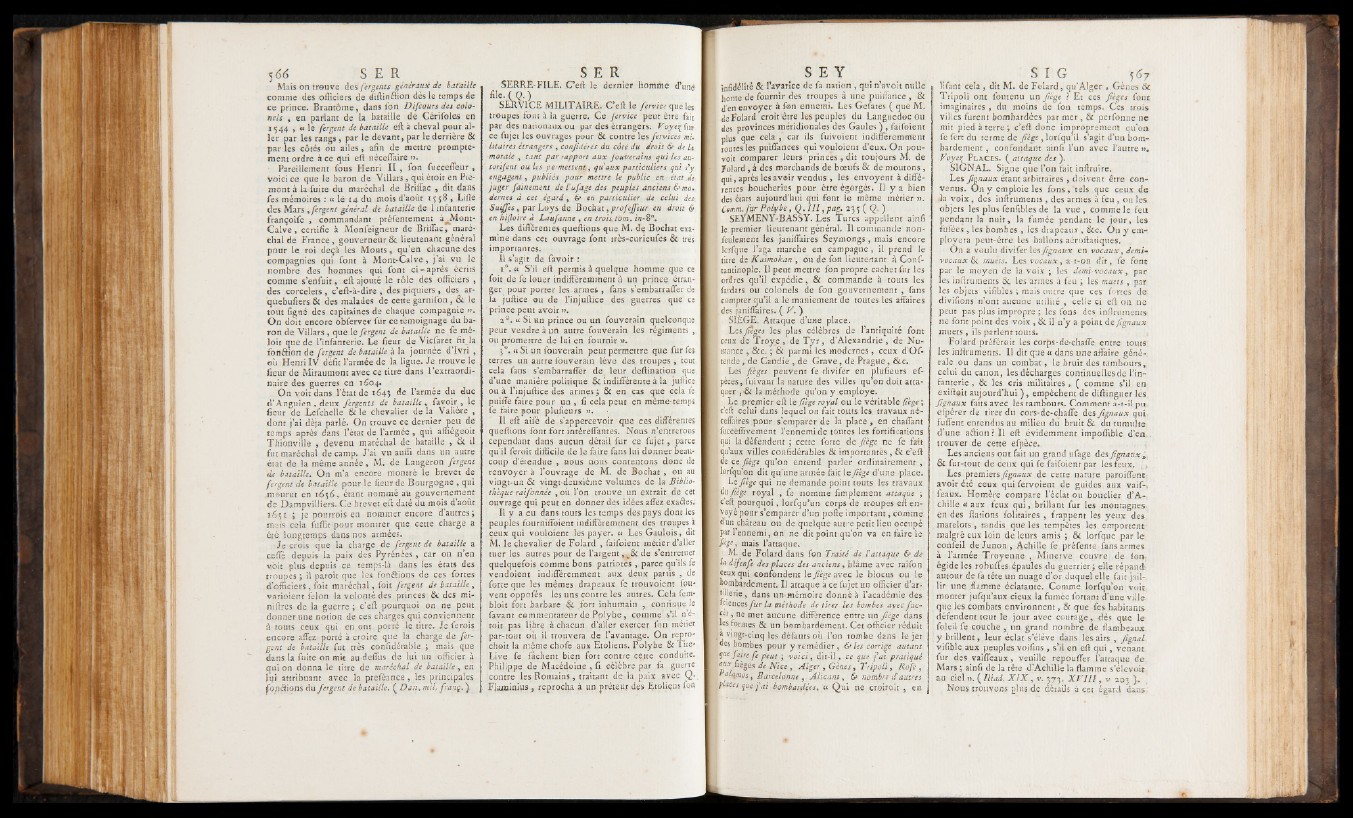
5 66 S E R
Mais on trouve des fergents généraux de bataille
comme des officiers de diftindion dès le temps de
ce prince. Brantôme, dans fon Difcours des colonels
, en pariant de la bataille de Cérifoles en
1544 , «c le fergent de bataille eft à cheval pour aller
par Les rangs, par le devant, par le derrière &
par les côtés ou ailes, afin de mettre promptement
ordre à ce qui eft néceffaire ».
Pareillement fous Henri II , fon fucceffeur ,
voici ce que le baron de Villars, qui étoit en Piémont
à la fuite du maréchal de Briffac , dit dans
fes mémoires : « lé 14 du mois d’août 1558 , Lille
des Mars , fergent général de bataille de 1 infanterie
françoife , commandant préfentement à^Mont-
C a lv e , certifie à Monfeigneur de Briffac, maréchal
de France, gouverneur & lieutenant général
pour le roi deçà les Monts, qu’en chacune des
compagnies qui font à Mont-Calve, j ’ai vu le
nombre des hommes qui font ci-après écrits
comme s’enfuit, eft ajouté le rôle des officiers ,
des corcelets , c’eft-à-dire , des piquiers , des ar-
quebufiers & des malades de cette garnilon , 6c le
tout figné des capitaines de chaque compagnie ».
On doit encore obferver fur ce témoignage du baron
de Villars, que le fergent de -bataille ne fe mê-
loit que de l ’infanterie. Le fieur de Vicfaret fitja
îonâion de fergent de bataille à la journée d’Ivri ,
©ù Henri IV défit l’armée de la ligue. Je trouve le
fieur de Miraumont avec ce titre dans l ’extraordinaire
des guerres en 1604«
On voit dans l’état de 1643 l’armée du duc
d’Anguien , deux fergents de bataille , favoir, le
fieur de Lefchelle & le chevalier delà Valiere ,
dont j’ai déjà parlé. On trouve ce dernier peu de
temps après dans l’état de l’armée, qui affiégeoit
Th ion vil le , devenu maréchal de bataille , 6c il
fut maréchal de camp. J’ai vu aufîi dans un autre
état de la même année, M. de Laugeron fergent
de bataille. On m’a encore montré le brevet de
fergent. de bataille pour le fieur de Bourgogne , qui
.mourut en 1656, étant nommé au gouvernement
de Dampvilliers. Ce brevet eft date du.raois d août
1.651 ; je pourrois en nommer encore d’autres;
mais cela fuffit'pour montrer que cette charge a
été longtemps dans nos armées.
Je crois que la charge de fergent de bataille a
ceffé depuis la paix des Pyrénées, car on n’en
voit plus depuis ce temps-là dans les états des
troupes ; il paroît que les fondions de ces fortes
d’officiers , foi t maréchal, foit fergent de bataille ,
varioient félon la volonté des princes & des mi-
niftres de la guerre ; c’eft pourquoi on ne peut
donner une notion de ces charges qui conviennent
à touts ceux qui en. ont porté le titre. Je ferois
encore affez porté à croire que la charge de fergent
de bataille fut très confidérable ; mais que
dans la fuite on mit au-deffus de lui un officier |
qui on donna le titre de maréchal de bataille, en
lui attribuant avec la preféance , les principales,
fondions du fergent de bataille, Ç Dan, mit, franç. )
S E R
SERRE-FILE. C’eft le dernier homme tPuné file- C Q)
SERVICE MILITAIRE. C ’eft le fervict que les
troupes font à la guerre. Ce fervice peut être fait
par des nationaux ou par des étrangers. Voye^fa
ce fujet les ouvrages pour & contre les fervices mi.
litaires étrangers , confédérés du côté du droit & de U
morale , tant par rapport aux fouberains qui les au-
torifent ou les permettent, qu'aux particuliers qui s'y
engagent, publiés pour mettre le public en état .de
juger fainernent de l'ufage des peuples anciens & modernes
à cet égard, 6* en particulier de celui des,
Suiffcs, par Loys de Bochat, profejfeur en droit 6*
en hifloire à Laufanne , en trois, tom. in-$°.
Les différentes queftions que M. de Bochat examine
dans cet ouvrage font très-curieufes 6c très
importantes.
Il s’agit de favoir :
i°. « S’il eft permis à quelque homme que ce
foit de fe louer indifféremment à un prince étranger
pour porter les armes , fans s’embarraffer de
la juftice ou de l’injuftice des guerres que ce
prince peut avoir ».
20. u Si un prince ou un fouverain quelconque
peut vendre à uA autre fouverain les régiments ,.
ou promettre de lui en fournir ».
30. « Si un fouverain peut permettre que fur fes
terres un autre fouverain lève des troupes , tout
cela fans s’embarraffer de. leur deftination que,
d’une manière politique 6c indifférente à la juftice
ou à l’injuftice des armes ; 6c en cas que cela fe
puiffe faire pour un , fi cela peut en même-temps
le faire pour plufieurs ».
Il eft aifé de s’appercevoir que ces différentes
queftions font fort intéreffantes. Nous n’entrerons
cependant dans aucun détail fur ce fujet, parce
qu’il feroit difficile de le faire fans lui donner beaucoup
d’érendue , nous nous contentons donc de
renvoyer à l’ouvrage de M. de Bochat , ou au
vingt-un & vingt-deuxième volumes de la Bibliothèque
raifonnée , où l’on trouve un extrait de cet
ouvrage qui peut en donner des idées affez exaâes.'
Il y a eu dans touts les temps des pays dont les
peuples fourniffoient indifféremment des troupes à
ceux qui vouloient les payer. « Les Gaulois, dit
M. le çhevalier de Folard , faifoient métier d’aller
tuer les autres pour de l’argent ,^6c de s’entretuer
quelquefois comme bons patriotes , parce qu’ils fe
vendoient indifféremment aux deux partis , de
forte que les mêmes drapeaux fe trouvoient fou-
vent oppofés les uns contre les autres. Cela fem-
bloit fort barbare & Fort inhumain ,. continue le
favant commentateur de Pplyb.e, comme s’il n’é-
toit pas libre à chacun d!aller exerçer fon métier
par-tout où il trouvera de l’avantage. On reprochoit
la même chofe aux Etoliens. Polybe & Tire-
Live fe fâchent bien fort contre cette conduite,
Philippe de Macédoine , fi célèbre par fa guerre
contre les Romains, traitant de là paix avec Q *
Fiaaiinius, reprocha à un préteur des Etoliens
s E Y
1 infidélité & l’avarîce de fa nation , qui n’avoit nulle
I honte de fournir des troupes à une puiffance , &
I d’en envoyer à fon ennemi. Les Gefates ( que M.
| de Folard croit être les peuples du Languedoc ou
des provinces méridionales des Gaules ) , faifoient I plus que cela , car ils fuivoient indifféremment I toutes les puiffances qui vouloient d’eux. On pou- I voit comparer leurs princes, dit toujours M. de
Folard, à des marchands de boeufs & de moutons,
! qui, après les avoir vendus , les envoyent à diffé-
! rentes boucheries pour être égorgés. Il y a bien I des états aujourd’hui qui font le même métier ».
1 Comm.fur Polybe, Q. III 9pag. 235 ( Q. )
I SEYMENY-BASSY. Les Turcs appellent ainfi
I Je premier lieutenant général. Il commande non-
■ feulement les janiffaires Seymongs , mais encore
K lcrfque J’aga marche en campagne, il prend le
I titre de Kaimokan , ou de fon lieutenant à Conf-
I tantinople. Il peut mettre fon propre cachet fur les
I ordres qu?il expédie, & commande à touts les
I fardars ou colonels de fon gouvernement , fans
| compter qu’il a le maniement de toutes les affaires
I des janiffaires. ( V. )
I SIÈGE. Attaque d’une place.
I Les.feges les plus célèbres de l’antiquité font
■ ceux de T ro y e , de T y r , d'Alexandrie, de Nu-
I raan.ee , &c. ; & parmi les modernes , ceux d'Of-
I tende /de Candie , de Grave, de Prague, &c.
I Les fièges peuvent fe divifer en plufieurs ef-
IpèceS j fuivant la nature des villes qu’on doit atta-
I quer , •& la méthode qu’on y .employé.
R Le premier eft ïe fiège royal ou le véritable fiège,
I c’eft celui dans lequel on fait tonts les. travaux né-
I ceffaires pour s’emparer de la place, en chaffant
Ifuccèffivement l’ennemi de toutes les fortifications !
■ qui la défendent ; cette forte de fiège ne fe fait
■ qu’aux villes confidérables & importantès, & c’eft
Ide te.fiège qu’on entend parler ordinairement ,
B lorfqu’on dit qu’une armée fait le fiège d’une place.
| Le fiège qui ne demande point touts les travaux
9 àü fiège royal , fe nomme fimplement attaque ;
1 c’eft pourquoi/lorfqu’un corps de troupes eft env
o y é pour s’emparer d’un pofte important, comme
■ dun château ou de quelque autre petit lieu occupé i
■ par l’ennemi, on ne dit point.qu’on va en faire le
W M mais l’attaque.
I M. de Folard dans fon Tt mité de T attaque & de I
Wla défenfe des placés des anciens, blâme avec raifon.
■ ceux qui. confondent le fiège avec le blocus ou le
■ bombardement. Il attaque à ce fujet un officier d’ar-
; tillerie, dans un-mémoire donné à l’académie des
feiençes fur la méthode de tirer les bombes ayec fuc-
■ cej, ne met aucune différence entre un fiège dans
■ les formes & un bombardement. Cet officier réduit
;|a vingt-cinq les défauts où l’on tombe dans le jet
|ues bombes pour y remédier, & les corrige autant
I Que faire fe peut ; voici, dit-il, ce que fa i pratiqué
|fia*.fièges de Nice , Alger , Gènes, Tripoli, Rofe ,
■ **flqpnos, Barcelonne , Alicant, & nombre d'autres
nflaces que j'ai bombardées. « Qui ne croirait , en
S I G 567
lifant cela , dit M. de Folard, qu'Alger , Gènes &
Tripoli ont foutenu un fiège ? Et ces fièges font
imaginaires, du moins de fon temps. Ces trois
villes furent bombardées par mer, & perfonne ne
mit pied à terre ; c’ eft donc improprement qu’on
fe fert du terme de fiège, lorfqu il s’agit d’un bombardement
, confondant ainfi l’un avec l'autre ».
Voye{ P la c e s . ( attaque des).
SIGNAL. Signe que l’on fait inftruire.
Les fignaux étant arbitraires , doivent être convenus.
On y emploie les fons, ‘tels que ceux de
-la v o ix , des inftruments , des armes à feu , ou les
objets les plus fenfibles de la vu e , comme le feu
pendant la nuit, la fumée pendant le jour, les
fufées , les bombes , les drapeaux , %cc. On y em-
ployera peut-être les ballons aéroftatiques.
On a voulu divifer les fignaux en vocaux, demi-
vocaux 8c muets. Les vocaux , a- t-on dit, fe font
par le moyen de la voix ; les demi-vocaux, par
les inftruments 6c -les armes à feu ; les muets , par
les objets vifibles ; mais outre que ces fortes de'
divifions n’ont aucune utilité , celle ci eft on ne
peut pas plus impropre ; les fons des inftruments
ne font point des voix , & il n’y a point de fignaux
muets , ils parlent tours. .
Folard préféroit les corps-de-chaffe entre touts
les inftruments. Il dit que « dans une affaire générale
ou dans un combat, le bruit des tambours,
celui .du canon, les décharges continuelles de l’infanterie
, & les cris militaires, ( comme s’il en
exiftoit aujourd’hui ) , empêchent de diftinguer lés
fignaux faits avec les tambours. Comment a-t-il pti.
efpérer de tirer du cors-de-chaffe des fignaux qui-
fuffent entendus au milieu du bruit & du tumulte
d’une a â io n ? ïl eft évidemment impoffible d’en .
trouver de cette efpèce..
Les anciens ont fait un grand ufage des fignaux >
6c fur-tout de ceux qui fe faifoienr par les feux, i >
Les premiers fignaux de cette nature paroiffent-
avoir été ceux qui fervoient de guides aux vaif->
féaux. Homère compare l’éclat ou bouclier d’A chille
«c aux feux qui, brillant fur les montagnes
en des ftations folitaires , frappent les yeux des
matelots, tandis que les tempêtes les emportent
malgré eux loin de leurs amis ; & lorfque par le
confeil de Junon , Achille fe préfente fans armes
à l’armée Troyenne , Minerve couvre de loiv
égide les robuftes épaules du guerrier; elle répand
autour de fa tête un nuage d’or duquel elle fait jaillir
une flamme éclatante. Comme lorfqu’on voit
monter jufqu’aux deux la fumée fortant d'une ville
que les combats environnent, & que fes habitants
défendent tout te jour avec courage, dès que le
fo.leil fe couche , un grand nombre de flambeaux
y brillent, leur éclat s’élève dans les airs , fignal
vifibleaux peuples voifins , s’il en eft qui, venant
fur des vaiffeaux, veuille repouffer l’attaque de
Mars ; ainfi de la tête ,d’Achille la flamme s’élevoit
au ciel ». ( Iliad. X I X , v. 373. XVI I I , v 203 )-
Nous trouvons glus de détails à cet égard dans